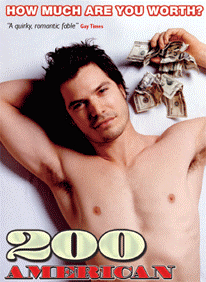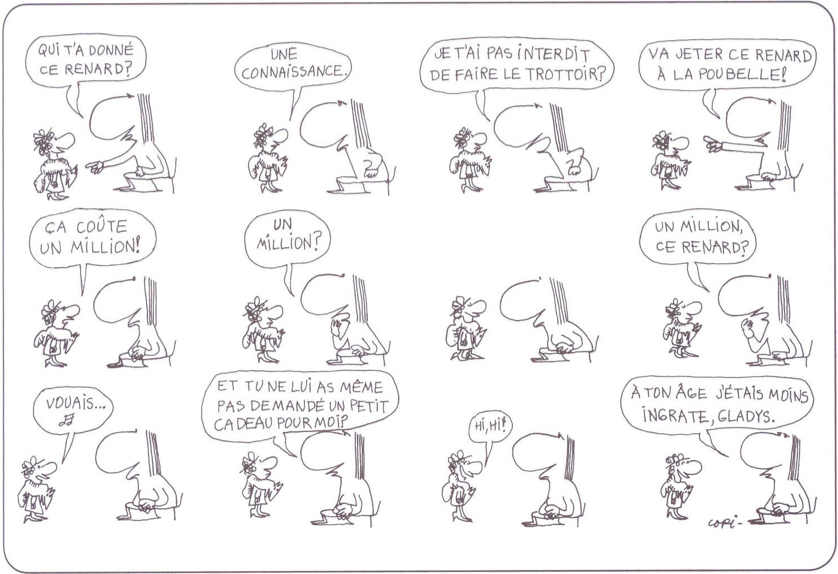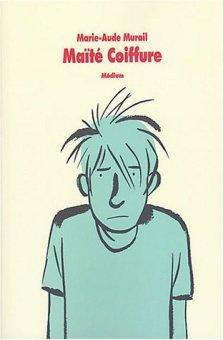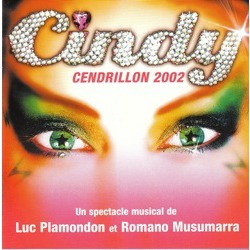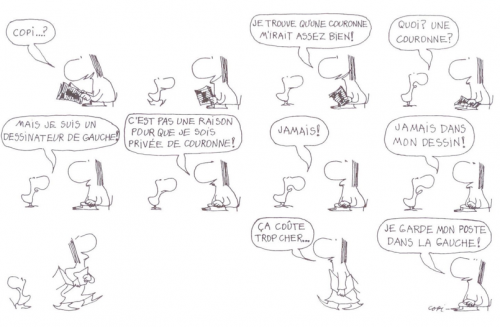Première fois
NOTICE EXPLICATIVE
La première fois homo : caractérisée par l’absence de liberté et de Réel
C’est curieux comme l’initiation homosexuelle, même dans des créations artistiques qui veulent donner une bonne image de l’homosexualité, se passe dans la douleur et l’absence de liberté.
Quand on écoute les personnages homosexuels fictionnels – et beaucoup plus d’individus homosexuels réels qu’on n’imagine – raconter leur « première fois homosexuelle » (premier baiser, premières caresses, premier coït, coming out), on est saisi de voir que pour eux, ce n’est pas une partie de plaisir, agréable et apaisée. Tout le contraire ! Ils sentent inconsciemment qu’en actes, ils s’éloignent du Réel, et que cette fuite est amère, qu’elle les catapulte dans un rêve éveillé qui corporellement semble répondre à la perfection à leurs attentes, mais qui dans leur cœur les blesse et les rend tristes.
Ils nous racontent par exemple qu’ils ont pleuré juste après avoir reçu leur premier baiser homo… bien qu’ils n’aient révélé leur curieuse réaction à personne, en croyant que c’était eux seuls qui avaient un « problème », un sursaut « injustifié » de culpabilité, qu’il n’y a pas de baiser spécifiquement « homosexuel » mais des baisers d’amour tout court. Ce réflexe de tristesse nous dit bien que le désir homosexuel n’est pas un désir uniquement d’amour, mais également un élan violent, même si sa violence est juste devinée, atténuée par le jeu ou l’euphorie des sens, et ré-écrite positivement a posteriori dans le rose sucré (de la sincérité, de la passion, des sentiments, de l’excitation face à la nouveauté) ou carrément dans le noir (de la gravité d’un sacrifice d’amour brutal et désespéré – dans le sens salafiste du terme « sacrifice » -, de l’orgueil gay militant et volontairement « dérangeant », de la comédie relativiste de la Drama Queen).
Non pas que la « première fois » amoureuse soit tellement plus réussie chez les personnes hétérosexuelles (ce n’est mieux que chez les couples femme-homme aimants, qui, eux, ont pris le temps de se choisir pleinement et de respecter le Réel) qui vivent aussi le premier baiser ou le premier coït comme une souillure, un mauvais moment, une déception.
Avant la publication de mon tout premier livre (sur les liens non-causaux entre homosexualité et viol), j’avais entrepris de récolter des témoignages de personnes homosexuelles dans le Marais, à Paris, en les interviewant sur leur « première fois » homosexuelle (premier émoi, premier regard, premier baiser, premier flirt, premier grand amour, première coucherie, etc.), car je sentais que dans l’initiation à l’acte homosexuel, il se passait quelque chose de pas normal, qui me mettrait sur la piste du viol. Je me suis vite rendu compte que le projet était trop audacieux et qu’il tournerait court, car lors des interviews, je me heurtais au même refus, chez mes témoins, de vraiment revenir sur les faits et sur leur « première fois ». D’emblée, ils enchaînaient sur le Grand Amour qu’ils souhaitaient trouver (sans trop y croire…) dans les aventures qui précédaient leur première fois. Mais bon, finalement, c’était une confirmation que la piste du mauvais souvenir était quand même la bonne ! Et puis les témoignages des amis sont finalement venus tout naturellement.
N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Coït homosexuel = viol », « Amant diabolique », « Amant triste », « Violeur homosexuel », « Symboles phalliques », « Moitié », « Viol », « Liaisons dangereuses », « Fusion », « Déni », « Manège », « Appel déguisé », « Jeu », « Douceur-poignard », et à la partie « Langue au chat » du code « Amant diabolique », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.
1 – PETIT « CONDENSÉ »
Il semble que, dans le rapprochement amoureux homosexuel, le passage violent du mythe à la réalité fantasmée s’initie bien avant le passage à l’acte génital et la pénétration anale ou vaginale. Le viol se limite au simple baiser sur la bouche. Quand on écoute certaines personnes homosexuelles raconter leur premier baiser homosexuel, on les trouve bizarrement peu enthousiastes. Elles ne sont ni dégoûtées, ni amusées, mais juste fascinées par un geste qu’elles situent davantage sur le terrain de la science-fiction que sur celui de la beauté mémorable. Il leur a souvent laissé une impression de catapultage forcé dans un monde inconnu, paranormal. « Nous nous sommes embrassées, et j’ai su que ma vie avait basculé. J’ai été projetée d’un monde à l’autre. J’ai été poussée. » (Corinne, intervenante lesbienne mimant le mouvement de projection violente vers l’avant avec la main, dans l’émission Ça se discute, sur la chaîne France 2, le 18 février 2004) C’est comme s’il faisait passer brutalement du fantasme à la réalité fantasmée en entravant une liberté. Relativement nombreux sont les sujets homosexuels qui ont fondu en larmes quand ils l’ont reçu. Même dans les fictions, nous voyons quelques exemples de ce surprenant « baiser-homosexuel-qui-fait-pleurer ». « Et voilà que je pleure, sans expliquer pourquoi. G. me regarde avec une douce interrogation. Que lui dire ? Que je ne l’aime pas ? Ce n’est pas vrai. Aimer, c’est si facile. Que je l’aime moins ? Ce n’est pas vrai non plus. C’est autrement, voilà tout. Je pleure parce que je cède à mon désir de caresses. » (Cathy Bernheim, L’Amour presque parfait (2003), pp. 47-48) Il est parfois clairement associé au viol (cf. « Yossi et Jagger » (2002) d’Eytan Fox, « L’Homme blessé » (1983) de Patrice Chéreau, « La Vie d’Adèle » (2013) d’Abdellatif Kechiche, « Shower » (2012) de Christian K. Norvalls, etc.). Le baiser homosexuel peut avoir la violence d’une caresse dénuée d’amour, comme le décrit Stefan Zweig dans son roman La Confusion des sentiments (1926) : « Ce fut un baiser comme je n’en avais jamais reçu d’une femme, un baiser sauvage et désespéré comme un cri mortel. » (p. 126)
Bien souvent, l’initiation à la génitalité homosexuelle est vécue comme un traumatisme. Il n’est pas anodin que les artistes homosexuels traitent régulièrement des « premières fois » dans leurs créations. Même si les personnes homosexuelles n’ont pas le monopole du viol ou du fantasme de viol – beaucoup de jeunes filles ou de garçons hétérosexuels ont vécu leur défloration comme un viol –, en revanche, je crois que leurs unions corporelles y sont plus biologiquement, corporellement, psychiquement, et symboliquement exposées que les unions entre la femme et l’homme, du fait de l’exclusion radicale de la différence des sexes dans tous les couples homosexuels, et de la nature du désir homosexuel, davantage tourné vers la réification. Si les jeunes adolescents homosexuels reculent au maximum l’échéance de leur premier « passage à l’acte », que la majorité d’entre eux sont allés à la génitalité « comme on va chez le dentiste », ce n’est pas sans raison. Il y a une violence dans l’acte génital (et simplement sensuel) homosexuel, qui reste difficile à définir, mais qui pourtant existe. Cela vaut le coup d’écouter les récits du premier rapport sexuel des personnes homosexuelles : on a parfois l’impression d’entendre une mise en scène de viol – et plus rarement un viol réel. Ceci transparaît parfois dans le discours des personnages fictionnels homosexuels. « La première fois, c’est toujours bizarre » avoue Julián, dans le film « Krámpack » (2000) de Cesc Gay. Dans « Quels adultes savent » (2003) de Jonathan Wald, le jeune Roy, demande à son amant qui vient juste de le déflorer : « On se sent toujours comme ça après ? ».
Si la pénétration anale va en se banalisant dans les discours sociaux actuels, il ne faut pas oublier qu’au départ, elle fait mal aux personnes pénétrées et pénétrantes, pas seulement physiquement mais aussi psychiquement. Dans le film « Mauvaises Fréquentations » (2000) d’Antonio Hens, le personnage de Guillermo nous dit bien ce qui se passe la « première fois », et aussi pendant l’après-sodomie. « Je ne m’étais jamais laissé pénétrer. Mais il a dit que j’allais aimer, je n’avais qu’à me détendre. Malgré la salive et mes efforts pour me relaxer, ça faisait un mal de chien. Voyant qu’il n’y arrivait pas, il s’est mis à pousser de toutes ses forces. J’ai jamais eu aussi mal. Mais depuis, je me dilate sans problème. » Par la suite, beaucoup de personnes gay réécrivent l’épisode de la pénétration dans l’angélisme – la prostate serait même, selon certains, le « point G homosexuel » ! (pourquoi pas, après tout ?) –, ou se mettent à mépriser les partenaires sexuels qui mettent du temps à accepter la sodomie. Mais le malaise concernant la pénétration anale revient autrement dans le couple, généralement sous forme d’agressivité et d’indifférence mutuelles.
Dans la bouche des personnes homosexuelles réelles, le sentiment de viol concernant le dépucelage se mêle souvent à l’optimisme forcé. « La première fois où ça s’est fait avec un garçon, c’était très fort… très violent. » (Denis dans l’émission Bas les Masques, diffusée sur la chaîne France 2, en septembre 1992) Mais au final, la violence symbolique gagne tout le tableau. « Ça s’est passé mal, très très mal, parce que c’est comme si ça en rajoutait encore, en définitive. Le fait de passer à l’acte, pour moi, faisait que ça rajoutait encore de la complication à mon existence. » (Olivier, 37 ans, parlant de la découverte de son homosexualité et de son premier passage à l’acte homosexuel, dans le documentaire « Une Vie ordinaire ou mes questions sur l’homosexualité » (2002) de Serge Moati) Il n’est absolument pas rare de rencontrer des sujets homosexuels qui ont vu leur amant effondré juste après qu’ils l’aient « déniaisé ». Sur le coup, ils n’ont pas saisi pourquoi. Ce dernier s’est tout de suite excusé d’avoir pleuré, leur a assuré que c’étaient des larmes de joie et de découverte, qu’elles étaient un soubresaut de culpabilité induite par le poids culturel (« judéo-chrétien » !) et éducationnel. Et l’énigme s’est approfondie sans trouver d’écho. Beaucoup de personnes homosexuelles ne peuvent même pas dire leur souffrance du viol à leur partenaire, car elles sentent qu’il ne pourra pas les comprendre. Et plus profondément encore, il leur est difficile de lui avouer un fantasme de viol – et plus rarement un viol réel – consenti à deux.
2 – GRAND DÉTAILLÉ
FICTION
a) La première fois homosexuelle est vécue par le protagoniste gay comme un traumatisme :
Dans les fictions traitant d’homosexualité, il est souvent question de l’initiation coûteuse à la sensualité/sexualité homosexuelle : cf. le roman El Anarquista Desnudo (1979) de Luis Fernández, le film « Du sang pour Dracula » (1972) de Paul Morrissey, les films « Les Puceaux » (1997) et « Robe d’été » (1996) de François Ozon, le film « Carne Trémula » (« En chair et en os », 1997) de Pedro Almodóvar, le film « Eating Out » (2004) de Q. Allan Brocka, le film La Trilogie de la vie (1975) de Pier Paolo Pasolini, la chanson « Toute première fois » de Jeanne Mas, les chansons « Fuck Them All », « Plus grandir », « Libertine », « Dans les rues de Londres » de Mylène Farmer, le film « Ode To Billy Joe » (1976) de Max Baer, le film « Premier amour, version infernale » (1968) de Susumu Hani, le film « La Sagrada Familia » (2006) de Sebastián Campos, la chanson « Tu m’as possédée par surprise » de Madame Raymonde, le film « Einaym Pkuhot » (« Tu n’aimeras point », 2009) de Haim Tabakman (avec la tristesse post-acte homo visible dans l’attitude d’Aaron), etc.
Au départ, la première fois homosexuelle est totalement déproblématisée, sacralisée et banalisée. Par exemple, dans la pièce Ma Première Fois (2012) de Ken Davenport, les quatre comédiens distribuent au tout début des questionnaires au public pour qu’il raconte sa première fois (sexuelle). Dans le film « Children Of God » (« Enfants de Dieu », 2011) de Kareem J. Mortimer, Johnny prend le fait de s’abandonner à faire la planche sur l’eau avec son futur amant Romeo pour une incroyable révélation d’amour : « C’est la première fois. »… laissant sous-entendre que c’est l’amour homo qui l’aide à s’abandonner vraiment, à faire confiance pour la première fois à quelqu’un. Dans le film « Hoje Eu Quero Voltar Sozinho » (« Au premier regard », 2014) de Daniel Ribeiro, Léo, le héros homosexuel, croit que les premières fois sont toujours les bonnes. C’est sa théorie en amour. Il est obnubilé par l’idée d’embrasser quelqu’un et d’être embrassé en retour, et est certain que la première sera la bonne. Il n’hésite pas à verser dans le théorie relativiste de l’expérimentalisme de tout : « Il y a toujours une première fois. » dit-il par exemple avant de s’autoriser à vivre sa première cuite. Dans le film « A Moment in the Reeds » (« Entre les roseaux », 2019) de Mikko Makela, Tareq, le héros homosexuel, raconte que sa première fois homosexuelle, à l’âge de 17 ans, il l’a vécue avec un homme plus âgé que lui : « Je cherchais sûrement une figure paternelle. Quant à Leevi, son amant, il dit que sa première fois homosexuelle (quand il est sorti avec un homme) a impulsé la mort de sa maman : « Ça a commencé juste avant la mort de ma mère. » Dans la série et téléfilm It’s a Sin (2021) de Russell T. Davies, le dépucelage homo de Ritchie (avec Ash) se passe tellement mal qu’il fond en larmes après avoir été jeté comme un malpropre.
Mais assez vite, on découvre que le fait de tomber amoureux homosexuellement n’est déjà pas source d’apaisement chez certains héros homosexuels. « À la première seconde, je savais que j’allais l’aimer, que j’allais souffrir. Au fond, il m’avait déjà échappé au premier instant où je l’ai vu. J’ai voulu faire durer cette imposture le plus longtemps possible. La douleur est éblouissante, très pure. » (Stéphane parlant de son ex-amant, le jeune et beau Vincent qui le frappe de temps en temps physiquement, dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson) ; « Pourquoi je me sens si coupable ? » (Emmanuel, l’un des séminaristes, noir et homosexuel, suite à sa première expérience homosexuelle avec un homme anonyme de Carthage, dans la série Ainsi soient-ils (2014) de David Elkaïm) ; « J’avais trop peur. Je tremblais. » (Guillaume parlant de son histoire avec Michael, dans la pièce Commentaire d’amour (2016) de Jean-Marie Besset) ; « Tu trembles. » (Carol, l’héroïne lesbienne s’adressant à son amante Thérèse avec qui elle couche pour la première fois, dans le film « Carol » (2016) de Todd Haynes) ; « C’est la première fois ? Ben dis donc… T’es pas un grand bavard, toi… » (Serge s’adressant à son jeune amant Victor après leur nuit de sexe, dans le téléfilm Fiertés (2018) de Philippe Faucon, diffusé sur Arte en mai 2018) ; « Je peux pas… C’est pas bien… Ça ne peut pas durer… Je ne peux pas l’assumer. » (John s’adressant à son amant Will juste après leur nuit de sexe, dans le film « Ma Vie avec John F. Donovan » (2019) de Xavier Dolan) ; etc. Par exemple, dans le film « L’Inconnu du lac » (2012) d’Alain Guiraudie, Franck s’éprend d’un homme, Michel, qu’il a connu sur un lieu de drague homo où il y a une série de meurtres : « J’crois que je suis en train de tomber amoureux. » avoue-t-il à son pote Henri qui le sent quand même inquiet (et pour cause : Michel est le tueur !) : « Et c’est ça qui te tracasse ? » Dans le film « Test : San Francisco 1985 » (2013) de Chris Mason Johnson, juste avant de coucher avec son ami Todd, Frankie exprime une appréhension : « C’est peut-être pas une bonne idée… » Dans le roman Harlem Quartet (1978) de James Baldwin (mis en scène par Élise Vigier en 2018), Arthur, le héros homosexuel, vit très mal l’acte homo : « Ma bite a commencé à grossir, et j’ai commencé à pleurer. » ; « J’ai jamais oublié cet homme. À cause de lui, j’ai jamais pu toucher quelqu’un avant longtemps. » ; « Merde. C’est quoi mon problème ? » Dans le film « Call me by your name » (2018) de Luca Guadagnino, Elio pleure lorsqu’il pratique l’homosexualité avec Oliver. Dans le roman Harlem Quartet (1978) de James Baldwin, mis en scène par Élise Vigier en 2018, Arthur, le personnage homosexuel, fond en larmes en disant son « amour » pour son amant Crunch : « Je suis amoureux de toi. »… « Alors pourquoi tu pleures ? » lui demande Crunch. Dans le film « Jonas » (2018) de Christophe Charrier, Nathan embrasse Jonas sur la bouche dans la salle de sport du collège. Jonas ne s’en trouve pas bien : « Oh… j’ai la tête qui tourne. ».
Dans la pièce Soixante degrés (2016) de Jean Franco et Jérôme Paza, Rémi manque de s’étrangler (parce que son écharpe s’est prise dans la machine à laver) au moment où il rencontre pour la première fois Damien à la laverie, et dont il tombe amoureux. Et quand Damien raconte ses expériences homosexuelles, ce n’est pas brillant non plus : « C’est quand même vachement déstabilisant. J’ai tout de suite compris que c’était pas mon truc. Y’avait quelque chose en moins. » Dans la série Demain Nous Appartient diffusée sur TF1, Hugo, le héros homo, drague Bart Valorta pendant une baignade… et dans un premier temps, Bart réagit super mal et le renvoie chier… avant de céder un peu plus tard (c.f. les épisodes 260 et 262, diffusés les 7 et 9 août 2018).
C’est le premier rapport sexuel en général, qu’il se passe entre deux personnes de sexes différents ou entre deux personnes de même sexe, qui est mis en scène de manière dramatique dans les fictions homosexuelles : « Dorita se donna à lui [Silvano] pour la première fois la nuit des adieux, dans la salle de classe, sur le bureau de Silvano, tandis que la pluie fouettait les carreaux. Dorita était vierge. L’expérience fut douloureuse pour tous les deux. » (Copi, La Vie est un tango (1979), p. 12) ; « Comme elle me l’avait dit, la première fois est toujours déterminante, qu’elle soit de souffrance ou d’harmonie, surtout pour le goût spécial que j’ai. » (Alexandra, la narratrice lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 132) ; « Elle est rentrée en moi. J’ai cru que j’allais exploser. » (Irène après sa première relation lesbienne, dans la pièce Ma Première Fois (2012) de Ken Davenport) ; « T’as les mains froides… » (Karim parlant à Guillaume, son « plan cul » anxieux d’aller chez lui, un gars qu’il ne connaît pas, dans le film « Guillaume et les garçons, à table ! » (2013) de Guillaume Gallienne) ; « Ça, comme première tentative, c’était raté de chez raté. » (Guillaume, idem) ; « Je ne veux plus qu’on reparle de ça. C’est malsain. » (Clara après que Zoé, sa meilleure amie, lui ait fait sa déclaration et l’ait embrassée, dans le téléfilm « Clara cet été-là » (2003) de Patrick Grandperret) ; « Ce n’est pas grave si ta toute première fois était trop sombre. Ce n’est pas grave si ta seconde fois met à jour ta part d’ombre. » (c.f. la chanson « Grave » d’Eddy de Pretto) ; etc. Par exemple, le film « Tchernobyl » (2009) de Pascal Alex-Vincent filme un couple d’adolescents en train de vivre son tout premiers coït sylvestre. Dans le film « La Ballade de l’impossible » (2011) de Tran Anh Hung, Kisuki, le héros (homosexuel ?) se suicide parce que sa « première fois » avec Naoko, sa copine, se révèle désastreuse ; cette femme lui fait croire à son impuissance sexuelle. Dans le film « Naissance des pieuvres » (2007) de Céline Sciamma, Floriane veut être dépucelée par son amante Marie (« J’voudrais que ce soit toi, Marie. Que tu sois la première. Que tu me débarrasses. »), ce qui met cette dernière dans l’embarras (« Je peux pas faire ça. »). Cette défloration se passe mal, dans la tristesse et les larmes… même si Floriane conclut laconiquement, après le premier baiser sur la bouche : « Ben tu vois ?… c’était pas si difficile. » Dans le film « Les Astres noirs » (2009) de Yann Gonzalez, le premier baiser que s’échange Walter et Julien Doré est mal vécu par Walter. Dans la pièce Gothic Lolitas (2014) de Delphine Thelliez, Suki est inanimée suite au baiser forcé qu’elle a reçu de Rinn.
Dans le roman At Swim, Two Boys (Deux garçons, la mer, 2001) de Jamie O’Neill, Doyler, après sa nuit d’amour avec Jim, est pris de crampes insupportables au ventre : « C’est pas bon d’avaler la mer d’Irlande. » lui rétorque Jim, pour faire de l’humour.
Dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit, Benjamin raconte à son psy sa première rencontre homosexuelle avec son amant Arnaud, à qui il a fait volontairement un croche-patte, alors que le tableau est idyllique : « C’était comme au cinéma. C’était au bord de la plage. C’est alors qu’il m’est apparu. Un petit air de Ryan Goslin… avec le corps d’Élie Sémoun. » De son côté, Arnaud donne une autre version des faits au psychanalyste, en partant sur le quiproquo incestueux que le thérapeute lui parlait de sa première cuite : « Ma première fois, c’était avec mon oncle dans sa cave. » « Je comprends le traumatisme… » interrompt le psy. « J’avais 12 ans. J’étais consentant. […] C’était un Cabernet d’Anjou. Ma première cuite. » Réalisant qu’il y a eu malentendu, Arnaud se reprend : « Je sortais du cinéma. Il faisait 40° C. Ça puait la pisse. Je passe par Paris-Plage. Et là, avec le soleil qui m’aveugle, je me prends Ben en pleine gueule. Mais bon, moi j’ai le mal de mer, alors je lui en veux pas. »
Beaucoup de personnages homosexuels nous mettent en garde contre le passage douloureux à l’acte homosexuel (qu’ils ont vécu ou ont vu vivre), sans pour autant le dénoncer explicitement. « Ça devient vexant. J’ai l’impression de revivre mon dépucelage. […] Je suis à plat. La deuxième raison qui me rappelle mon dépucelage. » (Arnold, l’un des héros homos de la pièce En ballotage (2012) de Benoît Masocco) ; « J’ai détesté ça la première fois. » (Sven dans le film « Patrik, 1.5 », « Les Joies de la famille » (2009), d’Ella Lemhagen) ; « C’est quand même sacrément dur l’âge des premières amours, petit pédé. » (cf. la chanson « Petit Pédé » de Renaud) ; « Viens, ferme les yeux sur nos premières nuits. » (cf. la chanson « J’attends » de Mylène Farmer) ; « Quel malheur, quel coup de hache dans ma vie qui était déjà en morceau ! Quelle passion si insensée, coupable, odieuse, s’est emparée de moi ! C’est une honte, et elle me fera toujours rougir. » (Albert dans le roman Mademoiselle de Maupin (1835) de Théophile Gautier, paragraphe final du chapitre 8) ; « Pascal se sentait brouillé et malade. Et tellement sale. Il avait eu beau se frotter les mains à s’en écorcher la peau, il savait bien que c’était inutile. Ce genre de trace ne s’effaçait jamais. » (Claude Brami, Le Garçon sur la colline (1980), p. 246) ; « C’était l’été de nos treize ans. L’été des sœurs de sang. Dovid a eu migraine sur migraine, cet été-là. » (Ronit parlant de sa première fois lesbienne, dans le roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, p. 217)
Par exemple, dans le film « Keep The Lights On » (2012) d’Ira Sachs, Erik a eu du sexe homosexuel dès l’âge à 13 ans pour la première fois, et ça ne semble pas relié à de superbes souvenirs : « Je cache des vérités importantes depuis que j’ai 13 ans. » se contente-t-il de dire de manière laconique.
Dans le film « The Boys In The Band » (« Les Garçons de la bande », 1970) de William Friedkin, nous avons droit à tous les récits d’initiation homosexuelle des héros homosexuels. Par exemple, pour Hank, ça a été l’angoisse… même s’il s’empresse ensuite de banaliser : « La première fois que je l’ai fait, c’était pendant la grossesse de ma femme. Il y avait une réunion de professeurs, à New York. Ma femme ne se sentant pas bien, j’y suis allé seul. Et dans le train, j’y ai pensé. J’y pensais, j’y pensais pendant tout le voyage. Et peu après mon arrivée, j’avais emballé un mec dans les toilettes de la gare. […] Je n’avais jamais fait ça de ma vie auparavant. J’avais une trouille bleue. […] Mais je suis tombé sur un gars sympa. Je ne l’ai jamais revu ensuite. […] Ce qui est drôle, c’est que je ne me rappelle pas son nom. […] Après, ce fut plus facile. On s’améliore avec la pratique. » Michael raconte que lors de son dépucelage, il ne se souvient de rien : « La première fois, je tenais pas debout. » Bernard, quant à lui, a couché avec son pote Peter un soir alcoolisé, et il est le seul à s’en souvenir et à avoir accordé de l’importance à leur dérapage : « C’était l’après-midi. Toute la matinée, j’ai été malade à l’idée de l’affronter. […] Il a fait comme si rien ne s’était passé. »
Dans le film « Boys Like Us » (2014) de Patric Chiha, quand Nicolas, le héros gay, raconte son initiation à l’homosexualité au jeune Michael, lycéen en questionnement, il tente d’édulcorer les choses : « L’amour entre hommes, c’est pareil qu’avec les filles. Ça peut faire mal au début… mais tout ça, c’est l’expérience. » Comme Michael le rejette, Nicolas finit par cracher le morceau et par dire que sa « première fois » homosexuelle a été « plutôt glauque »… puis il s’empresse de renier son aveu : « Mais tu sais, la première fois, c’est jamais bien. »
b) Le baiser qui fait pleurer :
Symboliquement, le premier passage à l’acte homosexuel tourne surtout autour de l’action du baiser. Il est souvent question de l’importance (et des dégâts !) du premier baiser homosexuel dans les fictions homosexuelles : cf. le film « First Kiss » (1996) de Linda Cullen, le film « J’embrasse pas » (1991) d’André Téchiné, le film « Butterfly Kiss » (1995) de Michael Winterbottom, le recueil de poèmes Espadas Como Labios (Des épées comme des lèvres, 1932) de Vicente Aleixandre, le poème « Canción De Amor Para Los Nazis En Baviera » de Néstor Perlongher, le film « L’Ombre d’Andersen » (2000) de Jannik Hastrup, le roman El Peso De La Paja. El Beso De Peter Pan (1993) de Terenci Moix, la chanson « Tatuaje » de Rafael de León, le film « Les Amoureux » (1964) de Mai Zetterling (avec le baiser volé), le film « O Beijo » (1964) de Flavio Tambellini, le film « Csokkal Es Körömmel » (« Baisers et égratignures », 1995) de György Szomjas, le film « Kiss Kiss Bang Bang » (2005) de Shane Black, le film « O Beijo No Asfalto » (1985) de Bruno Barreto, le film « Kiss Or Kill » (1997) de Bill Bennett, le tableau Le Baiser (1992) de Michel Giliberti, le film « Kiss Me God Damn It ! » (2006) de Stian Kristiansen, etc.
Bizarrement, le personnage homosexuel a peur de ce baiser homosexuel. Il lui arrive de le fuir. Par exemple, dans le téléfilm « À cause d’un garçon » (2001) de Fabrice Cazeneuve, Benjamin se dérobe au baiser sur la bouche que Vincent s’apprête à lui faire : « Excuse-moi. J’peux pas te donner c’que tu veux. Pas ici… pas comme ça. »
Ce qui est très curieux, c’est qu’il fait souvent pleurer le héros gay qui le reçoit ou le donne : cf. le film « A Kiss In The Snow » (1997) de Frank Mosvold, le film « Les Chansons d’amour » (2007) de Christophe Honoré, le film « J’embrasse pas » (1991) d’André Téchiné, le film « Kissing Jessica Stein » (2002) de Charles Herman-Wurmfeld, le film « Madame Satã » (2001) de Karim Ainouz, le film « La Mala Educación » (« La mauvaise éducation », 2003) de Pedro Almodóvar, le film « Le Temps qui reste » (2005) de François Ozon, le film « Aimée et Jaguar » (1998) de Max Färberböck, le film « Fire » (2004) de Deepa Mehta, etc.
« Et vous l’avez embrassé ! Vous en frémissez. Vous n’ignorez pas qu’il est des étreintes dont on conserve à jamais la brûlure. » (la voix narrative parlant de la déesse « Littérature », dans le roman N’oubliez pas de vivre (2004) de Thibaut de Saint Pol, p. 150) ; « Les baisers, les premiers, goût d’embruns, goût de spleen. » (cf. la chanson « Gourmandises » d’Alizée) ; « J’attends ma peine, sa bouche est si douce. » (cf. la chanson « Je t’aime Mélancolie » de Mylène Farmer) ; « Ce fut un baiser comme je n’en avais jamais reçu d’une femme, un baiser sauvage et désespéré comme un cri mortel. Le tremblement convulsif de son corps passa en moi. […] Mon âme s’abandonnait à lui, et pourtant j’étais épouvanté jusqu’au tréfonds de moi-même par la répulsion qu’avait mon corps à se retrouver ainsi au contact d’un homme – affreuse confusion des sentiments… » (le héros homosexuel recevant son premier baiser de son amant, dans le roman La Confusion des sentiments (1928) de Stefan Zweig, p. 126) ; « Ce fut une secousse comme quand un corps se désarticule violemment. » (idem) ; « Ce fut un innocent coup d’œil en arrière qui perdit le fils. L’homme, que le père semblait fuir, lança au fils un baiser aérien, et ce baiser percuta avec une telle violence l’innocence de ses pensées qu’il faillit tomber à la renverse ; mais le fourmillement délicieux que cette collision déclencha le laissa sur sa faim. » (cf. la nouvelle « À l’ombre des bébés » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 30)
Le baiser homosexuel fictionnel n’est généralement pas donné et reçu en toute liberté : il est arraché (comme dans les films « Baisers volés » (1968) de François Truffaut, « L’Homme blessé » (1983) de Patrice Chéreau, la chanson « Le Baiser » du groupe Indochine, etc.), ou bien à l’image d’une collaboration, d’un viol. « Y’a des baisers volés dans les trains de tsarine. » (cf. la chanson « Gourmandises » d’Alizée) ; « Cette nuit, je te l’ai pris, ce baiser que tu n’as pas voulu me donner. […] Je suis encore troublé par ce baiser volé. » (Kévin à son amant Bryan dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 207) ; « Mes baisers sont souillés. » (cf. la chanson « Plus grandir » de Mylène Farmer) ; « Je souffre de tes yeux, de tes mains, de tes lèvres… qui savent si bien mentir… et je demande à mon ombre, sans trêve… si ce baiser sacré… peut me trahir. » (les paroles d’un boléro chanté dans le roman El Beso De La Mujer-Araña, Le Baiser de la Femme-Araignée (1979) de Manuel Puig, p. 215) ; « Je n’aimais pas son haleine à l’odeur de bière et de cigarette. […] Quand j’ai été dans sa bouche, j’ai trouvé ça divin. J’ai oublié qui j’étais. » (le jeune Mathan parlant de sa première fois homosexuelle, dans la pièce Un Cœur en herbe (2010) de Christophe et Stéphane Botti) ; etc.
Dans le film « Shortbus » (2005) de John Cameron Mitchell, quand James se fait embrasser pour la première fois sur la bouche par Ceth, un amant insistant, il lui dit qu’« il ne le sent pas » tout en se laissant néanmoins faire ; mais plus les baisers s’enchaînent avec fougue, plus il pleure et rejette violemment son partenaire comme une furie : « Non !!! Tu ne vois pas que je ne veux pas ??? » Dans le film « Babysitting » (2014) de Philippe Lacheau, Sam et Franck s’embrassent à leur insu dans le noir (une Dark Room d’un parc d’attractions), mauvaise blague orchestrée par Sonia que les deux hommes se disputent : en découvrant les images, ça ne les fait pas rire du tout.
Le baiser homosexuel peut être associé aussi au meurtre et à l’acte diabolique. « Ta petite bouche m’a appris à pécher. » (cf. la chanson « Piensa En Mí » de Luz Cazal) Par exemple, au moment du baiser entre Julia et Élisabeth dans le film « Danse macabre » (1963) d’Antonio Margheriti, la seconde saisit un coupe-papier pour poignarder sa tentatrice. Dans le film « Memento Mori » (1999) de Kim Tae-yong, le premier baiser a le goût amer de la pomme du Jardin d’Éden.
Dans le film « The Burning Boy » (2000) de Kieran Galvin, le premier baiser homosexuel entraîne la mort. En effet, c’est au moment où Ben donne à son meilleur ami Chill le signe charnel que ce dernier attendait tant que paradoxalement, Chill se met à pleurer. « Mais tu pleures ? » s’étonne Ben. « Non, je ne pleure pas. » répond Chill. Ben essaie alors de relativiser l’acte qu’ils viennent de poser (« Écoute, ça va, c’est pas grave. Je sais que je te plais. ») mais Chill s’énerve, pousse son copain, qui finit par faire une mauvaise chute le laissant totalement inanimé dans un cabanon qui prendra entièrement feu. Ce film vise à faire comprendre au spectateur que le refus de sa propre homosexualité est criminel ; mais au-delà de cette dialectique idéologique, on nous montre en toile de fond que le baiser homosexuel tue.
c) L’acte homosexuel rejoint indirectement ou directement le viol :
Le passage à l’acte homosexuel n’est pas violent prioritairement parce qu’il y aurait pénétration génitale (car certains militants homosexuels se plaisent à penser que ce serait uniquement la vision de deux corps masculins qui s’emboîtent et s’enculent qui gênerait les opposants à l’homosexualité), mais bien parce que le désir homosexuel est violent par nature.
Dans le film « Respire » (2014) de Mélanie Laurent, Sarah et Charlène, les deux amantes, se retrouvent à parler de leur dépucelage dans un bosquet. Sarah dit que « la première fois [génitale], ça ne se passe jamais bien. Charlène lui rétorque qu’elle ne l’a jamais fait avec un homme. Puis elles entendent un bruit de bête sauvage effrayante qui les fait quitter précipitamment le lieu, terrorisées. Un peu plus tard, sous l’effet de l’alcool et dans un moment d’intimité, elles s’embrassent sur la bouche dans leur caravane. Ce geste recouvre une forme de mélancolie fataliste : « It’s too late. I’m in love. » déclare Charlène à Sarah. Juste après le baiser, étonnamment, Sarah lui fout tout de suite après une gifle magistrale : « I’m not ready ! », geste blessant qui déromantise bien évidemment la scène. Dans le film « Mezzanotte » (2014) de Sebastiano Riso Davide, le héros homo de 14 ans, est enculé contre un mur en verre, sur fond rouge, par un autre prostitué.
D’ailleurs, c’est bien pour cela que dans les fictions homosexuelles, la violence et la tristesse de l’acte homosexuel sont ressenties bien avant le passage au lit. Elles se présentent déjà à partir de la rencontre de l’amant, de la perception d’un attachement sentimental disproportionné.
Le héros homosexuel a un étrange mauvais pressentiment quand il rencontre son amant : « La première fois que j’ai vu Julien, j’ai su que j’étais perdu. Julien me donne l’image retouchée, parfait, d’une condamnation à l’avance. » (le juge Kappus dans le roman Portrait de Julien devant la fenêtre (1979) d’Yves Navarre, p. 114) Il freine des quatre fers au moment de réaliser son fantasme, et on/il ne comprend pas pourquoi. « Moi, ce qui m’a ouvert les yeux, c’est un type. On s’apprêtait à faire l’amour et… il éclate en sanglots. Là-dessus, il dit : ‘Excuse-moi, j’suis désolé… Ce n’est plus aussi drôle qu’autrefois.’ » (Jeffrey, le héros homosexuel, dans le film éponyme (1995) de Christophe Ashley) ; « Tu ne sais pas pourquoi je pleure. » (Violette Leduc à son amie Hermine, dans le roman La Bâtarde (1964), p. 221) ; « J’ai pas envie de la voir nue, j’ai pas envie de le voir nu. » (cf. la chanson « Troisième Sexe » du groupe Indochine) ; « Puisque c’est la première fois, ça vous dérange pas si on éteint la lumière. » (Dzav–Bonnard à leur producteur, au moment du coït, dans la pièce Quand je serai grand, je serai intermittent (2010) de Dzav et Bonnard)
Dans le roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, quand Esti et Ronit se retrouvent toutes les deux pour la première fois dans un bosquet et qu’elles sont prêtes à se révéler leurs sentiments, Ronit dit à Esti qu’elle « a l’air d’un tueur en série ». (p. 139) Elles finissent par sortir ensemble. Mais plus tard, c’est toujours la même résistance qui revient : « Je l’ai repoussée et tenue à l’écart, à bout de bras. Je suis plus forte qu’elle, je l’ai toujours été. Ça n’a pas été difficile. ‘Non, Esti ! ai-je dit. Tu dois arrêter maintenant. Ce n’est pas, enfin, ça suffit, tu arrêtes, d’accord ?’ » (Ronit, idem, p. 145)
Dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, au moment de vivre son premier rapprochement homosexuel, Bryan se sent très mal et repousse son copain Kévin, même s’il se cherche ensuite des excuses pour trouver sa gêne absurde (il dit qu’il se trouve « compliqué ») : « Je regrettais presque d’avoir réagi aussi connement. Évidemment que j’en rêvais, pourquoi lui faire croire le contraire ? Je pouvais mentir aux autres mais pas à lui… et à chaque fois, cette impression d’avoir un cerveau compliqué… c’était lui le responsable, pas moi ! » (p. 120)
La première fois homosexuelle est marquée par un contexte d’absence de liberté (on appelle cela l’« homosexualité de circonstance » dans la réalité). Par exemple, dans le film « Órói » (« Jitters », 2010) de Baldvin Zophoníasson, Markus et Gabriel s’embrassent sous l’effet de l’alcool, alors qu’ils ne sont pas en pleine possession de leurs moyens. Dans le film « In & Out » (1997) de Frank Oz, Peter embrasse de force Howard sur la bouche.
Le désir homosexuel n’est pas un élan libre à la base. « Un jeune garçon aux yeux verts vous sourit. On vous pousse par derrière. Vous avancez. » (Thibaut de Saint Pol, N’oubliez pas de vivre (2004), p. 16) Il peut dire un attachement malsain aux origines. C’est la raison pour laquelle la première fois homosexuelle est parfois associée à un acte incestueux : « Que signifiait le baiser qui l’avait tant troublé : défi, ou mépris ? L’homme les avait-il pris, son père et lui, pour des invertis ? » (la voix narrative dans la nouvelle « À l’ombre des bébés » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 31) Dans la pièce Une Souris verte (2008) de Douglas Carter Beane, Alex affirme en blague que sa « première fois homosexuelle », ça a été avec son beau-père. Dans le film « Hôtel Woodstock » (2009) d’Ang Lee, le baiser entre Elliot et Paul, au départ plaisant, laisse place à la culpabilité : Elliot regarde la place vide de son père dans le bar. Idem dans le film « Shower » (2012) de Christian K. Norvalls, où ce sera le fait que le baiser homosexuel soit vu et rendu concret par le regard d’un vieillard, qui remplira le héros homosexuel d’une culpabilité criminelle à l’égard de son camarade de vestiaires. Dans le téléfilm « L’Homme que j’aime » (2001) de Stéphane Giusti, le premier rapport amoureux homosexuel fait l’objet d’une vraie bagarre dans les vestiaires entre les deux amants, Lucas et Martin.
Plus radicalement, la première fois homosexuelle renvoie au viol, à la trahison, à une imposture identitaire et amoureuse. « Toute sodomie commence par un viol. » (Paul dans la pièce Homosexualité (2008) de Jean-Luc Jeener) ; « Soudain, tandis que j’étais à moitié nu, je ne sais par quel subterfuge inconscient de l’esprit, les images de ma première nuit d’amour avec Franck se projetèrent sur ce lit, comme en surimposition. Scènes de film muet, où l’un des protagonistes – moi, en l’occurrence –, est pris d’un terrible remords pour ce qu’il a fait subir au jeune garçon. » (Éric en parlant de son amant Franck, dans le roman L’Amant de mon père (2000) d’Albert Russo, p. 35) ; « La honte et le plaisir, l’impression à la fois d’être souillé et d’enfreindre un tabou vieux comme le monde se mêlent en lui. » (la description de Franck sodomisé, idem, p. 39) ; « Tu sais, ma première amie, je l’ai trahie. » (Cherry à son amante Ada dans la pièce La Star des oublis (2009) d’Ivane Daoudi) ; « C’est très perturbant de découvrir le sexe comme ça. » (Joe, un homme homosexuel obèse, très anxieux et efféminé, qui a été violé par un prêtre à l’adolescence, dans le film « Spotlight » (2016) de Tom McCarthy) ; etc.
Dans la pièce Dépression très nerveuse (2008) d’Augustin d’Ollone, Balthasar dit : « J’ai eu un orgasme mais ça fait mal. » Ce à quoi Louis lui répond : « T’étais pourtant prévenu… Le dépucelage… » Dans le film « Gun Hill Road » (2011) de Rashaad Ernesto Green, le jeune Michael, au moment de réaliser sa première fellation, fait tout pour reculer l’échéance : « Tu as un bonbon ? » Dans le film « Edge Of Seventeen » (1998) de David Moreton, on observe une sodomie qui fait mal, qui inquiète, qui n’est pas librement choisie. Dans le film « Vil Romance » (2009) de José Celestino Campusano, le premier coït homosexuel entre Raúl et le jeune Roberto se passe très mal, dans une grande appréhension et violence : « Tu vas me faire mal! […] Ça fait mal ! » hurle Roberto avant d’être effectivement violé et frappé par son amant.
Dans le film « Ander » (2009) de Roberto Castón, José et Ander font la première fois l’amour dans les toilettes un jour de mariage ; certes, Ander a bu, mais il est aussi tellement traumatisé de la violence de la pénétration anale et de son assujettissement à son homosexualité qu’il en vomit sur place.
Dans le film « Prora » (2012) de Stéphane Riethauser, les deux meilleurs amis, Jan et Matthieu, finissent par coucher ensemble, et Matthieu le vit super mal : « Putain, mais lâche-moi, espèce de pédale ! » Il pousse Jan contre une fenêtre qui vole en éclat et qui le blesse à la jambe.
Dans le film « Week-End » (2012) d’Andrew Haigh, la première fois où Russell et Glenn se rencontrent, c’est dans les toilettes d’une boîte gay, un soir de déprime mutuelle. Et quand ils font ensemble un brin de causette (présenté comme « profond » par le réalisateur), on apprend que la toute première fois de Russell lui est apparue comme « trop violente ».
Les dommages collatéraux du premier acte homosexuel peuvent être bien entendu d’ordre physique : « Tu avais mal à l’endroit du… coït. » (Dominique à Jérôme en parlant de la nuit d’amour alcoolisée entre Jérôme et François l’homosexuel, dans la pièce On la pend cette crémaillère ? (2010) de Jonathan Dos Santos) Mais ils sont avant tout psychologiques.
Dans le film « Une si petite distance » (2010) de Caroline Fournier, par exemple, l’amour lesbien naît du voyeurisme : l’héroïne observe par le trou du mur de son appartement sa voisine nue dans sa salle de bain, et la toute première fois, celle-ci hurle de se découvrir ainsi violée… avant de se laisser au fur et à mesure espionner avec complaisance.
Dans le film « Like It Is » (1998) de Paul Oremland, le premier rapport sexuel entre Craig et Matt est vécu comme un drame. En effet, dans un premier temps, Craig, en bon puceau, attend son amant au fond de leur lit, avec une réelle appréhension, même s’il lui assure que « tout va bien », et qu’il sera par la suite à l’initiative de tous les actes sensuels qu’ils vont poser. Ensuite, il reçoit les caresses de son copain comme un vrai supplice. Puis il demande machinalement à Matt : « Je veux que tu me baises. » Son copain, entièrement nu, lui demande s’il est « sûr » de sa décision, étant donné le peu d’appétence manifestée. Craig prend sur lui et se force à ne pas se contredire : « Oui, pénètre-moi ! ». Matt, déjà coupable, insiste à nouveau : « Tu es sûr que tu veux le faire ?… ». Son ami lui ordonne : « Fais-le ! ». Au moment où Craig se fait finalement pénétrer, il se relève précipitamment du lit, réagit très violemment, se tape la tête contre les murs de la chambre en injuriant Matt. Plus tard, son compagnon lui avouera qu’il a compris sa mauvaise réaction, car lui aussi avait pleuré lorsqu’il s’était fait jadis déflorer. Dans le film « La Vie d’Adèle » (2013) d’Abdellatif Kechiche, Adèle est poussée dans les bras des femmes parce qu’elle avait été prématurément et préalablement poussée dans les bras des garçons à cause de la pression des copines de lycée.
La première fois homosexuelle est aussi en lien avec la violence des rapports sociaux et commerciaux au sein de la communauté homosexuelle, de l’inhumanité des sites de rencontres Internet et des lieux de drague homosexuelle (qui offrent parfois le cadre du premier contact brutal du héros avec son homosexualité). Par exemple, dans la comédie musicale Sauna (2011) de Nicolas Guilleminot, Benji, le héros homosexuel, débarque pour la première fois au sauna et vit un parcours initiatique difficile…
La première fois homosexuelle est également liée à la mort, à la guerre et aux grandes catastrophes. « J’avais l’impression que j’étais en train de mourir. Mais vue comme ça, la mort, c’était ce que j’avais connu de meilleur dans ma vie. » (Mourad, le personnage homosexuel décrivant son premier émoi amoureux homosexuel, dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 339) Dans le one-man-show Changez d’air (2011) de Philippe Mistral, le héros homosexuel dit avoir rencontré son « mari » pour la première fois le 11 septembre 2001. Dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, Bryan et Kevin, les deux amants homos, se rencontrent pour la première fois au cimetière, face à la tombe de Julien, un gay du lycée qui s’est suicidé : « Nous étions là, figés devant ce cercueil que nous regardions en silence. » (p. 50) Dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson, le beau Vincent raconte que la première fois qu’il a couché homosexuellement, c’était dans un coin reculé d’une plage, à l’âge de 15 ans, avec un homme de 20 ans, Sébastien, qui s’est tué à l’arme à feu un an après.
d) La ré-écriture enchanteresse et volontariste de la « première fois » homosexuelle :
Pourtant, l’initiation homosexuelle n’apparaît pas tout de suite comme violente, car sa brutalité est amortie par les intentions amoureuses. Beaucoup de personnages homosexuels, dans leurs élans ados, fantasment sur l’idée de « première fois » : « Just a first kiss from my lover… beautiful kiss and forever : I love him… » (cf. la chanson « Father I Am » de Jann Halexander) ; « On s’assied sur le lit, on se caresse, on s’embrasse avec fureur ou grande tendresse, alternativement. Vianney s’allonge et je le caresse doucement, je découvre son corps avec mes doigts devenus beaucoup plus sensibles. J’arrive à son visage, il murmure ‘J’ai envie de pleurer. C’est comme un rêve, un truc trop beau pour être vrai. Je me demande quand la tuile va nous tomber dessus.’ » (Mike, le narrateur homosexuel faisant pour la première fois l’amour avec un inconnu, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 85) ; etc.
On comprend que si la « première fois homosexuelle » est parfois décrite en des termes positifs, ce n’est pas tant parce que les faits sont regardés tels qu’ils sont, mais bien parce qu’ils sont l’objet d’une ré-écriture enchanteresse postérieure à l’acte homo : « Nos corps se sont touchés. Soudain, nous nous sommes embrassées. Je ne sais pas comment cela s’est produit. Je me sentais nauséeuse… Je me suis laissée aller. Je me suis sentie bien. » (l’héroïne racontant une aventure lesbienne à sa mère, dans le film « Les Rendez-vous d’Anna » (1978) de Chantal Akerman) ; « Je ne sais même plus si je l’ai vraiment aimé. Quand je l’ai rencontré, il était comme perdu. Moi, je n’étais pas mieux que lui. […] Son histoire m’a touché, sa souffrance, ses larmes, ses questions. […] Je le sentais désespéré et c’était la première fois que je rencontrais quelqu’un d’aussi vrai. […] Je me suis attaché à ce qu’il représentait, peut-être plus qu’à lui d’ailleurs. » (Malcolm en parlant d’Adrien, dans le roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, pp. 119-120) ; « ‘L’autre jour, il faisait gris comme le jour où Gilberto m’a quitté, mais ça allait. Je suis allé chez un mec pour baiser, on a fumé et avant de baiser, d’un coup tout est remonté. Je me suis mis à pleurer, je ne pouvais plus m’arrêter.’ En riant, il ajoute ‘Le pauvre garçon ne savait pas quoi faire !’ » (Simon dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 113) ; etc.
Même si dans les faits la « première fois » et la virginité sont rendues bien loin, certains héros homos s’évertuent en amour à rejouer cycliquement la comédie de la « première fois ». « C’est dans la nuit de Rebecca que la légende partira, et aujourd’hui pour une troisième fois elle décidait de sa première fois. » (la chanson « Trois nuits par semaine » du groupe Indochine) ; « Inconsciemment, reproduire chaque fois la toute première fois, le tout premier mauvais choix. » (cf. la chanson « L’Inconstant » d’Étienne Daho) ; « Avec un mec, c’est chaque fois la première fois… Encore plus. » (Franck dans la pièce Mon Amour (2009) d’Emmanuel Adely) ; « Je pourrais citer chaque premier baiser de mes relations. » (Matthieu… qui, plus tard, trompera quand même son copain Jonathan, dans la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H.) ; etc. Dans la pièce Mon cœur avec un E à la fin (2010) de Jérémy Patinier, la première fois est le lieu de la division déniée : « J’ai été seule puis une et demi, j’ai grandi en comprenant comme ça que je ne supporterais mon corps que lorsque je nouerais au sien, lorsque nous serons en nous, l’un dans l’autre, chacun réconciliés avec sa première fois… » (une jeune femme dans l’acte 2 intitulé justement « La Première fois ») ; « Je n’ai jamais eu de première fois puisque j’ai tout de suite eu l’impression que c’était déjà la deuxième. » (idem)
Le personnage homosexuel, dans ses élans bourgeois-bohème, fantasme beaucoup sur l’idée de « première fois ». Intellectuellement, elle lui plaît. Même si ses actes ne sont pas purs, il exhibera souvent à l’amant qu’il cherche à posséder ses intentions de retour à la virginité à travers l’amour homosexuel : « Et ne croyez pas que, d’ordinaire, je sois sujette à ces sortes d’emballements. Pour moi comme pour vous, sans doute, c’est une première fois. Il me faut, il nous faut l’accepter. » (Émilie à son amante Gabrielle, dans le roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami, p. 69) Il affectionne les coups de foudre, les « premières fois » saturées de désirs (pulsionnels) et de sensations, mais où la liberté est quasi absente. A-t-il compris qu’il n’était pas à l’origine de l’Amour originel ? que l’Amour vrai n’était pas brutal ? Visiblement, non.
Par exemple, on l’entend dire toutes les trois semaines qu’il est tombé fou amoureux, que « cette fois, il a vraiment rencontré LE bon », que « c’est complètement différent de tout ce qu’il a connu auparavant »… Face à l’amant, il sert le même discours sincère de la renaissance : « C’est la première fois que ça m’arrive ; t’es la première personne avec qui je le fais ; Tout ça, je ne l’ai jamais dit à personne avant ». Mais concrètement, dans sa vie, la réalité de la « première fois » sexuelle est beaucoup plus liée à celle de la rupture, de la bonne intention non-actée, ou de la pulsion égoïste romantisée (autrement dit de la masturbation), qu’à la véritable virginité, une virginité reçue et non pas créée par ses propres forces/perceptions humaines. « Je rêve pour sortir du bois, pour ma toute première fois… [d’une branlette] » (un des personnages homos de la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel) ; « Ma première relation homo, je l’ai eue avec moi-même. » (David dans la pièce Ma Première Fois (2012) de Ken Davenport) ; etc.
Par exemple, dans le film « Como Esquecer » (« Comment t’oublier ?, 2010) de Malu de Martino), Julia, l’héroïne lesbienne, se palpe sous sa douche (en souvenir de sa dernière relation amoureuse terminée) et pleure tout de suite après.
Dans le one-man-show Raphaël Beaumont vous invite à ses funérailles (2011) de Raphaël Beaumont, la « première fois » est tellement idéalisée qu’en actes, elle fait faire n’importe quoi au héros homosexuel : « Je m’étais juré de pas coucher le premier soir ! Mais que voulez-vous ? J’avais rencontré mon Prince Charmant ! Je me sentais comme Cendrillon ! Elle avait trouvé chaussure à son pied et moi… »
Dans le film « Quels adultes savent » (2003) de Jonathan Wald, la première fois entre le jeune Roy et son amant plus âgé, Maurice, se déroule de manière tragique et en même temps totalement dédramatisée. En effet, à la fois Roy pleure quand il se fait pénétrer (on comprend qu’il ment quand il fait croire à son aîné que ce n’est pas sa première fois homosexuelle), et juste après le coït douloureux, il caresse langoureusement le poitrail de son « copain d’un soir » en scandant à voix basse et de manière répétée le prénom « Maurice… Maurice… » qu’il vient de découvrir (les amants ne s’étaient même pas donnés la peine de se présenter avant de passer au lit !)… alors que pour l’homme plus expérimenté, on voit qu’il s’agissait d’un banal « plan cul », d’une formalité qu’il va s’empresser d’oublier. Au moment du départ de Maurice, Roy, assis sur la cuvette des toilettes, dés-idéalise l’idylle, et pose une question dans le vide, qui restera sans réponse : « On se sent toujours comme ça après ? »
Une autre parade trouvée par le personnage homosexuel pour noyer sa tristesse d’être un homosexuel pratiquant débutant, c’est l’intention ludique : « Le passage à l’acte ressemble à s’y méprendre à ces jeux où les enfants se répartissent les rôles entre gendarmes et voleurs : ‘On dirait que tu es mort’, en sachant que le pistolet est en bois. La cravache de Mathilde est un gourdin en papier mâché, mes fesses la tête de guignol. » (la voix narrative lesbienne, dans le roman Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train (2005) de Cy Jung, p. 60)
Par exemple, dans les films « I Want Your Love » (2010) de Travis Mathews ou « Action Vérité » (1994) de François Ozon, le passage à l’acte passe par le biais du défi ludique.
Mais le jeu en question ressemble à un piège, une diversion mensongère, un catapultage précipité dans le monde de la sexualité clinique et pornographique. Par exemple, dans la pièce Faim d’année (2007) de Franck Arrondeau et Xaviéra Marcjetti, Marc évoque sa première expérience homogénitale : « Ça s’est fait bizarrement. Au détour d’un jeu. »
Dans le film « Infidèles » (2010) de Claude Pérès, un réalisateur et un acteur s’enferment dans un appartement, seuls, avec une caméra, toute une nuit, jusqu’au lever du jour, pour mettre à l’épreuve leurs désirs. Leur jeu ambigu finit par tourner mal.
Dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, Kévin, juste avant de passer au lit avec Bryan, lui fait passer un drôle de bizutage : il « dit sur un ton catégorique : ‘On va jouer à un jeu : la bataille. T’as un jeu de cartes ?’[…] J’aime bien jouer avec toi’, dit-il, avec ce sourire qui en disait long sur ce qu’il pensait. » (p. 123)
Dans beaucoup de fictions homosexuelles, le passage à l’acte homosexuel finit par faire rire jaune, et par blesser.
e) Le premier viol homosexuel vient de l’imaginaire et de l’éloignement du Réel :
Comme je l’ai dit un peu plus haut, la violence de l’acte homosexuel n’est pas prioritairement une question de pénétration génitale ou de gestes brusques dans le cadre amoureux (les pratiques ouvertement violentes restent circonscrites aux sphères très minoritaires de l’univers SM). Elle se situe avant tout dans la violence d’une sincérité, sincérité exposée comme vraie et aimante, alors qu’elle n’équivaut pas à la Vérité ni à l’Amour (on peut vouloir le bien sans le faire ! on peut être franc, consentant, sincère, intentionnel, sans être vrai !)
Le meilleur exemple de « premières fois homosexuelles » ratées, d’actualisations violentes de la sincérité, ce sont déjà les coming out : « C’était la première fois que je parlais de mon homosexualité et c’était pour la renier ! » (Ednar disant à Yvonne qu’il n’est pas homo alors qu’elle a découvert à raison son homosexualité, dans le roman Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 44)
La violence de la première fois homosexuelle, c’est aussi celle du regard libidineux, ou d’un simple « Je t’aime », tellement inapproprié au Réel et à la réalité de la relation qu’il a l’effet d’une gifle : « En sortant du casino, […] je lui ai dit que j’avais envie de faire l’amour avec elle. Elle m’a regardée tristement. Je pouvais lire dans ses pensées : ‘Si même les femmes ne me laissent pas tranquille, maintenant, qu’est-ce que je vais devenir ?’ » (Suzanne en parlant de Fédora et de leur première rencontre, dans le roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, p. 238) La déclaration d’amour homosexuel apparaît comme un arrivisme suspect, flattant la défaillance humaine des deux personnages qui vont s’adonner à leur désir homosexuel en toute passivité/sincérité : « Elle a ajouté, d’une voix étranglée : ‘Je vous aime’ et elle s’est mise à pleurer. » (Erika décrite par Suzanne lorsqu’elle lui déclare sa flamme pour la première fois, idem, p. 185)
L’acte homosexuel a le pouvoir d’anesthésier la conscience de mal faire. Il rend flou la frontière entre le bien et le mal, entre réalité et fantasme, si bien que le héros homosexuel qui se décide à croire en la beauté et en la réalité de l’identité homosexuelle ou de l’amour homosexuel vit une forme de division interne indéfinissable, de captation psychique, d’hypnose, de rêve éveillé digne des meilleurs films de science-fiction (quand l’être humain s’extériorise trop), entre ce qu’il ressent et ce qu’il vit concrètement. « Quand j’ai sonné à la porte, j’étais dans un état second. » (Florence dans la pièce Confidences (2008) de Florence Azémar) ; « Je ne me reconnais plus. Ce qui me faisait l’égal des autres n’existe plus. Je leur ressemblais malgré mes défauts. Les miens et ceux de mon monde. Tu m’as soustrait à l’ordre naturel des choses. Je ne m’en suis pas rendu compte lors de ton séjour. Je m’en aperçois, alors que tu t’en vas ? En te parlant, je prends conscience de ma diversité. Qu’adviendra-t-il de moi ? Ce sera comme vivre tout près d’un autre moi-même qui n’a rien de commun avec moi. Faut-il toucher le fond de cette diversité que tu m’as révélée et qui est ma vraie nature angoissée ? » (Pietro à l’Étranger qui l’a défloré, dans le film « Teorema », « Théorème » (1968), de Pier Paolo Pasolini) ; « La chambre obscure impliquait certains actes concrets. Julien attendait des choses, que son hôte n’avait à présent guère le courage d’entreprendre. La chaleur était pénible. Nicolas se sentait décalé, hors de lui-même, tandis que ce corps offert devenait soudain réel. Attendant d’être accommodés à la cuisine de Nicolas, les 65 kilos de Julien s’imposaient maintenant comme un paquet de chair peu compatible avec la rêverie qui les avait conduits jusque-là. […] Il devenait spectateur de Julien et de lui-même. […] Nicolas n’osait révéler son malaise à celui devant lequel il avait, depuis trois jours, montré tant de détermination. Il fallait payer. » (Benoît Duteurtre, Gaieté parisienne (1996), pp. 82-85)
Dans le roman Papa a tort (1999) de Frédéric Huet, Antoine entraîne Julien dans un guet-apens (cette situation finit par plaire à ce dernier, malgré la violence objective de la démarche) : « Je lui ai emboîté le pas. Antoine m’a entraîné jusqu’aux toilettes où il m’a brusquement poussé. J’ai demandé : ‘Pourquoi ?’. ‘Tu verras. C’est un secret’. Alors je me suis avancé sans broncher et Antoine a refermé la porte derrière lui. Et puis là… oh, la, la, la, la, j’en tremble rien qu’à l’écrire mais Antoine qui s’est immobilisé devant moi, m’a plaqué violemment contre le mur, s’est collé à ma poitrine jusqu’à presque m’étouffer, et d’un geste langoureux, il a posé sa bouche contre ma bouche, et tout en se penchant délicatement près de mon oreille, il m’a soufflé : ‘Je t’aime.’ J’ai failli m’évanouir à cet instant. J’étais transporté aux anges, renversé, ébranlé. »
Dans le roman Tanguy (1957) de Michel del Castillo, Tanguy déclare vivre écartelé « entre deux mondes » (p. 237) juste après avoir vécu sa première expérience homosexuelle.
Dans la pièce Gouttes dans l’océan (1997) de Rainer Werner Fassbinder, Franz (20 ans) se retrouve dans l’appartement de Léopold (35 ans) – ils se sont flairés dans la rue et ils ne se connaissent pas – et la situation précipitée mais voulue par eux deux laisse Franz dans un profond désarroi. Juste avant qu’ils s’embrassent, le jeune homme semble perdu (« Je ne sais pas… Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Vous m’avez pris de court… ») et raconte que son tout premier baiser homosexuel (avec la langue) reçu par Joachim – un camarade dans un foyer de lycéen – l’avait troublé (« Je me suis senti très mal. »). Lorsqu’il embrasse Léopold pour la première fois, Franz est pris d’étourdissements : « Ça fait tout drôle… J’ai vraisemblablement trop bu. » Une fois l’acte sexuel consumé, Franz est à la fois repu et pris de culpabilité : « Je me suis bien fait avoir. »
Le personnage homosexuel semble nous dire que la beauté de l’acte homosexuel réside prioritairement dans sa non-actualisation, dans sa non-réalisation ; dès que celui-ci devient concret, il perd de sa splendeur. La première fois n’a que la magie de l’irréel : « Tout est allé très vite et Olivier ne réalise pas trop ce qui vient de se passer. Il est content que son ami ait pris cette initiative. Plusieurs fois il avait rêvé de ce moment, où il pourrait enfin embrasser son fantasme sur la bouche. Mais la réalité a finalement été bien décevante. Maintenant, il ne sait plus s’il est heureux que ça se soit produit ou non. » (Olivier, le héros homo du roman Le Musée des amours lointaines (2008) de Jean-Philippe Vest, p. 173)
Dans le film « Jongens » (« Boys », 2013) de Mischa Kamp, quand Sieger reçoit et donne son premier baiser à son amant Marc, il s’allonge sur l’eau en regardant le ciel, comme éberlué par une irréalité. Dans le film « Fotostar » (2002) de Michele Andina, Konrad, le héros homosexuel, une fois qu’il se trouve enfin dans le salon de Jonas, l’homme qu’il a dragué et qui l’embrasse langoureusement sur la bouche, finit par se rétracter. Au moment d’accéder enfin pour de vrai à l’homme de ses fantasmes érotiques, il découvre avec effroi l’envers du décor, la vanité de la possession de l’homme-objet que son désir homosexuel avait commandé. On le voit paralysé par la peur. Jonas essaie de le tranquilliser : « Tu n’as aucune raison d’avoir peur. » Mais Konrad nie sa crispation sans pour autant y remédier (« Mais je n’ai pas peur. »)… contradiction qui perturbe bien évidemment Jonas (« Alors détends-toi. Qu’est-ce que tu as ? »). C’est au moment où Konrad prétexte d’aller aux toilettes qu’il quitte en douce l’appartement de son ami. Dans le film « Rafiki » (2018) de Wanuri Kahiu, les deux amantes Kena et Ziki se retrouvent pour la première fois en intimité dans une camionnette… mais au moment de s’embrasser, Kena est tellement gênée qu’elle quitte le lieu : « Je dois y aller. » Plus tard, juste après leur première coucherie et leur nuit d’amour, les deux amantes Ziki et Kena partagent leurs impressions… et Ziki a du mal à réaliser la factualité de leur acte génital : « J’aimerais que ce soit vrai. »… « Mais c’est vrai ! » lui répond gentiment Kena, pour la rassurer.
Dans le film « Krámpack » (2000) de Cesc Gay, c’est le même scénario : l’amant-puceau qui avait « allumé le chauffe-eau » ne prend finalement pas la douche, parce qu’il a inconsciemment peur du viol qu’il a enclenché en toute bonne foi et toute audace. Dani, adolescent de moins de 18 ans, drague Julián, un écrivain homosexuel à la quarantaine bien tassée, et lui saute littéralement dessus pour qu’il couche ensemble. D’abord, il lui vole un baiser… ce qui laisse Julián pantois (il noie sa gêne dans un rire nerveux : « Ça te gêne pas d’embrasser un homme ? ») Dani joue alors la carte du naturel forcé (« Pourquoi ça me gênerait ? ») et du mensonge, puisqu’il fait croire que ce n’est pas sa première fois et qu’il a déjà couché avec son meilleur ami Nico, ce qui est pertinemment faux (« Ce n’est pas ma première fois. Oui, je l’ai déjà fait avant. Et le reste aussi. Baiser, faire l’amour… Bon… plus ou moins. »). Dani cherche à masquer sa peur par une audace effrénée, démesurée : il ouvre précipitamment la braguette de Julián et se met torse nu devant lui. Ce dernier essaie d’amortir la précipitation suspecte du jeune « chien fou » (« Dani… Dani… On continue ? T’es sûr ? Tu veux vraiment qu’on continue ? »), et sans pour autant rejeter sa proposition, il fume, met de la musique, part se préparer, afin de rajouter à la baise pédophile une lenteur et un romantisme qui la déréaliseront. Mais au moment où il revient dans le salon, entre-temps, le petit oiseau soi-disant téméraire et effronté s’est envolé…
FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION
PARFOIS RÉALITÉ
La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :
a) La première fois homosexuelle est vécue par beaucoup de personnes homosexuelles comme un traumatisme :
J’entends déjà d’ici certains esprits pessimistes me rétorquer à propos de ce code : « Mais pourquoi inventes-tu un malaise là où il n’y en a pas eu ? Moi, j’ai vécu mon premier baiser comme une libération ! Et le jour de la découverte de mon homosexualité a été, sans déconner, une révélation, le plus beau jour de ma vie ! Pourquoi fouilles-tu la merde et cherches-tu à culpabiliser l’ensemble des personnes homosexuelles en les faisant revenir sur un souvenir intime et lointain qu’elles n’ont plus en mémoire ? » Et je leur répondrai : « Et pourquoi, d’après vous, elles se sont autant empressées de l’oublier ou de ne pas l’analyser, ce souvenir ? »
De même, j’imagine le parallèle immédiat et facile qui peut être fait avec l’hétérosexualité : « Tu sais, ce que tu dis sur la ‘première fois’ homosexuelle, c’est la même chose pour tous les couples hétéros… Ce n’est jamais parfait pour eux non plus du premier coup. On est tous gauches et inexpérimentés quand on débute sexuellement. On ne sort jamais la première fois avec la bonne personne. Et l’acte sexuel humain a toujours une part de violence naturelle, inhérente à la passion, au rythme bestial du coït, aux jeux sexuels, au rapport de pouvoirs entre amants pendant l’accouplement. J’ai l’impression que tu idéalises un peu le tableau des couples hétéros, pour mieux noircir le tableau des homos. Mais c’est noir… ou gris… pour tout le monde ! Il n’y pas d’amour ou de baiser spécifiquement homos : il y a de l’amour et des baisers tout court ! ». Et je pourrais rétorquer à ces défenseurs de la banalité du coït humain : « Mais qui vous dit que la première fois n’est jamais parfaite dans les couples femme-homme, si ce n’est vous, parce que vous ne croyez plus en l’Amour vrai ? Qui vous dit qu’il n’y a pas des couples qui s’attendent vraiment et qui soignent complètement leur première fois, au point de vivre même leurs petits défauts de débutants comme des occasions de rire et de s’aimer davantage ? » Ce n’est pas parce que techniquement ce n’est pas parfait – quand on est novice, on est, c’est vrai, forcément maladroit – que ce n’en est pas moins idéal et génial dès la première fois quand même pour ces deux êtres de sexes différents qui vivent l’émerveillement de la découverte de leurs différences et de leur virginité offerte intacte à la bonne personne qui les a attendus. Même si la première fois homosexuelle n’est pas systématiquement facteur de tristesse et d’horreur, en tout cas, elle n’est pas autant source d’émerveillement, de paix profonde, de patience, de respect, de durée, de joie, de surprise, que la première fois entre deux personnes de sexes différents qui ne se sont pas ruées sur le gâteau de la sexualité et qui ont vraiment pris la peine de ne pas se posséder l’une l’autre dans une fusion fiévreuse et une précipitation angoissée.
Même dans la réalité, j’ai constaté à maintes reprises que la première fois homo-affective/homosexuelle est souvent traumatique (ce n’est pas rien de vivre concrètement l’exclusion de la différence des sexes !). D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si statistiquement le premier rapport homosexuel est vécu beaucoup plus tard que dans les couples femme-homme, comme si le choc était inconsciemment deviné, reporté, craint : « Les personnes qui ont eu un partenaire du même sexe dans les 12 derniers mois rapportent une activité sexuelle plus diversifiée que les autres. Elles ont débuté leur vie sexuelle plus précocement : 17,3 ans ‘versus’ 18,6 ans pour les femmes hétérosexuelles, et 17,1 ans ‘versus’ 17,6 ans pour les hommes hétérosexuels. Leur premier rapport homosexuel a eu lieu à 22,8 ans pour les filles et 18,8 ans pour les garçons. » (Enquête sur la sexualité en France (2008) de Nathalie Bajos et Michel Bozon, p. 251) Le caractère précipité, compulsif, pressé, bâclé, que prend souvent la première expérience homosexuelle ne fait que renforcer le climat de peur qui entoure inconsciemment l’acte homosexuel, ne fait que prouver que celui-ci est né d’une frustration ou même qu’il engendre une frustration).
Beaucoup de psychiatres et de psychologues vous le diront. Il n’est pas anodin de passer à l’acte homosexuel. Quand je m’étais entretenu, en 2012, avec le journaliste Jacques Arènes (qui semblait un peu timoré à l’idée d’envisager, comme moi, un lien entre désir homosexuel et viol), ce dernier n’a pas pu s’empêcher de m’avouer qu’au vue de son accompagnement psychologique auprès de ses patients homosexuels, il constatait à maintes reprises une ambiguïté violente qui se cristallisait autour de l’initiation à la pratique homosexuelle.
Et quand les individus homosexuels posent un regard rétrospectif honnête sur leur dépucelage homosexuel, quand ils s’aventurent à ouvrir le livre de leur honte, on entend beaucoup de remords : « Ça s’est passé mal, très très mal, parce que c’est comme si ça en rajoutait encore, en définitive. Le fait de passer à l’acte, pour moi, faisait que ça rajoutait encore de la complication à mon existence. » (Olivier, 37 ans, parlant de son premier passage à l’acte homosexuel, dans le documentaire « Une Vie ordinaire ou mes questions sur l’homosexualité » (2002) de Serge Moati) ; « Mon premier contact avec un pédé fut un réel moment d’intense stupidité. » (Gaël-Laurent Tilium, Recto/Verso (2007), p. 72) ; « Le premier soir, ça a été presque beurk. La première rencontre ça a été un peu catastrophique. » (Yann parlant de son amant Pierre, dans le documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz) ; « J’avais seize ans. La prof d’italien nous emmenait voir une pièce. Je suis arrivé en retard. Chaillot était fermé. Alors j’ai voulu connaître le sexe. Le sexe était plus fort. Plus fort que la peur. Plus fort que moi. Je suis descendu dans les jardins. J’avais lu dans ‘Le Nouvel Obs‘ que ça draguait. J’ai zoné dans les bosquets, moyennement rassuré. Un mec s’est approché, beaucoup plus vieux que moi, trente ans, moustachu. Il m’a demandé ce que je faisais là. J’ai dit ‘Je drague’. Il a dit ‘Moi aussi’. Je l’ai suivi jusque derrière une espèce de monument grec. On s’est embrassé. J’avais déjà roulé des pelles à deux ou trois filles, mais là c’était différent. Électrique. Après on s’est sucé. Le goût était horrible. J’ai joui, je ne me souviens pas comment. Je ne me permettais pas de faire très attention à ces choses-là à l’époque. Quand je suis rentré à la maison j’étais en sueur, j’avais envie de vomir. » (Guillaume Dustan, Plus fort que moi, 1998) ; « J’y suis allé pour avoir du sexe avec les hommes. C’est la première chose que j’ai faite. Donc ce gars avec qui j’avais chatté un temps sur Internet était de Flint, dans le Michigan. C’est là-bas que j’ai perdu ma virginité. La capitale mondiale des assassinats, c’est de notoriété publique [rires] . Ce n’était pas la destination la plus romantique. […] Ce fut un épisode sans importance. Ça n’a pas été… il n’y a pas eu de feux d’artifice. Juste après, j’ai senti une forte culpabilité et honte. » (Dan, homme homosexuel, dans le documentaire « Desire Of The Everlasting Hills » (2014) de Paul Check) ; « Il est arrivé. Ça n’a pas vraiment bien collé. Il est reparti. Ça n’a pas collé la première fois. » (Pierre racontant sa première rencontre avec Bertrand, dans l’émission Infra-Rouge du 10 mars 2015 intitulée « Couple(s) : La vie conjugale » diffusée sur France 2) ; « Mon ancien camarade de classe me met sous les yeux deux photos de Janson, cinquième et quatrième, toute la classe. […] Moi, mince, l’air silencieux, innocent d’une innocence évidente. Cela m’a ému, car depuis… Et tout à coup, le visage de Durieu que j’avais oublié et qui m’a arraché un cri : un visage d’ange résolu. Silencieux aussi celui-là, on ne le voyait pas, il disparaissait, je ne pouvais pas m’empêcher de ressentir sa beauté comme une brûlure, une brûlure incompréhensible. Un jour, alors que l’heure avait sonné et que la classe était vide, nous nous sommes trouvés seuls l’un devant l’autre, moi sur l’estrade, lui devant vers moi ce visage sérieux qui me hantait, et tout à coup, avec une douceur qui me fait encore battre le cœur, il prit ma main et y posa ses lèvres. Je la lui laissai tant qu’il voulut et, au bout d’un instant, il la laissa tomber lentement, prit sa gibecière et s’en alla. Pas un mot n’avait été dit dont je me souvienne, mais pendant ce court moment il y eut entre nous une sorte d’adoration l’un pour l’autre, muette et déchirante. Ce fut mon tout premier amour, le plus brûlant peut-être, celui qui me ravagea le cœur pour la première fois, et hier je l’ai ressenti de nouveau devant cette image, j’ai eu de nouveau treize ans, en proie à l’atroce amour dont je ne pouvais rien savoir de ce qu’il voulait dire. » (Julien Green, L’Arc-en-ciel, Journal 1981-1984, avril 1981, pp. 23-24) ; etc.
Dans le documentaire « Vivant ! » (2014) de Vincent Boujon, Romain demande à ses amis homos séropos quelle a été leur pire expérience sexuelle. Seul Mateo répond en boutade : « Ma pire expérience sexuelle ? Je sais pas. Y’en a eues tellement ! » Il raconte plus sérieusement qu’il a été violé à l’âge de 15 ans, dans un bar gay, par « un type qui avait mis une saloperie dans son verre ». Il avoue que sur le coup qu’il ne se souvenait plus de rien.
Énormément de personnes homosexuelles nous mettent en garde contre le passage douloureux à l’acte (qu’ils ont vécu ou ont vu vivre), sans pour autant le dénoncer explicitement. « La première fois que nous avons passée ensemble, je n’ai fait que pleurer. Elle était aussi démunie que moi si bien que l’une comme l’autre, en toute bonne foi, nous avons cru nous aimer. » (Paula Dumont en parlant de son couple avec Martine, dans son essai autobiographique La Vie dure : Éducation sentimentale d’une lesbienne (2010), p. 70)
Par exemple, dans le documentaire « Le Bal des chattes sauvages » (2005) de Véronika Minder, l’acte homosexuel n’est pas présenté comme anodin : à la perspective de la rencontre d’amour homosexuelle, les amantes ressentent une profonde et curieuse tristesse. Elles préfèrent appeler cela une « sauvagerie »…
b) Le baiser qui fait pleurer :
Symboliquement, le principal premier passage à l’acte homosexuel est le baiser. Dans le discours de certaines personnes homosexuelles, il est souvent question de l’importance (et des dégâts !) du premier baiser homosexuel : « Dans mon premier film, ‘Crescendo’, on voit un premier baiser, celui que le personnage principal, qui au début du film est hétéro, échange avec un garçon. Comme il n’est pas habitué, il court cracher dans un lavabo. Moi aussi j’ai fait ça la première fois. Mais évidemment, il y prend vite goût… » (le réalisateur Jean-Daniel Cadinot, cité dans la revue Triangul’Ère 4 (2003) de Christophe Gendron, p. 70)
En écoutant certains amis homosexuels me raconter leur initiation homosexuelle en privé, j’ai été frappé de voir qu’elle ressemblait parfois à un viol, bien que cela ne soit même pas conscientisé et identifié comme tel par la victime « consentante ». Parmi eux, quelques-uns ont littéralement fondu en larmes juste après avoir reçu un simple baiser, ou une caresse soi-disant anodine. Je n’invente rien. On me l’a raconté.
Le baiser homosexuel n’est généralement pas donné et reçu en toute liberté. Il est arraché, ou bien apparaît comme une collaboration, un viol : « Une seule pensée traverse alors mon esprit avant de sombrer totalement dans le plaisir indescriptible du premier baiser échangé avec un garçon : comment vais-je réagir en me regardant dans la glace demain matin ? » (Alexandre Delmar, Prélude à une vie heureuse (2004), p. 123)
Par exemple, dans le documentaire « Homos, et alors ? » de Florence d’Arthuy (diffusé dans l’émission Tel Quel, sur la chaîne France 4, le 14 mai 2012), Guillaume, homosexuel, raconte qu’il a éclaté en sanglots devant sa glace après sa première nuit de passage à l’acte homo.
c) L’acte homosexuel rejoint indirectement ou directement le viol :
La première fois homosexuelle est marquée en général par un contexte d’absence de liberté (on appelle cela l’« homosexualité de circonstance » : je parle plus longuement de ce type particulier d’homosexualité dans les codes « Entre-deux-guerres » et « Drogues » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels) : « J’avais bien eu une première expérience après l’armée, mais ça s’était très mal passé. Alors j’ai cru que j’étais hétéro. » (Joaquim cité dans la revue Têtu, n°130, février 2008, p. 102)
Elle n’est pas une expérience plaisante. Elle provoque parfois même un malaise corporel, un dégoût. « Je n’aimais pas Djaghilew et pourtant, je vivais avec lui. Je l’ai haï du premier jour que je l’ai connu. […] Tout de suite, je lui permis de faire l’amour avec moi. Je tremblais comme une feuille et je m’efforçais de dissimuler la haine qu’il m’inspirait… » (le danseur Waslaw Nijinksy à propos de son amant Djaghilew, dans le Journal de Nijinsky)
Dans son autobiographie Mon théâtre à corps perdu (2006), le dramaturge Denis Daniel raconte que les démarrages de ses rapports homosexuels provoquèrent chez lui d’« inexplicables malaises » (p. 113).
Salvador Dalí raconte que la « première fois » (pénétration anale) avec le poète espagnol Federico García Lorca a été très mal vécue par le second (Alberto Mira, De Sodoma A Chueca (2004), p. 235).
Dans son autobiographie Une Mélancolie arabe (2008), Abdellah Taïa décrit son tout premier contact avec la sexualité : à 13 ans, il voit un voisin des impasses du Bloc 14 se masturber. « C’était l’été, en plein été, août, le 7 août. […] Abdellah, fils de Ssi Aziz, se masturbait. » (p. 11) Plus tard, il vit sa première expérience sexuelle avec un cousin plus âgé que lui, Chouaïb, qui le viole… ce qui n’empêche pas l’écrivain de penser qu’il a finalement adoré cela : « Chouaïb était maintenant nu, entièrement nu. […] C’est à ce moment-là que j’ai réalisé ce qui allait physiquement m’arriver, se produire en moi. Exploser en moi. Pour la première fois. J’ai fermé mes fesses. J’ai fermé mes yeux. Avec force. » (p. 22)
La première fois homosexuelle est aussi en lien avec la violence des rapports sociaux et commerciaux au sein de la communauté homosexuelle, avec l’inhumanité des sites de rencontres Internet et des lieux de drague (qui offrent le premier contact concret avec une homosexualité pratiquée). Par exemple, dans son autobiographie Libre : De la honte à la lumière (2011), Jean-Michel Dunand raconte que sa première fois homosexuelle s’est passée dans un contexte glauque : un homme plus âgé que lui l’a tripoté dans des toilettes publiques.
La première fois homosexuelle est associée également à la mort, à l’amour impossible avec un être absent. « C’est l’amour le plus douloureux ! C’est la première fois que mon cœur s’est ouvert à l’amour, l’amour vrai, peut-être la seule fois de ma vie. » (Emilio Prados cité dans l’essai De Sodoma A Chueca (2004) d’Alberto Mira, p. 233)
Dans son autobiographie Le Flamant noir (2004), Berthrand Nguyen Matoko raconte avec des mots précis « le traumatisme de sa première expérience homosexuelle » (p. 99) : « À peine fut-il sur moi, que je versais des larmes de désolation. L’instant de sodomie, rigoureusement chargé, vit tout mon être disparaître dans les profondeurs du mal pour ne devenir qu’une empreinte. Les filles pensais-je alors, subissent-elles le même sort ? J’avais terriblement mal et je hurlais que jamais plus je ne résisterais, mais qu’il fallait que cela cesse. Torture terrifiante qui m’incendiait de partout, son sexe sans pitié qui me ravageait par des tamponnements secs et violents. » (idem, p. 68) ; « Je sentais chaque centimètre de mon corps me distendre et m’étirer. Indéfiniment. De me sentir possédé, je me mis à pleurer. » (idem, p. 69) ; « ‘Tu m’appartiens désormais, me dit-il’. C’était des mots d’homme, des mots possessionnels et j’en avais la cognition. À seize ans, je n’étais plus le même. J’avais soudainement comme une impression de vide, ce vide qui semblait être ma mort et mon humiliation. […] Qu’étais-je devenu, pour un jour, une nuit, toute une vie ? » (idem, p. 70) ; « Rien ne m’avait préparé à l’extraordinaire sensation que j’avais éprouvée à contempler ma propre sexualité de l’extérieur. J’estimais au fond de moi, qu’un passionnant épisode de ma vie ratait son départ. » (idem, p. 74)
d) La ré-écriture enchanteresse et volontariste de la « première fois » homosexuelle :
Pourtant, l’initiation homosexuelle n’apparaît pas tout de suite comme violente aux yeux des personnes homosexuelles pratiquantes, car sa brutalité est amortie par les intentions amoureuses, et par une auto-persuasion individuelle (matinée d’un « militantisme de l’optimisme ») qui stipule que « le mal était malgré tout nécessaire et en valait la chandelle ».
Parfois, le traumatisme de la « première fois » est interprété sous forme de conte de fée révolutionnaire, pour atténuer le vrai choc. « J’ai perdu ma virginité avec bonheur. Ses regards d’admiration et d’incrédulité ont suffi à faire compenser toutes mes frustrations. » (Kim Pérez Fernández-Figares, homme transsexuel cité dans l’essai El Látigo Y La Pluma (2004) de Fernando Olmeda, p. 254) ; « En 2005, Christine Bakke fait pour la première fois l’amour avec une femme : ‘C’était sa première fois à elle aussi, ce que j’ai trouvé très beau. Il n’y avait aucune attente, c’état naturel, ça coulait de source.’ » (Christine Bakke, ex-ex-lesbienne, interviewée à Denver, dans le Colorado, fin 2018, dans l’essai Dieu est amour (2019) de Jean-Loup Adénor et Timothée de Rauglaudre, Éd. Flammarion, Paris, p. 84) ; etc.
On comprend que si la « première fois homosexuelle » est parfois décrite en des termes positifs, ce n’est pas tant parce que les faits sont regardés tels qu’ils sont, mais bien parce qu’ils sont l’objet d’une ré-écriture enchanteresse postérieure à l’acte homo.
Beaucoup de personnes homosexuelles, dans leurs élans bobos, fantasment sur le concept de « première fois ». Même si dans les faits la « première fois » et la virginité sont rendues bien loin, certaines s’évertuent en amour à rejouer cycliquement la comédie de la « première fois ». Par exemple, on les entend dire toutes les trois semaines qu’elles sont tombées folles amoureuses, que « cette fois, elles ont vraiment rencontré LA bonne personne », que « c’est complètement différent de tout ce qu’elles ont connu auparavant »… Face à l’amant, elles servent le même discours sincère de la renaissance : « C’est la première fois que ça m’arrive ; t’es la première personne avec qui je fais ça ; Tout ça, je ne l’ai jamais dit à personne d’autre ». Mais concrètement, dans leur vie, la réalité de la « première fois » est beaucoup plus liée à celle de la rupture, de la bonne intention non-actée, ou de la pulsion égoïste romantisée, qu’à la véritable virginité, une virginité reçue et non pas créée par nos propres forces/perceptions humaines.
L’esprit bobo, vénérant l’instant au détriment de la durée, a un rapport idolâtre aux premières fois : à la fois il les idéalise, et il les méprise comme des rêves de midinettes. « J’essaie de me rappeler. Le début. Ce qui m’a attiré. La nuit. Une boîte de nuit où je me rendais pour la première fois de ma vie. La foule branchée que je n’aimais pas. […] Il dansait. Seul. […] Plus tard, audacieux, je lui ai parlé, je l’ai complimenté. Il a levé les yeux, a souri et moi je suis tombé amoureux, immédiatement, instantanément. On appelle ça le coup de foudre. Moi, j’appelle ça la reconnaissance mutuelle. […] Je ne l’ai pas quitté. Il ne m’a pas quitté. On a dansé ensemble. Une fois. Un slow. ‘Pull marine’. Isabelle Adjani. » (Abdellah Taïa parlant de sa première rencontre avec Slimane, celui qui sera son amant pendant quelques années, dans son autobiographie Une Mélancolie arabe (2008), p. 108) ; « Comment une vie bascule à travers une main qui s’aventure… Je suis devenue une vraie femme. » (Thérèse par rapport à sa toute première fois lesbienne, où une ancienne camarade de classe dévergondée l’a dépucelée, dans le documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz) ; etc.
Une autre parade trouvée par les personnes homosexuelles pour noyer leur tristesse d’être des individus homos pratiquants régulièrement débutants, c’est la focalisation sur le coming out, sur l’exhibition de soi : elles vont régulièrement mettre en scène la première fois qu’elles ont annoncé leur homosexualité, pour ne pas avoir à révéler que la véritable difficulté n’a pas été d’annoncer son désir homosexuel, mais bien de l’avoir actualisé/concrétisé avec un copain !
Et une grande partie de la société participe de ce déni de violence de la première fois homosexuelle qu’est le coming out. Le coming out est une fausse première fois qui cache la vraie, le train qui en dissimule un autre. C’est pour cette raison, à mon avis, que les premières fois homosexuelles sont guettées autant que craintes par nos contemporains (excitation voyeuriste et misérabiliste sur le coming out, suspens autour du baiser homo dans les séries télévisées, curiosité malsaine par rapport à l’acte génital, attente de conversion inexpliquée de l’hétérosexualité à l’homosexualité, gros plan scabreux sur la violence soi-disant « homophobe », etc.).
Sinon, bien évidemment, l’astuce la plus efficace que se sont trouvées beaucoup de personnes homosexuelles pour nier la déception/violence de leur premier passage à l’acte homosexuel, c’est la victimisation, et son corollaire : l’extériorisation du viol sur un ennemi tout-puissant (qui portera tantôt le nom d’« homophobie intériorisée », de « culpabilité », de « regard culturel »).
En général, le fameux « regard social » – qui bien souvent et l’autre nom d’un regard sur soi et sur sa propre situation qu’on n’ose pas assumer ni écouter – a bon dos… « La première fois, c’était pas très bien. Parce que j’avais peur du regard des gens. » (Amélie, 28 ans, à qui on demande comment était son premier baiser lesbien, dans le documentaire « Des Filles entre elles » (2010) de Jeanne Broyon et Anne Gintzburger)
Certains individus homosexuels vont inverser les choses, en disant que l’acte homosexuel est objectivement bon, mais qu’il n’est rendu mauvais que par une lecture postérieure et subjective à l’aune des préjugés éducationnels, religieux, et sociaux sans fondements qu’on nous aurait mis dans la tête. Je ne suis bien sûr pas d’accord avec cette interprétation réductrice. Notre regard sur l’acte homosexuel vient de l’acte en lui-même, de la perception de celui qui le vit, et de la société : les trois ensemble. L’apparente valeur positive de l’acte homosexuel tient à mon sens davantage de la décharge émotionnelle/nerveuse qu’il a permise dans l’instant, du défouloir post-dépression, du petit soulagement vécu dans une frustration affective globale, du contentement rassurant et ponctuel dans les câlins, que de l’acte en lui-même. « Il m’a invité à le suivre dans une cabine et j’ai eu ma première expérience sexuelle adulte. Ce n’est pas ainsi que j’avais imaginé cette première fois, mais j’avais envie d’y aller à son contact, besoin de me perdre dans un corps-à-corps. Toute cette frustration accumulée me pesait, j’avais une folle envie de me défouler, je me suis donc lancé. Sur le moment, cette intense décharge d’adrénaline n’a pas été désagréable. C’est seulement après que je me suis senti mal à l’aise. J’avais un goût amer à la bouche, je me sentais sale. » (Brahim Naït-Balk, Un Homo dans la cité (2009), pp. 44-45) Je crois en effet que l’acte homosexuel (contrairement à la découverte initiale de son désir homosexuel – qui n’est pas triste –, ou bien du bon déroulement de certains coming out) est traumatique en lui-même, pas dans le sens commun, brutal, et évident du mot « viol », mais dans le sens de « ravissement » : on ne sait pas quoi en penser, de ce cette première fois homosexuelle ; elle n’est ni assez grande pour remplir de joie, ni assez douce pour être banale. « Au début, j’étais à la fois surpris et gêné. Mais, dès que j’ai su répondre à ses avances, nous avons multiplié les occasions de nous isoler et, à mon grand bonheur, nos jeux sexuels se sont poursuivis pendant plusieurs mois. Mais, subitement, j’allais découvrir le chagrin de la perte, car il s’est détourné de moi pour une fille. Il m’a abandonné. Il avait tourné la page. J’avais été utilisé et jeté, sans même un mot d’explication. Je m’en suis voulu d’avoir répondu à ses avances. Je n’étais pas capable de lui faire des reproches, puisque tout s’était passé dans le non-dit. J’ai ravalé mon humiliation ; ce ne serait pas la dernière fois. » (idem, pp. 20-21)
e) Le premier viol homosexuel vient de l’imaginaire et de l’éloignement du Réel :
La violence de l’acte homosexuel n’est pas prioritairement une question de pénétration génitale ou de gestes brusques (qui pourraient être vécus dans le cadre très minoritaire de l’univers SM par exemple). Elle se situe avant tout dans la violence d’une sincérité, sincérité exposée comme vraie et aimante, alors qu’elle n’équivaut pas à la Vérité ni à l’Amour (on peut vouloir le bien sans le faire ! on peut être franc, consentant, sincère, intentionnel, sans être vrai !)
« C’était la première fois qu’Ednar faisait l’amour ; enfin un ‘câlin’. Quoi de plus naturel pour un jeune homme de seize ans, si le prétendant n’était pas un copain de son âge rencontré par hasard un soir sur la plage ! Mais voilà, une fois ce premier ‘rapport sexuel’ consommé, il lui procura plus de dégoût que de plaisir. » (Jean-Claude Janvier-Modeste dans son autobiographie romancée Un Fils différent (2011), p. 19) ; « Avec ma première petite amie, je n’ai pas eu de relation sexuelle. C’était un amour platonique. Elle disait qu’on faisait quelque chose de très laid. » (Mària Takàcs, la réalisatrice hongroise lesbienne, dans le documentaire « Homo et alors ?!? » (2015) de Peter Gehardt) ; etc.
Le meilleur exemple de « premières fois homosexuelles » ratées, d’actualisations violentes de la sincérité, ce sont déjà les coming out : « Depuis l’âge de 16 ans, je savais que j’étais vraiment attirée par les femmes, je le savais, je le sentais ce truc-là. C’était assez paradoxal, parce que la première connaissance que j’ai eue de l’homosexualité, j’étais plutôt prête à la rejeter, à l’éviter. » (Laura, une femme lesbienne de 49 ans, dans l’essai Se dire lesbienne : Vie de couple, sexualité, représentation de soi (2010) de Natacha Chetcuti, p. 52) ; « Moi je me dis, je viens d’un milieu plutôt intello, alternatif, où a priori, c’était possible d’assumer ça plutôt facilement, et en fait je me suis grave pris la tête pendant dix ans et je ne sais pas pourquoi. » (Louise, femme lesbienne de 31 ans, idem, p. 54)
La violence de la première fois homosexuelle, c’est aussi celle du regard libidineux de notre semblable sexué, ou bien celle d’un simple « Je t’aime », tellement inapproprié au Réel et à la réalité de la relation qu’il a l’effet d’une gifle. Par exemple, lors de l’émission Dans les yeux d’Olivier d’Olivier Delacroix et Mathieu Duboscq, diffusée sur la chaîne France 2 (spéciale « Les Femmes entre elles », le 12 avril 2011), quand Tina a annoncé à sa copine Stéphanie, 24 ans (et de vingt ans sa cadette !) qu’elle l’aime et qu’elle ne peut pas vivre sans elle, celle-ci avoue « s’être effondrée » La déclaration d’amour homosexuel apparaît comme un arrivisme suspect, flattant la défaillance humaine des deux amants qui s’adonnent (de manière consentie mais si peu libre !) à leur désir homosexuel.
L’acte homosexuel a le pouvoir d’anesthésier la conscience de mal faire. Il rend flou la frontière entre le bien et le mal, entre réalité et fantasme, si bien que les personnes homosexuelles qui se décident à croire en la beauté et en la réalité de l’identité homosexuelle ou de l’amour homosexuel vivent une forme de division interne indéfinissable, de captation psychique, d’hypnose, de rêve éveillé digne des meilleurs films de science-fiction (quand l’être humain s’extériorise trop), entre ce qu’elles ressentent et ce qu’elles vivent concrètement.
Par exemple, lors du talk-show Ça se discute (diffusé sur la chaîne France 2, le 18 février 2004), une intervenante lesbienne, Corinne, jadis mariée à un homme qui s’appelle Matthieu, décrit sa « première fois » lesbienne. Pendant qu’elle s’exprime, elle mime avec les mains le mouvement de projection violente vers l’avant qui a immédiatement précédé le baiser homosexuel : « Nous nous sommes embrassées, et j’ai su que ma vie avait basculé. J’ai été projetée d’un monde à l’autre. J’ai été poussée et je suis rentrée au travail avec elle, et tout ce que je savais dire sur le trajet – c’est elle qui me l’a dit plus tard parce que moi, j’étais un peu partie ailleurs – c’était ‘putain merde, fait chier, putain merde, fait chier, putain merde, fait chier’ parce que j’ai tout de suite su en 3 secondes que mon mariage était fini et qu’en fait, le ‘putain merde, fait chier’ c’était ‘putain merde, ça y est, ce que tu attendais depuis X années vient enfin d’arriver’. Et 15 jours plus tard, j’annonçais à Matthieu que je le quittais. »
Les personnes homosexuelles pratiquantes semblent nous dire que la beauté de l’acte homosexuel réside prioritairement dans sa non-actualisation ; dès que celui-ci devient concret, il perd de sa splendeur. Il n’a que la magie de l’irréel.
Pour ma part, je me souviens de ma première fois homosexuelle. Je l’ai vécue tard. À 29 ans. En 2009. À Paris. Dans un contexte relativement respectueux, sincère, consenti, pas du tout glauque, mais malgré tout précipité et peu libre. Je n’en garde pas un souvenir cauchemardesque, au contraire. C’était juste un moment surréaliste, où j’étais dans un état second. Je n’aimais pas cet homme (un peu plus âgé que moi et qui m’a servi de cobaye, au fond). Quand il m’a serré dans ses bras puis embrassé sur la bouche, je tremblais de tout mon corps (alors que je n’avais pas froid). J’étais tétanisé. Il a bien fallu quinze minutes avant que je me détende. Pourtant, il n’a pas été brusque avec moi et m’offrait des gestes qui me faisaient plaisir, qui étaient censés me rassurer. Cet homme a été, en apparences, très respectueux avec moi (même s’il me traitait comme un bibelot). Mais j’étais transi de peur et de culpabilité parce que je sentais que je vivais la médiocrité que j’avais devinée depuis mes 20 ans (sans que personne ne m’ait dit que « c’était mal »). Parce que je sentais que le fantasme devenait réalité et que malgré tout, il ne me comblait pas. Je voyais déjà que ça n’allait pas. Je tremblais comme une feuille. Je n’étais plus moi-même. Mais sur le coup, j’ai accepté comme logiques cette transformation, mon laisser-faire, un abandon à la sensualité et à la facilité. Je crois que pour ce premier contact avec la sexualité homosexuelle, j’ai été violenté et j’ai violenté. Mais comme mon partenaire et moi étions d’accord pour le faire, nous nous sommes forcés à amortir mentalement le choc. Nous n’avons même pas couché ensemble. Nous nous sommes juste enlacés et embrassés. La violence dont je parle n’est effectivement pas tant dans la brutalité des gestes – car les gestes posés étaient doux, presque chastes, d’une naïveté adolescente – que dans l’absence de liberté, l’égoïsme mutuel, l’éloignement du Réel, le manque de désir et de joie. C’est drôle : alors que je n’étais pas du tout dans l’état d’esprit de trouver ce que j’allais vivre « diabolique » ou au contraire totalement idyllique, alors même que mon premier amant n’avait absolument pas connaissance de ce que j’avais déjà écrit des années auparavant sur le passage à l’acte homosexuel (dans mon livre qui venait d’être publié), tout s’est pourtant passé exactement comme je l’avais écrit, à la virgule près. J’ai en effet vécu, pendant ma première fois homosexuelle, un « truc » surjoué, narcissique, immature, hallucinant (dans le sens de « ravissement » peu choquant), assez banal, désordonné, insensé, sans joie profonde. Tout sauf exceptionnel, en somme. Comme quoi, on n’a pas besoin d’en passer obligatoirement par l’expérience pour voir juste sur l’acte homosexuel et juger de son irréalité/sa violence consentie. Et de cela, je n’en ai jamais douté.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.