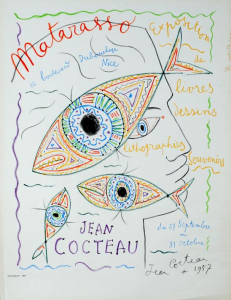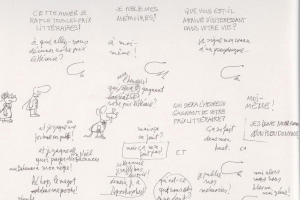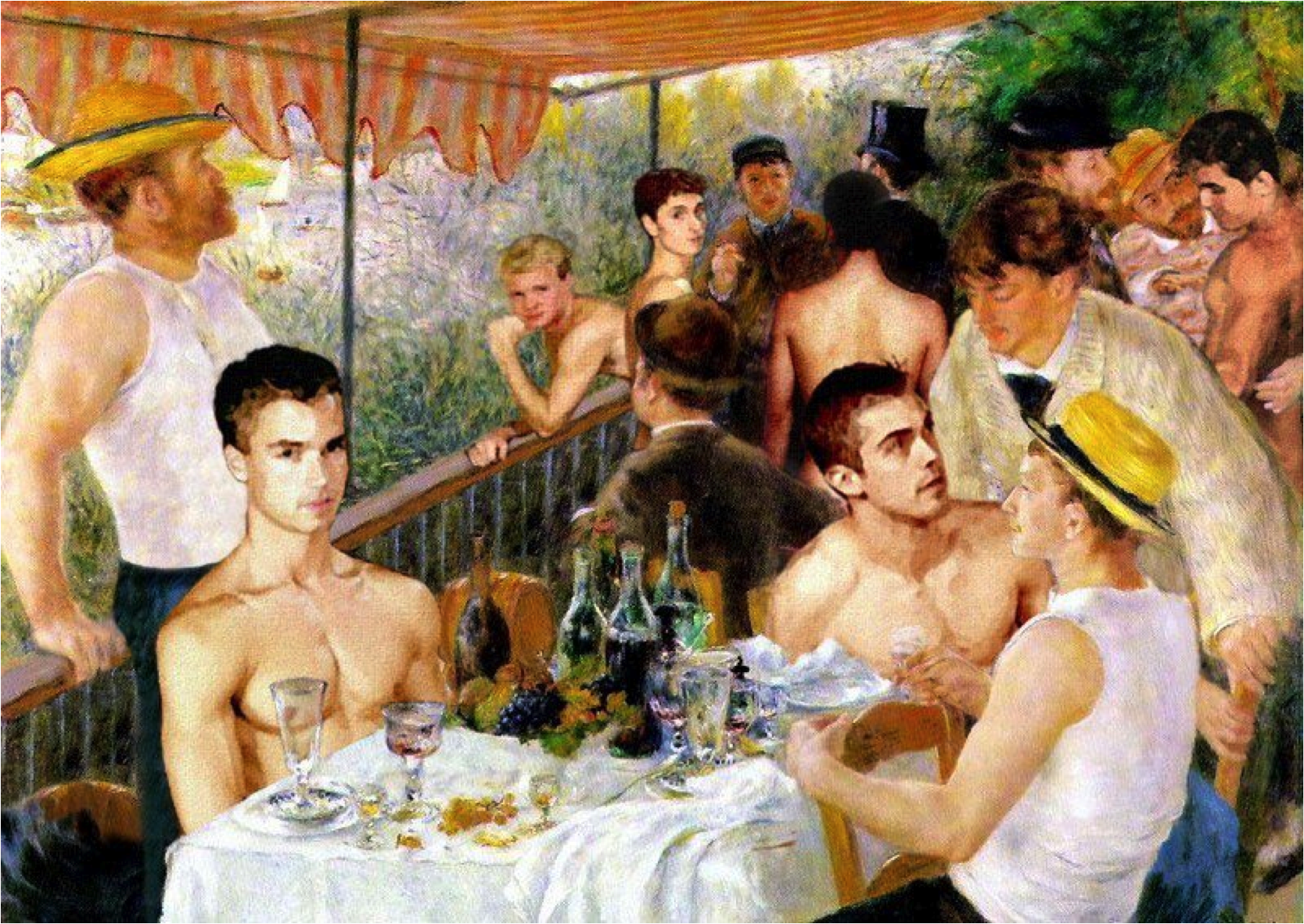Artiste raté
NOTICE EXPLICATIVE
« Les homosexuels sont tous des artistes car ils sont plus sensibles et esthètes que les autres. » Qu’est-ce que c’est que cette blague ? Cela en étonnera plus d’un, mais je le dis quand même : il y a beaucoup de faux artistes, de créateurs sans talent, de rois du kitsch, de chanteurs de pacotille, parmi nous, gens « homosensibles » qui avons pourtant investi en grand nombre le monde des Arts comme si c’était « notre » fief privé. D’ailleurs, il est stupéfiant de voir en masse dans les fictions homosexuelles la figure de l’artiste homosexuel raté. Surtout quand on sait que cela ne correspond pas du tout au cliché de l’Artiste qu’on prête à tout individu homosexuel, ou presque, qui aurait, depuis son plus jeune âge, une prédisposition artistique « naturelle », une sensibilité et une créativité hors du commun… En réalité, nous ne devrions pas être étonnés : celui qui se prend pour Dieu – alors qu’il ne l’est pas – finit toujours par mal agir et par afficher la médiocrité de son orgueil en créant du laid. Et à l’évidence, l’homosexualité est une crise d’orgueil de l’Homme qui n’a pas reconnu ses limites, qui n’a pas regardé son désir homo en face, et qui veut être Dieu à la place de Dieu (cf. le code « Se prendre pour Dieu » dans le Dictionnaire des Codes homosexuels). Alors bien sûr, on me dira que c’est dans la nature-même de l’artiste d’être raté : le ratage n’a rien de typiquement homosexuel, il est humain, et il serait le moteur principal de toute Inspiration artistique ! Et puis le vrai créateur a toujours connu, même dans son parcours artistique brillant, des hauts et des bas, soit pour atteindre le succès (parfois post mortem), soit pour le conserver. MAIS je persiste en disant qu’un Homme est d’autant plus artiste qu’il intègre l’échec (chose que font rarement les personnes homosexuelles), qu’il crée du beau et du sensé (chose que peu de créateurs homos font), qu’il a affronté ses démons (chose que ne fait pas la grande majorité des personnes homosexuelles qui banalisent leur désir homo et qui veulent défendre l’amour homo), et qu’il n’oublie pas de toujours se reconnaître créature face au Créateur (qu’est Dieu) malgré l’illusion de toute-puissance et d’auto-création que lui confère son acte artistique (mégalomanie à laquelle peu de créateurs homosexuels échappent).
Qu’on m’entende : je ne dis pas que l’homosexualité est un critère de nullité artistique. J’écris bien qu’il y a des grands artistes homosexuels. Mais ceux-là n’ont ni pratiqué ni justifié leur homosexualité. Il faut arrêter de mentir aux personnes homosexuelles et arrêter de les anesthésier par la flatterie d’une homophobie positive.
N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Faux révolutionnaires », « Dilettante homo », « Bobo », « Faux intellectuels », « Se prendre pour Dieu », « Bovarysme », « Patrons de l’audiovisuel », « Déni », « Homosexualité, vérité télévisuelle ? », « Promotion ‘Canapédé’ », « Peinture », « Homosexualité noire et glorieuse », « Planeur », « Fantasmagorie de l’épouvante », « Amant narcissique », « Clown blanc et masques », à la partie « Divin Artiste » du code « Pygmalion », et à la partie « Kitsch » du code « Fan de feuilletons », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.
1 – PETIT « CONDENSÉ »
Je préfère vous prévenir tout de suite. Ce code que vous allez lire, et les constats qu’il me fait faire, peuvent paraître cruels de l’extérieur, surtout à une époque où le relativisme est roi, où on nous dit que l’art, les goûts et les couleurs ne se discutent jamais et sont sacrés, où on fait croire à la masse que le statut d’artiste appartient à tout le monde (« Réveillez l’artiste qui est en vous ! Vous avez tous un destin de star ! »). Cela peut paraître aussi complètement caricatural, généraliste, et homophobe de faire un jugement de valeurs sur le talent d’une communauté entière sur la seule base d’une orientation sexuelle. Je vous rassure tout de suite : je ne dis jamais que le désir homosexuel fait de mauvais artistes, ni qu’il n’y a aucun vrai artiste qui soit homosexuel (mais pour qu’il soit bon, en revanche, il faut à mon avis qu’il ait fait un sacré travail de réflexion sur le désir homo… et là, on est loin du compte et c’est en effet très rare !) ! L’unique chose que je tente de faire, c’est d’indiquer une tendance au manque de créativité que le désir homosexuel impulse, tendance qui ne doit en aucun cas être transformée en généralité ou en espèce humaine clairement identifiée. Je sais que la nuance entre « tendance » et « généralité », entre « désir » et « personne », entre « coïncidence » et « cause », est tenue et mal comprise par notre société… mais elle est capitale, et je me battrai pour l’expliquer.
La figure de l’artiste raté et méprisé, revenant fréquemment dans les films et les romans homo-érotiques, ressemble à ce que les personnes homosexuelles peuvent être parfois. En musique, pour commencer, beaucoup d’individus homosexuels passent maîtres dans les arrangements musicaux de mauvaise qualité, les paroles insensées, et leur manque de voix (la musique disco est d’ailleurs associée directement aux premiers mouvements homosexuels). Ils qualifient eux-mêmes leur musique de « commerciale » – ou d’« anti-commerciale », ce qui revient finalement au même (la chanson « On est tous des imbéciles » de Mylène Farmer en fournit un parfait exemple). Au cinéma et au théâtre, nous les retrouvons en masse dans les sous-genres : péplum, porno, épouvante, comédie musicale, parodie, music-hall, ou mélo. Ils tournent souvent ce qu’on pourrait appeler des « films carte postale » à la trame narrative très légère, n’ayant pour arguments principaux que l’auto-mise en scène et la nostalgie pop. Au niveau littéraire, ils ne font guère mieux : les auteurs homosexuels sont souvent les écrivains des genres bâtards du monde des Lettres : romans à l’eau de rose, autobiographie pornographique, bande dessinée, science fiction, poésie, etc. Dans les années 1960, ils ont même été les vilains petits canards des surréalistes… Qu’on ne s’étonne pas de les voir figurer aujourd’hui parmi les écrivains les plus cités de La Littérature sans estomac (2002) de Pierre Jourde. Les membres du « milieu homosexuel » ne s’y sont pas trompés : peu s’intéressent à la production littéraire « communautaire ». Et pour cause ! Il n’y a pas grand-chose à en tirer.
Les créations d’un certain nombre d’artistes homosexuels sont à l’image de la grande machine capitaliste : un immense travail à la chaîne qui place la quantité et le profit avant la qualité. « Je suis une machine » proclamera avec fierté Andy Warhol, enfermé dans sa Factory. L’alliance de l’art homosexuel avec le marketing est particulièrement bien illustrée par le mouvement Pop Art, apparu aux États-Unis en 1964. Certains artistes homosexuels transforment l’art en marché juteux sans être véritablement inventifs, et se cachent derrière l’excuse de l’excentricité humoristique ou du militantisme pour justifier leur business. C’est ce qui arrive par exemple à Pierre et Gilles, à Andy Warhol (je vous renvoie à l’article « Un Échantillon de bêtise moderne : la fortune critique d’Andy Warhol » de Jean-Philippe Domecq, dans la revue Esprit, L’Art aujourd’hui, n°173, Paris, juillet-août 1991), à Salvador Dalí (André Breton l’avait surnommé, non sans raison, par l’anagramme de son nom : « Avida Dollars »… et le tableau Dollar Sign (1981) d’Andy Warhol va dans le même sens), à Keith Haring, à Mylène Farmer, à Jean Cocteau, etc., particulièrement prolifiques artistiquement, mais peu ingénieux quand leurs désirs de surface se sont davantage exprimés que leurs désirs profonds.
Les œuvres artistiques homosexuelles prennent souvent la forme d’un bric-à-brac désordonné pour prouver que la transmission et la création sont davantage possibles dans la destruction ou le merdique que dans le beau et le constructif. Nous identifions dans leurs compositions littéraires le baratin surréaliste obéissant au procédé du flux de la conscience soi-disant « spontané ». À maintes reprises, les poètes homosexuels rallongent la sauce, volontairement, et surtout involontairement, un peu comme les chorales médiocres qui, pour se donner l’illusion qu’elles chantent juste, ralentissent les chants, soit pour masquer leur faiblesse vocale, soit pour s’écouter narcissiquement chanter (la note est étirée jusqu’à l’asphyxie).
Baignée à l’excès dans l’idéologique (en l’occurrence l’anti-fascisme moralisant), leur production artistique se politise/poétise bien souvent à l’excès. De nombreux artistes gays et lesbiennes imposent « une sorte de dadaïsme homosexuel psychédélique, une idéologie de la dérision, violemment antiautoritaire » (Hélène Hazera, « Gazolines », dans le Dictionnaire des Cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, p. 213), et remettent au goût du jour tout ce qui serait soi-disant attaqué par le conformisme. Mais comme le conformisme en question est souvent le fruit de leurs propres fantasmes, ils finissent par être conformistes dans l’anti-conformisme, en croyant faire ainsi œuvre de sauvetage héroïque de la merde flottant sur l’océan artistique. En énonçant que l’art n’a pas de règles et qu’il doit être un espace de liberté totale, ils formulent implicitement d’autres poncifs encore plus rigides que ceux qu’énonceraient le classicisme tant redouté : l’obligation du scandaleux, du frivole, de « l’effet schizo », du fragmentaire, de l’insolite, de la neutralité, du doute, de l’émotionnel, du pluralisme, de la prolifération, de l’opposition, de la rupture avec les techniques dites « traditionnelles », de la surcharge (pour masquer le manque de contenu) ou du minimalisme (pour mimer le contenu), de la sincérité, de l’exhibition (au moins un acteur à poil par pièce : c’est le quota), de l’originalité « conceptuelle », du loufoque, du torturé, du laid, de l’insensé, de l’autoparodie, de la caricature, du nihilisme, de la bêtise, du paradoxe, de l’ambiguïté, bref, l’obligation du faire agressivement/légèrement authentique pour se dispenser de l’être.
Non pas que les genres pornographico-autobiographiques, scatologiques, gore, camp, parodiques, sentimentalistes, journalistiques, etc., soient en eux-mêmes condamnables. Aucun style artistique n’est mauvais en soi. Seulement, c’est la suffisance et l’impression de contenu que leur utilisation systématique donne à beaucoup de créateurs homosexuels qui prêtent à sourire. Le « sans concessions », l’opposition, et le scandale n’ont jamais été à eux seuls des garanties de qualité, ne libèrent pas automatiquement les esprits, ne délivrent pas plus de sens et ne touchent pas plus au vrai qu’une création qui montre moins tout en suggérant plus, qui défend un message intelligible, plein d’Espérance, et assumé.
C’est le fait qu’ils refassent souvent du même « parce que ça a marché/choqué une fois », que ça a rapporté des sous, et que ça a parfait leur image de marque d’artistes anti-normes, qui rend leurs œuvres si médiocres. Les meilleurs ennemis de l’art sont bien toujours les mêmes : le goût du paraître, l’attachement à l’argent (y compris en se focalisant sur les « gens de peu »), le fuite du risque, une vision manichéenne du monde, l’anti-conformisme de principe, le refus de tendre à la Réalité universelle, l’absence de prétention à la perfection et à la Vérité. « Entre eux et moi, l’argent s’imposait, c’est vrai. […]. Comme si la culture ou l’art se limitait à cela. » (Berthrand Nguyen Matoko parlant du « milieu homosexuel » qu’il fréquente assidument, dans son autobiographie Le Flamant noir (2004), p. 122)
Chez beaucoup d’artistes homosexuels, l’invocation du style est un prétexte pour ne pas en user, et évacuer ainsi le sens des œuvres. Leur passion du détail les entraîne dans le sempiternel verbiage autour de leurs textes pour dissimuler qu’ils n’ont rien à en dire. En plaçant le style avant le contenu, par un travail mythique de transformation « du sens en forme » (Roland Barthes, Mythologies (1957), p. 217), ils focalisent paradoxalement sur le fond au détriment de la forme… parce qu’implicitement, ils veulent signifier que le fond n’existe pas : n’oubliez pas que la majorité d’entre eux voient la Réalité comme un miroir sans fond et qu’ils cherchent pourtant à se convaincre de sa réelle profondeur. Ils se persuadent que la superficialité de leurs œuvres artistiques a quand même son utilité parce qu’elle « questionnerait l’art » : Peut-on tout faire d’un point de vue artistique ? À partir de quand est-il possible de parler d’œuvre d’art ? L’art a-t-il un sens ? Qu’est-ce que l’art finalement ? etc. Je ne vous cache pas que nous aurions très bien pu nous poser toutes ces questions avec des créations de meilleure qualité. Mais eux se plaisent à croire que ce sont leurs œuvres « génialement merdiques » qui amorcent ce débat, et que sans elles, nous n’aurions pas poussé aussi loin la réflexion. Comme ils n’en retirent en général qu’une pensée évasive sur le sens de l’art, ils finissent, après être pris de court, par se tourner vers leur public pour lui demander (en faisant mine de ne pas s’y intéresser, ou pour le responsabiliser démagogiquement : politique populiste et « participative » oblige…) la signification de ce qu’ils ont réalisé. « Ce sont les regardeurs qui font le tableau » assure Marcel Duchamp. Cela donne généralement une mise en scène assez pathétique de l’auto-questionnement de l’intellectuel qui prétend en connaître autant (sinon moins) que son public, autrement dit de « l’artiste-qui-a-honte-de-se-dire-artiste ». C’est pourquoi la majorité des spécialistes de la réflexion sur le camp (Susan Sontag en tête) affirment que dans quasiment toutes les œuvres homosexuelles, « l’accent est mis dans la réception » (cf. l’article « Andy Warhol » d’Élisabeth Lebovici, dans le Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, p. 496). Généralement, un artiste homosexuel qui parvient au succès le doit davantage à la médiatisation autour de sa personnalité qu’à sa production. Par exemple, lors de sa conférence « Pierre Loti, l’Homme aux deux visages » à Savigny-sur-Orge, le 15 février 2007, le chercheur Georges Poisson explique que « Pierre Loti a été sauvé par sa personnalité plus que par son œuvre. »
Mais le grand public ne se laisse pas longtemps aveugler : il trouve plus intéressantes les réflexions suscitées par la critique des œuvres des artistes homosexuels que leurs œuvres en elles-mêmes. Le Saint-Genet (1952) de Jean-Paul Sartre l’illustre parfaitement puisque ce qui devait initialement n’être qu’une préface aux Œuvres complètes de Jean Genet a fini par dépasser l’œuvre maîtresse et par faire connaître l’auteur du Journal du voleur.
Je pense au final que les créations artistiques homosexuelles ne remportent pas un franc succès par leur manque d’idéal et d’Espérance, par la pauvreté de leur message, parce qu’elles ne se tournent pas assez vers l’universel incarné – Néstor Perlongher, par exemple, affirme que « la poésie n’est pas communication » et que « le poète doit faire des vers qui ne se comprennent pas » (Néstor Perlongher, « Poesía Y Éxtasis », dans Prosa Plebeya (1990), p. 149) –, parce qu’elles n’ont pas abordé la souffrance de manière dépassée et un minimum comprise. Moins le désir homosexuel est saisi dans toute son ambiguïté violente, plus la production artistique homosexuelle se transforme en plat sans saveur, et le public (gay ou pas d’ailleurs) ne s’y retrouve pas. Ce n’est évidemment pas l’homosexualité qui convertit beaucoup d’auteurs en artistes minables et cupides, mais bien un désir schizophrénique inconsciemment actualisé. Foncièrement, je n’ai rien contre Andy Warhol et ses alter ego (je me suis assez intéressé à leurs productions pour le dire !). Il est fort possible que dans d’autres circonstances, et une fois qu’ils auront fait jour sur certains désirs qui les aveuglent, certains artistes homosexuels qui se montrent encore médiocres, révèleront leur génie et leur humour avec brio. Je crois simplement qu’ils sont encore en dessous de ce qu’ils pourraient créer s’ils cessaient de s’inventer un personnage torturé qu’ils croient être eux et qui les divise en deux. Dans le cas précis de Salvador Dalí par exemple, Julien Green a tout à fait raison de défendre l’idée qu’« il y a deux Dalí » : l’un qui est un artiste artificiel assoiffé d’argent, et l’autre, plus profond, très généreux et créatif (cf. Julien Green dans l’émission Apostrophe diffusée le 20 mai 1983 sur la chaîne Antenne 2). Ce n’est qu’en mettant une certaine actuation de leur homosexualité de côté que les créateurs homosexuels décolleront et nous offrirons le meilleur d’eux-mêmes. Je ne désespère pas de connaître un jour le grand réveil artistique homosexuel (que des créateurs comme Patrice Chéreau, Manuel Puig, Cathy Bernheim, Hervé Guibert, Laurent Lafitte, Muriel Robin, Frédéric Martel, Jarry, Christian Faure, Océane Rose-Marie, ou Jean-Luc Revol, ont déjà bien amorcé) !
Je dois vous avouer ma « pathologie personnelle » concernant les œuvres sur l’homosexualité : je crois que je m’imposerai de les éplucher toute ma vie, car vraiment elles me passionnent, même si, d’un point de vue strictement personnel et gustatif, je les trouve dans leur ensemble de mauvaise qualité, nases, insipides, et affligeantes. Je peux rester planté devant une infinité de films qui agacent et ennuient la majorité des personnes homosexuelles, lire des navets de romans à l’eau de rose à tour de bras, j’ai quand même une endurance qui m’étonne moi-même pour ingurgiter la soupe artistique homosexuelle sans me révolter, sans bailler… tout cela si et seulement si on y parle d’homosexualité, bien sûr (si la création que je vois, en plus d’être nulle, ne parle même pas d’homosexualité, je me tortille sur mon fauteuil et m’impatiente comme tout le monde !). Suis-je maso ? Suis-je obsessivement homo-centré ? Peut-être bien ! Moi, je ne pense pas, puisque je ne vais pas aux œuvres homosexuelles dans une optique identitariste ou amoureuse, bref individualiste. Cependant, j’ai conscience que je peux donner l’impression que ma démarche de recherche du Désir par le biais du désir homosexuel est monomaniaque. En fait, si les gens pensent que je m’enferme dans mon thème, c’est qu’eux-mêmes ont tendance à vider l’homosexualité d’universalité, à enfermer les personnes homosexuelles dans « leurs » clichés, pour ne pas les analyser, ni voir ce qu’ils pourraient en tirer comme conclusions sur eux-mêmes. Ce que je constate pour mon cas, c’est que mon travail de recherche m’ouvre au contraire à l’Amour, même si j’avance à tâtons sur un chemin obscur, peu défriché et balisé, qui m’était à la fois totalement étranger et que j’apprends à rendre familier. Je peux m’intéresser pour ce qui n’attirerait pas d’emblée mes goûts (car si je désire vraiment aller vers ce que j’aime, si je veux réellement du contenu, de l’Art de qualité, il me suffit d’ouvrir ma Bible et d’écouter Jésus et ses saints !). Mais du coup, ce détachement affectif et sensitif narcissique de la plupart des « critiques » littéraires et artistiques actuels – qui pensent à tort qu’il faut forcément « adorer » ou « détester » une œuvre pour pouvoir en faire un bon papier, qu’il suffit de parler de ses petites impressions et de s’épancher sur ses vibrations du cœur (« j’aime/j’aime pas ») pour analyser une création à fond –, me permet de vraiment plonger au cœur des œuvres, en dehors de toute considération de goût, d’« avis », d’« opinion », d’« impression ». C’est cela, pour moi, le vrai travail d’analyse et de respect de l’œuvre artistique : s’appuyer sur ce qui est dit concrètement, et comment c’est dit. Le reste, c’est du blabla, de l’esbroufe, de la dégoulinade narcissique. J’ai trop vu pendant mes années de chroniqueur radio des pseudo critiques littéraires ou cinéma qui lisaient sans lire, qui voyaient sans voir, qui n’avaient aucun sens critique parce qu’ils se centraient sur leurs putains de goûts. J’avais envie de leur dire : « Qu’est-ce qu’on s’en fout de savoir si t’as aimé ou pas cette œuvre ! ‘De quoi elle parle et qu’elle est son sens ?’ C’est ça qui nous intéresse ! Putain de bordel de merde !!! » Alors, OUI, je ne suis pas un ennemi des œuvres homosexuelles, ni des artistes ratés. Je me rue dans leurs brancards pour qu’ils se réveillent. Car ils ont un cerveau pour aimer et pour créer ! Qu’ils ne l’oublient pas.
2 – GRAND DÉTAILLÉ
FICTION
Le personnage homosexuel est un artiste raté dans énormément de productions homo-érotiques : le film « Like It Is » (1998) de Paul Oremland (avec Kelvin, le producteur de musique dance), le film « Días De Boda » (2002) de Juan Pinzás (avec le personnage de Nacho), le film « Le Grand Alibi » (2007) de Pascal Bonitzer (avec le personnage de Philippe), le film « Amour et mort à Long Island » (1997) de Richard Kwietniowski, le film « Un autre homme » (2008) de Lionel Baier (avec François, le journaliste plagiaire), le film « Hôtel Woodstock » (2009) d’Ang Lee (avec Elliot, le peintre raté), le film « Ed Wood » (1994) de Tim Burton, le film « L’Ange bleu » (1930) de Josef Von Sternberg (avec le professeur Emmanuel Rath, humilié jusqu’au bout, en cours comme sur scène), la pièce Jeffrey (1993) de Paul Rudnick, le film « Presque célèbre » (2000) de Cameron Crowe, le concert Le Cirque des mirages (2009) de Yanowski et Fred Parker (avec la figure du poète raté), la pièce Érik Satie… Qui aime bien Satie bien (2009) de Brigitte Bladou (où Satie y est décrit comme un compositeur de « musique d’ameublement »), le film « 800 Tsu Rappu Rannazû, Fuyu No Kappa » (1994) de Kazama Shiori, le film « Mort à Venise » (1971) de Luchino Visconti (Aschenbach, le musicien raté qui se fait lyncher lors de ses concerts), le film « Mambo Italiano » (2003) d’Émile Gaudreault (avec Angelo en scénariste de séries B), le film « Je t’aime toi » (2004) d’Olga Stolpovskay et Dmitry Troitsky (avec le personnage de Tim), le film « Bouche à bouche » (1995) de Manuel Gómez Pereira (avec le personnage de Victor), le film « Le Placard » (2001) de Francis Veber (avec François Pignon, présenté comme un homme sans relief), le film « La Mala Educación » (« La mauvaise éducation », 2003) de Pedro Almodóvar (avec Enrique, le cinéaste de seconde catégorie), le film « La Fleur de mon secret » (1995) de Pedro Almodóvar (avec Leo, l’écrivaine de roman à l’eau de rose), le film « Le Temps qui reste » (2005) de François Ozon (avec Romain, le photographe raté), le film « Billy’s Hollywood Screen Kiss » (1998) de Tommy O’Haver (avec le héros Billy, qui n’arrive pas à faire carrière), le film « Un Año Sin Amor » (2005) d’Anahi Berneni (avec Pablo, le poète raté n’arrivant pas à se faire publier), la chanson « Blues du Businessman » dans le spectacle musical Starmania de Michel Berger (avec le businessman Zéro Janvier qui « aurait voulu être un artiste »), la pièce L’Anniversaire (2007) de Jules Vallauri (avec le personnage de Vincent, l’écrivain sans talent), le one-woman-show Karine Dubernet vous éclate ! (2011) de Karine Dubernet, le film « Diferente » (1962) de Luis María Delgado, la pièce Jupe obligatoire (2008) de Nathalie Vierne (avec France, l’écrivaine ratée), le spectacle musical Yvette Leglaire « Je reviendrai ! » (2007) de Dada et Olivier Denizet, le film « Quartet » (1948) d’Harold French, le film « Du mouron pour les petits oiseaux » (1962) de Marcel Carné (avec Jean Parédès, l’auteur de romans de gare), le film « Piège mortel » (1982) de Sidney Lumet, le film « La Tourneuse de pages » (2005) de Denis Dercourt, le film « Baba-It » (1987) de Jonathan Sagall, le film « Néa » (1976) de Nelly Kaplan (avec Sibylle Ashby, l’auteure de romans érotiques), la pièce La Estupidez (2008) de Rafael Spregelburd, le roman Le Cœur éclaté (1989) de Michel Tremblay (avec Jean-Marc, l’écrivain frustré), la pièce Les Babas cadres (2008) de Christian Dob (avec Jeff, l’artisan des objets en bois inutiles), le film « Musée haut, Musée bas » (2007) de Jean-Michel Ribes (avec José, l’artiste contemporain aux meurtriers happening, et les très ambigus jumeaux Sulki et Sulku), la chanson « Fais-moi un chèque » (2011) de Jena Kanelle (où « le fric c’est chic »… au détriment de la qualité), la caricature Les artistes pédérastes (1880) d’Heidbrinck (avec les cercles artistiques homosexuels, dépeints comme malsains et frivoles), le film « Dérive » (1983) d’Amos Gutmann (avec Robbie, le réalisateur homo raté), le one-woman-show Nana vend la mèche (2009) de Frédérique Quelven (avec la poétesse ratée), le film « La Mante religieuse » (2014) de Natalie Saracco (avec Jézabel, l’artiste bisexuelle évoluant dans un milieu beaux-ardeux branchouille), le film « La Vie d’Adèle » (2013) d’Abdellatif Kechiche (avec Emma, l’artiste peintre lesbienne, et ses amis « artistes » qui pensent que disserter sur Klimt et Egon Schiele c’est « hyper profond »…), la pièce Gouttes dans l’océan (1997) de Rainer Werner Fassbinder (avec tous les acteurs à poil sur scène), la série Mon petit renne (2024) de Richard Gadd, etc.
« Je mets donc toute mon âme dans la musique, et mon cœur sombre d’un seul coup dans le chagrin de ce peintre raté qui voit se défaire devant lui un couple d’amis. » (le narrateur homosexuel parlant de l’opéra La Bohème de Puccini dans le roman La Nuit des princes charmants (1995) de Michel Tremblay, p. 19) ; « Mais je ne suis pas un artiste. » (Benjamin, l’un des héros homosexuels, dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit) ; etc.
Même s’il prétend être un artiste, on voit très souvent que le personnage homosexuel a du mal à emballer les foules avec ses créations : « Rémi était romancier. Du moins se plaisait-il à l’affirmer. […] Il avait toujours aimé écrire, tout en sachant qu’il ne possédait pas le talent suffisant pour prétendre à l’originalité. » (Jean-Paul Tapie, Dix Petits Phoques (2003), p. 14) ; « Vous êtes un médiocre musicien. » (Wagner à Nietzsche, dans la pièce Nietzsche, Wagner, et autres Cruautés (2008) de Gilles Tourman) ; « Parfois, par association d’idées, Gabrielle repensait à son dernier roman Dernier amour que tous les éditeurs avaient refusé à ce jour. » (Élisabeth Brami, Je vous écris comme je vous aime (2006), pp. 198-199) ; « Tous les trois ans un bouquin publié avec une sinistre régularité. […] Beaucoup de jactance. Beaucoup trop. Pour un écrivain. » (Vincent Garbo parlant du romancier François Letailleur, dans le roman Vincent Garbo (2010) de Quentin Lamotta, pp. 26-27) ; « C’est un esprit médiocre. » (Saint Loup au sujet d’un de ses assistants coiffeurs gay, dans le film « Rose et Noir » (2009) de Gérard Jugnot) ; « Moi, je choisis des pièces contemporaines où il n’y a que des mecs à poil sur scène. » (Dominique dans le one-man-show Hétéro-Kit (2011) de Yann Mercanton) ; « Il avait transcrit en japonais : ‘Quoi ? Zob, zut, love’, des bulles presque courantes, n’ayant pas envie de faire un véritable effort de concentration. L’empereur Hiro-Hito en fut bouleversé et décida de le sacrer Prince des poètes du Soleil Levant. […] Ninu-Nip craignit d’être victime d’une plaisanterie douteuse. » (le narrateur de la nouvelle « Quoi ? Zob, zut, love » (1983) de Copi, p. 14) ; « Qu’est-ce que tu fais encore nu ? » (Junon trouvant Jupiter à poil dans une prairie, dans le film pourri « Métamorphoses » (2014) de Christophe Honoré, où tous les acteurs jouent à poil) ; « Ouais, j’suis un comédien raté. Et alors ? » (Dodo dans la pièce Le Gai Mariage (2010) de Gérard Bitton et Michel Munz) ; « Benjamin est chorégraphe. Comme tous les mecs qui ont raté leur carrière de danseur… » (Pierre parlant de son amant, dans la pièce Le Fils du comique (2013) de Pierre Palmade) ; « Écoutez-moi, vous le marchand, siffla Smokrev. Vous êtes un échec. Vous étiez un artiste médiocre dont tout le monde se moquait en société. » (le Comte Smokrev, homosexuel, titillant l’homosexualité continente de Pawel Tarnowski, dans le roman Sophia House, La Librairie Sophia (2005), p. 482) ; etc.
Par exemple, dans la pièce Les Sex Friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau, Jules, le héros homo, se fait d’abord passer pour un artiste incroyable : il demande à être appelé pompeusement « le Prince des Poètes » ou « L’Homme en noir ». Et puis au fur et à mesure, on découvre que c’est un homme pédant, un beau-parleur alcoolique, sans succès : « Je suis écrivain de littérature philosophique internationale… dans le porno. » Michèle, l’actrice de séries B qui passe la soirée à ses côtés s’étonne même qu’il démente son côté artiste : « Comment ?? Drogué, alcoolique et gay… Et t’es pas comédien ??? » Dans la pièce Les Favoris (2016) d’Éric Delcourt, Guen, le héros homosexuel, crée un jeu improvisé « le Jeu des Favoris ». Ninon, la bisexuelle, ne mâche pas ses mots : « C’est scolaire, homo, nul. » Dans le one-man-show Les Gays pour les nuls (2016) d’Arnaud Chandeclair, le narrateur homosexuel se moque du cliché « ‘Le gay est doué dans l’art’ : mon cul ! ». Il raconte son essai raté de devenir musicien : « Un vrai désastre ! » Dans la pièce Jardins secrets (2019) de Béatrice Collas, Maryline, l’héroïne bisexuelle, prof d’arts plastique, est présentée ironiquement par Sandra comme « une artiste fonctionnaire (le rêve pour tout intermittent du spectacle…) »… mais Anne-Charlotte, une amie de Maryline, prend sa défense : « Maryline n’est pas fonctionnaire ! C’est une artiste ! ».
Dans le film « Marguerite » (2015) de Xavier Giannoli, Kyril, le dandy avec son monocle, fait des dessins et des poésies anarchistes, et organise des spectacles scandaleux qui se finissent en baston. Quant à Atos Pezzini, le prof de chant homosexuel, c’est aussi une « vieille pédale » jouant dans des opéras-bouffe qui n’ont pas de succès et qui sortant avec des petits éphèbes dont il collectionne les photos de nus « Tout le monde se moque de vous. » lui balance le Noir Madelbos à propos d’Atos et de son jeune amant Alberto.
Dans le film « Toute première fois » (2015) de Noémie Saglio et Maxime Govare, Nounours, l’un des héros homos, est un artiste d’art contemporain qui peint des vagins en forme de nénuphars roses. Tout le monde gaffe quand, spontanément, il trouve « ces trucs moches » ignobles à regarder.
Dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, il n’y a que des trentenaires homosexuels bobos qui sont des artistes ratés : par exemple, Simon a présenté son film « A-mor(t) » en ouverture d’un festival à Beaubourg, et ce fut un gros bide : « Après le court-métrage de Simon, les gens huent. Nous sortons. Les yeux de Simon perlent, il se retient. » Polly, l’une d’entre eux, leur fait le reproche de ne « créer » que pour satisfaire au fond que leurs pulsions sexuelles : « Vous me faites penser aux gens qui regardent des photos d’art de modèles nus en ayant la gaule. Tous ces gens qui n’ont pas encore compris que l’art ne servait pas à bander lamentablement. » (p. 36) La fusion constante entre cul et monde artistique gâche les talents, et transforme ces beaux-ardeux (plasticiens, photographes, écrivains de fortune) en imposteurs sincères : « Tiens, c’est Léo Durand, il est un écrivain raté, vous avez le même âge et je sais pas pourquoi, j’ai l’impression que vous êtes faits l’un pour l’autre ! » (Vianney présentant un mec à Mike, op. cit., p. 94)
Dans la pièce Géométrie du triangle isocèle (2016) de Franck d’Ascanio, Pierre-André, un dentiste, prend Nina, l’héroïne lesbienne, pour « une grande artiste en mosaïques », ce qui fait bien glousser Lola l’amante de Nina, ainsi que Vera la copine de celle-ci : « Il lui a donné l’illusion d’être une artiste ! » (Lola) Nina se console comme elle peut : « Y’a au moins quelqu’un qui me reconnaît un peu de talent. »
Dans la pièce Mon frère en héritage (2013) de Didier Dahan et Alice Luce, Philippe de Monceys, le héros homosexuel, est auteur de romans de gare. Dans le film « Cloudburst » (2011) de Thom Fitzgerald, Prentice, le jeune auto-stoppeur hétéro accompagnant le couple de vieilles lesbiennes, est un artiste de seconde zone : lors de ses shows de danseur, son chorégraphe lui demandait de pisser sur scène en guise de geste « artistique ». Dans la pièce En circuit fermé (2002) de Michel Tremblay, Nelligan Bougandrapeau, le héros homosexuel, dit qu’il a « passé son enfance à voir qu’il n’a aucun talent pour l’écriture ». Dans le film « Week-End » (2012) d’Andrew Haigh, Russell, le héros homosexuel, écrit des nouvelles de merde. Dans la pièce Nous deux (2012) de Pascal Rocher et Sandra Colombo, Duccio, le personnage homo, est un simple acteur figurant. Dans le film « Keep The Lights On » (2012) d’Ira Sachs, Erik, le héros homosexuel, conçoit des documentaires, et son prochain projet est un reportage « À la recherche d’Avery Willard » retraçant le parcours d’un photographe homosexuel qui a fait des nus à New York et qui est décrit comme un homme sans talent par ses proches collaborateurs. Dans le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza, Zach, le héros homosexuel, se décrit lui-même comme un réalisateur raté : « Je fais des films de mariage pourris et j’enchaîne les petits boulots. Je n’ai aucune relation stable. Je suis un 7 que les 9 rejettent. » Dans le film « Cruising » (« La Chasse », 1980) de William Friedkin, Tedd, le héros homosexuel, est dramaturge et écrit des pièces rétro qui n’intéressent personne ; il ne cache pas qu’il ne fait ça que pour l’argent : « Moi ce que je vise, c’est le fric. » Dans la série nord-américain Modern Family (2009-2011), Cameron, un des héros homos, est un clown raté qui n’arrive pas à faire rire. Dans le film « Boys Like Us » (2014) de Patric Chiha, Rudolf, l’un des héros gays, a été jadis libraire, et écrit des romans narcissiques et indigents à souhait. Dans la pièce Gouttes dans l’océan (1997) de Rainer Werner Fassbinder, Franz, le héros homosexuel, n’a pas de boulot mais veut vaguement faire « quelque chose qui ait un rapport avec l’art ». Dans le film « The Comedian » (2012) de Tom Shkolnik, Ed, le héros homo, galère à Londres comme comédien stand up. Dans le film « Mommy » (2014) de Xavier Dolan, Steve, le héros homosexuel, se destine à aller dans une école artistique à Juilliard (Québec)… mais son parcours se révèlera de courte durée car c’est un caïd refusant de travailler et complètement instable. Dans le film « Love Is Strange » (2014) d’Ira Sachs, Ben se demande s’il arrivera à devenir célèbre avec ses toiles. Son amant à la fois le rassure et lui dit que ce n’est pas très important : « Il y a un nouveau peintre à la mode toutes les semaines… J’adore tes tableaux. Et je me fiche de l’avis des autres. » Dans le film « L’Objet de mon affection » (1998) de Nicholas Hytner, Paul est comédien dans du théâtre contemporain merdique reprenant du Shakespeare : Rodney a trouvé ça d’une « nullité » incroyable. Dans la pièce L’Héritage était-il sous la jupe de papa ? (2015) de Laurence Briata et Nicolas Ronceux, Vincent, le héros homosexuel, est montré comme un violoncelliste raté, qui ne gagne que des petits cachets. Dans l’épisode 1 de la saison 1 de la série Sex Education (2019) de Laurie Nunn, Éric le héros homo se ridiculise devant tout le monde en ratant sa prestation publique de trompette dans l’amphi de sa High-school. Il est d’ailleurs surnommé « Trompette en l’air » par ses camarades après cela. Dans le film « Le Journal de Bridget Jones » (2001) de Sharon Maguire, Tom, le meilleur ami gay de Bridget, est l’artiste d’un « tube » tombé dans l’oubli et datant d’un disque sorti il y a 9 ans.
Le one-woman-show La Lesbienne invisible (2009) égratigne les artistes bobos homosexuels qui organisent des ateliers artistiques bidon : Océane Rose-Marie évoque avec un brin d’ironie ses « copines lesbiennes profs de peinture sur soie dans la Creuse ». Dans la pièce À plein régime (2008) de François Rimbau, Lola la lesbienne est décrite comme une « comédienne ratée ». Dans le film « Saisir sa chance » (2006) de Russell P. Marleau, Levi fait partie d’un groupe de rock merdique, les Participe Présents, qu’il finira par quitter. Dans la pièce Fixing Frank (2011) de Kenneth Hanes, Frank s’essaie à l’écriture (il dit qu’il « écrit sur les tulipes et les antiquités. »), et son copain, Jonathan, lui avoue qu’il ne sera pas un journaliste « assez doué ». Dans la pièce La Dernière danse (2011) d’Olivier Schmidt, quand Jack Spencer se vante à son amant Paul Wood d’« avoir du talent », celui-ci lui répond cyniquement : « C’est ce que tu crois… » Il finit quand même par réussir un peu dans le milieu de la danse, mais perd vite son titre, pour finir comme une misérable « star déchue » : « Jack Spencer, après avoir touché la lune, touche le fond » indique un article de journal. Paul Wood suit le même parcours que son copain : il était danseur de ballet de l’Opéra mais sa carrière a été de courte durée : « La roue tourne. Personne n’en sort indemne. » Dans le spectacle Charlène Duval… entre copines (2011), les journalistes se délectent à annoncer que « la carrière de Charlène Duval est finie ». Dans le roman Accointances, Connaissances, et Mouvances (2010) de Denis-Martin Chabot, Bertrand, homosexuel, est un acteur de seconde zone, subissant une retraite anticipée : « On ne parle plus beaucoup de lui dans les journaux à potins, sauf pour lui rappeler qu’il n’est plus rien, figurant dans le film de série B qu’est devenue sa vie. » (p. 36). Dans le film « Ma Vie avec John F. Donovan » (2019) de Xavier Dolan, John, le héros homo, fait des séries B puis sombre dans l’oubli et meurt d’une overdose. Par ailleurs, à deux reprises au cinéma – dans le film « Fame » (2009) de Kevin Tancharoen et le dessin animé « Anastasia » (1997) de Don Bluth et Gary Goldman, pour être précis –, j’ai vu des mises en scène de casting où c’est le personnage homosexuel ou androgyne qui est recalé, se ridiculise, et déprime les sélectionneurs (mais il doit y en avoir bien d’autres, à en croire les « best of du pire » que l’on retrouve sur des émissions de télé-réalité comme La Nouvelle Star de la chaîne française M6)
Et le pire, c’est que le protagoniste homosexuel se rend parfois compte qu’il n’a pas la vocation d’être artiste : « J’ai pas de talent. » (Jean-Marc, l’écrivain raté et « sans envergure » de la pièce Parfums d’intimité (2008) de Michel Tremblay) ; « J’étais même pas foutu de faire un cendrier qui était pas bancal. » (Jean-Luc, le héros homo ayant monté son propre atelier poterie, dans la pièce Cosmopolitain (2009) de Philippe Nicolitch) ; « Certains diront que j’ai écrit une œuvre illisible, inabordable, incompréhensible, inintéressante ou je ne sais quoi encore. Je ne cherche pas à nier qu’il s’agit d’une œuvre incommode […]. » (la figure de Marcel Proust, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 112) ; « Je ne suis qu’un violoneux de 3e ordre. » (la figure très queer de Sherlock Holmes dans le film « La Vie privée de Sherlock Holmes » (1970) de Billy Wilder) ; « C’est pire que du Bacchus. » (cf. la chanson « Tango » dans le concert Chansons bleues ou à poing (2009) de Nicolas Bacchus) ; « J’ai essayé d’écrire, moi aussi. Un échec. » (Peter dans le film « Joyeuses Funérailles » (2007) de Franz Oz) ; « Vous savez, je n’avais pas une ombre de talent, je ne savais que m’habiller et m’efforcer de paraître jolie. » (Angela, lesbienne et artiste de music-hall, dans le roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 236) ; « J’ai essayé et échoué toute ma vie. » (l’écrivaine lesbienne Vita Sackville-West, dans le film « Vita et Virginia » (2019) de Chanya Button) ; « J’ai l’impression de rater tout ce que je fais. » (Alma, l’héroïne lesbienne dans le téléfilm Under the Christmas Tree (Noël, toi et moi, 2021) de Lisa Rose Snow) ; etc. Les personnages lesbiens du roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) sombrent dans la désespérance face à leurs limites de créateurs : « Je ne serai jamais un grand écrivain à cause de mon corps insupportable et mutilé… » (Stephen, p. 285) ; « Dégingandée, impuissante, désordonnée et terriblement découragée, Jamie luttait pour finir son opéra, mais, ces derniers temps, elle détruisait très souvent son travail, sachant que ce qu’elle avait écrit était sans valeur. » (p. 517) Dans les pièces de Tennessee Williams, en général, les artistes détruisent toujours leurs œuvres. Dans la pièce Ça s’en va et ça revient (2011) de Pierre Cabanis, Hugo arrive au même constat d’échec face à sa carrière de dessinateur : « J’ai raté ma vie. » Dans la pièce Bill (2011) de Balthazar Barbaut, le professeur Foufoune, homosexuel, est un artiste frustré puisqu’il aurait voulu faire du cirque au lieu de travailler dans un asile psychiatrique. Dans le film « Como Esquecer » (« Comment t’oublier ?, 2010) de Malu de Martino, Antonia, l’ex de Julia, se définit comme « poubellologue ». Dans la pièce 1h00 que de nous (2014) de Max et Mumu, Max, le héros homosexuel, dit qu’il est un « acteur amateur en fin de droit ». Dans le film « Parking » (1985) de Jacques Demy, Orphée est un chanteur populaire qui sait qu’il mourra avec ses chansons, qui est souvent mécontent de ce qu’il produit, qui est tout aussi mécontent lorsqu’on lui fait savoir que ce qu’il produit est mauvais. Dans son concert Free : The One Woman Funky Show (2014), Shirley Souagnon torpille les messes (« La messe est un spectacle. On raconte de la merde, ça rapporte de l’argent. »)… mais ensuite décrit son propre show comme un « mestacle »… Dans le film « A Moment in the Reeds » (« Entre les roseaux », 2019) de Mikko Makela, Leevi, le héros homosexuel, aimerait savoir bien écrire, et pensait que son arrivée à Paris allait l’inspirer… mais il avoue que ce n’est pas magique.
Il se dit parfois que pour être moins ridicule et visible, il lui suffit d’assumer, voire de grossir, la nullité de ses œuvres : illusion narcissique s’il en est ! « C’est sûrement pas être artiste que d’frapper sur un piano. C’est sûrement pas être poète que d’chagriner la p’tite fille assise au bord du Styx. […] Les producteurs trouvent ça bien. Toi et moi on l’sait quand même, on n’est pas loin d’l’enfer. […] On est tous des imbéciles. On est bien très bien débiles. C’qui nous sauve c’est le style : équivoques et aussi paradoxes, et ça suffit. » (cf. la chanson « On est tous des imbéciles » de Mylène Farmer) ; « Sur fond d’musique baba ou variété débile. Stratégie oblique oblige. » (cf. la chanson « Mes Amis et moi » d’Arnold Turboust) ; « Peu importe le fond, la forme… Admirez ma technique ! » (Leni Riefenstahl dans la pièce Nietzsche, Wagner, et autres cruautés (2008) de Gilles Tourman) ; « Elle attribue le succès du livre, moins à son fond qu’à sa forme. » (Françoise Dorin, Les Julottes (2001), p. 85) ; « Y avait rien de politique, rien d’artistique dans ce que Willie disait. Il n’était pas cultivé. C’était de la bouillie. » (Tristan Garcia, La Meilleure part des hommes (2008), p. 55) ; « C’était devenu un style, le style : tant que je parle, j’ai raison, je peux mentir ou j’ai rien à dire, j’ai raison – j’ai la parole, et ça s’appelle un livre ; William allait bien là-dedans. » (idem, p. 135) ; « Tout art est parfaitement inutile. » (Oscar Wilde cité par la conteuse dans la pièce Le Portrait de Dorian Gray (1890) d’Oscar Wilde, mise en scène par Imago en 2012) ; « Moi, je suis une artiste brute. J’ai besoin d’aller jusqu’au bout de moi-même. » (David Forgit, le travesti M to F, dans le one-(wo)-man show Désespérément fabuleuses : One Travelo And Schizo Show, 2013) ; etc. Dans une auto-parodie qui sent l’aveu indirect, Essobal Lenoir, l’auteur du recueil Le Mariage de Bertrand(2010), arrive à s’étonner que son « éditeur ait accepté de publier son écœurant opuscule » (p. 168)
Dans le film « Teorema » (« Théorème », 1968) de Pier Paolo Pasolini, le personnage de Pietro dévoile très bien les stratégies de camouflage de la supercherie artistique mises en place par l’Homme qui ne veut pas renoncer à son titre de « génie » : « Il faut inventer de nouvelles techniques, impossibles à reconnaître, qui ne ressemblent à aucune opération existante, pour éviter la puérilité du ridicule, se construire un monde propre, sans confrontation possible… pour lequel il n’existe pas de mesures de jugement… qui doivent être nouvelles comme les techniques. Nul ne doit comprendre qu’un auteur ne vaut rien, qu’il est anormal, inférieur, que comme un ver, il se tord et s’étire pour survivre. Nul ne doit le prendre en péché d’ingénuité. Tout doit paraître parfait, fondé sur des règles inconnues… donc, non mises en doute… comme chez un fou, oui, un fou. Verre sur verre, car je ne sais rien corriger… et nul ne doit s’en apercevoir. Un signe sur un verre… corrige sans le salir… un signe peint auparavant sur un autre verre. Il ne faut pas qu’on croit… à l’acte d’un incapable, d’un impuissant. Ce choix doit paraître sûr, solide, élevé et presque prépondérant. Nul ne doit se douter qu’un signe est réussi ‘par hasard’. ‘Par hasard’, c’est horrible. Lorsqu’un signe est réussi, par miracle, il faut immédiatement le garder, le conserver… Personne ne doit s’en percevoir. L’auteur est un idiot frissonnant, aussi mesquin que médiocre. Il vit dans le hasard et dans le risque, déshonoré comme un enfant. Sa vie se réduit à la mélancolie et au ridicule… d’un être qui survit dans l’impression… d’avoir perdu quelque chose pour toujours. » Comme Lourdes, l’héroïne de la pièce Les Gens moches ne le font pas exprès (2011) de Jérémy Patinier, qui dit qu’elle « va remplir avec du vide », le faux artiste homosexuel essaie de substituer le travail de déguisement de la médiocrité de son œuvre artistique à l’œuvre artistique elle-même ! Dans Les Petites Annonces d’Élie Sémoun, Gérard Saint-Brice, le (très androgyne) directeur de théâtre contemporain proposant des mises en scène complètement rasoir et barrées, cultive une ambiguïté sexuelle qui parachève l’équation « théâtre-masturbation-intellectuelle = théâtre homosexuel ». Dans le film « À travers le miroir » (1961) d’Ingmar Bergman, la figure de l’artiste raté homosexuel renvoie clairement à l’inceste, puisqu’à un moment du film, Mino joue à son père écrivain une pièce intitulée Le Tombeau des illusions ou l’art fantôme. Il prononce ces mots : « Je suis roi d’un royaume qui est petit mais très pauvre. Je suis artiste ! Oui. Princesse. Artiste pur sang. Poète sans poèmes, peintre sans tableaux, musicien sans musique. Je méprise l’art fabriqué, résultat banal d’efforts vulgaires. Ma vie est mon œuvre vouée à mon amour pour toi. »
FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION
PARFOIS RÉALITÉ
La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :
a) L’artiste raté :
Les artistes homosexuels n’ont pas souvent bonne réputation. Ils sont connus comme faisant partie intégrante du paysage audiovisuel et artistique, certes, mais passent pour des amuseurs plus que pour des artistes compétents. Par exemple, dans Palimpseste – Mémoires (1995), Gore Vidal est décrit par Latouche comme le « Lope de Vega de la télévision » (p. 420) car fait un travail de nègre trop prolifique et commercial. Il ne dément pas cet avis. « On disait que j’étais ‘le petit pisse-copie de Hollywood’, ce qui n’était pas complètement faux. » (idem, p. 482) Dans l’essai De Sodoma A Chueca (2004) d’Alberto Mira, Jacinto Benavente est qualifié de basique « dramaturge de théâtre de boulevard » (p. 108). Josyane Savigneau, dans sa biographie de Carson McCullers (1995), rapporte que Carson McCullers est considérée comme une « auteure mineure » (p. 11). Les papiers écrits sur les célébrités homosexuelles ou les icônes de la communauté gay ne sont pas dithyrambiques, c’est le moins qu’on puisse dire… : « Chez Mylène Farmer, c’est la sensation d’un trop. Trop de cordes, trop de nappes, trop de chœurs, pas la place de respirer. » (cf. la revue Télérama, mai 1999) ; « Mylène Farmer, c’est un peu comme la Joconde. Tout le monde la voit, mais personne ne l’entend. » (Samuel Laroque dans le one-man-show Elle est pas belle ma vie ?, 2012) ; « Oscar Wilde fut un créateur prolifique, public, commercial, de mauvaise qualité, trivial, répétitif. Il fut un plagiaire. » (Neil Bartlett, Who Was That Man ? A Present for Mr Oscar Wilde (1993), pp. 201-202) ; « Il n’a rien écrit, il ne chante pas, il ne peint ni ne joue, il ne fait que parler ! » (Richard Ellmann, Oscar Wilde, cité par Anne-Sylvie Homassel, « Le Soleil Wilde », dans Magazine littéraire, n°343, Paris, mai 1996, p. 30) ; « L’image que l’on retient de cet auteur est celle d’un raté, non seulement peu cultivé, mais aussi peu intelligent : un espèce de bouffon grotesque sans cour qui croit qu’il est difficile de comprendre la vérité et surtout qu’il est obligatoire de le dire. » (Pier Paolo Pasolini concernant Witold Gombrowicz, cité sur le site www.islaternura.com, consulté en janvier 2003)
Les critiques de la production artistique sur l’homosexualité fusent et concordent pour dire que les trois-quarts du temps elle rase les pâquerettes : « Les résultats ? Presque toujours médiocres, sinon consternants. Une grande partie de la production littéraire et artistique homosexuelle se confond avec les plus vulgaires manifestations de la sous-culture pornographique hétérosexuelle. […] L’homosexualité, à peine libérée, n’a rien eu de plus pressé que de débonder ses fantasmes en oubliant de se donner des contraintes intérieures, contraintes sans lesquelles il n’y a pas de véritable création. » (Dominique Fernandez, L’Amour qui ose dire son nom (2000), pp. 301-302) ; « Mièvrerie et fadeur de l’ensemble : plus le sentiment homosexuel cherche à s’exprimer, sans métaphores ni faux-semblants, plus il perd en force et en saveur. C’est une loi que nous aurons l’occasion de vérifier. » (idem, p. 69) ; « L’homosexualité a atteint un niveau de banalisation inimaginable précédemment. Cette normalisation tous azimuts ne va toutefois pas sans une forme d’affadissement, qu’on retrouve peu ou prou dans la plupart des cinématographies occidentales. » (Didier Roth-Bettoni, L’Homosexualité au cinéma (2007), p. 418) ; « Mal écrit surtout, et ennuyeux, pour ‘faire littéraire’. À de tels auteurs, la modernité a appris que la littérature n’avait rien à dire. Barthes leur a montré la ‘fatalité du signe littéraire, qui fait qu’un écrivain ne peut tracer un mot sans prendre la pose particulière du langage’. Il a appelé à une ‘écriture blanche’, ‘innocente’ par son ‘absence idéale de style’. » (Pierre Jourde, La Littérature sans estomac (2002), p. 189) ; « Les textes attaqués en deux principales espèces : parataxe voyante, minimalisme syntaxique, lexical et rhétorique (écriture blanche). Inversement, syntaxe complexe, métaphores flamboyantes, énumérations (écriture rouge). Ces deux manières a priori opposées, la blanche et la rouge, reviendraient plus ou moins au même. L’écriture blanche est un mélange de naturalisme et de romantisme dégradé au même titre que l’écriture rouge : du drapé, de la posture, de la déclamation, charriant des morceaux de réalisme. L’une cherche à se singulariser dans une affectation de détachement, l’autre dans le cabotinage. Dans les deux, le désir de la singularité pour elle-même engendre le poncif. À ces deux espèces de faux-semblants, on en a ajouté une troisième, plus récente. On pourrait la baptiser écriture écrue. […] Petits objets du quotidien, gens de peu, prose poétique, effets stylistiques discrets mais repérables. L’écriture écrue, elle aussi, part du principe de l’authenticité. Elle fait croire que son originalité tient à la modestie de ses objets. » (idem, pp. 38-39) Le bilan artistique homosexuel est tellement pitoyable que certains en arrivent à se demander : « Mais est-il vraiment indispensable d’être hétérosexuel pour avoir du talent, voire du génie ? » (Lionel Povert, Dictionnaire gay (1994), p. 11)
L’artiste homosexuel connaît souvent « ce statut d’utilité frivole qui lui fait mesurer tout ce qui le sépare des véritables créateurs » (Frédéric Mitterrand, La Mauvaise Vie (2005), p. 299). Par exemple, sur l’aveu du « couple » Pierre Bergé/Yves Saint-Laurent, l’Empire YSL a démarré sur un gros coup de « bluff » et une manœuvre stratégique de Pierre Bergé. Saint-Laurent n’a eu le talent que du publiciste qui s’aligne et qui sent ce qu’attend de lui son époque. Et Pierre Bergé, le talent du gestionnaire cupide et profiteur. Dans la biopic « Yves Saint-Laurent » (2014) de Jalil Lespert, Yves le lui rappelle vertement : « Espèce de raté ! T’es un parasite ! » Francis Bacon, quant à lui, est très surpris d’avoir autant de succès. D’ailleurs, il affirme haïr ses toiles : « Je n’ai pas le sentiment d’être créatif. Je fais partie de ces gens qui ont reçu une grande dose de chance. » (cf. le documentaire « Francis Bacon » (1985) de David Hinton) Dans le documentaire « Cocteau/Marais : un couple mythique » (2013) Yves Riou et Philippe Pouchain, on apprend que Jean Marais « se voit traiter de plus mauvais acteur de France » quand il interprète Œdipe-Roi de son amant Jean Cocteau. Lui-même confirme : « J’étais très très très mauvais. » Et en effet, il a été refusé au conservatoire, n’a été connu que grâce à ses relations et sa réputation sulfureuse (c’était l’artiste raté qui osait jouer presque nu, à l’époque). Autre cas : celui du réalisateur italien Pier Paolo Pasolini. Plus que pour ce qu’il a écrit ou fait, c’est sur ses intentions qu’il a été jugé surtout. « Bien sûr, ça a fait scandale. Comme tout ce qu’il faisait. » (Dacia Maraini dans le documentaire « L’Affaire Pasolini » (2014) d’Andreas Pichler) Quelques jours avant sa mort, il interprétait le silence qui l’entourait comme un « symptôme d’incompétence » (idem). Bruno Ulmer, obnubilé par la publicité, fait un art pop de la redite, peu inventif (cf. le documentaire « Une Vie de couple avec un chien » (1997) de Joël Van Effenterre). « Je ne me sens pas un écrivain » dit Jean-Luc Lagarce dans son Journal : il déprime de ne pas parvenir à « vendre ses salades » (c’est comme cela qu’il qualifie ses livres). Andy Warhol, quant à lui, est très lucide sur la qualité de son œuvre : « Je suis peut-être célèbre mais c’est sûr que je ne produis pas du beau travail. Je ne produis rien. » (cf. le reportage « Vies et morts de Andy Warhol » (2005) de Jean-Michel Vecchiet) ; « Les choses que je désire montrer sont mécaniques. Les machines ont moins de problèmes. Je pense que quelqu’un devrait être capable de faire toutes mes toiles à ma place. » (Andy Warhol cité dans le Dictionnaire gay (1994) de Lionel Povert, p. 452) Quentin Crisp ne déroge pas à la tendance homosexuelle à la médiocrité : « Emblème du ratage social, il ne fait rien de bien probant et se considère désormais comme un raté. À défaut de mettre son talent dans son œuvre, il va exceller à en mettre dans sa vie. » (Lionel Povert, Dictionnaire gay (1994), p. 151) ; etc.
Par exemple, dans son film « La Bête immonde » (2010), le chanteur et réalisateur Jann Halexander présente (avec sévérité ou réalisme ?) sa trilogie sur Stratoss Reichmann à travers son personnage d’Ariane : il lui fait dire qu’il fait des films et des romans de mauvaise qualité : Ariane parle en effet d’un artiste qui a écrit sur Stratoss Reichmann « un roman qui a donné lieu à un film en deux parties, sans grand intérêt d’ailleurs ».
Dans le docu-fiction « Le Dos rouge » (2015) d’Antoine Barraud, c’est assez pathétique : Bertrand Bonello se filme en train de douter de l’utilité de son travail, et en faire un reportage : « Je ne sais pas où ça va. ». Ses amis bobos essaient de le rassurer sur son projet vide comme ils peuvent : « C’est casse-gueule. Mais c’est ce que j’aime. Sans scénario. Sans rien d’écrit. » (Alice) Il se fait interroger par un journaliste homo sans discours, sans avis (« Je ne sais pas trop quoi dire… »), mal dans sa peau (« J’arrête pas de rougir… Je me demande ce que je vais devenir. » ; « J’ai même songé à disparaître. »), qui lui pose des questions creuses (« Est-ce que la contradiction est une valeur artistique, un espace ? »).
Pendant tout le film biographique « Howl » (2010) de Rob Epstein et Jeffrey Friedman, l’écrivain homosexuel Allen Ginsberg est décrit comme un auteur de pacotille : « Je pense qu’il n’a aucune valeur littéraire. » (une femme témoin s’exprimant au procès d’Allen Ginsberg par rapport au recueil de poèmes « Howl ») Il confirme sa réputation d’imposteur artistique puisqu’il dira lui-même de son vivant que son poème « Howl » n’est qu’un ramassis de « conneries sensibles » : « J’escroque un peu mon monde. » Et ses quelques défenseurs bobos ne trouvent, à sa décharge, que les intentions : ils ne parlent jamais de l’œuvre de Ginsberg en elle-même, mais de ce qu’elle « aurait voulu dire » : l’honnêteté, la sincérité, la provocation, une transcendance, la dénonciation sociale, la puissance des mots, etc.
Pour certains « artistes » homosexuels, la revendication de la nullité artistique agirait comme paravent voire comme une conjuration magique de cette même nullité. Tel artiste ose dire qu’il est médiocre = c’est donc qu’il est génial ! Par exemple, André Gide et Pierre Louÿs créent en 1889 la Potache-Revue. Paul Verlaine et Arthur Rimbaud inaugurent le mouvement littéraire « zutiste ». Andy Warhol vénère la « célébrité d’un quart d’heure ». Aymeric Peniguet de Stoutz dit qu’il « n’a absolument rien contre le léger et le ludique : ‘Le superflu, chose très nécessaire’ disait Voltaire ! » (cf. le Magazine Égéries, n° 1, décembre 2004/janvier 2005, p. 80) Vanité des vanités, tout est vanité ! (… surtout la vanité !)
Comme dans les fictions, c’est l’argument du style qui revient pour faire illusion, tout cela dans le but d’occulter le manque de fond. Roland Barthes souligne dans la pensée baroque « la prévalence de la forme sur le fond » (Roland Barthes, « La Face baroque », Le Bruissement de la langue, 1984). Selon ces pseudo artistes, l’Art n’aurait pas de but, ne devrait pas avoir de dialectique, sous prétexte qu’il n’a pas qu’un seul sens ni qu’une seule perception de Lui : l’Art « serait », de toute éternité. Par exemple, Gilles Deleuze et Félix Guattari, dans leur manifeste L’Anti-Œdipe (1973), pensent « l’art comme un processus sans but, mais qui s’accomplit comme tel. » (p. 443) ; « C’est cela le style, ou plutôt l’absence de style, l’asyntaxie, l’agrammaticalité : moment où le langage ne se définit plus par ce qu’il dit, encore moins par ce qui le rend signifiant, mais par ce qui le fait couler, fluer et éclater – le désir. Car la littérature est tout à fait comme la schizophrénie : un processus et non un but, une production et non pas une expression. » (idem, pp. 158-159) En général, le geste artistique que ces « artistes » cautionnent n’est pas maîtrisé, prémédité (la seule chose calculée, c’est le fait justement que ce ne soit pas calculé ! Belle hypocrisie !) : « Ma méthode de dessin ressemble à l’improvisation du jazz » déclare Jean Cocteau (cf. le documentaire « Cocteau et compagnie » (2003) de Jean-Paul Fargier). Parfois, cela donne des phrases qui ne veulent objectivement rien dire mais qui font profondes, une dégoulinade verbale ininterrompue et sans goût : « Le rôle de l’art consiste à saisir le sens de l’époque et à puiser dans le spectacle de cette sécheresse pratique un antidote contre la beauté de l’inutile qui encourage le superflu. » (Jean Cocteau cité par Gérard de Cortanze, « Le Journal de l’inconnu », dans Magazine littéraire, n°423, Paris, septembre 2003, p. 54) Vous comprenez cette phrase, vous ? (Moi pas). Comme l’explique à juste raison Élisabeth Lévy dans Les Maîtres censeurs (2002), « cette idéologie dominante qui se pense libérée de toutes les idéologies ne peut triompher qu’au prix d’une abdication fondamentale qui conduit à faire prévaloir l’émotion sur la compréhension, la morale sur l’analyse, la vibration sur la théorie. » (p. 17) Les artistes homosexuels s’appesantissent en général sur les sens pour délaisser le Sens.
Depuis un certain temps dans le cinéma homo-érotique, c’est la mode : beaucoup de réalisateurs (Pasolini dans « Salò ou les 120 journées de Sodome », Christophe Honoré dans « Métamorphoses », ou encore Karim Aïnouz dans « Praia Do Futuro ») se mettent à chapitrer leurs films. Le chapitrage, ça fait plus intello et un peu moins merdique. Ça donne un semblant de sens à ce qui ne prétend pas en avoir.
Le modèle du genre, dans le registre des œuvres homosexuelles bobos merdiques, c’est quand même les films de François Zabaleta. J’étale mes goûts, je m’écoute ressentir… et je vois ce que ça donne… et même si ça donne de la merde, ça serait quand même génial parce que je m’en rendrais compte. Par exemple, dans son film narcissique « Le Cimetière des mots usés » (2011), on y entend l’éloge du ratage artistique : « Julien s’abuse. Il n’a aucun talent. » (Daniel parlant d’un écrivain et ami à lui) ; « Dans le ratage, on est condamné à l’originalité. […] Le ratage n’est pas une stratégie. […] Il n’est pas donné à tout le monde d’être un vrai raté. » (Daniel) ; etc. Les héros de ce navet cinématographique s’écoutent parler, sans chercher à énoncer une quelconque vérité intelligente ou à donner un sens à leur verbiage. Leur manque de prétention suffit à leur tenir chaud : « Mots qui me viennent à l’esprit quand je pense à toi… » (Denis à son amant Luther) Zabaleta philosophe sur la nullité artistique. Il fait même créer à ses personnages homosexuels des « Musées des projets avortés ». L’un de ses héros, Denis, dit « s’entêter à être un artiste », mais comme il voit que ça ne marche pas, il finit par dénigrer tout talent artistique : « Le pire ennemi de l’artiste, c’est le savoir-faire. […] Est-ce que ça sert à quelque chose d’être un artiste ? »
b) On parle plus de l’image scandaleuse que va engendrer l’artiste que de l’œuvre en elle-même :
« Ce n’est pas son œuvre qui faisait de Wilde un héros : c’était sa légende » dit-on du dandy britannique le plus connu de tous les temps, et célébré comme la crème de la crème des artistes homosexuels (cf. le documentaire « Pierre Louÿs : 1870-1925 » (2000) de Pierre Dumayet et de Robert Bober) Par exemple, l’essai Corydon (1905) d’André Gide semble avoir eu le succès de l’image, du scandale, mais n’a pas été jugé concrètement pour ce qu’il disait ; à propos de cet ouvrage, Guillermo de Torre affirme en 1956 que « Corydon n’est pas tant une œuvre absurde qu’une œuvre inutile » (cf. l’article « Anverso Y Reverso de André Gide », dans l’essai Metamórfosis De Proteo de Guillermo de Torre, 1956). Christine Angot est davantage connue pour le scandale suscité par L’Inceste (1999), et l’étonnement qu’un livre pareil puisse se vendre comme des petits pains, que pour la qualité de ce qu’elle a écrit. Dans son émission Apostrophe du 20 mai 1983 sur Antenne 2, Bernard Pivot dit combien le travail du peintre Salvador Dalí repose sur la fanfaronnade : « Dalí, c’est le fric, le scandale, l’esbroufe. » Dans le docu-fiction « Brüno » (2009) de Larry Charles, l’excentrique Brüno (un mélange de Steevy, de Nabila et d’Afida Turner, mais à la sauce nord-américaine), affublé de la méritée réputation de « crétin sans talent », joue de son bagou – et par la même occasion de ses déhanchés de mannequin, de sa gueule et de son cul – pour faire illusion sur la bêtise de ses propos et la violence de ses happening. Avec le vidéo-clip de la chanson « Je suis gay » de Samy Messaoud, on comprend que l’intention (militante, « artistique », « provocatrice ») passe avant la création.
La victoire du paraître sur l’être fait beaucoup de bruit et de sensation, mais tout le monde ne mord pas à l’hameçon. Dans ses articles très connus sur le camp, la philosophe nord-américaine Susan Sontag croque à souhait ce qu’on pourrait appeler la « prétention prétentieuse » de ces artistes (homosexuels ou hétérosexuels, peu importe ; surnommés aujourd’hui « artistes des genres » ou « queer ») qui s’attribuent le label d’« artistes d’avant-garde » sans que personne, pas même ceux qui sont censés évaluer leurs productions, ne leur résiste : « Les critiques qui entendent louer une œuvre d’art se croient tenus en général de démontrer que chaque partie est indispensable et qu’il serait impossible de rien changer. Mais l’artiste, qui se souvient du rôle que jouent la chance, la fatigue, les distractions, se rend bien compte que les déclarations du critique ne correspondent pas à la réalité, qu’en bien des points le résultat pouvait être fort différent. L’impression que tout dans un chef-d’œuvre est d’une nécessité absolue ne vient pas du fait que chaque partie devait être présente, mais de la cohérence du tout. » (cf. l’article « À propos du style » (1968), p. 63) Susan Sontag tourne en dérision le tour de passe-passe de ces artistes qui saturent leurs œuvres d’art de style et de forme pour nous faire oublier qu’elles proposent peu de sens : « Il existe, à mon sens, entre ‘style’ et ‘stylisation’ une différence du même ordre que celle qui distingue la volonté de la bonne volonté. » (idem, p. 64) ; « Mettre l’accent sur le style, c’est faire peu de cas du contenu, ou refuser tout engagement par rapport au contenu. Il va sans dire que le mode de sensibilité exprimé par le ‘Camp’ est entièrement non-engagé et dépolitisé, ou, à tout le moins, apolitique. » (cf. l’article « Le Style Camp » (1968), p. 424) ; « De nombreux exemples de ‘Camp’ sont, soit des œuvres ratées, soit des fumisteries. » (idem, pp. 426-427)
Enfin, pour vous convaincre de l’océan de nullité dans lequel la culture homosexuelle est tombée, je vous suggère une idée toute simple : il vous suffit d’ouvrir un numéro de Têtu, la revue censée nous représenter, nous, personnes homosexuelles. Et vous aurez l’illustration de ce que j’ai essayé de vous montrer !
L’Art véritable, par définition, a deux vocations : celle de refléter le Réel (visible et invisible : je n’ai rien contre l’art contemporain ou non-figuratif et non-naturaliste, encore une fois) et celle de révéler la beauté de l’Homme. Toute oeuvre qui ne respecte pas ces deux critères, n’est pas, à mon avis, artistique. Et comme la majorité des oeuvres faites par les personnes actuelles s’appuient sur la justification du désir homosexuel sous forme d’identité et d’amour alors que le désir homosexuel est éloigné du Réel et qu’il défigure l’Homme dès qu’il cherche à se pratiquer, il est difficile de trouver parmi elles de véritables artistes dignes de ce nom.
3 – COPI : L’EXEMPLE DU FAUX ARTISTE
J’ai décidé de terminer cet article consacré au code de l’« Artiste raté » dans les œuvres homosexuelles par un focus spécial sur une vedette homosexuelle que je connais plutôt bien puisque j’avais amorcé une thèse sur elle : il s’agit du dessinateur, dramaturge, et romancier argentin Copi (1939-1987).
Avec son air goguenard et son culot (corrosif pour son époque), il est parvenu à embobiner un peu son monde à propos de ses qualités artistiques… et il continue surtout de le faire post mortem, puisqu’on voit au sein du monde du théâtre contemporain actuel ses pièces exploitées jusqu’à épuisement complet des troupes dans les théâtres nationaux de France et de Navarre ! L’art de manipuler les autres et de faire croire à son talent fictif, est-ce aussi du talent, quand bien même cette vocation soit plus travaillée, plus tardive, plus artisanale, et plus volontariste, que véritablement innée ? Si certains veulent y croire dur comme fer et applaudir aveuglément à l’intention et au mérite, à la flagrance queer, moi je n’y crois pas du tout. Copi, à mon sens, est un « artiste raté ». Un artiste raté réussi, c’est vrai, mais un artiste raté quand même ! Un chanceux plus qu’un talentueux. Il y en a, des comme ça, qui passent par les mailles du tamis de la célébrité. Mais ne nous excitons pas sur leur compte : c’est par accident (et parce qu’ils font un moment recette) qu’ils jouent dans la cour des grands ; non par une manœuvre maîtrisée et la reconnaissance méritée d’un réel talent. Je le dis sans peur ni aigreur personnelle.
Copi a cultivé toute sa vie le double jeu, la contrefaçon. Déjà, à l’âge de 10 ans, on le découvre plagiaire du poète Lorca alors qu’il se voit offrir une bicyclette pour son beau poème. Par la suite, artistiquement, sa vie de jeune artiste fils-à-papa commence très bas : il erre dans les rues de Paris, et vend ses collages sur le Pont des Arts ou à la Coupole. Il est le père de La Femme assise, bande dessinée publiée dans le Nouvel Observateur, et connaît une petite notoriété dans les années 1960 grâce à elle. Touche-à-tout du milieu artistique, il collabore avec le monde de la publicité (« Perrier c’est fou ! », c’est lui). Il devient l’auteur de quelques romans et de pièces de théâtre telles que La Tour de la Défense ou Eva Perón, passées à la postérité bien après sa mort, notamment grâce au metteur en scène Marcial Di Fonzo Bo. Quand Copi meurt en 1987, pas une ligne ou presque n’est traduite dans son pays.
Aujourd’hui, on déroule le tapis à l’œuvre de Copi, parce qu’il est l’un des premiers artistes homosexuels connus à être frappés violemment par le Sida, et que son franc-parler est irrévérencieux et d’une violence incroyable… mais il semblerait que notre intelligentsia artistique actuelle ait la mémoire courte : si on ne regarde que le public – qui, contrairement à ce qu’essaient de nous faire croire les adulateurs snobinards de Copi – est le principal roi à servir par les comédiens, et le meilleur juge d’une œuvre artistique, si on sort des considérations purement intellectualisantes d’artistes se flattant entre eux, on voit très bien que peu de spectateurs ressortent rassasiés par l’œuvre de Copi. Soit ils quittent précipitamment la salle (rappelons le tollé qu’a suscité la représentation de La Tour de la Défense au théâtre Fontaine de Paris, en 1981 ; ou bien le merveilleux flop de la version italienne de Loretta Strong au Théâtre Gerolamo de Milan ; ou encore les vives réactions au sein de la rédaction de Libé et parmi les lecteurs quand Copi a commencé à déraper avec son personnage de B.D. transsexuel « Libérette »…), soit ils s’emmerdent, soit ils ressortent choqués… et pour ne pas passer pour des cons, ils disent qu’ils ont adoré (ceux qui détestent n’ont pas trop l’énergie de chercher à dire pourquoi). Et pour cause ! Copi se fout bien de son public : « Je ne regarde jamais le public, cela me ferait retomber sur terre. » dit-il dans l’article « Copi lit sa copie, c’est du joli » de Jean-Jacques Samary, au journal Libération du 5 novembre 1994) Sinon, il lui offrirait davantage de qualité et de contenu dans ses œuvres !
Alors que le vrai artiste est toujours un chercheur de Vérité, Copi, lui, envisage le chemin de la Vérité comme une prétention. Par exemple, il présente son roman La Cité des rats (1979) comme un banal manuscrit qui n’a pas été écrit pour être publié et qui est retrouvé par hasard. Selon l’auteur, c’est une manière « d’innocenter la personne qui raconte, en ce qui concerne ses prétentions littéraires. Parce que rien n’est plus ridicule que les prétentions littéraires chez un personnage de fiction. » Copi préfère se cantonner à la médiocrité, à produire un « théâtre du pauvre » (cf. article « Entretien avec Michel Cressole : Un mauvais comédien, mais fidèle à l’auteur » (1987) de Michel Cressole dans Libération)… comme ça, pas de risque de tomber de haut ! Dans la pièce Cachafaz (1993), par ailleurs, le héros essaie d’écrire un tango et soutient « qu’il sent venir l’inspiration », alors que Raulito lui rétorque qu’« il ne sait même pas écrire ». Dans les créations de Copi, les personnages jouent même les stars involontaires, ou les écrivains du dimanche : « Je lui ai fait remarquer très poliment que mon succès à la télévision est tout à fait accidentel. » (la voix narrative le roman L’Uruguayen (1972) de Copi, p. 54) ; « J’avais déjà raté plus d’un roman, j’insistai, et puis je n’avais aucune idée de nouvelle, c’est tout. » (la voix narrative dans la nouvelle « Virginia Woolf a encore frappé », Virginia Woolf a encore frappé (1983), p. 78) ; « Je publiai mon premier roman qu’il adora mais qui n’eut aucun succès. » (la voix narrative en parlant de son éditeur dans le roman Le Bal des folles (1977), p. 9) ; « Est-ce que le lecteur soupçonne que j’oublie ce que j’écris ? En tout cas bon débarras, un roman de plus, une avance de plus. » (la voix narrative dans le roman Le Bal des folles, p. 155) Les narrateurs de Copi font un livre comme un enfant « a fini » son dessin pour enchaîner sur un autre gribouillis… mais pour eux, ce sera pour un autre cachet : « Qu’est-ce que tu écris vite, me dit-il [l’éditeur]. Un roman en une semaine ! En effet, ça fait juste une semaine que j’ai commencé. Qu’est-ce que je vais faire maintenant ? Je n’en sais rien, je vais me mettre à dessiner, j’écrirai peut-être une autre pièce. Avec les 5000 francs qu’il me donne je partirai me reposer une semaine à Rome, j’ai envie de me balader. » (la voix narrative du roman Le Bal des folles, p. 163)
Copi semble davantage attiré par l’argent qu’il peut se faire sur le dos de son statut d’exilé politique argentin persécuté par la junte militaire de son pays d’origine (l’Argentine, c’est « in » = l’argent-« in ») ou de son originalité homosexuelle, que soucieux de produire de la qualité. Déjà, dans toutes ses œuvres, l’obsession pour l’argent saute à la figure : cf. les B.D. Kang (1984), la Femme assise, l’Acte 2 de la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986). Et puis certaines répliques de personnages ne trompent pas : « Nous sommes inondés de chèques ! » (la Comédienne dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne, 1986) ; « Je n’ai plus l’âge de présenter des modes de plage ! Mon éditeur attend mon manuscrit depuis l’année dernière ! Je ne suis le mannequin que vous avez connu, je suis devenue écrivain ! Comment qu’est-ce que j’écris ? Mes mémoires ! Qu’est-ce que j’ai d’autre à écrire ? En plus, je vis de ça, des avances de mon éditeur ! » (« L. » à Hugh dans la pièce Le Frigo, 1983) Par exemple, dans le roman La Cité des rats, la figure de Copi-Traducteur ne rêve que de mettre « le chèque de son éditeur dans sa poche » (p. 156). Copi, en bon intrus complexé, n’est pas dupe sur son succès : il comprend inconsciemment qu’il est reconnu non pas tant pour son talent que pour son étrangeté sexuelle et étrangère, celle qui amuse teeeeellement la bourgeoisie parisienne, qui le rend si « typique » et « folklorique » : « Je vais te présenter en ville comme un jeune artiste qui débarque d’un pays exotique. » (« L. » au Rat dans la pièce Le Frigo) ; « Je suis un mauvais comédien, mais je suis fidèle à l’auteur. » (Copi affirmant qu’il ne voit pas quelqu’un d’autre que lui jouer dans sa pièce Le Frigo, cité sur l’article « Entretien avec Michel Cressole : Un mauvais comédien, mais fidèle à l’auteur » de Michel Cressole, 1987) Mais Copi, sûrement par arrivisme, et pour ne pas contredire ses quelques fans, s’est lui-même servi de l’excuse de la différence culturelle pour gravir les marches de la gloire et de l’argent sans trop d’effort (et beaucoup de drogue !) : « Je ne suis pas un romancier à la façon française ou tout autre ; je ne suis pas non plus un écrivain d’Apostrophe et, si j’ai participé à cette émission une fois, c’est parce que je suis latino-américain. » (Copi, La Quinzaine littéraire, 16 janvier 1988)
Copi ne cache absolument pas son arrivisme et le fait qu’il se laisse téléguider par son époque. Son but est d’être l’ère du temps : « J’ai le Sida. J’attrape toutes les modes. » (Copi s’adressant à Facundo Bo, et cité dans l’essai Le Rose et le Noir, les Homosexuels en France depuis 1968 (1996) de Frédéric Martel, p. 479)
Le but de Copi n’est pas de porter son œuvre, d’y exprimer un Essentiel universel. Il l’abandonne comme une malpropre, accouche sous X. « Lorsque j’écris un roman […], il s’écrit presque tout seul, après quoi je l’oublie, car je ne garde pas en mémoire mes romans. » (Copi dans l’article « Copi : ‘Je suis un auteur argentin même si j’écris en français.’ » de Raquel Linenberg, journal La Quinzaine littéraire du 16 janvier 1988) « Toute création étant hasardeuse » (le Dieu des Hommes, dans le roman La Cité des rats, 1979), la technique « artistique » de Copi repose essentiellement sur l’écriture automatique (les répétitions phoniques automatiques, les associations de mots par sonorité, les calembours faciles, les interjections, les cris, les injures, les rimes décontextualisées, les improvisations, les happening… même si le dramaturge dira qu’il vomit les happening et qu’il n’en fait jamais).
Chez Copi, il n’y a pas à proprement parler d’Art (ars en latin signifie « savoir-faire ») mais plutôt un « ignorer-faire ». Ses sources d’inspiration sont gangrenées de culture télévisuelle de bas étage et de presse people : « Je commence mon deuxième projet de roman. Rien que des images de la télévision italienne me viennent à la tête. Je n’avance guère. » (la voix narrative dans le roman Le Bal des folles, p. 145) L’Eva Perón de Copi est d’ailleurs comparée à « une Lady Macbeth de soap bon marché » (cf. l’article « L’Eva Perón de Copi au Chili » de Maia Bouteillet, dans le journal Libération du 26 janvier 2001). Dans ses romans, on a l’impression de lire du Guillaume-Dustan-racontant-ses-courses-au-Monop’ avant l’heure : « Je rentre chez moi en zig-zag […] j’ai sommeil, je me fais un viandox […] Je décide de me coucher […] Je rentre dans la chambre. » (la voix narrative du roman Le Bal des folles, p. 37) Copi écrivait d’un trait. Alfredo Arias, son confrère argentin, nous dit bien qu’« il n’aimait pas se corriger. » Et c’est quand on regarde vraiment son écriture, sans idées préconçues, que la lumière se fait. « Il faut bien écouter le texte. Il est d’une pauvreté sans pareille, émaillé de grossièretés arbitraires. Comme si cela ne suffisait pas, les interprètes émettent par instants des cris inarticulés, des grognements, éructations, hurlements ou barrissements tels que l’on se croirait au zoo… En fin de compte, tout cela ne veut strictement rien dire. » (Maurice Rapin parlant de la pièce Eva Perón dans le journal Le Figaro, le 7 mars 1970) C’est pour cela qu’il est si facile de jouer du Copi, que ses pièces sont la manne des troupes amateur actuelles et des jeunes compagnies théâtrales qui sortent des Cours Florent. En effet, les comédiens ne sont pas obligés de coller au texte pour interpréter les pièces de Copi : même les trous de mémoire, les changements de texte, les impros, peuvent passer pour des reconstitutions fidèles du langage inénarrable du « génie révolutionnaire » du dramaturge.
Ce que fait Copi, c’est de l’art inversé, ni plus ni moins. Par exemple, dans le roman La Cité des rats, il explique très clairement que ses célèbres rats sont les allégories anagrammiques d’un art corrompu, travesti (cf. l’écriteau « RATS = ARTS »). On retrouve le même écho dans le dialogue entre « L. » et son Rat dans la pièce Le Frigo (1983) : « Hé bien, c’est ça l’art, mais on ne prononce pas ‘rat’, on prononce ‘art’. » Copi a tout de l’artiste « RATé » (même son gratte-papier de La Cité des rats s’appelle « Gouri » ! Ça ne s’invente pas !)
J’irai même plus loin en disant que l’« art » de Copi a pour but de détruire l’art même : « C’est le théâtre que je tue ! » déclame sa femme de ménage Madame Lucienne dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1986). Les pièces de Copi sont généralement servies par une remarquable économie de moyen. Son théâtre n’est guère différent de son œuvre picturale, où prédomine la simplicité du trait. Côté bande dessinée, objectivement, même les dessins de Copi ne sont pas bien dessinés. Il a un mauvais coup de crayon, pas de technique, une mauvaise couleur, ils racontent des histoires parfois incompréhensibles. « On a cru assez longtemps que Copi dessinait parce qu’il ne savait pas écrire. Cette idée saugrenue empêchait de voir que Copi qui, en effet, ne sait pas écrire, ne dessinait pas non plus. » (Michel Cournot, « Des Cris à Montevideo », dans Le Nouvel Observateur, 3 décembre 1973) Tout comme pour le théâtre, on est invité, avec Copi, à un Concert du Vide, que même les amis de « l’artiste » ont bien du mal à défendre : « La conversation s’engage. Une conversation pleine de trous. Parce que, quand l’interlocuteur a envoyé sa réplique, s’ensuivent deux ou trois dessins où ça ne cause pas. […] On voit bien que ça pense, là-dedans. Copi a des silences éloquents, dirai-je. […] Déconcertant, voilà. Copi est déconcertant. » (Cavana parlant de la B.D. La Femme assise, 1988) Copi, selon René de Ceccatty, aurait même le génie de faire exprès d’être mauvais… (Si c’est pas géant, ça !) « Il y a peut-être dans l’arbitraire des rimes et du rythme des vers un équivalent de l’abstraction du dessin. Copi, comme chacun sait, était un faux-mauvais dessinateur. Il imitait l’hésitation du trait des enfants. Mais des détails qui ne trompaient pas indiquaient la maîtrise de l’expression. De la même manière, dans Cachafaz (comme il l’avait fait en français dans les Escaliers du Sacré-Cœur), il imite les ritournelles de l’opérette et les duos d’amour de l’opéra, les tirades tragi-comiques et les apartés mélodramatiques. Mais ce n’est pas pour autant une farce. Car à travers les excès de la situation théâtrale et sous le flots de sang, Copi avait en tête, aussi, un certain tableau social. » (Copi, Cachafaz (1993), p. 7) Quand on ne sait pas comment défendre un auteur, on lui invente des intentions militantes, on politise son œuvre, et le tour est joué !
La nudité (dans tous les sens du terme : rares sont les fois où on ne voit pas un comédien entièrement à poil dans les pièces copiennes) et la nullité de l’œuvre de Copi ont tout pour ravir les troupes de comédiens bobos, les artistes de seconde catégorie qui veulent « s’éclater » ensemble, se donner une image à la fois branchouille, incorrecte, révolutionnaire, MAIS professionnelle quand même. Avec Copi, c’est les copains d’abord. Comme l’explique Myriam Mezières, une de ses anciennes partenaires de scène, son théâtre permet de « militer tout en s’amusant » : « Jouer avec Copi c’était militer pour le pur plaisir. Ça tenait des jeux d’enfants. » (cf. la biographie Copi (1990) de Jorge Damonte, p. 71) Quand les défenseurs de Copi (= ses amis intimes) ne tarissent pas d’éloges pour son œuvre et son humour, on se demande toujours s’ils ne confondent pas les pièces et les romans qu’ils ont vus de lui avec les souvenirs de bringue vécus dans la sphère du privé : « Je me souviens de tant de verres bus ensemble, de tant de rencontres ratées dans mon bureau, du jeu compliqué passionnel et familial de nos rôles d’éditeur et d’écrivain. » (Christian Bourgois, dans la biographie Copi (1990) de Jorge Damonte, p. 6) La critique la plus lucide que j’ai lue sur le théâtre de Copi (et croyez-moi, ils sont rares, les articles qui n’encensent pas Copi, dans la presse d’aujourd’hui !), c’est celle du journaliste Gilles Sandier, qui ne se laisse pas du tout impressionner par l’épate-bourgeois qu’est l’œuvre du dramaturge argentin : « On dira que Grand-Guignol et folinguerie sont les masques de la pudeur de Copi. Soit. L’ensemble cependant, drame compris, constitue une amusette assez anodine, même si elle peut scandaliser encore quelques boétiens attardés. Cette amusette, drôle au début, ensuite s’éternise et s’appesantit. Elle ressortit au genre du théâtre pour copains, celui qu’on fait entre soi, dans le grenier, les soirs de nouvel an précisément. Mais on éprouve quelque gêne aussi à voir les homosexuels, au théâtre comme à la ville, non seulement se complaire à leur propre dérision (que les bien-pensants charitables diront « émouvante » ou tragique) mais surtout se conformer à l’image que les autres se font d’eux : des monstres assez dérisoires. Ces minauderies sophistiquées, ces hanches tortillées, ces piaillements appliqués, assortis de la drogue, de l’hystérie et de l’infanticide – avec tout l’humour noir qu’on voudra, celui qu’on reconnaît volontiers à Copi – n’amusent que deux sortes de gens : les copains et les poujadistes. Cela fait, il est vrai, de nombreux Français. » (cf. Gilles Sandier, « La Tour de la Défense de Copi : La Cage aux folles version rive gauche », dans Le Matin de Paris, le 26 novembre 1981)
S’il était encore vivant, Copi verrait certainement d’un très mauvais œil que je puisse porter un jugement de valeur sur son œuvre, et que je le présente comme un imposteur artistique, puisque pour lui, l’« Art » est incritiquable, et l’artiste est un demi-dieu (… camé et fumeur de marijuana) : « Je déteste l’introspection. Pourquoi jeter en pâture ce qui est au tréfonds de nous ? Cela tient généralement de la poubelle. La forme dramatique se suffit à elle-même. » (Copi par rapport à sa pièce Le Frigo, dans l’article « Au Festival d’Automne : Copi sur le ring », journal Le Figaro, le 8 octobre 1983) Il montre patte blanche et se désolidarise de toute forme d’intentions, comme si ses œuvres s’étaient créées toutes seules, sans lui : « Le théâtre est encore l’un des derniers arts où on réussit à faire scandale. Si je le recherche ? Non. Je n’ai ni perversité ni volonté de me venger de qui que ce soit. Je ne m’inspire de rien. Le Frigo est un spectacle avant tout visuel. […] Mon spectacle ne propose aucun symbole érotique. » (idem) Mais désolé, à moi, en tout cas, on ne la fait pas ! Toute création artistique a un sens (et plusieurs lectures pour tendre à ce sens, aussi imparfaites et innombrables soient-elles !) ; et si ses auteurs ne veulent pas qu’il y en ait un, c’est qu’elle en a un d’autant plus violent !
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.