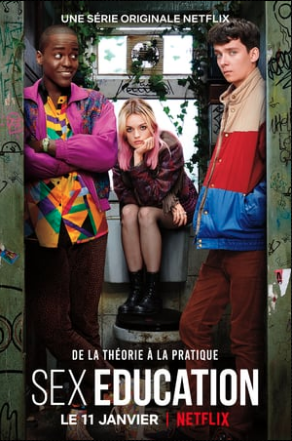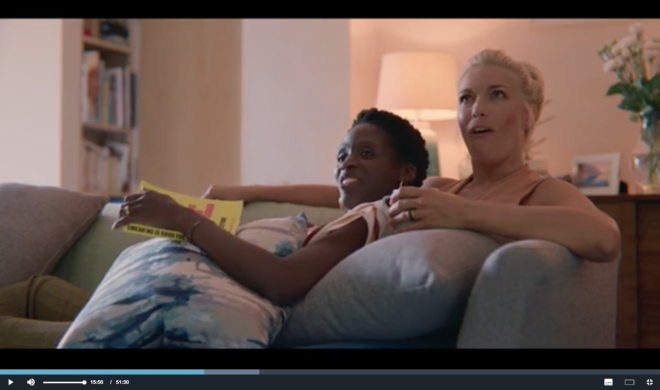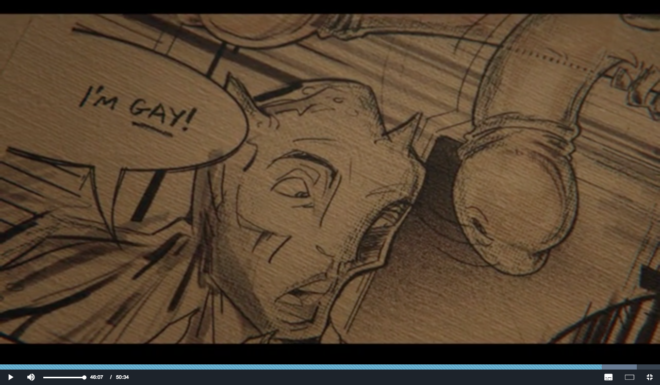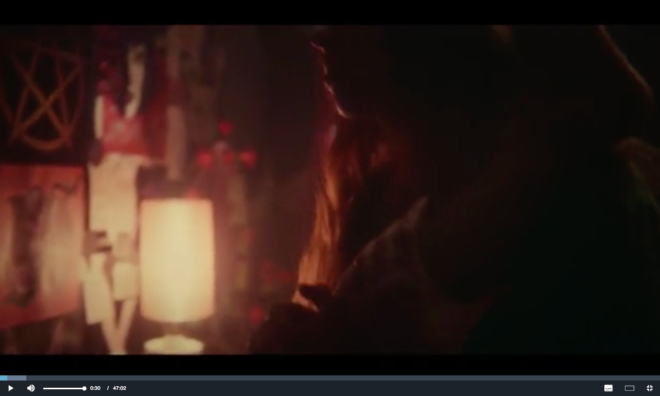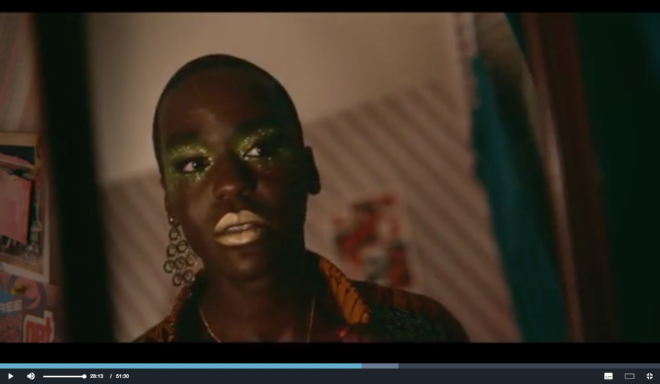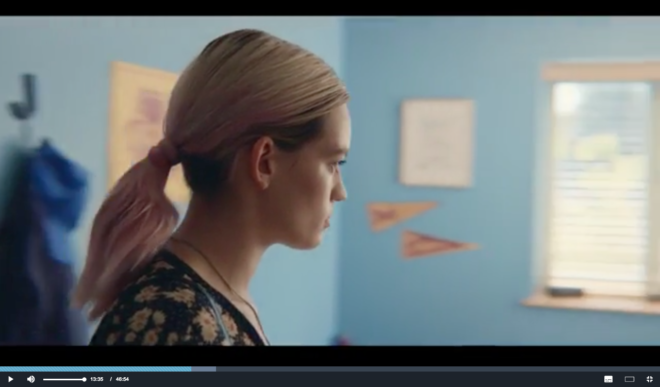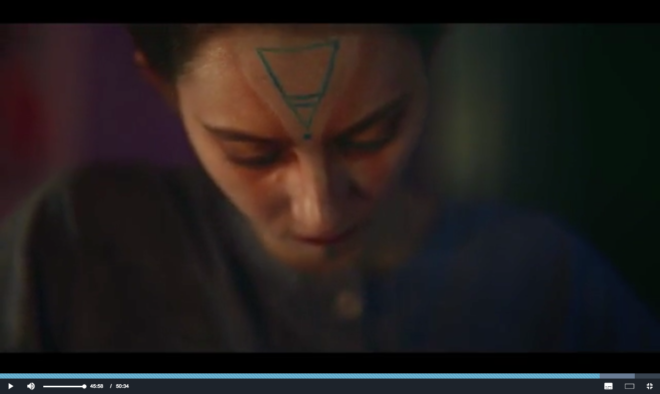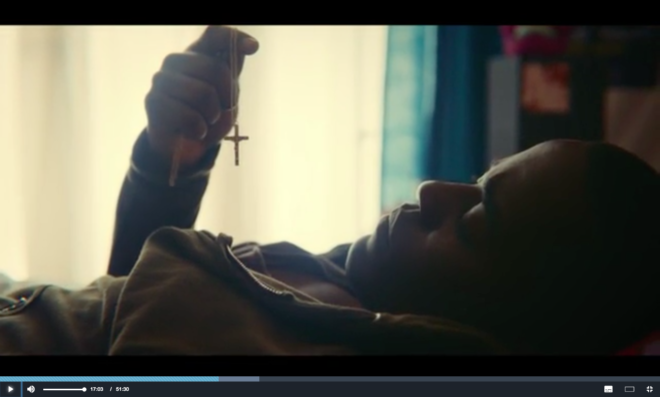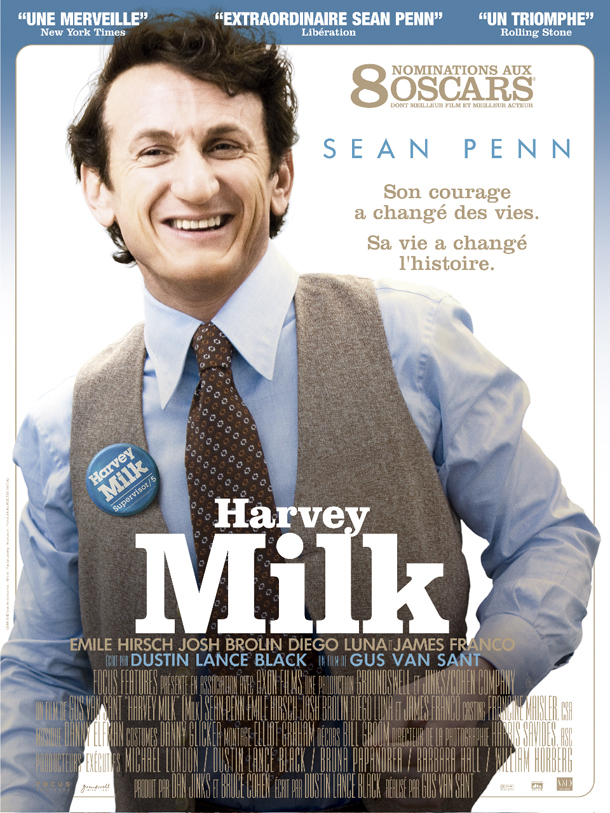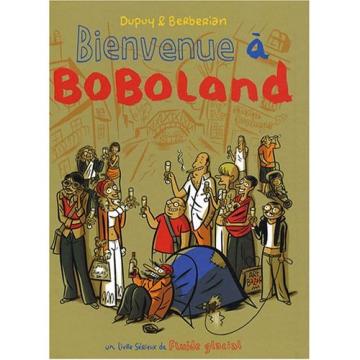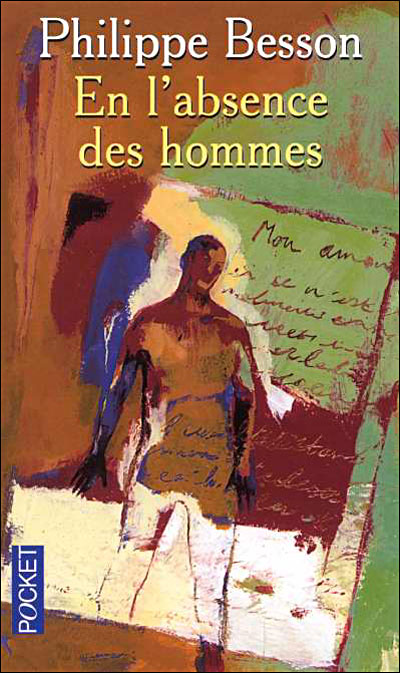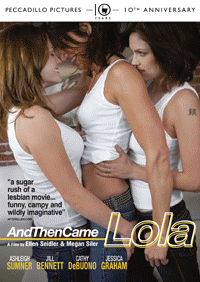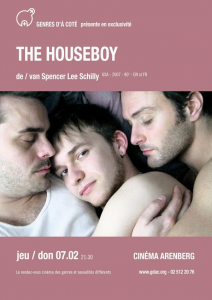Bobo
AVANT-PROPOS sur les 50 sous-codes bobos

Pour vous aider à suivre au mieux la logique de ce code si spécial, je vous engage à bien retenir les sous-codes répertoriés dans cet article CAPITAL, et surtout mon livre Les Bobos en Vérité, qui sont un peu le langage symbolique de l’idéologie bobo. Vous les repérerez, je pense, dans énormément de films, vidéo-clips et discours de nos contemporains, car nous baignons médiatiquement et politiquement dans une ambiance bourgeoise-bohème sans trop le savoir (D’ailleurs, le bobo s’est tellement en horreur lui-même que dès qu’il apprend que quelque chose est étiqueté « bobo », il cherche à le fuir : c’est sa marque de reconnaissance, la fuite de soi et la haine de la bobo-attitude). Merci, donc, de relire au moins deux fois les 50 mini-codes de l’univers « bobo » avant de vous jeter à l’eau, en sachant qu’ils fonctionnent comme les 186 codes du désir homo : ils sont plus à prendre comme des symboles d’un désir que comme une espèce humaine à part, des faits ou des actes réels (ex : tous les barbus qui aiment les bougies ne sont pas nécessairement « des bobos » : tout le monde est un peu bobo – surtout dans les moments où ça ne va pas et où on se centre sur soi en oubliant l’Église et la différence des sexes – et personne n’est « le bobo » véritablement ;-)).
NOTICE EXPLICATIVE :
HOMOSEXUALITÉ ET BOBOÏTUDE
Reflets d’une même hypocrisie contemporaine
(version rose ou verte)

Stuck In The Sound
Donnez-moi un clitoris, je n’en veux pas…
Vous aussi, vous soupirez dès que vous entendez les premières notes de la chanson « Je veux » de ZAZ qui a le courage « révolutionnaire » de manger avec ses doigts au Ritz, et qui défend « SA » vision individualiste et libertaire de la bonne humeur, « SON » indépendance et « SA » réalité ? Vous aussi, vous commencez à avoir une poussée d’urticaire dès qu’« on vous souhaite tout le bonheur du monde », comme Sinsémilia sur un air sautillant de guitare « à la Brassens » ? Vous aussi, vous trouvez que des films comme « Tree Of Life » sont insipides, et illustrent parfaitement le mauvais coton (ou la mauvaise guimauve verte, en l’occurrence…) que notre planète, en perte de Sens et en manque de Dieu, est en train de filer ? Bienvenue au club ! Le Festival d’Avignon et les Inrockuptibles, c’est ici ! 😉 Journalistes de Têtu et de Minorités.org, entrez ! Ce code est fait pour VOUS ! Et tous les autres, ceux qui haïssent tout ce qui « fait bobo », venez participer à ce grand exorcisme collectif que sera, j’espère, la lecture de ce code ! (car c’est fou la montagne de culpabilité, de complexes, d’agressivité, qui se cache derrière cette étiquette « des bobos »^^)

Film « Cabaret » de Bob Fosse
Pour résumer ce que je pense de l’adjectif « bobo » – employé à l’heure actuelle à toutes les sauces dès qu’on veut discréditer quelqu’un ou une idée –, je vais prendre un exemple simple : je vais partir de notre cher Francis Cabrel national (mais j’aurais pu parler aussi d’Yves Duteuil ; en revanche, j’ai écarté Florent Pagny et Yannick Noah, je sais pas pourquoi…). La différence entre Francis Cabrel et l’individu bobo, c’est que Francis, lui, il est vrai et aimant, il est dans la proposition, il ne fait pas semblant d’aimer la Nature et la Vérité, il agit en leur faveur ; alors que l’individu bobo, au contraire, il fait semblant d’agir (il crie « Allô le monde ? », comme la chanteuse Pauline, pour faire la morale à tout le monde, puis retourne fumer son shit), il est triste et agressif, et se place dans le registre de la révolte (cf. les chansons « Travailler plus », « Peuple d’Occident » ou le magistral « Plus on en fait », de Tryo), de l’opposition molle. Voilà, en gros, ce qui rend bobo : le manque de désir, le manque de Réel et la haine de soi/des autres, sous prétexte de défense du naturel (ici, comprendre par « naturel » toute pulsion).

Charlie Winston
Le bobo, je dirais que c’est le Mâle/mal du Siècle : la version Charlie Winston des romantiques déprimés et révoltés du XVIIIe, qui refusent Dieu et ont peur de désirer. « bobo » signifiait déjà littéralement « petite blessure » (Tamalou ? Gebobola), et actuellement, il renvoie aussi à la contraction des adjectifs « bourgeois » et « bohème » (l’expression est née sous la plume de David Brooks en 2000). Dans le langage commun, et grâce à des chansons populaires telles que « Les Bobos » de Renaud ou « Tes parents » de Vincent Delerm (vous savez, le chauffage à 17°C dans la baraque familiale…), l’homme bourgeois-bohème est passé très vite dans les esprits pour l’archétype du citadin « nouveau riche », qui mangerait bio, habiterait tel quartier précis, ferait des voyages « humanitaires », écouterait France Inter, lirait Télérama, et voterait à gauche pour faire illusion qu’il vit en réalité comme un soi-disant « bourgeois de droite ». Mais cette acception du terme me paraît spectaculairement réductrice, car elle ne considère absolument pas l’hybridité/la bipolarité – donc la richesse – de l’expression « bobo ». En effet, nos contemporains, parce que cela les arrange et leur permet d’extérioriser le phénomène social généralisé du boboïsme sur d’autres personnes qu’eux-mêmes (attitude bourgeoise s’il en est !), préfèrent oublier qu’il y a aussi, parallèlement à cette élite réduite de gens « bobos plus bourgeois que bohèmes », une foule beaucoup plus grande de bourgeois ratés et de gens « plus bohèmes que bourgeois », qui ne se considèrent absolument pas bobos alors que pourtant ils le sont, non pas au niveau du porte-monnaie, mais d’abord en désir (et parfois en actes). Être bobo n’est pas prioritairement une question d’argent possédé (même si, bien sûr, quand on a de l’argent, on est d’office plus exposé à devenir superficiel et à vivre pour le paraître), mais de fantasme (y compris sexuel et homosexuel). Oui monsieur ! On peut tout à fait être pauvre et snob. Pauvre et arrogant. On peut manger des graines au petit déjeuner et être obnubilé par les marques et la société de consommation. On peut défendre le « pauvre du bout du monde » tout en écrasant le « pauvre de son pallier ». On peut ne pas avoir la télé et être un geek qui croit tout ce que les médias lui disent. On peut être écolo et un beau salaud. On peut être un étudiant, un militant de la gauche radicale, un va-nu-pieds, parcourir le monde avec son sac à dos, faire du coach surfing, traverser l’Atlantique à la rame, et quand même vivre dans le paraître, comme le bourgeois… avoir un cœur sec, comme le bourgeois. Être bourgeois, ce n’est pas d’abord la conséquence directe de la possession d’argent (il est possible d’avoir de l’argent, de le faire fructifier, et de le partager avec les autres), mais bien un rapport non-détaché à l’argent, et une primauté laissée au matériel et aux bonnes intentions plutôt qu’aux humains et aux actes concrets pour les aider. Au fond, nous sommes tous potentiellement des bobos (et personne ne l’est complètement : « le bobo » reste une étiquette, un être mythique ; pas un être humain), parce que désirer le paraître et vivre pour soi, c’est humain. Après, la personne la moins bobo qui soit, c’est celle qui tolère dans l’humour l’idée qu’elle puisse être « un peu bobo » (de par son humanité) et qu’elle puisse être jugée comme tel, mais qui, en actes, essaie de lutter contre cette part sombre, artificielle, mondaine, de sa personnalité/de ses désirs.
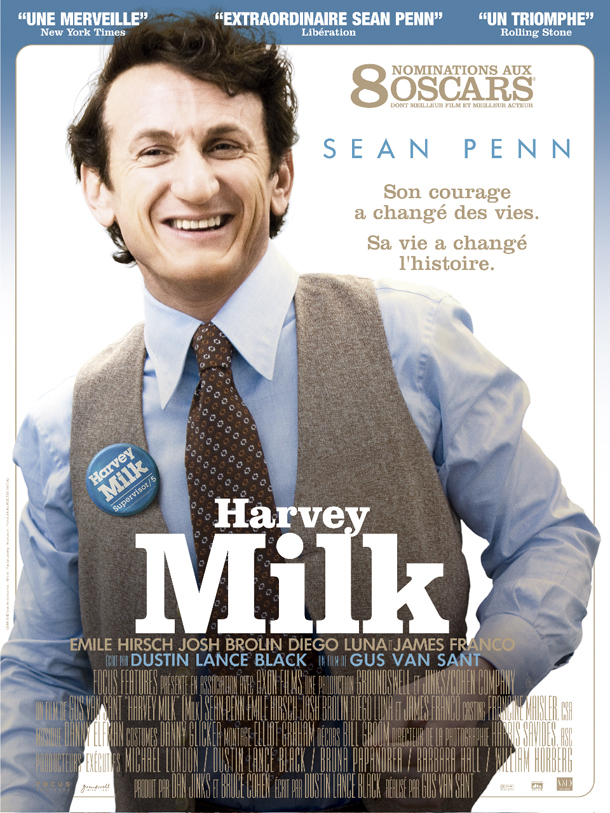
saint Sean Penn
Être bobo, pour moi, c’est être puriste sans chercher à être pur. C’est rechercher la Nature, la Vérité, la Réalité, l’Amour, la transcendance, par les mauvais moyens, c’est-à-dire en évacuant Dieu de sa vie et en se mettant à sa place. Pour le coup, l’Homme bobo est surtout un être qui manque de Désir, un révolté triste et « indigné », un individu qui oscille entre des phases de grandes violences et des phases d’anesthésie planante de drogué, un révolutionnaire frustré qui tue mal son ennui parce qu’il panique pour le sort du monde sans réellement le changer. D’un certain côté, il est touchant étant donné qu’il aspire à une radicalité, à une authenticité, à un retour aux sources, à la paix, à l’humanisme, à une spiritualité ; mais il est aussi hypocrite, pathétique et puant dès que son élan premier de grands changements, en théorie louable, se fige en diktat politique, en esthétisme, en égocentrisme « bouddhisant », en confort, en bonnes intentions non-suivies des actes, en haine des autres sous prétexte de défense des Droits de l’Homme, en libertinage liberticide, en « fascisme vert », en hédonisme ronflant, en indifférence, en humanisme athée. En gros, on devient bobo dès qu’on se place en unique créateur de soi-même, dès qu’on mise toutes nos espérances en l’être humain et en une Nature biologique censée dominer ce dernier plutôt qu’en Dieu fait homme, un homme libre de respecter mais aussi de dominer la Nature. Personnellement, je crois que le véritable humanisme se fait avec Dieu-Église. Si Dieu-Église incarné n’est pas là, l’Homme n’y est pas non plus, n’est plus à sa juste place, ne sait plus à qui donner son cœur, et on ne peut plus parler d’humanisme : on en reste alors à un pauvre optimisme anthropocentré/ethnocentré et hédoniste, qui bien souvent cache une grande désespérance en l’Humanité.
Comme le boboïsme est une idéologie de la contestation du « carcan bourgeois » que serait la différence des sexes, une pensée de l’ouverture inconditionnelle à toutes les différences (y compris les différences qui ne grandissent pas l’Homme, ou qui font appel à ses instincts « naturels » les plus pulsionnels), il était logique qu’il fasse très bon ménage avec un autre courant social qui s’avance aussi sous la bannière du « naturel » et de « l’Amour » : la bisexualité (baptisée parfois de « pansexualité »). De même que Marx proposait une société sans classe et les gender feminists une société sans sexe, les bobos queer pro-gay imposent un monde sans classe et sans sexe.
Nous allons maintenant observer les nombreuses passerelles qui existent entre les individus bobos et les individus homos/bis. C’est parti !
N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Amant triste », « Inversion », « Voyage », « Ennemi de la Nature », « Amour ambigu de l’étranger », « Femme au balcon », « Sommeil », « Trio », « Oubli et Amnésie », « L’homosexuel riche / L’homosexuel pauvre », « Chevauchement de la fiction sur la Réalité », « Drogues », « Dilettante homo », « Vent », « Peinture », « Amoureux », « Innocence », « Mère Teresa », « Méchant pauvre », « Cour des miracles homosexuelle », « Se prendre pour Dieu », « « Plus que naturel » », « Ville », « Artiste raté », « Morts-vivants », « Promotion « canapédé » », « Homosexualité noire et glorieuse », « Blasphème », « Désir désordonné », à la partie « Anti » du code « Faux révolutionnaires », à la partie « Afrique » du code « Noir », à la partie « Accident » du code « Passion pour les catastrophes », à la partie « Veuve » du code « Mort-Épouse », à la partie « Antiquaire homo » du code « Fresques historiques », à la partie « Mélomane » du code « Musique comme instrument de torture », à la partie « Mer » du code « Eau », à la partie « Bouddhisme » du code « Attraction pour la « foi » », à la partie « Ennui » du code « Manège », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.
FICTION
I – LA CONTRADICTION DES NOUVEAUX MATÉRIALISTES BISEXUELS :
Le bourgeois-rastaman révolté
Étant donné que les seules « valeurs révolutionnaires » qui aient du prix aux yeux du bobo sont l’inversion, la contradiction sociale, et l’opposition dans l’originalité, il était logique que la boboïsme s’oriente vers la bisexualité, et en particulier vers la sexualité des personnes jadis baptisées « les invertis » de la fin du XIXe siècle, à savoir les personnes homosexuelles.
Les films homo-érotiques mettant en scène un héros bobo, anti-système et homo malgré lui, sont nombreux : cf. le film « Humpday » (2010) de Lynn Shelton (dans lequel deux copains soi-disant « hétéros » se retrouvent, après une beuverie, en train de tourner un film porno ensemble), le film « Little Miss Sunshine » (2005) de Jonathan Dayton (avec l’oncle homosexuel bobo), le film « Un Élève libre » (2009) de Joachim Lafosse, le film « Good Morning England » (2009) de Richard Curtis (avec l’équipage underground du bateau aux mœurs très libérées : leur leader est une grande folle), le film « Le Mariage à trois » (2009) de Jacques Doillon, le film « Les Chansons d’amour » (2007) de Christophe Honoré, le film « El Niño Pez » (2008) de Lucia Puenzo, le film « Shortbus » (2006) de John Cameron Mitchell (dans lequel l’homosexualité est traitée comme un expérimentalisme artistique « conceptuel »), le film « A Single Man » (2009) de Tom Ford, tous les films de François Ozon et surtout « Le Refuge » (2009), le film « Totò Che Visse Due volte » (« Toto qui vécut deux fois », 1998) de Daniele Cipri, le film « Beautiful Thing » (1996) d’Hettie MacDonald, le film « Patrik 1.5 » (« Les Joies de la famille », 2008) d’Ella Lemhagen, le film « Un autre homme » (2008) de Lionel Baier, le film « Brüno » (2009) de Larry Charles, le film « J’ai tué ma mère » (2009) de Xavier Dolan, le film « L’Homme de sa vie » (2006) de Zabou Breitman, beaucoup de films avec l’icône gay Julianne Moore, le film « Fire » (1996) de Deepa Mehta, le film « Harvey Milk » (2008) de Gus Van Sant, le film « C.R.A.Z.Y. » (2005) de Jean-Marc Vallée, le film « The Bubble » (2006) d’Eytan Fox, le film « My Own Private Idaho » (1991) de Gus Van Sant, la chanson « Ce soir c’est moi qui fait la fille » de Vincent Baguian (traitant du glissement d’un hétéro vers la bisexualité), la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H. (avec le couple Jonathan/Matthieu qui prévoit de « bruncher » chez leur amie Sophie), le roman Bohème (2012) d’Olivier Steiner, la pièce Folles Noces (2012) de Catherine Delourtet et Jean-Paul Delvor (avec Jean-Paul qui est tout fier de boire son jus d’ananas bio du Gers), le film « Pride » (2014) de Matthew Warchus (avec Zoé et sa compagne qui sont végétaliennes), la pièce Le Mariage (2014) de Jean-Luc Jeener (avec Suzanne, la lesbienne végétarienne), le film « Bleus Cycle » (2013) de François Labarthe, le film « Bobo » (2012) de Bardi Gudmunsson, le téléfilm « Ich Will Dich » (« Deux femmes amoureuses », 2014) de Rainer Kaufmann, le film « À trois on y va ! » (2015) de Jérôme Bonnell, le film « La Belle Saison » (2015) de Catherine Corsini, etc. Par exemple, dans le film « Respire » (2014) de Mélanie Laurent, Sarah, l’héroïne lesbienne, a sa mère qui travaille apparemment dans une ONG en Afrique. Et la mère de Charlène (la copine de Sarah), séparée de son mari, confectionne des bijoux. Dans son one-woman-show Chatons violents (2015) d’Océane Rose-Marie, Océane, l’héroïne lesbienne, croque les bobos dont elle fait aussi partie, de son propre aveu. Dans le téléfilm « Just Like A Woman » (2015) de Rachid Bouchareb, Marilyn tombe amoureuse de Mona, une femme maghrébine avec qui elle va faire de la danse orientale dans un club.
Comme pour le bobo « l’amour n’a pas de sexe » (= comprendre « n’est pas sexué »), et que selon lui, dans les relations sexuelles humaines, il n’y a pas lieu de mettre la conscience avant l’expérience, la génitalité avant la « personne », la « relation », la « rencontre », l’« expérience sensible », la « surprise » – tous ces concepts qu’il poétise à l’excès, et vide de réalité –, il s’autorise tout et n’importe quoi en matière d’affectivité à partir du moment où, dans sa tête, il l’appelle « Amour » : « J’avais décidé de ne plus aimer les hommes. Mais toi, c’est différent. » (Arthur, le héros homosexuel, à son amant Vincent, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 44) Il se dit « ouvert » à tout, y compris à l’expérience homosensuelle. Même pas nécessairement « sexuelle » (selon sa propre définition de la sexualité). Avec un homme, avec une femme, peu importe : c’est l’instant et l’envie qui décideront pour lui !
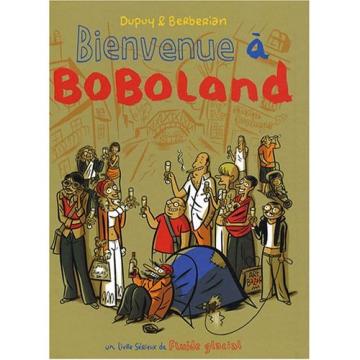
B.D. « Bienvenue à Boboland » de Dupuy & Berberian
Ce n’est pas un hasard que le couple gay soit l’un des archétypes du couple bobo dépeint par l’excellente B.D. satirique Bienvenue à Boboland (2008) de Dupuy & Berberian, (on ne s’étonnera pas non plus que le présentateur télé Franz-Olivier Lombard y soit baptisé « F.O.L. »…). Dans la pièce Nos amis les bobos (2007) d’Alain Chapuis, le chef du groupe des bobos est précisément homosexuel. Dans le film « On ne choisit pas sa famille » (2011) de Christian Clavier, Jean-Paul est le parfait « pédé bourgeois » qui rêve de voyage humanitaire en Thaïlande, dans son salon style colonial, mais qui est incapable de se séparer de son confort occidental ou de son petit roquet. Dans la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H., pour leur première rencontre (premier « plan cul », en fait), Matthieu et Jonathan choisissent d’aller non pas au Marais (jugé trop « beauf ») mais dans un resto indien de Saint-Germain-des-Prés. Je pense également à Adèle, l’héroïne du film « La Vie d’Adèle » (2013) d’Abdellatif Kechiche, qui dès les premières images, porte son bonnet péruvien ; à la fin, dans ses cours de professeur des écoles « cools Africa », elle fait danser ses petits de maternelle sur une chorégraphie de danse tribale pour la kermesse de l’école. Dans le film « The Boys In The Band » (« Les Garçons de la bande », 1970) de William Friedkin, Michael se rie du goût d’Emory, un de ses amis homos, pour la musique ethnique, qui serait « une de ses spécialités ». Dans beaucoup de films homo-érotiques d’ailleurs, les personnages homosexuels intègrent des milieux beaux-ardeux branchouille bobos : cf. le film « la Vie d’Adèle » (2013) d’Abdellatif Kechiche, le film « La Mante religieuse » (2014) de Natalie Saracco, le film « Chacun cherche son chat » (1996) de Cédric Klapisch, etc.
Dans la pièce Nous deux (2012) de Pascal Rocher et Sandra Colombo, Bernard, le héros homosexuel, est l’archétype de l’homo-bobo parisien : il est très attaché à ses petites affaires et ses fringues, est suspendu à son I-phone, organise des « slunch » (un néologisme de son cru, qui condense « souper + lunch »), se fait appeler « Jean-Kévin », travaille à la télé et dans la mode, voyage au Japon et mange dans des restos japonais, part vivre à la campagne pour quitter le stress parisien. Dans le film « Partisane » (2012) de Jule Japher Chiari, la protagoniste lesbienne Mnesya s’exprime comme un robot, et vit pourtant dans un refuge en pleine jungle indienne. Il n’est pas rare que l’homosexualité soit une résurgence, chez quelques personnages de fictions homo-érotiques, de la supposée « libération sexuelle » des années 1960. Par exemple, dans le film « Pride » (2014) de Matthew Warchus, Hevina avoue à Cliff qu’elle s’est découverte lesbienne « depuis 1968 ». Dans le film « A Moment in the Reeds » (« Entre les roseaux », 2019) de Mikko Makela, Leevi, le héros homosexuel finlandais, se fait chambrer par son amant syrien Tareq sur « son côté bohème ».
Certains héros homosexuels sont définis – ou se définissent eux-mêmes – ouvertement comme « bobos » : « C’est pas parce que t’es né chez les bobos que la vie es forcément PINK. » (Didier Bénureau dans son spectacle musical Bénureau en best-of avec des cochons, 2012) ; Dans le film « Vita et Virginia » (2019) de Chanya Button, la maman de Vita Sackville-West, Lady Sackville, reproche à sa fille lesbienne de rester enfermée dans « sa bulle bohème et dépravée » ; « La vie, c’est pas trop rigolo quand t’es élevé chez les bobos. » (idem) ; « Au Café de Flore y’avait déjà des folles. » (cf. la chanson « Et mon père » de Nicolas Peyrac) ; « cette classe de jeunes bourgeois-bohème dont Alice et toi faites partie » (Denis s’adressant à son amant secret bisexuel Luther, dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta) ; « Le jeune Marius, il sort de la noblesse, mais il se la joue bohème. » (Valjean dans la comédie musicale Les Miséreuses (2011) de Christian Dupouy) ; « Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l’amour infini me montera dans l’âme. Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la Nature, – heureux comme avec une femme. » (cf. le poème « Sensation » (1870) d’Arthur Rimbaud) ; « Je vais par les chemins. Un peu bohème. Je ne m’attache à rien. » (cf. la chanson « Boulevard des rêves » de Stefan Corbin) ; « Nous sommes bien dans notre peau, qu’on soit bobo, qu’on soit prolo. » (les protagonistes homosexuels de la comédie musicale À voix et à vapeur (2011) de Christian Dupouy) ; « En écoutant la fin du troisième acte de La Bohème ce jour-là, je me fais une promesse qui me met un peu de couleurs aux joues et m’accroche un sourire de satisfaction. C’est un rêve encore, bien sûr, mais je sens que c’est l’ultime échappatoire avant le grand plongeon, un dernier accroire, comme dirait ma mère, avant la vraie chose, et je m’y vautre avec une évidente complaisance. » (le narrateur homosexuel parlant de l’opéra La Bohème de Puccini dans le roman La Nuit des princes charmants (1995) de Michel Tremblay, p. 20) ; etc. Par exemple, dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson, Stéphane Belcour, le héros homosexuel quinquagénaire (aimant le « luxe et vivant en palace), est décrit comme un vieux beau « au look bohème travaillé ».
Contrairement à l’idée reçue selon laquelle les comportements homosexuels ne se rencontreraient qu’en milieu bourgeois et propret, on voit beaucoup d’homosexualité dans les sphères relationnelles « plus bohèmes que bourgeoises », les milieux « cools », « roots », et « babos » dépeintes dans les fictions : « Dormant dans des hôtels crasseux et mangeant des mets douteux, son bonheur tenait surtout au sentiment d’être un vrai routard. » (Dimitri dans le roman Pavillon noir (2007) de Thibaut de Saint Pol, p. 88) ; « Ça doit pas être facile d’être une lesbienne au Népal. » (Hélène parlant de Clothilde, le personnage lesbien de la pièce Cosmopolitain (2009) de Philippe Nicolitch) ; « On ne s’est jamais entendu avec les bourgeois. » (Alfonsine, la bourgeoise, dans la pièce Le Cheval bleu se promène sur l’horizon, deux fois (2015) de Philippe Cassand) ; etc.
Détrompons-nous ! Concrètement, le héros bobo bisexuel est aussi rastaman, anti-system, sans le sou, marginal, punk. Il fait certes plutôt partie de la famille de l’homosexualité de circonstance, de ceux qui viennent à la pratique homosensuelle et homo-érotique par « accident », par ignorance, par expérimentalisme (lui dira « par ouverture »), par l’absorption de drogues (comme on peut le voir avec le personnage du rastaman gay de la pièce Bang, Bang (2009) des Lascars Gays), plutôt que parce qu’il ressent précocement un désir homosexuel en lui. Mais la « grande folle » maraisienne sophistiquée n’est pas la seule à être un bourgeois dandy. Le bobo fictionnel est aussi un individu homosexuel tardif, avec un passif dit « hétérosexuel ». C’est l’homme bisexuel par excellence, qui n’ira pas forcément jusqu’à coucher avec des garçons, mais qui testera volontiers la fascination qu’il engendre chez les individus plus profondément homosexuels que lui. Le bobo est un séducteur né, ne l’oublions pas. Il drague tout ce qui bouge. Et les garçons (ou les filles, pour le cas lesbien), ça bouge aussi ! Dans la série Clara Sheller (2005) de Renaud Bertrand, par exemple, Gilles, le voisin homo (plutôt « bi » en réalité, parce qu’il se doit d’être « trop open » et de rejeter les étiquettes, bien entendu), mal rasé, exerçant le métier d’ébéniste (détail important : contact avec la matière et la création, c’est capital), est le prototype du bobo. Dans le film « Qui a envie d’être aimé ? » (2010) d’Anne Giafferi, Alain (le frère d’Antoine, interprété par Benjamin Biolay), bobo alcoolique, dit avoir « un copain ». Dans le film « Les Témoins » (2006) d’André Téchiné, Sarah (Emmanuelle Béart) incarne également une parfaite bobo : elle se lance dans l’écriture de livres pour enfants (finalement, elle se lassera assez vite de ce métier : le bobo entame des tas de projets mais a du mal à les mener à terme), incarne la femme « moderne » capricieuse, indépendante, libertaire, la mère démissionnaire, la femme-enfant. Dans le film « Prête-moi ta main » (2006) d’Éric Lartigau, Charlotte Gainsbourg est aussi un beau spécimen de femme bobo bisexuelle : elle joue la bad girl au cœur tendre, bordélique, qui adore la peinture, les jouets en bois, et qui, par son incorrection, donne une leçon d’humanité à tout son entourage. Dans la comédie musicale HAIR (2011) de Gérôme Ragni et James Rado, les personnages homos sont tous des trentenaires en perte de repères, rêvant de vivre en ermites en Inde, promouvant une économie solidaire (Burger et Claude se fabriquent leur pain eux-mêmes, par exemple). Dans le one-man-show Hétéro-Kit (2011) de Yann Mercanton, la « fille à pédés » lesbienne tricote des pulls pour les bébés gorilles du Kilimanjaro (une cause très utile).

Rastaman gay de la pièce « Bang, Bang » des Lascars Gays
Le héros bobo bisexuel est un enfant, et surtout un petit-enfant de mai 1968, de la supposée « Libération sexuelle » (celle qui a mal tourné…). Il est bourré de contradictions, écartelé entre les objets (= nouvelles technologies) et la Nature, son passé qu’il renie et son futur qu’il fuit, l’« éducation » permissive qu’il a reçue et ses désirs d’indépendance que celle-ci lui a imposés. Par exemple, dans la pièce Les Homos préfèrent les blondes (2007) d’Eleni Laiou et Franck Le Hen, Cosmos, le typique homosexuel, a des parents babas-cools. Dans le film « Saturn’s Return » (2001) de Wenona Byrne, Barney, le héros homosexuel, est fils de deux hippies « soixante-huitards attardés » qui l’ont abandonné depuis qu’il était enfant, et qui l’ont rendu dépendant des drogues. Dans le film « Margarita » (2014) de Dominique Cardona et Laurie Colbert, Margarita évolue comme nounou dans une famille de bobos de Toronto (Canada). Dans la série Ainsi soient-ils (2014) de David Elkaïm (épisode 2 de la saison 1), la mère de Guillaume, le séminariste homo, est possessive, illuminée, babos et bobo, voulant partir en Inde alors qu’elle est sous anti-dépresseurs et qu’elle a été quittée par son mari. Dans la série Faking It (2014) de Dana Min Goodman et Julia Wolov, les parents de Karma (l’héroïne pseudo lesbienne) sont hyper bobos et consomment du bio.

Film « Unveiled » d’Angelina Maccarone
Par certains côtés, le bobo se montre réfractaire à la modernité, à la civilisation, et à la consommation… et par d’autres, il ne peut pas vivre longtemps à la campagne, loin des gadgets de la société de consommation : « Tu vois Mimile, j’t’observe. Et j’me demande si tu ne regrettes pas ta p’tite vie de bourgeois parisien. » (Jeff à son compagnon Mimile, venu vivre avec lui au fin fond du Cantal, dans la pièce Les Babas Cadres (2008) de Christian Dob)
Le bobo, même s’il est riche matériellement, s’auto-persuade qu’il est pauvre, non pas parce qu’il manquerait effectivement d’argent, mais uniquement parce qu’il a peur d’en manquer (concrètement, il faut comprendre que pas un riche ne supporte de se comprendre riche, ne s’imagine une seule seconde se définir comme tel !) : « Le fait est que je n’ai pas d’argent ! Vous avez déjà entendu parler de la crise économique ?!? » (la Marquise millionnaire du film « Entre Tinieblas », « Dans les ténèbres » (1983) de Pedro Almodóvar) ; « Les pauvres n’imaginent pas les soucis que les gens aisés ont avec leur personnel. Ils sont trop gâtés, et puis c’est tout ! » (le protagoniste homosexuel imitant sa mère bourgeoise, dans le one-man-show Gérard comme le prénom (2011) de Laurent Gérard) ; « Mais j’avais un problème : quoi porter ? On ne s’habillait pas n’importe comment pour aller à l’opéra. […] Je n’allais tout de même pas me présenter devant le Tout-Montréal déguisé en cousin pauvre ! Même si je n’étais que le cousin pauvre du cousin pauvre ! […] J’aimais mieux faire artiste que péquenaud. » (le narrateur homosexuel dans le roman La Nuit des princes charmants (1995) de Michel Tremblay, p. 39) ; etc.
Le bobo est un enfant gâté du capitalisme, qui voudrait avoir plus d’argent et d’honneurs, mais qui s’annonce comme un « plus pauvre que lesdits bourgeois » pour leur ravir discrètement leur place (cf. le film « Eat The Rich » (1987) de Peter Richardson), qui se déguise en pauvre pour arriver à ses fins. Revient très souvent dans son discours l’attaque contre « les riches », les banquiers (cf. la chanson « Paradis imaginé » du rappeur Monis) et contre les intellectuels bourgeois : « J’en ai bouffé, de la culturalité ! » (Prétorius, le vampire homosexuel précieux de la pièce Confessions d’un vampire sud-africain (2011) de Jann Halexander) ; « Je les vomis. […] Je hais les mini et les super-puissants !!! » (Belle Espérance en parlant des riches et des « gens de la Haute » dans la pièce Les Oiseaux (2010) d’Alfredo Arias, 2010) ; « Sales bourgeois ! » (Daphnée, la bourgeoise-bohème par excellence, dans la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi) ; etc. Il exprime sa haine du libéralisme économique et du système capitaliste, en affichant comme un étendard son goût pour le dénuement matériel et un mode de vie champêtre en apparence spartiate et bordélique, en total décalage avec l’éducation étriquée qu’il aurait reçue. « J’en ai marre de la vie civilisée. » (Ray Smith dans le roman Les Clochards célestes (1963) de Jack Kerouac, p. 89) Dans l’idée, il se positionne contre la mondialisation (… sauf quand celle-ci est au service de son idée de l’« humain » à lui !).
Qu’il soit matériellement riche ou non (il appartient généralement à la classe moyenne d’ailleurs), le bobo est tellement obsédé par l’intention (son refus de l’argent et de la propriété, son dégoût des fascismes historiques, sa soi-disant « clairvoyance » quant à la bobo attitude et ses limites, sa passion pour l’authenticité – humaniste dans l’idée mais misanthrope dans les faits –, etc.) qu’il en devient artificiel, et donc bourgeois. Il se veut, comme le personnage homo de Sébastien dans le film « Suddenly Last Summer » (« Soudain l’été dernier », 1960) de Joseph Mankiewicz, « plus bourgeois que bourgeois » : « Sébastien n’avait pas le snobisme de la caste ou de la fortune… mais c’était un snob tout de même. Il avait le snobisme de la beauté et de l’élégance des objets, du charme personnel et de la grâce physique des êtres. » Le bobo est un bourgeois rebelle, « chemise ouverte et chaîne en or qui brille », mettant les pieds sur sa table de bureau de publiciste, tutoyant (dans ses rapports professionnels) les gens qu’il veut soumettre en les appelant par leur prénom et en surjouant la fausse camaraderie. C’est un crooner et un dragueur des bacs à sable (en général « vieux beau »), un aristo « éclairé » qui aurait la simplicité et la distance qu’un bourgeois ordinaire n’aurait pas, tout en ayant miraculeusement conservé la « classe » et le sex-appeal du bourgeois : « J’ai la faiblesse de penser que nos dialogues valent mieux que les conversations de salon. » (la figure de Marcel Proust parlant à son amant Vincent dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 165) Bref. C’est un petit péteux.
Le héros bobo bisexuel fait partie de ces « riches » qui se rêvent « bourgeois partiels », « bourgeois ratés » comme dirait Pierrette (Fanny Ardant) dans le film « Huit Femmes » (2002) de François Ozon, car son désir homosexuel l’oriente davantage vers le paraître ou l’avoir que vers l’être et l’aimer. « Il faut que je t’avoue quelque chose : je ne suis pas riche. Je suis une mythomane. En fait, j’habite dans une chambre de bonne, rue Monsieur-le-Prince. Je ne m’habille en femme que pour sortir le soir. » (Micheline, le travesti M to F, s’adressant à son amant maghrébin Ahmed, dans la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi) ; « J’ai beau être chauffeur-livreur, je suis le mec le plus snob de la planète. » (Eugène dans le one-man-show Un Barbu sur le net (2007) de Louis Julien) ; « J’ai du mépris pour les choses légères. » (Chris, le héros homo du roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 49) ; etc. D’ailleurs, il habite en général dans un bel appart ou un loft savamment (et, quelque part, sobrement) décoré : cf. le film « The Bridge » (2005) de George Barbakadze (l’appartement aseptisé de Niko et Luka), le film « Rue des Roses » (2012) de Patrick Fabre (où Medhi et son jeune amant Axel vivent dans un superbe appartement), le film « Bug Chaser » (2012) de Ian Wolfley (où l’amant noir de Nathan possède une coquette demeure design), la pièce Sugar (2014) de Joëlle Fossier, la pièce Gouttes dans l’océan (1997) de Rainer Werner Fassbinder (Léopold et Franz vivent dans un appartement épuré et « chic » à la fois, qui fait leur fierté, et où ils peuvent écouter leurs disques de jazz)etc.

Film « Bug Chaser » de Ian Wolfley
En règle générale, il n’apprécie pas du tout d’être associé à ces bourgeois planqués ou ratés que sont les bobos. Pour lui, le mot « bourgeoisie » ne va pas avec militantisme homosexuel, anti-capitalisme, intellectuel clope au bec et muni d’un livre d’un auteur classique, bar « crade » de Saint-Germain-des-Prés, appartenance à la gauche politique et au socialisme, dénuement matériel, haine de la mondialisation, dénonciation de la société de consommation, piano-bar et clope, « plaisir de désobéir » (cf. le film « Un autre homme » (2008) de Lionel Baier), tous ces séduisants concepts dont il s’imagine être le digne représentant. Par exemple, dans le film « Les Enfants terribles » (1949) de Jean-Pierre Melville, Élisabeth a « peur d’avoir l’air riche ». Dans le roman La Vie est un tango (1979) de Copi, Silvano « aime le luxe » mais craint par-dessus tout que cela se sache (p. 30), que son identité de provincial « ploucos » débarquant à Buenos Aires soit démasquée. Dans la pièce Le Funambule (1958) de Jean Genet, adaptée par Pierre Constant, le protagoniste veut qu’Abdallah cultive vestimentairement « une misère apparente ». Dans le film « Que Viva Eisenstein ! » (2015) de Peter Greenaway, Sergueï Eisenstein, homosexuel, est le bourgeois qui prend la cause des pauvres, parce que ça fait bien. Il va tourner un film sur la Révolution communiste pour le style : « Mexico est à la mode pour tous les gens de gauche ». Dans le film « La Forme de l’eau » (« The Shape of Water », 2018) de Guillermo del Toro, Giles, le personnage homo âgé, aime porter des vêtements rétro qui « font décontracté et chic » à la fois.
Dans la pièce Les Favoris (2016) d’Éric Delcourt, Guen, le héros homosexuel, est l’archétype du bobo : il prépare du thé au jasmin, vit à Paris, fait brûler de l’encens dans son appart, se fait des plateaux sushis-bio avec sa voisine de pallier lesbienne, vit en couple homo avec Brice mais est contre le mariage gay, , aide aux Restos du Coeur, vote à gauche, mais diabolise la droite et se montre très sectaire avec ceux qui ne pensent pas comme lui.
Au bout du compte, « l’homosexuel » est ce jet-seteur écartelé entre Nord et Sud, symbolisant la fracture économique mondiale entre pays riches et pays pauvres, rêvant, comme le businessman de Starmania, à la fois d’« être un anarchiste et [de continuer à] vivre comme un millionnaire », « ne pouvant pas supporter la misère » et la voulant éternelle pour sauvegarder ses privilèges ou son rôle de bon samaritain. Il ne désire pas l’union entre ceux qu’il classe parmi les « riches » et ceux qu’il étiquette « pauvres » et qui doivent surtout le rester : dans les films homosexuels, le mélange inter-classes sociales ne s’opère quasiment que par le sexe, l’esthétique, l’émotionnel, la consommation, ou l’oppression.
Par exemple, dans le roman Gaieté parisienne (1996) de Benoît Duteurtre, le héros homo sexuel Nicolas, pseudo artiste anticonformiste, est en réalité chef d’entreprise. Dans le film « Taking Woodstock » (« Hôtel Woodstock », 2009) d’Ang Lee, Elliot, le jeune garçon hippie homosexuel, devient businessman et va s’enrichir grâce au festival de musique. Dans le roman Une Saison en enfer (1873) d’Arthur Rimbaud, le protagoniste revendique son statut d’« esclave » alors que par ailleurs il dit qu’« il exècre la misère ! ». Dans le one-man-show Elle est pas belle ma vie ? (2012) de Samuel Laroque, le PS est qualifié de « Parti des Sodomites » à la place de « Parti Socialiste » (Jack Lang et toute l’équipe de Bertrand Delanoë et de François Hollande peuvent en effet se sentir implicitement visés…).

Jack Lang
La sacralisation de la différence conduit forcément le bobo à la (l’auto-)contradiction, à la (l’auto-)trahison… puisqu’un beau jour, une différence viendra forcément s’opposer à la mienne ! Le bobo trouve sa fierté à accepter chez lui y compris ce qu’il trouverait honteux ou avilissant chez les autres (par exemple, quand il regarde une émission de variété ou de télé-réalité, il s’empressera de trouver sa démarche « géniale », exceptionnelle, décalée, sociologique, hilarante, limite subversive… quand il la trouvera « beauf » et « à vomir » chez les autres), car il se donne ainsi à lui-même les signes tangibles de son incroyable ouverture d’esprit. Même quand il fait preuve de mauvais goût, il se persuade qu’il a bon goût parce qu’il choisirait le mauvais goût en connaissance de cause : « Le charme de l’île Moustique tenait à son absence de charme ; et à son sens cultivé du snobisme, du ridicule et du mauvais goût. » (Emmanuel Pierrat, Les Dix Gros Blancs (2005), p. 22)
Dans les fictions homo-érotiques, les élites bobos homos, revendiquant leur marginalité pour gravir l’échelle sociale et s’assurer une place au soleil, et se valant de l’excuse de l’Art afin d’asseoir leur autorité, sont légion. On retrouve les « théâtreux branchouille », la « jet set d’écrivains de pacotille », les « adeptes mondains de design architectural », les « rats de musée contemporain », par exemple dans la pièce La Estupidez (2008) de Rafael Spregelburd (avec Richard et Emma, les bobos « néo-modernes »), la pièce Les Amazones, 3 ans après… (2007) de Jean-Marie Chevret (avec Annie, la bourgeoise adepte du mobilier design minimaliste ou étrange), le film « Grégoire Moulin contre l’Humanité » (2002) d’Artus de Penguern (avec Bénureau en bobo libertin néo-baroque), le film « Nos Vies heureuses » (1999) de Jacques Maillot, le film « Musée haut, Musée bas » (2007) de Jean-Michel Ribes (avec Sulku et Sulky), le film « Le Goût des autres » (1999) d’Agnès Jaoui (avec le couple de galeristes homos présomptueux), etc.
Côté chanson, le personnage bobo aime particulièrement les musiques peu populaires et alternatives : la musique métal ou punk par exemple (cf. le film « New Wave » (2008) de Gaël Morel), la musique planante et soporifique à la Björk ou à la Portishead (cf. le spectacle musical Panique à bord (2008) de Stéphane Laporte – avec Kévin, le fan gay de Björk –, le roman Riches, cruels et fardés (2002) d’Hervé Claude – avec Victor écoutant Björk, etc.), la musique électro (qu’on peut vraiment savourer qu’avec un gros coup dans le nez ou une bonne dose de poppers), la soupe « soul », la chansonnette de l’artiste autodidacte (au piano ou avec son orgue de barbarie), la fanfare tzigane ou africaine, etc. Tout du moment que ce n’est pas encore étiqueté « commercial » et que ce n’est pas trop connu !
En réalité, le bobo bisexuel est un consommateur qui ne veut pas se voir consommer, ni se « pétassiser »… pour mieux consommer en douce : « C’est simple, si la vie était un magazine féminin, j’habiterais un superbe loft duplex de 458 mètres carré mansardé avec poutre apparentes, beaucoup de cachet… Je ne pourrais pas travailler, ah ben non, je suis une femme libérée mais comment vous voulez que je bosse avec toutes les choses que j’ai à acheter… » (le Comédien dans la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier) ; « Je regarde pas la télé. Je déteste raconter des histoires grasses ou vulgaires. Et puis j’aime pas le foot. Je fais pas mes courses le samedi, et puis surtout pas au supermarché. J’achète même pas en fonction des pubs. J’essaie même pas d’être à la mode. » (Jarry, pourtant attiré par le strass et les paillettes, dans le one-man-show Entre fous émois (2008) de Gilles Tourman); etc.
Par exemple, dans le roman Le Cœur éclaté (1989) de Michel Tremblay, Mathieu et Jean-Marc composent le parfait couple homo bobo de consommateurs. Ils vont à leur rendez-vous cinématographique annuel : le Festival des Films du Monde. Ce sont les amants globe-trotters, qui planifient à chaque vacances un voyage lointain et exotique hors des sentiers touristiques dits « classiques » (… et Dieu sait s’il en existe beaucoup en vrai, des couples homosexuels comme celui-là !). Une fois que Mathieu quitte Jean-Marc, ce dernier consomme autrement, en veuve déprimée : il se paye une nuit d’hôtel dans sa propre ville alors qu’il n’aspire qu’à retrouver son vrai lit, part sur un coup de tête en voyage sur une île, décommande des soirées amicales pour aller voir au cinéma un navet qui le déprimera encore plus, etc. Il ne voit pas pourquoi ses désirs futiles passeraient après ses désirs plus constructifs, puisque dans l’instant, rien ne les distingue, et qu’il ne faut, selon lui, « jurer de rien ».
II – LA DÉPRIME SPIRITUELLE :
L’obsession pour le naturel sensible

Film « A Marine Story » de Ned Farr
D’habitude, pour prouver la force de sa sincérité, le héros bobo bisexuel se focalise sur la Nature. Il est obsédé par la spontanéité, l’instantanéité des sensations et des pulsions, la recherche des origines, l’authentique « sobre », la création de Nature et des sens : cf. la chanson « La Bourgeoisie des sensations » de Calogéro (traitant de la bisexualité d’une femme qui part avec une autre après avoir été en couple avec un homme).

Film « Le Secret de Brokeback Mountain » d’Ang Lee
Dans un soubresaut de conscience citoyenne, et surtout pour pallier à son désert affectif intersidéral, il fuit la ville et la société de consommation, et décide de se mettre au vert (même s’il fume souvent comme un pompier, et qu’ouvrir son jardin aux « Roms », très peu pour lui !). Le bobo fuit la ville et la société de consommation : cf. le film « Leaving Metropolis » (2002) de Brad Fraser, le film « Torch Song Trilogy » (1989) de Paul Bogart (avec Ed et Arnold, le couple homo « champêtre »), le film « El Niño Pez » (2008) de Lucia Puenzo (racontant la fuite de la ville vers une forêt), la chanson « Mon coloc » de Max Boublil (avec le colocataire écolo particulièrement à cheval sur les économies d’eau), le film « Oublier Chéyenne » (2004) de Valérie Minetto, etc. « Je ne pars que pour six mois. Je ferai une tonne d’argent, et l’on va l’avoir, notre maison de campagne. » (Ginette s’adressant à sa compagne Lucie, dans le roman Accointances, connaissances, et mouvances (2010) de Denis-Martin Chabot, p. 30) ; « Moi, mon rêve, ce serait un mec proche de la Nature. » (Gwendo dans le one-man-show Hétéro-Kit (2011) de Yann Mercanton) ; « Oui. Le gay boit du thé. » (le narrateur homosexuel dans le one-man-show Les Gays pour les nuls (2016) d’Arnaud Chandeclair) ; etc.

Film « Oublier Chéyenne » de Valérie Minetto
Le héros bobo bisexuel va jusqu’à se prendre pour la Nature même. Nombreux sont les passages de films ou les extraits de romans homo-érotiques dans lesquels il joue la symbiose parfaite avec le « Cosmos ». Par exemple, dans le film « Como Esquecer ? » (« Comment t’oublier ? », 2010) de Malu de Martino, Julia, l’héroïne lesbienne, affirme adorer rester sous la pluie, marcher face à la mer sur son ponton (vous savez, comme dans la pub du parfum Fahrenheit), accompagnée par les violons.
Le bobo se choisit comme nouveau Dieu le reflet embellissant de lui-même que lui renverrait la Nature. Cette Nature en question a pour particularité d’être prise pour un être humain, et surtout de ne pas être dominée par l’Homme (En gros, ce n’est pas une Nature biblique). Dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta, par exemple, Denis, la voix-off, nous dit qu’« on ne tutoie pas l’aube. » ; il nous montre les images d’une Nature capricieuse et dévastatrice (celle du tsunami sur Fukushima, au Japon), « le bruit de fond du monde ».
Allez viens, j’t’emmène au vent !… ou face à la mer

Film « Drôle de Félix » de Ducastel et Martineau
Dans les fictions bobos-homos, l’Homme se laisse entraîner par les éléments naturels, et particulièrement par les forces invisibles que sont le vent ou l’eau. « Je vais comme les gens de rien vers le destin. […] une brindille dans le vent, une goutte d’eau dans l’océan. » (cf. la chanson « Boulevard des Rêves » de Stefan Corbin) Le vent, dans ce cas, c’est le désir qui s’enfuit, qui se fige en esthétisme sentimentaliste et meurt ; c’est la liberté qui se liquéfie et se quitte : « J’entends le vent […] giflé par les rafales d’un vent d’est. » (Stefan Corbin lors de son concert Les Murmures du temps au Théâtre de L’île Saint-Louis Paul Rey, à Paris, en février 2011) ; « Comme une vague se retire pour mieux revenir, mes sentiments refirent surface avec une force inouïe, décuplée et incontrôlable. J’étais comme le capitaine d’un navire perdu en pleine tempête, sans savoir quoi faire. Parfois persuadé qu’il valait mieux faire demi-tour, parfois convaincu de mon insubmersibilité et qu’il fallait au contraire aller de l’avant. Mais peu importe puisque la barre ne répondait plus et que j’allais au hasard, porté par les vents, par cette force invisible qui s’appelle l’amour et qui n’obéit à aucune règle, à aucune loi ni à aucune logique. » (Bryan, le héros homo du roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 36) ; « Encore un jour contemplatif où je fais l’idiot au bord de la falaise, les yeux dans les récifs. » (cf. la chanson « À force de retarder le vent » de Jann Halexander) ;
Le héros bobo bisexuel a trouvé dans les espaces de l’infini que sont l’océan et le ciel les lieux idéaux où déverser son âme et son désir pour ne plus jamais les retrouver : cf. la chanson « Parler aux mouettes » de Stéphane Corbin, le film « Contracorriente » (2011) de Javier Fuentes-León, le film « Storm » (2009) de Joan Beveridge, le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta (avec Luther, le héros homo habitant une maison-bateau en Californie), la pièce Confessions d’un vampire sud-africain (2011) de Jann Halexander (avec Prétorius se racontant face à la mer), le film « The Bridge » (2005) de George Barbakadze, le film « Cloudburst » (2011) de Thom Fitzgerald (avec Dotty, l’héroïne lesbienne, face à la mer), le film « Prora » (2012) de Stéphane Riethauser (avec Jan, le héros fixant l’océan), le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza (avec Toph et son amant Zach face à la mer, assis sur un toit), le téléfilm « Clara cet été-là » (2003) de Patrick Grandperret, le film « Praia Do Futuro » (2014) de Karim Aïnouz, etc. Par exemple, dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson, Stéphane, le romancier homo bobo, écrit des pages entières sur les bords de mer ; son ex-amant Vincent rentre dans le même « trip » sentimentalo-gélatineux maritime (« Je vais aller marcher sur la plage, en attendant… »), même s’ils se défendent ensuite tous les deux de sombrer dans le « cliché ». Bref, la mer et le vent constituent les parfaits miroirs narcissiques du bobo… et ce qu’ils lui font dire – c’était à craindre – c’est bien du vent ! des larmes de joie forcée et surtout de déprime à la Mickey 3D !
« Aimer jusqu’à l’aurore, aimer encore, aimer le ciel. » (cf. la chanson « Lonely Lisa » de Mylène Farmer) ; « J’aime les fleurs et le vent dans les branches. » (Aldebert dans la comédie musicale HAIR (2011) de Gérôme Ragni et James Rado) ; « Impuissante, épuisée, Gabrielle regardait encore parfois la mer au loin comme le naufragé attend le secours d’une voile à l’horizon. Mais l’océan turquoise restait désespérément vide. Vide comme son âme qui ne trouvait pas le repos. » (cf. les dernières lignes du roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami, p. 209) ; etc.
On voit souvent, dans les fictions homosexuelles, l’image d’un rideau balayé doucement par le vent, comme la métaphore d’une démission ou d’un abandon du désir : cf. le film « L’Homme de sa vie » (2006) de Zabou Breitman, par exemple. « Dehors, par la porte-fenêtre encore ouverte, c’est toujours l’été, toujours le soleil, à peine un léger souffle qui fait se soulever un rideau, une chaleur, une douceur sur tout. » (Vincent, le héros homosexuel du roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 22)
La simulation de contemplation émue de la mer – et plus globalement l’exposition à la beauté esthétique (un joli film, un paysage grandiose, un grand concert classique, une belle expo, un coucher de soleil…) –, c’est la technique de drague la plus cheap (… et la caution morale la plus navrante) que le libertin bobo ait trouvée lors de sa première rencontre réelle avec l’ami internaute qu’il ne connaît que depuis quelques semaines (ou heures) et sur lequel il va se jeter à corps perdu le soir même, pour ne pas passer pour un chaud lapin … et pourtant, elle marche quasiment à tous les coups ! À croire que les héros homosexuels sont vraiment les proies faciles du romantisme bon marché ! Il suffit de jouer l’épicurien, l’Homme contemplatif devant la Nature, pour devenir irrésistible et crédible en amour : « Il m’entraîne dans le métro, sans mot, c’est long, puis dans les labyrinthes du Louvre, sur une petite prairie isolée par une barrière de buissons aux branchages nus, l’herbe gelée crisse sous nos pas. Il enlève ses deux gros gants, son écharpe, son bonnet, son manteau, son pull, son tshirt, il ordonne ‘Fais pareil’. Quand il a fini, dans son petit slip made in India, il s’allonge dans l’herbe, sur le dos. Je le rejoins, transis de froid. Il se tourne et murmure doucement en grelottant ‘Maintenant respire, fort, à fond, le plus possible, sens les odeurs, ferme les yeux, le froid ça va passer quand tu auras oublié où tu es. On est bien là, non ?’ Je chuchote un ‘oui’ à peine audible, mais j’ai envie qu’il me prenne dans ses bras. Il ne le fait pas. Petit à petit, il tremble moins. Je le regarde. Il est apaisé et étrangement calme. Je l’aurais cru mort si son ventre ne se levait pas à intervalle régulier. Je le trouve beau, jeune, fort. Après un moment, il se rhabille, je l’imite. Je lui demande son prénom, il répond ‘H.’ et j’ajoute ‘Tu vois, ce qui est important, c’est de vivre chaque instant. Peu importe quoi, peu importe avec qui.’ Puis il dit ‘Adieu’ et il s’en va sans se retourner. Je hurle le plus fort possible ‘Connard, gros connard, sale pédé de merde, va crever.’ » (Mike, le narrateur homo, en parlant de « H. » qu’il rencontre à la gare du Nord, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 61)
Le bobo bisexuel se sert de la Nature pour satisfaire son narcissisme égocentré de dragueur à deux balles. Il déguise ses pulsions égoïstes et sexuelles en hédonisme, en amour des plaisirs naturels, évacue de sa vie la quête du Sens au profit de la glorification vaniteuse des sens. « Liberté des corps, égalité des sexes (c’est moi qui prend la mesure), fraternité et sonorité ! Soyez vous-même, réveillez vos sens ! Ne dites jamais la première chose qui vous vient par la tête, c’est toujours de la fatalité, un réflexe… Soyez naturel, dites la deuxième ! Vous verrez, la deuxième chose qui vous vient à l’esprit, c’est souvent, le corps… » (la « folle » militante, dans la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier)
Comme le bobo bisexuel ne se choisit pas d’autre Dieu que lui-même et que son petit bagage de valeurs humanistes politiquement correctes (la tolérance, l’égalité, la différence, la solidarité, à peine le respect, etc.) qui ne veulent rien dire en soi, il lui arrive très souvent de faire preuve d’un holisme qui spiritualise les objets. Plus clairement, il prête des sentiments aux choses, aux animaux, aux paysages, bref, à tout ce qui possède très peu de désir et de liberté, contrairement à l’Homme : « Est-ce de l’une de ces statues que jaillit un gémissement nostalgique ? » (le narrateur homo de la nouvelle « Au Musée » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 112) ; « Les jours de pluie, mes jouets sont vivants. » (cf. la chanson « Parler tout bas » d’Alizée) ; « Les objets comme des collections de sable, témoins de nos escales dans le monde amoureux. » (le Comédien dans la pièce Les Hommes aussi parlent d’amour (2011) de Jérémy Patinier) ; « Autour de vous, le bourg défile à toute vitesse. Tu fixes les tours de brique et de silex du château de Dieppe. On dirait qu’elles te disent au revoir. » (Félix, l’un des héros homosexuels du roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 23) ; « Autour de toi, la nature prend des notes. » (idem, p. 100) ; « Tu es peut-être tout simplement dans ta chambre, avec cet ours stupide qui te regarde. Il ne connaît pas son bonheur ! Il veille sur toi depuis si longtemps. J’aimerais tellement être à sa place. » (Bryan à son amant Kévin, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 303) ; « Dans cette ville, on ne pouvait jamais être sûr de ce qui s’était passé. La souffrance s’imprégnait-elle dans les murs des bâtiments, les cris capturés telle une image sur une plaque photographique ? » (Jane, l’héroïne lesbienne, à propos de Berlin, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 39) ; etc. Ça s’appelle la schizophrénie animiste. Tout à fait.
Le bobo bisexuel applique une forme de « matérialisme vert », d’idolâtrie profane, si vous préférez. Paradoxal pour un être qui se veut détaché du matériel… Et beaucoup plus grave qu’on ne le pense, puisqu’à travers une idéologie apparemment alter-mondialiste et généreuse, il cherche à ne plus être libre et devient aussi matérialiste et superficiel que les matérialistes bourgeois qu’il prétend neutraliser : « Tout glisse et roule sur moi. Rien ne pénètre. » (Julia, l’héroïne lesbienne du film « Como Esquecer ? », « Comment t’oublier ? » (2010) de Malu de Martino) Il se présente comme un électron libre, un éternel errant (géographique et désirant), un globe-trotteur itinérant sans attache et sans but, totalement « free » dans sa tête, mais aussi peu libre : « Je suis habituée à ma vie de nomade. » (Helena, l’autre héroïne lesbienne du même film)
La sacralisation bobo du détail médiocre
Habituellement, le héros bobo bisexuel joue l’ermite-artiste s’émouvant lui-même d’être capable – dans l’adversité et le néant que serait sa vie – de capter malgré tout des petites choses de la vie (« ces petits rien qui font ces petits tout » comme le parodie l’humoriste Élie Sémoun) : cf. l’album Être amoureux : Petits bobos, petits bonheurs (2005) d’Élisabeth Brami, les chansons « Des milliers de baisers » et « Je t’aime encre » de Céline Dion, la chanson « La Liste » de Rose, le roman La Première Gorgée de bière et autres plaisirs minuscules (1997) de Philippe Delerm, le film « C’est une petite chambre aux couleurs simples » (2013) de Lana Cheramy, etc. Sa fausse humilité s’exprime par un manque de prétention. Il choisit petit car c’est un petit joueur, qui s’installe dans sa timidité, sa lâcheté et une sobriété tellement forcée qu’elle en devient bourgeoise. « C’est ça le plus important : les petites choses. » (Camille, la mère dans le film « Après lui » (2006) de Gaël Morel) ; « Il y a toujours des raisons de s’émerveiller, de voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. » (Stéphane Corbin lors de son concert Les Murmures du temps au Théâtre de L’île Saint-Louis Paul Rey, à Paris, en février 2011) ; etc.
L’Homme spirituel mais sans Dieu
Comment vivre sa spiritualité tout en renonçant à Dieu-Église ? Le personnage bobo bisexuel tente d’opérer ce tour de force impossible en misant toutes ses « forces » et ses espoirs sur lui-même et sur les Hommes. Autant dire qu’il se prépare à de grosses déceptions ! car l’Homme sans Dieu et sans Institution religieuse à son service devient vite un triste saint, un égoïste relativiste, un goujat (sans autre morale que ses envies du moment et ses petites « valeurs »), un indifférent, un salaud que rien ne touche : « J’étais soudain libre. Libre et libérée du fardeau de la connaissance, et donc de toute morale qui en découle. Seuls comptaient les sentiments. Et les sensations. » (Anamika, l’héroïne lesbienne du roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, p. 27) ; « Je suis l’enfant insouciant. Je n’ai pas de morale. » (Vincent, le héros homosexuel du roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, pp. 46-47) ; « D’ailleurs, rien n’est grave. » (idem, p. 30) ; « Je pourrais être, si l’on m’autorisait cette formule usée, le bel indifférent. » (idem, pp. 26-27) ; « Il faut passer par des chemins de traverse, porter un chapeau mou, une écharpe, avoir l’air de rien. » (Félix dans le roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 56) ; etc.
Chez lui, l’indifférence individualiste est fêtée comme une singularité, une pureté, un luxe, une audace, une posture esthétique de dandy. « Cette indolence est ma signature, cette nonchalance. » (Vincent dans le roman En l’absence des hommes de Philippe Besson, p. 151) ; « Je suis éloigné de toute idée de provocation. Je dis les choses comme elles me viennent sans véritablement les réfléchir. » (idem, p. 142) ; « Vous êtes ainsi, n’est-ce pas ? indifférent. […] C’est en hommage à votre pureté absolue, à votre honnêteté quasi virginale que je souhaite témoigner. » (la figure de Marcel Proust s’adressant à son jeune amant Vincent, op. cit., pp. 105-106) Péteux pédant pédé, je vous dis.
Le héros bobo bisexuel croit en une sainteté accidentelle et non-libre : cf. le film « Nazarín » (1958) de Luis Buñuel, le film « L’Évangile selon saint Matthieu » (1964) de Pier Paolo Pasolini, etc. « Le jeûne assis durera quarante jours et prendre fin comme il aura commencé, sans que je le décide vraiment. » (Vincent Garbo dans le roman éponyme (2010) de Quentin Lamotta, p. 111) Et comme il essaie quand même de trouver parfois un sens à sa vie, et répondre à sa soif de croyance, il va souvent essayer de se créer une « home-made religion » sans Dieu, sans Institution ecclésiale, sans incarnation. Et là, c’est le ridicule assuré…
On le voit imiter les rites catholiques sans en assumer l’âme, en les instrumentalisant sous forme de folklore New Age ou bouddhisant pour s’autosacraliser lui-même. Comme le démontre très justement l’historienne Marie Pinsard, « chez le bobo, tout est rituel, rien n’est sacré ». Le bobo bisexuel s’habille tout en blanc, compose des « chansons du dimanche », adopte un nouveau calendrier avec des fêtes qui ne sont plus festives (la Fête du Sida, la Journée mondiale de la Lutte contre l’Homophobie, la Fête de la Musique, la Marche des Fiertés, etc.), fait brûler les barrettes d’encens dans son salon, s’embaume de toute sorte de crèmes relaxantes et d’huiles essentielles, fait des chemins de saint Jacques non-agréés avec ses amis randonneurs, met des bougies (on y revient tout de suite après) autour de sa baignoire et dans sa chambre à coucher, participe à des ateliers sophrologie ou massages, fout son canapé dans des endroits improbables (comme les Cranberries), etc.

Film « Contracorriente » de Javier Fuentes-León
« Là-bas, la marche est devenue une religion ! » (Suze, l’héroïne lesbienne partie « se ressourcer » en Ardèche, dans le one-woman-show Wonderfolle Show (2012) de Nathalie Rhéa)
Le héros bobo bisexuel rêve d’une cérémonie de mariage dans une yourte, dans une forêt « celtique », ou face à la mer (les églises-bâtiments, c’est ringard, c’est vrai…), brillante de mille feux et de mille pétales de roses (c’est bio, les pétales de roses), en partant en amoureux en pirogue, en bicyclette ou sur une caravane tzigane : cf. le film « Rachel Getting Married » (« Rachel se marie », 2008) de Jonathan Demme, le film « A Family Affair » (2003) d’Helen Lesnick, le vidéo-clip de la chanson « The Edge Of Glory » de Lady Gaga, etc. Par exemple, dans la pièce Folles Noces (2012) de Catherine Delourtet et Jean-Paul Delvor, Jean-Paul, le héros bisexuel, est obnubilé par le recyclage écolo et la sauvegarde de l’environnement : il fait même faire à sa femme une robe « en toile de maïs ».

Vidéo-clip de la chanson « Only Gay In The World »
Les amis de fortune du héros bobo bisexuel (soit Monsieur le Maire, soit un pasteur évangélique complaisant, soit un homme politique, soit le pote-gay-friendly-qui-passait-par-là) jouent volontiers le rôle du prêtre catholique qui aurait dû, à ses yeux, les marier, lui et son/sa partenaire : cf. le film « Cloudburst » (2011) de Thom Fitzgerald (avec le vieux couple de vieillardes lesbiennes, mariées in extremis par le jeune autostoppeur), toujours le vidéo-clip de la chanson « The Edge Of Glory » de Lady Gaga (avec le bon pote, « Black » évidemment, et son chapeau bobo), le film « Quatre mariages et un enterrement » (1993) de Mike Newell (trop exccccellent, l’« humour anglais » qu’on comprend pas…), la publicité « Love For All » pour la marque de vêtements Björn Borg (dans laquelle le spectateur découvre progressivement que le mariage religieux auquel l’assemblée va assister ne se fait pas entre un homme et une femme, mais entre deux prêtres devant une femme pasteure) ; etc.

Vidéo-clip de la chanson « Edge Of Glory » de Lady Gaga
Le héros bobo bisexuel est la version contemporaine des hypocrites pharisiens du temps de Jésus, un homme qui est « croyant » mais « non-pratiquant », qui dit qu’il a la foi mais qui n’agit pas en fonction, qui désire aimer mais n’aime pas en actes, qui se sert de l’Église (où il met rarement les pieds) pour se regarder le nombril et spiritualiser ses sens dans une religiosité sensibleriste : « Mes désirs étaient aussi forts que les bruits de la cloche de l’église. » (cf. une réplique du film « Dans le village » (2009) de Patricia Godal) ; « Libérée de ce passé, elle s’aperçoit qu’elle [Gabrielle, l’héroïne lesbienne] croit encore aux miracles : retour de vigueur, espoir insensé. Elle croit à la naissance d’autres mots, d’autres émois. » (Élisabeth Brami, Je vous écris comme je vous aime (2006), p. 124) ; « Ça va aller. J’ai la foi. » (Ronit, l’héroïne lesbienne du roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, p. 305) ; etc.
Le silence vide sacralisé
Pour continuer la liste de ces codes bobos qui « font religieux » mais qui sont concrètement vidés de sacré et d’incarnation humaine, on a le Roi des Rois : le Silence ! Le vide, le silence, la pudeur, chez le romantique bobo, sont sacralisés, deviennent des absolus en soi, des idéologies. Il ne vient jamais à l’esprit du bobo bisexuel de penser qu’il puisse exister des silences pleins, mais aussi des silences très vides et très creux (qui s’appellent « nullité »), des silences violents (qui s’appellent « censure », « démission de la pensée », « lâcheté » ou « drogues ») : cf. le film « Week-End » (2012) d’Andrew Haigh, le roman Le Contenu du silence (2012) de Lucía Etxebarría, la chanson « Mes silences » de Claire Keim, l’album « La Pudeur » d’Oshen (la Lesbienne invisible) ; etc. « Ce qui se produit a quelque chose de sacré, de miraculeux. » (Vincent à son amant Arthur, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 40) ; « Silence, le silence, c’est le mieux. » (Esti, l’héroïne lesbienne du roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, p. 263) ; « Il nous faut du temps, des insomnies, des engueulades, des retrouvailles à la bougie. Il nous faut du vent, un peu de pluie, de longues balades et pas de bruit. Non pas de bruit. […] Il nous faut aussi un jean usé que l’on partage. Deux trois secrets d’enfants pas sages. Il nous faut l’envie de rendez-vous, un très grand lit sans rien autour. Non rien. […] » (cf. chanson « Il nous faut » d’Élisa Tovati et Tom Dice) ; « Je parle, je parle, je parle. À chacun son fardeau et à moi l’innocence. Je dis tout ça, oui mais tu vois, je me défile. Oui j’ai dit ça et puis soudain, je reviens à la ligne. Car la pudeur est une robe que je porte. Car la pudeur, une frontière qui me conforte. Car la pudeur, la pudeur ne dira pas. La pudeur ne dira pas. » (cf. la chanson « Je parle je parle » de Pauline) ; etc.
Dans la vie du bobo bisexuel, au bout du compte, c’est l’amant et les pulsions – temporairement qualifiées de « sentiments » – qui finissent par prendre la place de Dieu : « Vous, comme ça, trônant dans ce décor mi-colonial mi-artiste. Vous, ma Gabrielle. » (Émilie s’adressant à son amante Gabrielle, dans le roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami, p. 143)
L’insupportable voix-off
Le plus fascinant dans la prétention silencieuse du bobo à se prendre pour Dieu, c’est qu’il laisse parler généralement son orgueil par une voix-off : une espèce de filet vocal fatigué et doucereux, parfois sirène (façon pin-up sixties suicidaire underground, venue d’outre-tombe), anesthésiant et infantilisant, qui raconte des fadaises ou des sensations, avec un lexique vaguement ésotérique : comme par exemple dans le film « Partisane » (2012) de Jule Japher Chiari, dans beaucoup de films de François Zabaleta et de Christophe Honoré, dans énormément de publicités et de bandes-annonces de films actuels. Les insipides navets oscarisés « The Tree Of Life » (2011, Terrence Malick) et « The King’s Speech » (2010, Tom Hooper), sans autre message « profond » que « l’important c’est d’être soi et de ressentir la vie », nous poursuivent ! Cette petite voix-off narcissique (qui se fait passer pour la voix de la conscience alors qu’elle est plutôt l’inverse : une voix de l’inconscient, autrement dit la voix des pulsions et du refoulé humain, pas spécialement connu pour être tendre… même si elle a des phases de mollesse), je trouve ça personnellement pervers et diabolique (le mot est lâché), en plus de creux !
C’est la voix de la sincérité (ou bonne intention) déconnectée de l’agir. La voix du schizophrène qui se sert du beau pour déconnecter celui-ci du bien et du vrai. Par exemple, dans le docu-fiction érotique « New York City Inferno » (1978) de Jacques Scandelari, le héros homosexuel, Paul, se transforme en espèce de voix-off romantique qui à la fois communique dans le vide avec Jérôme son amant absent, mais en images, enchaîne les « plans cul » avec d’illustres inconnus (chauffeur de taxi, vendeur sur un marché, etc.).
Cette voix-off, qui initialement était censée illustrer un propos et être au service du Réel, est devenu un but. Et on la retrouve dans énormément de créations bobos bisexuelles d’aujourd’hui. Particulièrement dans la bande-annonce cinématographique actuelle. Nous, spectateurs, sommes conviés à assister au spectacle de l’exhibition émue du personnage (ou du réalisateur : on ne sait plus trop !) qui s’écoute parler, et qui avant tout veut nous anesthésier et nous faire CONSOMMER (de l’image technique, de la beauté plastique, du bon sentiment, du sexe, de la pulsion).
La folie bobo des bougies
Dernier reliquat pitoyable de religiosité chrétienne visible dans les œuvres de fictions homo-érotiques occidentales : la bougie (voire la guirlande lumineuse dans un lieu improbable : genre dans une forêt ou un lac la nuit).

Film « El Niño Pez » de Lucía Puenzo
Je me suis amusé à recenser dans les oeuvres toutes les fois où les personnages homos (se) sont représentés et (auto-)sacralisés autour d’une baignoire encerclée de bougies, ou un lit « nuptial » bordés de torches, ou une garden party décorée de lampions : cette icône top-bobo est juste omniprésente ! cf. le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta (avec les bougies dans le salon, et les barrettes d’encens), le film « Shortbus » (2005) de John Cameron Mitchell (surtout la scène finale, avec les bougies sur les rebords des fenêtres, pour fêter l’amour universel asexué et le dieu « Orgasm »), le film « Harvey Milk » (2008) de Gus Van Sant (avec la procession aux flambeaux à la fin), le film « Morrer Como Um Homen » (« Mourir comme un homme », 2009) de João Pedro Rodrigues (avec Rosário et le travesti Tonia dans le cimetière décoré de bougies), le film « El Niño Pez » (2008) de Lucia Puenzo, le film « Les Yeux fermés » (1999) d’Olivier Py, le film « Howl » (2010) de Rob Epstein et Jeffrey Friedman (avec les bougies autour du miroir), le film « Cloudburst » (2011) de Thom Fitzgerald (avec les bougies autour de la baignoire de Dotty, l’héroïne lesbienne), le film « Seeing Heaven » (2011) de Ian Powell, le film « The Boys In The Band » (« Les Garçons de la bande », 1970) de William Friedkin (avec l’appartement d’Harold et de Michael, décoré de lanternes et de lampions sur la terrasse new-yorkaise), le film « Children Of God » (« Enfants de Dieu », 2011) de Kareem J. Mortimer (avec les lampions sur la plage), la pièce Quartett (1980) d’Heiner Müller (mise en scène en 2015 par Mathieu Garling), etc.

Film « Seeing Heaven » de Ian Powell
« Il [Simon] allume des bougies chauffe-plat qu’il pose sur le rebord de la fenêtre et sur la table de nuit, à côté d’une bouteille de vin rouge que je viens d’ouvrir. Dans la lumière vacillante, il me rejoint dans le lit où étendu sur le dos, je joue avec mes pieds. […] Il bande. J’embrasse son front, il s’endort. » (Mike, le narrateur homo du roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 33) ; « Simon enfile une guirlande lumineuse autour de son cou et se laisse tomber dans un chariot de supermarché qu’il a trouvé dans la rue et monté tout seul. L’extrémité de sa guirlande le cloue irrémédiablement à une prise électrique. On écoute Chet Baker. » (idem, p. 78) ; « Nous allons dans la chambre, j’indique ‘Le lit droit devant, propre, draps changés ce matin, pour toi. Une bouteille d’Évian et un cendrier, des bougies.’ » (Mike racontant son « plan cul » avec un certain Vianney qu’il accueille chez lui alors qu’il a les yeux bandés, idem, p. 84) ; « Les amoureux sont là, au milieu de leur chambre, éclairée uniquement par des bougies. » (Jean-Philippe Vest, Le Musée des amours lointaines (2008), p. 13) ; « Je me souviens que nous avons fait l’amour les lumières allumées. » (Denis à son amant Luther, dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta) ; « J’allumerai des bougies, j’mettrai de la musique exotique… » (cf. la chanson « J’attends que tu te déclares » de Mélissa Mars) ; « Jean-Luc voulait mettre des bougies quand on faisait l’amour, enfin, quand on essayait. » (la femme à propos de son ex-compagnon Jean-Luc, devenu homo, dans la pièce La Fesse cachée (2011), p. 85) ; « Il [Bertrand] se glisse dans son bain chaud, savourant chaque seconde du contact de l’eau avec sa peau. Il a pris soin d’éteindre les lumières pour donner la place aux lueurs jaunes et orangées, quelques chandelles disposées autour de la baignoire. Un air de Vivaldi lui rappelle que le printemps est déjà bien loin derrière, que c’est plutôt l’hiver qui s’annonce sur la métropole. » (Denis-Martin Chabot, Accointances, connaissances, et mouvances (2010), p. 36) ; etc.

Film « Heavenly Creatures » de Peter Jackson
Par exemple, dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit, le Dr Katzelblum suit en thérapie un couple gay Benjamin/Arnaud parce qu’Arnaud ne s’assume pas comme homo. Il leur propose trois options d’ateliers au choix : une visite au Musée de la Mode, un atelier de création de bougies parfumées, et un atelier Mylène Farmer.
Dans le roman The Girl On The Stairs (La Fille dans l’escalier, 2012) de Louise Welsh, l’appartement bobo aseptisé dans lequel le couple lesbien formé par Jane et Petra brille de mille feux : Petra offre des bains avec bougies à sa compagne (« Jane éprouva un bref instant de désarroi en voyant que la bougie avait diminué de plus de deux centimètres. », p. 42) ; et quand elles organisent des dîners mondains chez elles, il y a plein de bougies, et la description de ces dernières s’accompagne immédiatement, comme par hasard, d’un discours sur les nouveaux riches bourgeois-bohème (« La femme envoyée par le traiteur avait dressé la table et celle-ci resplendissait sous l’éclat du cristal, de l’acier inoxydable et des bougies. De temps en temps, des diamants ou de l’or envoyaient des étincelles de lumière scintillantes, mais les banquiers et leurs partenaires étaient vêtus avec le genre de modestie propre aux gens vraiment riches. […]Petra avait déclaré : ‘Les Glaswegiens s’habille soit comme des clochards, soit comme des nouveaux riches américains qui veulent en mettre plein la vue. ’ Jane avait mis un moment à comprendre qu’elle entrait dans la catégorie clodo de ce verdict, mais l’habitude de Petra de lui offrir de nouveaux vêtements l’avait trahie. », pp. 109-110).
« Je suis vivant »
La déprime éthérée du bobo bisexuel éloigné du Dieu-Église se dilue et s’alimente dans une forme d’hédonisme chronique (« Je suis vivant »), d’optimisme forcé (« Même si ça n’a pas duré, au moins, j’ai aimé, j’ai senti, j’ai joui » : Sandrine Kimberlain « J’ai aimé »), d’élan combatif appris (« Non, rien de rien, non, je ne regrette rien »), qui ne règle absolument pas les problèmes, n’aboutit pas à un changement profond de comportement, et ne constitue que la maigre consolation du perdant (« L’important, c’est d’avoir essayé, c’est d’avoir participé. ») : « Je me suis trompé quelquefois… mais j’ai aimé. » (Océane Rose-Marie, la lesbienne invisible alias « Oshen », lors de son concert à L’Européen de Paris, le 6 juin 2011) ; « Je ne savais pas que la vie c’était tant d’émotions ! » (Bryan, le héros homosexuel du roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 208) ; « Dans ce mal, je me sens vivant. » (Denis, le narrateur homo du film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta) ; « Le corps cassé. Toujours vivant. Je traverse l’été. » (une femme dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta) ; « Nous demeurons longtemps, vraiment, dans cette immobilité. Nous sommes au centre de ma chambre, au centre du monde. Nous sommes immobiles et vivants. Nous sommes au plus près du vivant. » (Vincent s’adressant à son amant Arthur, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 40) ; « Je suis vivant. J’ai mon sang. J’ai des organes. » (Claude dans la comédie musicale HAIR (2011) de Gérôme Ragni et James Rado) ; « Mais je suis vivante. J’ai des pulsions comme tout le monde. » (Julia, l’héroïne lesbienne du le film « Como Esquecer ? », « Comment t’oublier ? » (2010) de Malu de Martino) ; « Je suis vivant parmi les vivants. » (cf. la chanson « De nous » de Stefan Corbin) ; « L’odeur du feu, la cheminée, un vieux berger dans la montagne. Je suis vivant. » (idem) ; « MAIS VOUS ÊTES VIVANTE ! » (Émilie s’adressant à son amante épistolaire Gabrielle, dans le roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami, p. 64) ; etc.
Quand l’esprit bobo dit qu’il « est vivant », il faut l’entendre non pas dans son sens positif et altruiste de « Joie vraie » et d’« Amour plein », mais bien de « jouissance » égoïste, de « bien-être » ponctuel. « Être vivant » se limite à « être sensitif », à verser dans la sensiblerie, la superficialité de l’épiderme, l’affectif ou le génital pulsionnel : « ‘Kévin est là et bien vivant, je confirme !’ Je souris en faisant allusion à la nuit que nous venions de passer ensemble. » (Bryan, le héros homosexuel du roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 360) ; « Martin me donne l’impression d’être terriblement vivant. » (Thierry, le héros homosexuel par rapport à son amour pour son compagnon Martin, dans la série Joséphine Ange-gardien (1999) de Nicolas Cuche, épisode 8 « Une Famille pour Noël ») ; « Pourtant, je ne me suis jamais sentie aussi vivante. » (Catherine après sa nuit d’amour libertine en trio avec le couple marié Fanny/Jean-Pierre, dans la pièce Un Lit pour trois (2010) d’Ivan Tournel et Mylène Chaouat) ; etc.
Le personnage bobo homo utilise le sexe pour avoir encore la sensation d’être en vie… mais ce qu’il ne dit pas, c’est que pour se réfugier à ce point dans le sensitif, dans les plaisirs faciles, il faut être sacrément drogué, anesthésié, malheureux, hors de sa sphère de conscience, se conduire vraiment en animal ou en minéral. Bref : ne plus se sentir. Il cherche à tout prix à ce que son corps vibre, jouisse, exulte… parce que dans le fond, il ne sent plus son cœur, et a honte d’avouer sa haine de lui-même.
Vive les vieux !
Avec le temps, quand le héros bobo bisexuel est philosophe ou qu’il s’assagit « un peu moins négativement que prévu », il décline son désir de mourir en désir de vieillir.
Il se la joue alors GPI (Grand Patriarche Infréquentable), qui attend dignement la fin de vie, comme un animal blessé « à la Jean Genet » ou « à la Violette Leduc », qui ne se révoltera pas contre la mort mais bien contre les Hommes et toutes leurs Institutions, qui se laissera mourir (d’alcool, de sexe, de nicotine, de cancer… : « Encore un que les Boches n’auront pas ! ») avant que la Science et l’Église (car le bobo est un « bouffeur de curés » invétéré, ne l’oublions pas) ne lui mettent la main dessus : « Bientôt, en février, toute la tribu se réunira à nouveau, à l’occasion de l’anniversaire de la mort d’Alfred. Un rite dont elle se passerait bien. Elle n’a jamais pu supporter les larmes, ni les siennes ni celles des autres. Surtout en public. » (Gabrielle, l’héroïne lesbienne de 80 ans, dans le roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami, p. 87) ; « Depuis la mort de son mari, elle [Gabrielle] est consciente d’avoir sensiblement augmenté la consommation de cet ‘élixir de jouvence’ [whisky] préconisé par Marc, son ami de longue date et médecin traitant. Elle n’est pas dupe. Qu’a-t-elle à perdre à quatre-vingt ans ? » (idem, p. 15) « La silhouette d’une vieille femme apparaît. Pas très grande, des cheveux bouclés et gris, elle porte un tablier de cuisine sur une robe en toile un peu défraîchie. Elle me demande ce que je veux, d’un air pas très engageant. […] Elle hésite visiblement à me claquer la porte au nez. […] Le plus dur est fait : elle m’a fait entrer. Elle sort des tasses d’un vieux buffet et m’offre du thé. Elle reste froide et méfiante, mais accepte de répondre à mes questions. Je lui confie que j’enseigne l’histoire dans un petit lycée de Sarre. Elle me déclare qu’elle méprise les historiens et leurs mensonges. Je lui parle de mon projet de livre. Elle me dit qu’elle déteste les livres. Contre toute attente, elle ne s’oppose pas à ce que j’enregistre notre discussion. Mais elle me prévient : elle voue une haine féroce aux gens de mon pays. » (Théo, le narrateur du roman À mon cœur défendant (2010) de Thibaut de Saint-Pol, pp. 17-18) ; « Tôt ou tard, je parviendrai à l’apprivoiser. » (idem, p. 28) ; etc.
Par exemple, le héros bobo bisexuel aime s’imaginer à une autre époque que la sienne (surtout les années 1920 ou les années 1960-1970). Il est fondamentalement anti-traditionnaliste mais pourtant passéiste et nostalgique. Il n’aime pas les vieux (en tant que personnes réelles ; rappelez-vous qu’il veut faire table rase de son passé, et qu’il a dit « merde » à ses parents et grands-parents) mais le vieux ( = le « style ‘vieux’ », l’idée de « vieux », l’allégorie de vieillesse, les Bidochons et les Deschiens, la vieille aristo qui a la classe, le vioc en peinture, quoi). « La terre des temps anciens dans mes lignes de vie… » (cf. la chanson « La Terre des temps anciens » de Stefan Corbin) ; « T’as braqué un vide-grenier ? » (Glen ironisant sur le mobilier d’appartement de son amant Russell, dans le film « Week-end » (2012) d’Andrew Haigh) ; etc.
D’une part, il développe une passion pour tout ce qui est ancien (les vieilles pierres, le Vieux Campeur, les vieux meubles en bois, les vieilles cheminées, les jouets anciens, les vieux tourne-disques vinyles, etc.), pour le rétro (les vieux cons, Brigitte Fontaine, l’esthétique des années 1960-1980, les chanteurs rebelles des années Saint-Germain, l’ambiance jazzy ou cabaret des « années folles », etc.). Rétro-bobo-homo ! : cf. la pièce Copains navrants (2011) de Patrick Hernandez (avec Vivien, le héros homo, qui a l’habitude de faire les brocantes ; et Norbert, son amant, qui interprète des chansons d’Édith Piaf), le film « Une si petite distance » (2010) de Caroline Fournier (avec une grande place laissée à la nana black jazzy), le film « Mathi(eu) » (2011) de Coralie Prosper (avec la chanson « La Vie en rose » d’Édith Piaf), etc.
Le héros bobo homo se dit fan des chanteurs seventies (excepté peut-être ceux du disco… encore que… il se contredit tellement qu’il peut épisodiquement se payer le luxe d’aimer le kitsch !) tels que François Hardy, Georges Brassens, Jean Ferrat, Anne Sylvestre, Barbara, Marie Laforêt, Jacques Brel, Léo Ferré, etc. : cf. la comédie musicale Chantons dans le placard (2011) de Michel Heim, le film « Mathi(eu) » (2011) de Coralie Prosper (avec la reprise de la chanson « La Vie en rose » d’Édith Piaf), le film « Une Nuit ordinaire » (1996) de Jean-Claude Guiguet (avec la chanson « J’ai rendez-vous avec vous » de Georges Brassens), le film « La Bête immonde » (2010) de Jann Halexander (avec les références à Anne Sylvestre), etc.
« Il se demandait si, comme dans la chanson de Barbara, à travers le visage de ceux qu’il avait aimés après Malcolm ou essayé d’aimer, ce n’était pas encore son image qu’il recherchait. […] Ils lui ressemblaient. » (Adrien, le héros homosexuel du roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, pp 34-35) ; « ‘Mais toi, tu es le premier – Mais toi, tu es le dernier’… Tu connais ? C’est une vieille chanson d’Édith Piaf que ma mère écoute parfois, ça s’appelle : ‘À quoi ça sert l’amour ?’ Les paroles sont géniales ! » (Kévin s’adressant à son amant Bryan, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 117) ; « Un dimanche après-midi, alors que nous étions chez lui, Kévin me fit écouter une chanson : ‘L’Hymne à l’amour’. J’eus les larmes aux yeux, la gorge serrée et les poils hérissés. Content de lui, il observa ma réaction et pleura avec moi. » (Bryan, idem, p. 140) ; etc.
Le bobo bisexuel aime se faire pleurer sur un air rétro : « Le jeune amant entend dans sa tête Jacques Brel qui chante ‘Voir un ami pleurer’, un des nombreux grands artistes que Bertrand lui a fait découvrir. Souvent Marcel doit aussi essuyer ses yeux mouillés. » (Denis-Martin Chabot, Accointances, connaissances, et mouvances (2010), p. 25) Chez lui, il y a une esthétisation top homo et ado de la souffrance, une souffrance liée à la musique du passé.
… et vive le vieux marin breton !

Film « Son Frère » de Patrice Chéreau
D’autre part, le personnage « intellectuel » bobo bisexuel adore « le » vieux marin breton, ou le papy qui sera son « pote » (du moment qu’il ne fait pas partie de sa famille de sang, ça va…). En général, il se plait à s’extasier devant les vieux clodos. Le vieillard duquel il se rapproche a un petit côté « maître spirituel non-agréé » : « C’était un barbu rastaquouère dans la quarantaine, installé dans la position du lotus, maigre, noueux, aux yeux d’un vert étonnant, à côté de qui j’avais justement décidé de m’asseoir pour avoir la paix, les contemplatifs étant rarement diserts. » (Jean-Marc, le narrateur homosexuel, décrivant sa rencontre avec le vieux « Lotus » sur l’île de Key West, dans le roman Le Cœur éclaté (1989) de Michel Tremblay, p. 133) ; « L’odeur du feu, la cheminée, un vieux berger dans la montagne. Je suis vivant. » (cf. la chanson « De nous » de Stefan Corbin) ; « Je viens de vider mon verre et de commander un autre demi quand un homme étrange entre et s’installe par le soleil et le sel, il a la tête du vieux loup de mer qui a parcouru tous les océans du globe, mais qui autrefois a dû avoir la beauté de ces marins que décrit Genet. » (Théo, le narrateur du roman À mon cœur défendant (2010) de Thibaut de Saint-Pol, p. 124) ; « J’ai fait un autre rêve, voilà quelques jours. J’étais dans une espèce de restaurant en plein air, entouré d’arbres et de buissons. Je déjeunais avec un vieil homme – il me faisait un peu penser à mon père. » (Ronit, l’héroïne lesbienne du roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, p. 304) ; « C’est bio, une vieille. » (Ali Bougheraba dans son one-man-show Ali au pays des merveilles, 2011) ; « Ils se bécotent, c’est mignon. » (Richard, le héros homosexuel regardant avec attendrissement et de loin Junn et Alan, le vieux couple de tourtereaux retraités hétéros qui se draguent comme des adolescents, dans le film « Lilting », « La Délicatesse » (2014) de Hong Khaou) ; etc.

Film « Shortbus » de John Cameron Mitchell
Le portrait ému du vieux pépé « à la Léo Ferré », anti-conformiste, inflexible, vivant à la campagne, ayant encore une vie sexuelle débridée pour son âge, fumant comme un pompier, alcoolique, illustre bien la maladie du bobo moderne : l’obsession du « faire authentique » par son idée de l’anti-politiquement correct, par son idée de l’opposition… en utilisant si besoin est les exclus, les plus fous, les plus faibles, les plus innocents de la société, et donc parfois les plus susceptibles d’être moqués : cf. le vieux marin breton dans le roman Son Frère (2001) de Philippe Besson, Mathilde-Patachou dans le film « Drôle de Félix » (1999) d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau, Jeanne Moreau dans le film « Le Temps qui reste » (2005) de François Ozon, la grand-mère baba cool du film « Tan De Repente » (2003) de Diego Lerman, le grand-père déjanté dans le film « Little Miss Sunshine » (2006) de Jonathan Dayton, Élie le grand-père grincheux/attachant du téléfilm « Sa Raison d’être » (2008) de Renaud Bertrand, la vieille mère de Michael discrètement/rebellement gay friendly dans le roman Michael Tolliver est vivant (2007) d’Armistead Maupin, Marta la petite vieille du film « Hammam » (1996) de Ferzan Ozpetek, la grand-mère « mignonne » du film « Nos Vies heureuses » (1999) de Jacques Maillot (avec qui on est invité à entonner « Les Amants de Saint Jean » en se balançant de gauche à droite sur notre fauteuil), le papy du film « Martin (Hache) » (1997) d’Adolfo Aristarain, le vieux du film « Boy Culture » (2007) de Q. Allan Brocka, la rencontre avec le clochard du début du roman Les Clochards célestes (1963) de Jack Kerouac, Zulma la grand-mère travesti fumant de l’herbe et volant à l’étalage dans la comédie musicale Se Dice De Mí En Buenos Aires (2010) de Stéphan Druet, le vieux couple de lesbiennes Stella/Dotty dans le film « Cloudburst » (2011) de Thom Fitzgerald, le vieux couple d’homos Ben/George dans le film « Love Is Strange » (2014) d’Ira Sachs, le vieux descendant des Indiens apaches dans le téléfilm « Just Like A Woman » (2015) de Rachid Bouchareb, : le vieux disquaire muet dans le film « Mezzanotte » (2014) de Sebastiano Riso, la méchante tatie du film « Tatie Danielle » (1989) d’Étienne Chatiliez, le vieux couple de papy/mamie Baucis et Philémon dans le film « Métamorphoses » (2014) de Christophe Honoré, les vieux mineurs gays friendly (… qui font leur coming out pour certains) dans le film « Pride » (2014) de Matthew Warchusetc. D’ailleurs, le papy ou la mamie en question ne comprend pas trop ce qui lui arrive et ce qui lui fait mériter autant d’effusion filiale (cf. la réaction étonnée de la mamie que la chanteuse ZAZ serre dans ses bras, dans son vidéo-clip « Je veux »).
L’intellectuel bourgeois gauchiste (ou droitiste après tout ! Les extrêmes se rejoignent…) se met démagogiquement en scène en train de se laisser enseigner par des « gens de peu » que tout le monde prendrait pour des fous mais que lui seul serait capable d’approcher et de comprendre.
Je crois que cette identification au vieux rebelle, au-delà de la tendresse un peu condescendante, dit quelque chose de l’attitude du héros bobo bisexuel dans la vie : même s’il se la joue marginal cool, il se comporte en réalité très souvent en vieux gars ou en vieille fille coincé(e) et inflexible. Il fait passer son attitude pour de la pudeur ou un courageux refus des conventions… mais il y a beaucoup de frustration, de complexes, de peur chez lui. Il cache sa haine de lui-même derrière une fausse décontraction.
Et plus fondamentalement, l’attraction du héros homosexuel bobo pour les vieux désigne son désir homosexuel comme incestueux et immature. Par exemple, dans le film « Gérontophilia » (2013) de Bruce LaBruce, le jeune Lake est attiré sexuellement par les vieillards et tombe amoureux de l’un d’entre eux. Dans le film « C’est une petite chambre aux couleurs simples » (2013) de Lana Cheramy, Mister Jones, vieux peintre aveugle et admirateur de Van Gogh, est soigné dans une maison de repos par Bob, un jeune infirmier dont il tombe amoureux… et Bob va voir sa vision de la réalité transformée par l’imaginaire de Mister Jones.
Vivre dans une communauté (qui soit tout sauf religieuse !)
Comme le héros bobo bisexuel veut d’une Église sans Église, centrée sur ses « valeurs » et les gens qui pensent comme lui, il va absolument chercher vivre en groupe. De nombreux films à thématique homosexuelle chantent les louanges de la vie communautaire : cf. le film « Como Esquecer ? » (« Comment t’oublier ? », 2010) de Malu de Martino) (dans lequel Julia, l’héroïne lesbienne, se remet d’une douloureuse rupture amoureuse entourée de ses amis homosexuels dans une baraque à retaper, aux bords de la mer), le film « On ne choisit pas sa famille » (2011) de Christian Clavier, le film « Nés en 68 » (2008) d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau, le film « Sitcom » (1998) de François Ozon, le film « Pourquoi pas moi ? » (1998) de Stéphane Giusti, le film « Hammam » (1997) de Ferzan Ozpetek, le film « Tan De Repente », le film « Le Mariage à trois » (2009) de Jacques Doillon, le film « Tableau de famille » (2001) de Ferzan Ozpetek, etc.
Par exemple, dans le roman autobiographique Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, Ednar, le héros homosexuel, avec son copain indien de l’époque, Nessan, décident d’« ouvrir » leur couple à leur ami Grégoire et son nouvel amant, Serge : « Pratiquement à chaque fin de semaine et durant les vacances nous nous retrouvions tous les quatre dans le pavillon. Cette cohabitation se passait sans anicroches et dans une ambiance plutôt festive et surtout amoureuse. À la maison, chacun avait son domaine : jardinage, ménage, repassage ; d’emblée, je m’imposais à la cuisine. » (p. 197) Dans le one-woman-show La Lesbienne invisible (2009), Océane Rose-Marie se fait inviter un été dans la maison de campagne de « copines lesbiennes profs de peinture sur soie dans la Creuse ».
Mais comme le bobo bisexuel est fondamentalement un sauvage, un indépendant, un misanthrope et un anti-social, il finit par s’éloigner des sous-groupes dont il a voulu faire partie à un moment donné (un groupe, c’est déjà le début du fascisme institutionnel culturel, selon lui !). Par exemple, dans le film « Le Refuge » (2010) de François Ozon, les personnages ne font jamais les choses ensemble, sauf sur des coups de tête, par accident. Le communautarisme, tout comme la vie de couple, se doivent d’être hasardeux et non-institués.
III – LA DÉPRIME ESTHÉTISÉE, PSEUDO «ARTISTIQUE» :
Le héros bobo bisexuel ne déprime pas qu’autour d’une bougie ou d’un crucifix. Le plus souvent, ce sera autour d’une toile, d’une œuvre d’art, d’un piano ou d’un disque. Il investit le terrain artistique comme moyen de reconquérir sa « divinité dans la sobriété » (voire dans le désordre et la destruction iconoclaste).
Grâce à l’art underground simulant les « petits moyens » et l’artisanat, il croit échapper à son identité de bourgeois. Il s’autoproclame « Maître du Bon Goût et de la Simplicité » … y compris en cultivant le soi-disant « mauvais goût » social, en posant pour les Inrock, en pratiquant une « incorrection jouissive », en « parlant cul » et en travaillant sa vulgarité verbale.
Mais en dépit de ses efforts pour prouver sa rébellion anarchiste contre la bourgeoisie, on voit bien qu’il finit par s’exprimer comme une bourgeoise : « Je n’ai pas des goûts de chiotte ! […] Nous n’avons pas les mêmes valeurs ! » (le narrateur homosexuel de la nouvelle « Mémoire d’un chiotte public » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 81) ; « Le hasard voulut que nous nous retrouvassions… » (le narrateur homosexuel de la nouvelle « Crime dans la cité » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 73) ; etc.
Il se pense « sans concessions », « alternatif », mais fonde une nouvelle élite de bourges et fréquente les musées branchouilles : par exemple, dans le film « Keep The Lights On » (2012) d’Ira Sachs, Paul, l’un des deux héros homosexuels, se rend à la Foire d’Art contemporain. Dans le pièce Brigitte, directeur d’agence (2013) de Virginie Lemoine, Chantal et Brigitte, les deux travestis M to F, vont voir un film expérimental nommé Éclats de viande.
L’un des bobos artistes les plus en vue du moment dans les fictions homo-érotiques (peut-être même qu’il dépasse, en importance, le statut de chanteur, de musicien, et d’écrivain), c’est le photographe. Quand le héros homosexuel révèle à son copain qu’il est photographe, la messe est dite ! Le temps se suspend ! Le charme agit instantanément ! (cf. le film « Elena » (2010) de Nicole Conn). L’amant devient Dieu sur terre ! « Ma seule activité de loisir jusque-là avait été la photographie noir et blanc. » (le narrateur homosexuel de la nouvelle « La Chaudière » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 18) ; « J’ai envie de vivre à la campagne et de vivre de mes photos. » (la tenancière lesbienne d’un bar, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 118) ; etc.
Promenade chorégraphique au ralenti
Le héros bobo bisexuel aime se montrer sensitif. Il se décrit arpenter la nuit les rues de sa ville en libre penseur (un poète muet en apparence, car on l’entend déverser son flot de pensées poétiques intérieures insignifiantes façon voix-off de Frédéric Mitterrand), parler du monde qui l’entoure (de préférence une jungle urbaine qu’une Nature virginale : il faut quand même qu’il se place en victime des Hommes et de la machine, toujours) avec un souci grotesque du détail, effectuer sa petite ballade chorégraphique de dépressif abasourdi par le triste/beau spectacle d’un monde à la dérive, au ralenti bien sûr, comme dans un film de la « Nouvelle Vague » : cf. le film « Strella » (2009) de Panos H. Koutras (avec la promenade de Strella, le personnage transsexuel M to F en pleurs, en plein cœur d’Athènes), le film « J’aimerais j’aimerais » (2007) de Jann Halexander (dans lequel on a droit à la ballade en forêt du héros, filmé au ralenti quand il marche, pleurant son amour impossible avec Philistin de Valence), le film « Nuits d’ivresse printanière » (2009) de Lou Ye, le film « Esos Dos » (2012) de Javier de la Torre (avec la promenade chorégraphique finale de Rubén dans la ville), le film « Keep The Lights On » (2012) d’Ira Sachs (avec la ballade finale d’Erik, le héros homo, marchant comme une âme en peine dans New York), le film « Praia Do Futuro » (2014) de Karim Aïnouz (avec Donato, le héros homosexuel, montrant ses émotions pendant sa ballade en ville dans les parcs où jouent des enfants), le film « Love Is Strange » (2014) d’Ira Sachs (avec la ballade dans Manhattan sur un air de piano), etc.
La musique joue un rôle primordial dans le sentimentalisme naturaliste bobo : « En conduisant, tu écoutes les violons hivernaux. » (Félix, le héros homo du roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 231) ; « Tu entends Le Roi des Aulnes. La mélodie de Schubert accompagne chacun de tes mouvements ; sous l’œil aguerri des kapos, une chorégraphie conduit ton labeur. » (Félix au camps de concentration, idem, p. 99) ; « Ton absence, c’est comme si je me trouvais en silence dans un cimetière un matin d’hiver. » (Stéphane s’adressant à son ex-compagnon Vincent, dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson) ; etc.
Le héros bobo bisexuel prend souvent la position de la Drama Queen errante et solitaire, défilant comme un mannequin dans un paysage romantique naturalo-apocalyptique. Tout est chorégraphié dans sa tête : « La marche lente, complice… » (Luca, le narrateur lascif du spectacle musical déprimé Luca, l’évangile d’un homo (2013) d’Alexandre Vallès) ; « Elle marche d’un pas régulier, calme et décidé à la fois. Elle regarde la vallée. Son village est minuscule vu d’ici. Elle décide de tout quitter : sa famille, son village, son pays. C’est agréable d’être seule. Pour la première fois de sa vie, elle est vraiment seule. Elle regarde les passants dans la rue. Leurs mouvements sont beaux. Brusquement, elle pleure. » (Rudolf, le héros gay se mettant dans la peau de sa grand-mère qu’il élève au rang de voix narrative de son nouveau roman, dans le film « Boys Like Us » (2014) de Patric Chiha) ; etc.
Par exemple, dans le film « Children Of God » (« Enfants de Dieu », 2011) de Kareem J. Mortimer, Johnny, l’un des héros homosexuels, roule seul en voiture, pour ressasser ses doutes zé ses peines amoureuses. Dans les dernières images du film « Drift » (2000) de Quentin Lee, par exemple, Ryan, le personnage homo, nous offre, sur fond de violons, sa conclusion existentielle façon « carnet de voyage », les clichés de sa vie… Et ce récit « J’ai mangé une pomme » se veut profond, même si, au fond, il n’y a rien à en tirer, en plus de sentir l’optimisme forcé ramolli, plein d’espoir mais si peu d’Espérance: « Quand j’ai quitté Dane, tandis que je regagnais ma voiture, je me suis senti perdu mais pas désespéré. Je n’étais pas entier, mais il ne me manquait rien. Je me sentais seul, mais aimé malgré tout. J’étais pensif, mais pas triste. Je pars en voyage. Je veux rouler au hasard. C’est ça, l’esprit de la Californie, de l’Amérique. J’idéalise trop ce pays, parce que je ne suis pas américain. J’ai fait mon sac, avec mon portable, mon carnet. J’ai laissé un message à Joel. J’ai parlé un moment à Carrie, et laissé un message à Matt. Ce n’est qu’une fois parti, une fois loin de Los Angeles, que j’ai réalisé ma chance, et combien je peux être heureux. Si je devais mourir à cet instant, je serais heureux, parce que je n’ai aucun regret. »
Le héros bobo homo a un côté spectateur passif, oisif, et distant (lui dira « contemplatif ») de son propre confort/de sa propre douilletterie : il aime se décrire « attablé à un café » (Stéphane Corbin lors de son concert Les Murmures du temps au Théâtre de L’île Saint-Louis Paul Rey, à Paris, en février 2011), observant le monde d’un œil ému, amusé, nostalgique, et jaloux à la fois, dorlotant sa déprime, ou nourrissant son imaginaire libertin et pulsionnel (lui dira « amoureux ») de pensées pudibondes, d’images pieuses, de ralentis et de violons : « Maintenant, Ethan en a plus qu’assez de ces gens qui se promènent main dans la main et qui s’embrassent langoureusement le long de l’Ill. Il n’en peut plus de ces terrasses de cafés qui font face à la cathédrale et où les amoureux passent d’agréables moments dans une atmosphère romantique. » (Jean-Philippe Vest, Le Musée des amours lointaines (2008), p. 21) ; « J’écrirai un jour un roman sur la solitude des gens dans les bars d’hôtel. » (Stéphane, le romancien bobo de la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson) ; etc.
Les artistes bobos bisexuels nous livrent souvent la même scène de sincérité narcissique peu profonde, que l’on peut voir dans les feuilletons-télé ennuyeux de début d’après-midi, ou dans les pièces contemporaines homosexuelles ronflantes (cf. l’excellent sketch parodique « Le Doutage » des Inconnus… avec une mise en scène d’une lesbienne dont le nom – Mylenie de Gouinaloux – est évocateur !), où deux personnages, derrière une fenêtre vitrée, « philosophent » sur le monde, le paysage et les passants qu’ils voient, sans se regarder entre eux : « L’agitation du café retombe un peu, étrangement. On dirait, tout à coup, que la pudeur reprend ses droits dans une sorte d’assourdissement des conversations. […] Mon regard s’évade. Vous demandez : à quoi pensez-vous ? Je réponds : précisément, à rien. Je regarde ce monde autour de nous, ce monde singulier des gens dans les cafés, ce monde qui est un instant, une réunion du hasard. Je pense que nous n’aurons plus jamais la compagnie qui est la nôtre en ce moment, que ceux qui sont ici, dans ce lieu, ne se connaissent pas entre eux, qu’ils se trouvent ensemble par coïncidence, qu’ils se disperseront sans éprouver un sentiment de perte, qu’ils ne se reverront pas, que cette assistance n’existe que le temps de boire un café, lire un journal, rédiger du courrier, raconter une enfance. Et c’est une idée qui m’intéresse, sans que je sache expliquer pourquoi. » (Vincent s’adressant à la figure de Marcel Proust, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 59)
Par exemple, dans le film « Boys Like Us » (2014) de Patric Chiha, après sa rupture avec son amant Pierre, Rudolf, tout pendant qu’il déménage, se met à pondre un texte improvisé « Je marche, je marche, je marche, je marche… » (niveau poésie de CE2). Plus tard, il se met à écrire un roman où il se met dans la peau de sa grand-mère morte qui, du haut de sa montagne, observe son village, revient sur son passé, s’émeut face au flot de passants marchant dans la rue… puis qui pleure sans savoir pourquoi. Comme par hasard, Rudolf fond aussi en larme derrière la vitre de sa fenêtre. Dans son film autobiographique « Guillaume et les garçons, à table ! » (2013), Guillaume Gallienne se raconte en partageant quelques-unes de ses « tranches de vie ».
Côté romans, discours et langage, maintenant, comme le bobo bisexuel est un bourgeois (ne l’oublions pas), il aime les sophistications langagières, même « cheap » (oh ! tiens ? un mot anglais !). Il va trouver ça charmant et original de truffer ses propos de mots étrangers, et surtout anglais, pour se distinguer. Par exemple, dans la pièce Les Sex Friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau, Jules, le bobo homo dandy, case des phrases en anglais par snobisme… et il se ridiculise : « I never look the publicity. »
À force de se rêver « Citoyen du monde » et de se projeter/de s’éparpiller sur ses écrans de télé (même s’il dit qu’il ne les possède pas ; ce sera Internet, sa nouvelle télé cachée), le héros bobo bisexuel a tendance à adopter une vision du monde et de lui-même éclatée, narcissique, kaléidoscopique, mercantile, un peu comme dans les publicités actuelles façon Benetton, ou les affiches de films nous montrant des mosaïques d’Humanité qui ne sont que des échantillons standardisés d’une diversité déshumanisée, programmée, attendue, imposée comme unique, avec des quotas précis et des personnages bien stéréotypés : cf. les affiches des films de Cédric Klapisch (« L’Auberge espagnole » (2001), « Les Poupées russes » (2004), « Chacun cherche son chat » (1995)), de Ferzan Ozpetek (« Saturno Contro » (2007), « Tableau de famille » (2001), « Le Premier qui l’a dit » (2010)), de François Ozon (« Huit Femmes » (2001), « Potiche » (2010)), d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau (« Nés en 68 » (2008) , « Drôle de Félix » (2000), « Crustacés et coquillages » (2004)), etc. Comme il ne veut pas être prêt à affronter sa solitude, ses problèmes personnels, ni ses désirs profonds, qu’il fait tout pour ne pas régler la question de l’amour et de la place centrale de la foi dans sa vie, il se cherche des dérivatifs, des échappatoires écologistes, humanitaires, artistiques, sentimentales, sexuelles, émotionnelles. Et ça part dans tous les sens !

Film « Chacun cherche son chat » de Cédric Klapisch
La confusion entre esthétique et éthique, entre art plastique et mode de vie, est le propre du boboïsme. Le protagoniste bobo bisexuel s’axe sur les goûts en les confondant avec l’Amour. Pour lui, c’est « profond » de confier qu’il aime les voyages, les massages tantriques, le thé aux senteurs exotiques inédites, un parfum particulier, les gants en laine, le vent dans les arbres, la musique classique aussi bien que le jazz manouche, les petits plaisirs simples comme les plaisirs sophistiqués… (cf. Sandrine Kiberlain, « Le Vent ») Il déverse sous forme de liste ce qu’il croit être, alors que les goûts, c’est ce qu’il y a de plus relatif, de plus superficiel et de plus extérieur à une personne.
Par exemple, dans le film « Plan B » (2010) du réalisateur argentin Marco Berger, top bobo soit dit en passant (je pense que le boboïsme est devenu pour le cinéma latino-américain actuel la nouvelle Terre promise à la mode, la bouée de sauvetage culturelle inattendue, vu la flopée de films bobos petits moyens que le continent exporte en ce moment aux cinémas d’art et d’essai occidentaux… surtout en Argentine !), Pablo et Bruno, les deux amants trentenaires bisexuels, pour se draguer, se soumettent des questions genre Quiz TéléLoisirs (« Si tu étais un minéral, que serais-tu ? » ; « Et si tu étais un jouet ou un animal ? » ; « De quel signe zodiacal es-tu ? », etc.), toutes ces QCM pour ados attardés, qui flattent l’Ego et où l’on s’épanche sur les goûts en pensant parler d’Amour.

Film « Plan B » de Marco Berger
Chez le héros bobo homo, la musique a une importance centrale dans la mise en scène pathos de sa conception de l’authentique : cf. le film « Homme au bain » (2010) de Christophe Honoré (avec la scène du bobo bisexuel jouant un air de guitare sèche), le film « L’Homme de sa vie » (2006) de Zabou Breitman (avec la chanson à la guitare, pendant l’après-midi au ruisseau), le film « Tacones Lejanos » (« Talons Aiguilles », 1991) de Pedro Almodóvar (avec la chanson « Piensa En Mí » de Luz Casal), le film« Sex Revelations » (2000) d’Anne Heche (avec la chanson « Thank You » de Dido), etc. En gros, il vit son amour comme un clip. La musique constitue pour lui une coupure esthétique indispensable, un charme inégalable de la vie… qui généralement anticipent le passage au lit, ou parfois l’encadrent. Les films musicaux que sont devenues les œuvres à thématique homosexuelle ne se dispensent pas non plus de longs intermèdes totalement silencieux, « où le mutisme est musique » (c’est conceptuel et puissant, vous pouvez PAS comprendre).
Quand le héros bobo bisexuel parle d’amour, il se focalise tellement sur ses sensations qu’on a parfois l’impression qu’il se masturbe, ou qu’il se sert de son amant virtuel ou épistolaire pour oublier le caractère pathétique et égoïste de son film intérieur : « Raconte-t-on jamais autre chose que sa propre histoire ? » (Vincent, le héros homosexuel du roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 103) ; « Le silence me rend presque belle. » (une protagoniste de la pièce Les Gens moches ne le font pas exprès (2011) de Jérémy Patinier) ; « Lorsqu’elle écrit, des vagues émotions la traversent. […] Elle n’a jamais ressenti cela. Elle se sent vivante. » (Gabrielle, l’héroïne lesbienne du roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami p. 99) ; « Enfin, elle redécouvre l’état d’écriture, jubile à évoluer parmi les créations de son esprit, éprouve sa toute-puissance à l’égard des personnages, repousse les limites des mots, affronte le courage de dire. » (idem, p. 98) ; « J’ai relu vos lettres à défaut d’en recevoir de récentes. Qu’ils sont doux ‘les baisers de la Dame’ qui chavire avec moi et parle avec délices de ‘la révolution’ causée par notre rencontre. » (Émilie à son amante Gabrielle, op. cit., p. 137) ; etc.
La bohème, la bohème… ça voulait dire on est peureux (ça voulait dire on est vieux, aussi !)
Vous l’aurez compris. Le héros bobo bisexuel, parce qu’il a peur de désirer, est un faux bon-vivant, un faux détendu, un faux « cool » frustré et bourré de complexes. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, dans beaucoup d’œuvres de fiction homo-érotiques, il est dépeint comme un triste sire (cf. le roman Bohemia Triste (1909) d’Antonio de Hoyos, le film « Up The Chastity Belt » (1971) de Bob Kellett, le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta, le film « A Family Affair » (2003) d’Helen Lesnick, le film « Torch Song Trilogy » (1989) de Paul Bogart, le film « Mambo Italiano » (2003) d’Émile Gaudreault, le film « Le Secret de Brokeback Mountain » (2006) d’Ang Lee, « Shortbus » (2005) de John Cameron Mitchell, le film « Like It Is » (1998) de Paul Oremland, le film « La Ley Del Deseo » (1986) de Pedro Almodóvar, etc.).
En somme, le bobo est un « p’tit con », un trouillard, un être ennuyeux, un faux révolutionnaire, un donneur de leçons, qui fait violence… et qui érafle – comme le montrent ces quelques lignes du roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz – parce qu’il refuse de se frotter à la Vie, aux limites du Réel, et aux autres. « Dans le salon, on s’assied par terre, autour d’une table composée d’un morceau de plexiglas sur lequel sont dessinés (toujours au marqueur) un cendrier, un ordinateur et un téléphone portable, la plaque elle-même posée sur plusieurs parpaings de chantier. Un clou dépasse auquel Simon s’érafle, il porte aussitôt son doigt à sa bouche. Polly n’est pas très à l’aise encore, elle nous sert du café en en versant à côté, essuie avec sa manche. Claude discute un peu, puis finit par jouer de la guitare dans la chambre. Après c’est l’hiver et nous ne nous voyons plus pendant au moins trois mois. » (Mike, le narrateur homo décrivant le nouvel appartement du couple lesbien Polly/Claude, pp. 55-56)
Derrière son hédonisme optimiste et humaniste se cache en réalité une profonde misanthropie et un désir de mort. Par exemple, dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta, Denis et Luther, le couple homo, rêvent leur vie comme un roman-photos qui fera date (cf. la séance collective de photomatons à la Gare de Lyon, le séjour en relais-château, les voyages en terres exotiques, etc.), mais qui ressemble curieusement aussi à une couronne mortuaire, à un album de vieillards : Denis présente déjà son testament à son compagnon (« Images que j’aimerais voir défiler avant de mourir. »).
Dans les fictions homo-érotiques, le héros bobo bisexuel a tendance à se mettre à la place des morts, des absents, des maudits d’amour, ou des personnes âgées, souvent dans l’optique pédagogique inconsistante de l’expression d’un « Carpe Diem » (= Profite de la vie avant qu’elle ne passe), dans l’optique narcissique de s’imaginer écrire ses mémoires comme s’il était un génie qui allait mourir prématurément à 25 ans, et surtout dans l’optique existentielle de se suicider à petit feu : cf. le film « Dead Poets Society » (« Le Cercle des poètes disparus », 1989) de Peter Weir (avec la scène d’observation de groupe des photos de classes en noir et blanc), tous les romans de Philippe Besson, tous les films homos-bobos intégrant la chanson « Bang Bang » de Nancy Sinatra (carrément le TUBE bobo par excellence : Nancy Sinatra, c’est, bien avant Amy Winehouse, Marilyn Monroe ou Lana del Rey, la première Prêtresse du désespoir amoureux hétérhomo, LA pin-up suicidaire préférée des bobos bisexuels !), etc.
« Je suis né à Paris à la fin du siècle dernier… Curieuse phrase et cette impression d’ancien combattant qui va raconter sa guerre ! Finalement, ça me va bien. Je ne l’ai pas toujours été. Je n’en avais pas très envie. Combattant. Je le suis devenu contraint et forcé le jour où j’ai décidé que je ne me laisserai plus faire, ni influencer ni modeler comme je ne voulais pas, comme je ne pouvais pas. » (le jeune Bryan, héros homosexuel âgé de 16 ans, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 18) ; « J’ai un curieux défaut. Celui de souvent penser à ceux qui ne sont pas là, à l’instant. » (idem, p. 44) ; « Encore une fois, penser à ceux qui ne sont pas là ! Toujours ce décalage, pourquoi ? Je me suis souvent posé cette question. Une seule réponse plausible : je me suis inquiéter pour ceux qui sont présents. Ça ne les rend pas invulnérables pour autant, mais c’est comme ça. Je n’ai peur que pour les absents ! Comment les protéger, les secourir ? » (idem, p. 242) ; « C’est troublant de penser qu’à un endroit – un même endroit – ont déambuler des gens qui ne sont plus. […] Désormais, des personnes que je ne connais pas vont habiter ce lieu, s’asseoir sur un nouveau siège de piano, s’allonger sur la même pelouse gelée en automne, dormir dans les mêmes chambres. C’est tout un sanctuaire qui s’échappe. Il ne me reste que quelques objets – et puis des souvenirs. » (Chris, le héros homo du roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 55) ; « Lorsque j’ai le malheur de m’entrevoir dans une glace, je frémis d’horreur en reconnaissant mes frères et sœurs juifs partis en fumée. Six millions de fantômes veillent à mon chevet, attendant que je les rejoigne. » (Émilie à son amante Gabrielle, dans le roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami, pp. 183-184)
Le héros bobo bisexuel a trouvé en la veuve (mi-hippie, mi-class) sa plus belle ambassadrice de la beauté de sa propre retenue, de la noblesse de sa lâcheté, de la grandeur de son goût de la mort : « Une fois qu’elle a été sortie, je me suis mis à pleurer. Inexplicablement, je me suis mis à pleurer. J’ai pensé que je venais de vivre un des moments les plus dignes et les plus émouvants de mon existence. » (Vincent, le héros homo, suite à sa rencontre avec la femme en deuil, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 170) ; « Elle le dit de façon désincarnée, distante, presque médicale. Je suppose que c’est le seul ton qu’on puisse employer si on ne veut pas être secoué de sanglots, que cette distance est nécessaire pour ne pas s’effondrer. » (idem, p. 209)
IV – LA DÉPRIME SENTIMENTALISÉE ET ÉROTISÉE :
L’amour comme une carte postale naturaliste romantique
Après la politique, la religion et l’art, parlons d’amour et voyons maintenant comment la boboïtude s’articule dans les fictions avec la pratique homosexuelle et les considérations sentimentales. Car comme le personnage bobo bisexuel a une trouille gigantesque d’appartenir, de se donner totalement et de s’engager (alors que l’Amour vrai n’est pas autre chose que le don entier de sa personne à l’Amour dans l’altérité des sexes), il déprime et se contredit fatalement. Et ça donne de belles crises de mélancolie bobo-pédaloïdes !
L’intention d’aimer plutôt que le désir en actes
En amour, le héros bobo homosexuel (qui ne se voit ni bobo ni homosexuel, d’ailleurs : il aurait plutôt tendance à s’afficher « hétérosexuel », « bisexuel » voire rien du tout, pour ne pas être étiqueté, précisément !) s’annonce très souvent sous la forme du trio (cf. Je vous renvoie avec insistance sur le code « Trio » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels)… comme ça, il peut glisser vers la pratique homosexuelle ou l’infidélité sans en assumer la responsabilité ni les conséquences. « Ils me courent après tous les deux. » (cf. la chanson « Ma langue au chat » d’Élodie Frégé) ; « Toutes les hommes sont belles, toutes les femmes sont beaux. » (cf. la chanson « Toutes les hommes sont belles » de Lionel Langlais) ; « J’ai dans le cœur comme un poids, dans la gorge une épine, de n’avoir fait le choix : lui ou toi. » (cf. la chanson « Lui ou toi » d’Alizée) ; etc.
La prévalence du désir d’aimer sur l’amour en actes est capitale à saisir dans le fonctionnement du désir bobo bisexuel et asexuel (cf. j’en parle plus longuement dans la partie « Paradoxe du libertin » du code « Liaisons dangereuses » dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels) : cf. le film « J’aimerais, j’aimerais » (2007) de Jann Halexander. « Je ne sais pas, fit Jason, en acceptant de croiser le regard de Mourad et de le soutenir. Je crois que je ne crois plus en rien. Et en même temps, je crois que j’ai envie de croire. […] J’ai envie de croire à l’amour, fit-il enfin, en essuyant ses joues d’un revers de main. » (Jason, le personnage homosexuel du roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 357). Pour le héros bobo bisexuel, l’amour ne se conjugue pas vraiment au présent : c’est une projection, une intention, une sincérité, une image d’Épinal, une sensibilité à l’art, plus qu’une réalité. Il défend un amour désincarné, platonique, asexué, résigné.
La particularité du héros bobo homo, c’est qu’il désire peu, et qu’il met en veilleuse ses désirs profonds, sa joie, son humour, son corps, pour se construire une prison amoureuse de volontarisme ou de hasard, où l’intellectualisme, l’esthétisme et l’instant passeront avant l’humain.
Là où mon désir est absent, dit le bobo, là seront mon cœur et mon destin ! : « Très souvent dans ma vie, ce que je prévois n’arrive jamais. C’est toujours au moment où je m’y attends le moins que tout bascule dans l’horreur. Quand je crois au bonheur, le temps et les événements, qui nous ignorent, en décident autrement et rien ne se passe comme prévu. Mais inversement, de sinistres soirées selon mes prévisions, finirent en feux d’artifices. » (Bryan, le héros homosexuel du roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 27)
Le bobo bisexuel pense que l’Amour est totalitaire, qu’Il s’impose à lui sans solliciter sa liberté, et surtout qu’Il l’étonnera en lui tressant dans la soumission ou l’insouciance ou le manque d’effort ou l’abandon une couronne d’Iphigénie maudite. Par exemple, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, quand Mike demande à son pote gay Simon comment il gère sa relation avec Gilberto, celui-ci se contente de répondre mollement : « Rien à déclarer, ça avance tout seul. Ça m’étonne moi-même, mais je m’y fais. » (p. 79) Dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson, Stéphane, le héros homosexuel, pense que l’amour vrai vient principalement quand on n’y croit pas : « Là encore, j’ai laissé couler. »
Être bobo, c’est être ennemi du désir durable et profond. C’est être ennemi de la liberté et de la volonté (même si, paradoxalement, la boboïtude procède de l’idéologie libertaire politisée). Pour le héros bobo, tout plutôt que montrer qu’il désire ! Car à ses yeux, aimer « c’est la honte ». S’il passe voir des amis, ce sera, selon ses plans, toujours « à l’improviste », pas programmé. S’il part en voyage, c’est « sur un coup de tête », sans prévenir personne. Et il croit qu’il n’aime vraiment quelqu’un que s’il ne lui montre pas qu’il l’aime, que si l’amour s’impose à lui sous forme de coup de foudre ou de long silence entendu.
Le bobo bisexuel considère que l’Amour est une question de « moment » (pas de « vie entière »), de hasard ou destin (pas de plan divin laissant libre), de sincérité (pas de vérité), de « feeling » (pas d’invisible incarné). « On ne fait pas l’amour en songeant à la fois d’après. C’est un acte qui n’existe que par lui-même, qui ne procède de rien, qui ne produit rien. C’est un événement, une circonstance. » (la figure de Marcel Proust s’adressant à son amant Vincent, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 118) ; « La sincérité est inévitable. » (Madame Garbo dans la pièce L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer (1971) de Copi) ; « Quand j’ai été prêt pour Esteban, il n’était pas prêt pour moi. Et quand il a été prêt pour moi, c’est moi qui n’étais plus là pour lui. Alors quand on s’est revus, on a senti tous les deux qu’on avait laissé passer le coche. C’est comme ça en amour. Il y a un moment où les fruits sont mûrs, et où il faut les cueillir. Sinon, ils pourrissent, et c’est fini. » (Mourad, le personnage homosexuel du roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 350) ; etc.
Le protagoniste bobo bisexuel adopte la loi de la simultanéité amoureuse parfaite ; bref, de la fusion. L’Amour s’imposerait comme une évidence incontournable, sans que les partenaires du couple ne s’y attendent et soient libres de Le refuser. Il serait à la fois chimique et divin (cf. la théorie de la « flamme jumelle » du film « Elena » (2010) de Nicole Conn). Une telle conception totalitaire de l’Amour sent, en arrière-fond, la justification aveugle de la pulsion, et même du viol (« Je sais que tu es fou de moi ; Si tu te refuses à moi, c’est juste que tu n’oses pas encore te l’avouer et que tu nies l’Évidence. » ; « Tout arrive. Nous n’avons pas le choix. En amour, ce qui doit se faire se fait. Nous étions destinés. Si tu me résistes, c’est que tu es un ennemi de l’Amour ! »).
Le héros bobo bisexuel développe souvent l’idée selon laquelle, parce qu’il ne peut logiquement pas rencontrer « l’Amour de sa vie » en boîte ou au sauna ou sur Internet – parce que son « éthique » personnelle exige un autre cadre plus clean et plus naturel, et parce qu’il n’irait jamais dans ce genre de lieux-là habituellement (mon œil, ouais !) –, c’est forcément là qu’il Le rencontrera exceptionnellement. « J’ai rencontré un être qui m’a bouleversé, dans des conditions improbables. » (Adrien, le héros homosexuel du roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, p. 37) L’improbabilité sera pour lui la preuve que sa pulsion s’est transformée en amour vrai ! Par exemple, dans le film « Esos Dos » (2012) de Javier de la Torre, on nous fait croire que l’amour peut naître dans une backroom : la tristesse et la compassion du client (Rubén) face au « prostitué qui se gâche » (Eloy), sont sublimées par l’esthétisme. Dans le film « Week-End » (2012) d’Andrew Haigh, on retrouve aussi la croyance qu’un « plan cul » inaugure une superbe histoire d’amour : un vendredi soir après une fête chez ses amis dits « hétéros », Russell finit dans un club gay. Juste avant la fermeture, il drague Glen, et ce qu’il croit être juste l’aventure d’un soir devient… juste l’aventure d’un week-end (totalement sublimée sur les écrans) ! Dans le film « Rosa la Rose : Fille publique » (1985) de Paul Vecchiali, Julien, un ouvrier peintre en bâtiment tombe amoureux de la prostituée Rosa. Dans le film « Spring » (2011) de Hong Khaou, pareil : un jeune homme rencontre un étranger pour un plan sexe, et on fait croire aux spectateurs que cette expérience change à jamais la vie des protagonistes. Dans le film « Little Lies » (2012) de Keith Adam Johnson, Phillip tombe amoureux d’un escort. Dans le film « Test : San Francisco 1985 » (2013) de Chris Mason Johnson, Frankie, le héros homosexuel romantique et fidèle, vit dans l’illusion qu’il va « sédentariser » amoureusement Todd, le Don Juan qui se prostitue.
Surtout, je ne drague pas ! Je courtise sans le vouloir…
Comme le bobo bisexuel est un hypocrite et un suiveur, il n’assume pas sa drague même quand il drague vraiment : « Je me souviens ne pas t’avoir dragué. » (Denis s’adressant à son amant Luther dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta) ; « Franchement, je ne vais jamais vraiment au sauna, mais là j’avais envie. C’est une chance qu’on se soit rencontré devant l’entrée ! » (« M. » parlant à Mike, le narrateur homosexuel du roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 40) ; « Il [Simon] bande. J’embrasse son front, il s’endort. » (Mike décrivant son pote Simon avec qui il finit par ne pas coucher, op. cit., p. 33) ; etc.
Par exemple, il considère comme une forme de charité héroïque le fait de ne pas être allé jusqu’au bout dans la consommation sexuelle avec ses amants d’un soir, ou de ne pas avoir « craquer » le premier. « On était si bien finalement à se caresser tendrement la nuit durant, sans éprouver le besoin de pénétrer à tout prix. » (le narrateur homosexuel de la nouvelle « Cœur de Pierre » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 50) Il adopte l’attitude du client qui paye un prostitué sans forcément coucher avec, du dragueur qui se targue de ne pas « niquer » le premier soir (… juste le troisième…), ou de l’adepte des câlins et des moments de tendresse gratuite (soutenant que « le cul pour le cul, ça ne l’intéresse pas » ; que le vocable « homosexualité » est réducteur car il transforme les personnes homosensibles en vulgaires « baiseurs » ; ou que les massages, ça n’a absolument rien d’ambigu). Dans la série des clients bobos du « milieu gay » jouant aux « homos pas comme les autres » (ou « homos mais pas gays »), aux modèles de savoir-vivre et de sobriété, on retrouve le voisin âgé d’Emmanuel dans le film « Homme au bain » (2010) de Christophe Honoré (au moment où Emmanuel se déshabille devant lui, le vieux monsieur le fait s’arrêter, et lui demande plutôt de lui offrir la gratuité d’un moment d’écoute collective de musique classique) ; ou encore le sénateur du film « Twist » (2004) de Jacob Tierney et Adrienne Stern, qui loue les services des prostitués tout en prétextant son désintérêt et le sacrifice de sa propre personne : « Je ne veux pas de sexe avec toi. Je veux juste discuter. »
Le libertin bobo feint la patience, la retenue (… pour mieux justifier sa précipitation dans les faits) : « J’avais envie d’être posé pour le découvrir. » (Matthieu à propos de son futur amant Jonathan, avec qui il va coucher le soir même, dans la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H.) Oscar du Meilleur Acteur !
Par exemple, dans le film « The Boys In The Band » (« Les Garçons de la bande », 1970) de William Friedkin, quand Larry se justifie de tromper allègrement son copain Hank (« Oui, je les aime tous ! Et Hank refuse de comprendre qu’il me les faut tous. Je n’ai pas la mentalité d’un homme marié ! »), Harold, leur pote gay, ironise direct (« La bohème, quoi ! »), en associant ainsi le libertinage, l’homosexualité et la boboïtude.
Face à ses actions sensuelles dictées par ses pulsions, il simule à merveille l’étonnement ou la surprise de la vieille effarouchée, genre « Je ne sais pas ce qui me prend… » : « J’ignore pourquoi j’éprouve ce besoin de vous jeter de la sorte cette mélancolie au visage, vous qui ne m’avez précisément rien demandé. » (la figure de Marcel Proust dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 133) Il ne se voit pas faire de comédie tellement il mise tout sur la sincérité, l’intention d’innocence : « Mots qui me viennent à l’esprit quand je pense à toi. » (Denis écrivant des mots fleuve à son amant Luther, dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta)
Parce qu’il se prend pour Dieu, il essaie de se rendre créateur des origines. Mais c’est ainsi qu’il se condamne à ne pas être libre. Il aime se rejouer la comédie de la « première fois », car c’est précisément lors des premières fois que notre liberté et nos désirs sont les plus menacés : « Depuis cette nuit-là, elles [Gabrielle et Émilie] s’écrivent, s’interrogent sans relâche sur la nature de leur sentiment, sur ce fol élan réciproque que rien ne laissait prévoir. » (Élisabeth Brami, Je vous écris comme je vous aime (2006), p. 12) ; « Que nous arrive-t-il ? Je sais à peine qui vous êtes, vous ne savez rien de moi. » (Gabrielle s’adressant à son amante Émilie, op. cit., p. 17) ; « Et ne croyez pas que, d’ordinaire, je sois sujette à ces sortes d’emballements. Pour moi comme pour vous, sans doute, c’est une première fois. Il me faut, il nous faut l’accepter. » (Émilie parlant à Gabrielle, op. cit., p. 69) ; etc.
Le héros bobo bisexuel est celui qui prévoit tout en (se) donnant hypocritement l’illusion de ne rien prévoir, de se laisser happer inconsciemment par un imprévu calculé, par un amour qui s’impose (or l’Amour, le vrai, ne s’impose jamais… sinon, Il ne serait pas aimant). Il transforme ses viles pulsions en hasard indomptable, puis ce même hasard en évidence d’amour : « Tu n’étais pas comme moi qu’un usager anonyme du 7h19, gare du Ranci-Villecomble-Montmerveil ; mais quoique le hasard seul nous eût placés en vis-à-vis ce jour-là, notre rencontre s’inscrivit au premier instant comme une évidence dans son livre. […] Je ‘lisais’ Maurice, le roman d’Edward Morgan Forster, et toi aussi, mais tu le disais vraiment, et en version originale. Qui étais-tu, que voulais-tu ? Si je m’affichais avec ce livre, qu’il me semblait avoir suffisamment lu en voyant le film qu’en avait tiré James Ivory, c’était parce que j’aspirais à un amour aussi… comment dire ? Romantique. Par ce truchement, peut-être forcerais-je le destin ? […] Ainsi la coïncidence du livre constituait-elle un signe susceptible de m’encourager à t’aborder. […] Ma confusion augmenta quand je sus que nous portions le même prénom. » (le narrateur homosexuel de la nouvelle « Un jeune homme timide » (2010) d’Essobal Lenoir, pp. 42-43) ; « Je m’entendis répondre sur le même ton qu’en effet je t’aimais, qu’il n’y avait plus de temps à perdre et que je voulais faire l’amour avec toi, même si je ne savais pas vraiment ce que c’était, l’amour. » (idem, p. 44) ; etc.
Il se donne bonne conscience en sacralisant une génitalité minimaliste, voulue trop fragile et épurée (la défaillance devient une valeur ajoutée à l’acte de consommation !) pour être véritablement légère et gratuite : « Je réchauffe ton corps […]. Même les tremblements, les tressaillements sont une chaleur. C’est un moment très long, très lent, très calme. Il ne se passe presque rien. Il y a juste cette étreinte silencieuse. Et ce presque rien, c’est tout. C’est immense. C’est la vie toute entière. » (Vincent s’adressant à son amant Arthur, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 39) Pour le héros bobo bisexuel, son imaginaire pulsionnel, qui repose prioritairement sur la matérialité corporelle extérieure, va acquérir une dimension sacrée, intérieure, grâce au silence. Le néant amoureux, le vide, ont valeur de Tout, de plénitude indicible, à ses yeux : « Nous, nous ne disons toujours rien. » (idem, p. 22) ; « Depuis notre très beau silence au milieu du salon devant la foule attentive, j’ai l’ardent désir de savoir la direction que va prendre cette histoire qui s’écrit. » (Vincent, le héros homo, s’adressant à la figure de Marcel Proust, op. cit., p. 29) ; « Vous reprenez, et j’ai peur, lorsque je vous entends reprendre, ainsi, un discours qui s’est suffi à lui-même, qui est assez. » (idem, p. 77) ; « Tant que je pourrai, je ne parlerai pas. » (la figure de Marcel Proust, op. cit., p. 86) ; « À nouveau, le silence. Épais, plein. » (Vincent, op. cit., p. 94) ; « Tant que je le pourrai, je ne parlerai pas. Je fais ce serment du mutisme, pour que tout demeure d’une pureté absolue, d’une blancheur intacte. » (idem, p. 103) ; « Écoutez le silence. » (Rudolf, l’un des héros homosexuels s’adressant à ses deux potes gays Nicolas et Gabriel, dans le film « Boys Like Us » (2014) de Patric Chiha) ; etc.
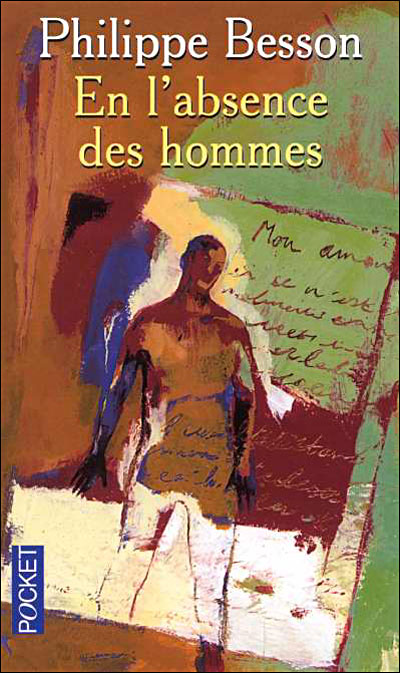
Le roman le plus bobo de la Terre !
« Prends soin de toi… Je t’embrasse… Fais de beaux rêves »
Le bobo veut faire passer sa retenue/son abstinence pour noble, alors qu’en réalité il la fera voler très vite en éclat au moment opportun. Il refuse lâchement de s’abandonner à l’Amour qu’il considère comme une maladie, un terrible danger. Il a peur de se voir fragilisé par ses passions, de ne pas les contrôler… parce que dans le fond, il ne veut pas les connaître ni les contrôler : « Faire court. Moins lyrique. Moins grandiloquent. Moins ridicule. Elle [Gabrielle, l’héroïne lesbienne] ne se pardonne pas les fadaises qu’elle lit sous sa plume. » (Élisabeth Brami, Je vous écris comme je vous aime (2006), p. 77)
Le personnage bobo bisexuel adore les au revoir laconiques, les amours impossibles, la symphonie des adieux, les « je t’aime » tus, la sobriété singée, l’Inachevé : c’est si romantique, l’absence ! « (Lettre non achevée, non envoyée.) » (Philippe Besson, En l’absence des hommes (2001), p. 128) ; « La lettre est restée de longs jours dans l’entrée avant d’être envoyée. » (Élisabeth Brami, Je vous écris comme je vous aime (2006), p. 62) ; « Demain, elle [Gabrielle] répondra. Demain, oui, c’est sûr. » (idem, p. 73) ; « La signature finale est illisible. » (idem, p. 101) ; « Le véritable je t’aime n’est pas sonore. » (le Comédien de la pièce Les Hommes aussi parlent d’amour (2011) de Jérémy Patinier) ; « Comme pour la première, je ne sais pas si je t’enverrai cette lettre, je ne sais pas si tu la liras… si tu riras… ou si tu pleureras. » (Bryan parlant à son amant Kévin, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 313) ; etc.
D’ailleurs, quand il drague et veut à tout prix montrer « discrètement » qu’il est intéressé par l’internaute qu’il vient de connaître il y a à peine 3 heures, et avec qui il veut déjà coucher dans la seconde (… mais patience, patience… simulation de patience), le bobo bisexuel arrive généralement avec ses gros sabots et sort toujours la même artillerie lourde de la fausse pudeur. Par exemple, il termine ses mails/lettres par des formules laconiques bien appuyées du type « Prends soin de toi », « Je t’embrasse » « Fais de doux rêves, mon cher X… » : « Prends soin de toi. » (Chris écrivant à son amant internaute Félix dans le roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 40 et p. 44) ; « Prenez soin de vous. » (Élisabeth Brami, Je vous écris comme je vous aime (2006), p. 82) ; « Enfin j’ai reçu une lettre de ma cousine. Elle ne dit rien de ce que nous avons fait ensemble, sinon qu’elle finit sa lettre par ‘je t’embrasse’. Trois fois à la suite. Elle m’écrit surtout pour me dire le bien que je lui ai fait en lui prêtant la somme dont elle avait grand besoin et qui la sauve tout à fait. » (Alexandra, la narratrice lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 75) ; etc. Comme il n’assume pas d’aimer, il dit qu’il réserve son « je t’aime » à la personne de sa vie… pour finalement, dans les faits, ne jamais le vivre vraiment, et le distribuer comme un soi-disant cadeau originel à tous ses amants de passage…
Dans son roman semi-autobiographique Par d’autres chemins (2009), Hugues Pouyé évoque à juste titre la « désinvolture finalement assez travaillée des bobos » (p. 53) En réalité, il s’agit d’une fausse improvisation, d’un mensonge sur la rigidité/impulsivité mise en place : « Il n’y a pas de stratégie. Je ne sais pas avoir de stratégie. » (Vincent dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 17) ; « Je n’ai pas de stratégie, je l’ai déjà dit, mais je sais ce que je fais, je le sais très précisément. » (idem, p. 23) Chez le bobo, tout doit arriver avec le moins de désir possible (paradoxal pour quelqu’un qui se vante de parler d’Amour 24h/24…) : « Je n’ai rien cherché, rien forcé. Cela s’est produit, voilà tout. » (idem, p. 25) Cet hypocrite en puissance est sincère dans sa perversité, inflexible dans sa mollesse ou son relativisme, lâche dans son laisser-faire qu’il fait passer pour héroïque et détendu : « Son expression te paraît démesurément tendre, sincère. » (Félix à propos de Bob dans le roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 152) ; « Je ne suis pas pervers. La perversité exige des efforts que je ne suis pas disposé à accomplir. Il y a dans la perversité quelque chose d’actif, de volontaire qui n’est pas dans mon caractère. Je ne cherche pas à peser sur les événements. Je les laisse survenir. Simplement, j’en mesure exactement la portée, les conséquences possibles. Je possède l’intelligence du monde et des hommes. On va ne pas m’aimer de tenir de tels propos. Qu’y puis-je ? J’en suis sincèrement désolé. Qu’on me croie lorsque j’affirme cela. » (Vincent, le héros homosexuel du roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 25) Oui, on PEUT le dire : le bobo est puant.
FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION
PARFOIS RÉALITÉ
La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :
I – LA CONTRADICTION DES NOUVEAUX MATÉRIALISTES BISEXUELS :
Le bourgeois révolté
Voici venir « les nouveaux aristocrates » (p. 179) décrits par Vincent Petitet dans son roman Les Nettoyeurs (2006) ! Comme le soulignait à juste raison Pier Paolo Pasolini pour ouvrir son film « Teorema » (« Théorème », 1968), « La bourgeoisie change de façon révolutionnaire. » Au sens littéral du terme ! Et l’arrivée des « bobos » sur la scène publique, depuis 2000, et dans le langage courant, ne fait que le confirmer. Pas une dictature humaine, par le passé, ne s’est avancée sous la bannière du progrès, de la révolution, de la liberté, de la louange des différences, de l’Amour, de la fête, de l’Égalité, du retour aux origines et au Naturel, de l’anti-conformisme, de l’anti-fascisme, pour s’imposer avec une brutalité pourtant incroyable.
Les dandys romantiques actuels, baptisés « les bourgeois-bohème », s’opposent en théorie aux anciens bourgeois… mais au fond ils les rejoignent, au moins en désir. « Je suis un dandy, Liz, si tu as compris ça, tout est élégant, c’est simple, sincère et pur à la fois. Suffit de l’avoir en tête. » (Willie, le jumeau underground de l’écrivain Guillaume Dustan, dans le roman La Meilleure part des hommes (2008) de Tristan Garcia, p. 99) Ils sont les défenseurs de l’indifférenciation sexuelle (concrètement, ils nous voudraient tous bisexuels en actes, et amoureux/asexués dans les discours : bref, pansexuels !), de l’idéologie du « pro-choix » (à savoir que c’est uniquement la conscience individuelle qui devrait dicter le vrai du faux, et non la morale ou une instance sociale collective), de la liberté sans cadre, de la Nature (en tant qu’abstraction transcendantale), d’un « art-de-vivre de l’abandon ».
Étant donné que les seules « valeurs révolutionnaire » qui aient du prix aux yeux de l’individu bobo sont l’opposition, l’inversion et la contradiction, il était logique que la boboïsme s’oriente vers la bisexualité, et en particulier vers la sexualité des personnes jadis baptisées « les invertis » au XIXe siècle, c’est-à-dire les personnes homosexuelles. « Je suis né auprès de deux soixante-huitards militants. J’ai eu une enfance très très heureuse et très très libérée. Mon père est quelqu’un extrêmement excentrique. C’est un peintre. Il m’a dit qu’il avait probablement des tendances homosexuelles cachées. » (Jonathan, séropositif et homosexuel, dans le documentaire « Prends-moi » (2012) de Sébastien Lifshitz) ; « Il y a une rencontre sociologique, au cœur des grandes villes, entre homosexuels, militants ou pas, et femmes modernes, pour la plupart célibataires ou divorcées. Le cœur de cible de ce fameux électorat bobo. Mêmes revenus, mêmes modes de vie, même idéologie, ‘moderniste’, ‘tolérante’, multiculturelle. À Berlin, Hambourg et Paris, ces populations ont élu comme édiles trois maires homosexuels – et fiers de l’être – qui ont la conviction de porter un nouvel art de vivre, une nouvelle Renaissance. » (Éric Zemmour, Le Premier Sexe (2006), pp. 22-23)
Contrairement à l’idée reçue selon laquelle les comportements homosexuels ne se rencontreraient qu’en milieu luxueux et propret, on voit beaucoup d’homosexualité dans les sphères relationnelles bobos, « cools », roots, underground, dark, gothique et bohème. Concrètement, l’individu homosexuel est aussi rastaman, anti-system, sans le sou, marginal, punk, hippie. Il fait certes partie de la famille de l’homosexualité de circonstance, de ceux qui viennent à la pratique homosensuelle et homo-érotique par accident, par ignorance, par expérimentalisme (lui dira « par ouverture »), par l’absorption de drogues, plutôt que parce qu’il ressent précocement un désir homosexuel en lui. Mais la « grande folle » maraisienne sophistiquée n’est pas la seule à être bourgeoise. Le sujet bobo est aussi un individu homosexuel tardif, avec un passif dit « hétérosexuel ». C’est l’homme bisexuel par excellence, l’Indifférent à l’amour sexué, celui qui n’ira pas forcément jusqu’à coucher avec des garçons, mais qui testera volontiers la fascination qu’il engendre chez les individus plus profondément homosexuels que lui. « Le bisexual chic : s’injecter un brin de bisexualité sans en assumer une identité. » (la voix-off du documentaire « Tellement gay ! Homosexualité et Pop Culture », « Out » (2014) de Maxime Donzel) L’homme bobo est un séducteur né, ne l’oublions pas. Il drague tout ce qui bouge. Et les garçons (ou les filles, pour le cas lesbien), ça bouge aussi !
En général, les individus bobos, très tatillons sur les questions d’écologie, sont beaucoup plus permissifs et laxistes sur les questions de morale sexuelle – masturbation, avortement, bisexualité, homosexualité, mariage gay, etc. – du moment qu’elles ne polluent pas… « On est très hippie, ici. » (Veronica, la mère porteuse qui a accepté d’aider un couple homo français à avoir un enfant, dans le documentaire « Deux hommes et un couffin » de l’émission 13h15 le dimanche diffusé sur la chaîne France 2 le dimanche 26 juillet 2015) Par exemple, en France, c’est le mouvement des Verts (Noël Mamère) qui a célébré le premier mariage homosexuel à Bègles (c’était le 19 avril 2005). Ce n’est pas un hasard.
Comme pour eux « l’amour n’a pas de sexe » (= comprendre « n’est pas sexué »), qu’ils ne doivent pas mettre en avant la génitalité mais la « personne », la « relation », la « rencontre », l’« expérience sensible » – tous ces séduisants concepts intellectuels qu’ils poétisent à l’excès, et vident de réalité –, ils s’autorisent tout et n’importe quoi en matière d’affectivité à partir du moment où, dans leur tête, ils l’appellent « Amour ».
La population bobo participe à l’inversion sexuelle, ne serait-ce déjà que vestimentairement et physiquement. La nana bobo n’est pas forcément très féminine : elle ne se maquille pas toujours, aime s’habiller en garçon manqué ou se travestir, porte parfois un turban dans les cheveux, ou aime se couper les cheveux court, « à la garçonne ». Certains gars bobos portent des petites sockettes qui les féminisent, se font des queues de cheval, se maquillent de temps en temps, jouent parfois les femmes à barbe (cf. la pochette de l’album « Pays sauvage » d’Émily Loizeau), portent des chapeaux à la Charlie Winston ou à la William Pharrell. Par exemple, dans le film « Boys Like Us » (2014) de Patric Chiha, Nicolas, Gabriel et Rudolf, les trois héros gays (barbus… quand ils peuvent), portent tous les trois le même chapeau Charlie Winston : ils sortent tout droit du moule de l’anti-conformisme… et finissent par comprendre qu’ils sont des moutons comme les autres : « On est un peu homos clichés aujourd’hui. » En ce moment, la tendance est aux transgenres (ou « cisgenres », si on veut), avec les guichetiers et ouvreurs du Théâtre du Rond-Point (à Paris), en barbe pour le haut (mal coiffés, de préférence), et jupe pour le bas.

Album d’Émily Loizeau
Maintenant, du côté des membres « déclarés » de la communauté LGBT, une grande majorité d’entre eux « se la jouent » aussi bohème et pauvres. « D’une certaine vie de bohème, insouciance du lendemain, des convenances et des idées établies, ces passages constituaient aussi ma défense et mon illustration. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 46) Beaucoup de personnes homosexuelles s’en prennent aux membres de la « bonne société » auxquels elles tentent de ravir la place. Par exemple, dans ses romans, John Banting s’en donne à cœur joie pour écorcher les bourgeois conservateurs. Dans les pièces de Joe Orton, on assiste également à la destruction de la famille bourgeoise. De leur côté, Pierre Dort et Roland Barthes, tous deux issus de la bourgeoisie, fondent en 1953 la revue Théâtre Populaire qui refuse le « divertissement bourgeois ». Comme son nom l’indique, le mouvement artistique britannique et nord-américain Pop Art, archi-bobo-homo, et ayant actuellement pignon sur rue dans le monde des médias et de l’art contemporain, se présente comme un « Art Populaire », proche des masses. Plus proches de nous, les sorties de « journalistes » ou d’« humoriste » telles que Sofia Aram ou Caroline Fourest sont clairement « anti-bourgeois ».
La majorité des personnes homosexuelles expriment leur haine du libéralisme économique et du système capitaliste, en affichant leur goût pour le dénuement matériel et un mode de vie en apparence spartiate et bordélique, en total décalage avec l’éducation étriquée qu’elles auraient reçue.« Les mondanités, c’est pas mon genre ! » (Jean-Claude Brialy, Le Ruisseau des singes (2000), p. 324) Dans l’idée, elles se positionnent contre la mondialisation (… sauf quand celle-ci est au service de leur « humain » à elles !). Pour devenir discrètement bourgeoises, certaines imitent alors « le bobo », un personnage fortuné qui se déguise en pauvre pour se persuader et convaincre son entourage qu’il n’est pas riche matériellement afin de le rester, en désir ou concrètement. Elles sont obnubilées par l’idée de « faire authentique et simple » (en vivant à la campagne par exemple), quitte à rentrer dans l’artifice champêtre forcé pour arriver à se convaincre qu’elles ne sont pas bourgeoises.
Dans le documentaire « Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé : l’Amour fou » (2010) de Pierre Thoretton, Pierre Bergé, qui est l’archétype de la gauche caviar richissime, qui a exploité son amant Yves Saint-Laurent en pressant le citron du monde de la haute couture jusqu’à la dernière goutte, a quand même le culot sincère de soutenir, face à la mer et depuis sa résidence secondaire battue par les vents, qu’il est un grand révolutionnaire ayant toujours lutté contre les inégalités (surtout sous la présidence de François Mitterrand : « Le retour de la gauche au pouvoir m’a permis de reprendre une place dans l’échiquier politique. »), et que le monde de la mode s’est embourgeoisé et qu’il n’est plus ce qu’il était ! « C’est un métier qui a été livré aux commerçants. » Le bourgeois qui joue sincèrement au pauvre.
Hallucinant.
Qu’il soit matériellement riche ou non (il appartient généralement à la classe moyenne d’ailleurs), l’homme bobo bisexuel est tellement motivé par l’intention (son refus de l’argent, son dégoût des fascismes historiques, sa « clairvoyance » quant à la bobo attitude et ses limites, sa passion pour l’authenticité – humaniste dans l’idée mais misanthrope dans les faits –, son âme de poète, etc.) plus que par l’être ou le faire, qu’il en devient artificiel, et donc bourgeois. Tout ce qui est entaché de désirs non-suivis des actes, ou bien d’idéologies ultra-politisées bon marché, fait bobo : cf. le défilé anti-Lepen en 2002 dans le film « Ma Vraie Vie à Rouen » (2002) d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau (on voit les personnages homos et gay friendly faire la manif), l’affichage d’un anti-sarkozysme de bon aloi dans le film « L’Homme au bain » (2010) de Christophe Honoré ou dans « Nés en 68 » (2008) d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau, le mépris de la bourgeoisie dans la chanson « Soyez pédé » de GierRé, etc.
L’individu bobo bisexuel se veut « plus bourgeois que bourgeois », plus raffiné et moins grossier que le « vieux cochon » riche (chanté par Jacques Brel). Il essaie de concilier discrètement ses rêves de bourgeoisie avec ses aspirations humanistes, autrement dit de vivre en homme bourgeois sans que cela se voie ni que lui-même s’en aperçoive : « Ne serait-il pas possible de jouir de la culture bourgeoise (déformée), comme d’un exotisme ? » (Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes (1975), p. 63) ; « Lorsque j’ai vu pour la première fois ‘Le Prince et le Pauvre’, je voulais être les deux à la fois. » (Gore Vidal, Palimpseste – Mémoires (1995), p. 34) ; etc. Ce n’est pas parce qu’il a renoncé à vivre concrètement dans le luxe qu’il y a renoncé en désir, dans son cœur (on est bobo surtout du point de vue du désir : pas d’abord matériellement). Par exemple, dans son autobiographie Mauvais Genre (2009), Paula Dumont avoue (seulement en boutade ?) qu’elle « regrette beaucoup de ne pas avoir été élevée chez les milliardaires comme Natalie Barney » (p. 104)
Beaucoup de personnes homosexuelles et bisexuelles font partie des « riches » partiels, de ces enfants gâtés du capitalisme, de ces « bourgeois ratés » comme dirait Fanny Ardant dans le film « Huit Femmes » (2002) de François Ozon, car leur désir homosexuel les oriente davantage vers le paraître ou l’avoir que vers l’être, vers la haine que vers l’Amour. Par exemple, un nombre conséquent de films à thématique homosexuelle figurent au palmarès de festivals de cinéma super bobos (Festival de Cannes en France, Festival du film « indépendant » de Sundance aux États-Unis, etc.).
En règle générale, elles n’apprécient pas du tout d’être associées à l’image des bourgeois planqués. Pour elles, le mot « bourgeoisie » ne va pas avec militantisme homosexuel, anti-capitalisme, bar « crade » de Saint-Germain-des-Prés, starlette seventies qui fume sa clope avec un bon roman de la littérature classique, appartenance à la gauche politique et au socialisme, dénuement matériel, haine de la mondialisation, dénonciation de la société de consommation, tous ces séduisants concepts dont elles s’imaginent être les dignes représentantes. Elles acceptent difficilement que le cliché homo = bourgeois ne soit pas vrai comme elles l’imaginent – à savoir causalement – mais vrai « coïncidentiellement », à travers le moyen terme lâche que constitue la population bobo.
Il faut bien réaliser intellectuellement que le bourgeois ne s’imagine même pas bourgeois. Des gens comme Louis II de Bavière, Marcel Proust, ou encore Denis Daniel, disent détester les petits-bourgeois, mais restent pourtant très petits-bourgeois en actes et en attitudes parce qu’ils demeurent soumis à l’image et au matériel. « Tu sais combien j’ai souffert de cette réputation fallacieuse de grand bourgeois distant et froid. » (Denis Daniel, Mon théâtre à corps perdu (2006), p. 139) ; « Pierre et Gilles ignorent superbement l’élitisme des Beaux-arts et le populisme télévisuel. » (cf. l’article « Pierre et Gilles » d’Élisabeth Lebovici, dans le Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, p. 365) ; etc.
Ils n’ont pas compris que c’est la haine de soi et des autres qui rend « petit-bourgeois », et non la simple intention affichée d’haïr la bourgeoisie, de cracher sur l’image du bourgeois ou sur l’argent des « capitalistes ». Je citerai volontiers Jean-Paul Sartre qui a si bien décrit l’élan paradoxal d’attraction-répulsion qu’expérimente les individus bobos vis à vis de leur milieu social : « Le héros romantique est un soldat perdu qui veut faire de sa vie une épopée de solitude en souvenir des victoires que ses ancêtres ont remportées pour de bon sur des champs de bataille ; c’est un noble en exil dans la société des bourgeois qui ont tué son roi. »
Qu’on le veuille ou non, l’anti-bobo-attitude et l’anti-bourgeoisie correspondent à une attitude bourgeoise aussi. « Festivus festivus, rejeton des soixante-huitistes, se retourne contre ceux-ci et les met en accusation. » (Philippe Muray, Festivus festivus : Conversations avec Élisabeth Lévy (2005), p. 76) La dernière phrase de la chanson « Les Bobos » de Renaud l’atteste… : « Ma plume est un peu assassine pour ces gens que je n’aime pas trop. Par certains côtés, j’imagine que j’fais aussi partie du lot ! » Comme l’a largement prouvé Michel Foucault, l’idéologie bourgeoise a des effets réverbérants : elle est pour et contre elle-même. C’est une idéologie de l’idolâtrie (Rappelons-nous par exemple qu’Hitler, à son époque, quand il a cherché à créer une nouvelle élite, s’interdisait de la penser « bourgeoise » ; dans son manifeste nazi Mein Kampf (1924), il parlait en des termes explicites du « lamentable troupeau des petits-bourgeois », et affirmait que son « mouvement n’a rien à voir avec les vertus bourgeoises »).
Il n’y a pas plus bobo que l’anti-bobos. Par exemple, le romancier homosexuel Essobal Lenoir censure son identité bobo : « De la vie de bohème menée par Essobal durant ces années, nous ne dirons rien. » (il parle de lui-même à la troisième personne, dans sa nouvelle « Une Vie de lutte » (2010), p. 170) Pour nier qu’il est bobo, il use même de l’autoparodie : « Essobal Lenoir ne rate jamais une marche de la section Neuilléenne de lutte contre le Front National. Tous les week-ends, au golf, il est très farouchement opposé à toute forme d’antisémitisme, voire même de racisme, vous savez le truc des nègres et des bougnoules. » (cf. la nouvelle « Une Vie de lutte » (2010), p. 171) Mais pourtant, quand on l’écoute parler en vrai, on se rend très bien compte qu’il n’a pas renoncé à son identité de dandy esthète. Il s’exprime d’ailleurs comme une vraie bourgeoise sophistiquée : « Je n’ai pas des goûts de chiotte ! […] Nous n’avons pas les mêmes valeurs ! » (le narrateur homosexuel de la nouvelle « Mémoire d’un chiotte public » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 81) ; « Le hasard voulut que nous nous retrouvassions… » (le narrateur homosexuel de la nouvelle « Crime dans la cité » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 73) ; etc.
Avec le dramaturge argentin Copi, la même contradiction est observable. Tandis qu’il passe toute sa vie à mimer de manière iconoclaste la bourgeoisie dont il est issu, et à côtoyer des cercles artistiques homosexuels avant-gardistes et bohème, Copi n’a jamais cessé d’être snob : « Avec un ami, j’ai vendu des dessins sur le pont des Arts, mais je restais très bourgeois. […] Mon père qui m’envoyait de l’argent était en exil dans une ambassade. » (Copi dans l’article « Entretien avec Michel Cressole : Un mauvais comédien, mais fidèle à l’auteur », publié dans le journal Libération du 15 décembre 1987) Même après sa mort, les metteurs en scène et les troupes qui montent actuellement ses pièces bigarrées n’échappent pas à l’embourgeoisement de leur démarche pourtant intentionnellement anti-bourgeoise (les mises en scène clinquantes de Lavelli au Théâtre de la Colline, ou de Marcial Di Fonzo Bo dans les grands théâtres nationaux parisiens, le montrent explicitement…). Le camp copien n’est plus une dérision, mais un luxe protecteur de faux rebelles.
Au bout du compte, l’individu bobo bisexuel est ce jet-seteur écartelé entre Nord et Sud, symbolisant la fracture économique mondiale entre pays riches et pays pauvres, rêvant, comme le businessman de Starmania, à la fois d’« être un anarchiste et [tout en continuant de] vivre comme un millionnaire », « ne pouvant pas supporter la misère » et la voulant éternelle pour sauvegarder ses privilèges. Il ne désire pas l’union entre ceux qu’il classe parmi les « riches » et ceux qu’il étiquette « pauvres » et qui doivent surtout le rester. Les personnes homos-bisexuelles sont la plupart du temps issues d’un milieu riche et aristocratique. « Parmi les gays, les classes aisées sont deux fois plus représentées et les bacheliers deux fois plus nombreux que chez les hétérosexuels. » (cf. l’article « Classes sociales » d’Éric Fassin, dans le Dictionnaire de l’homophobie (2003) de Louis-Georges Tin, p. 98) Si jamais elles ont eu le malheur de naître dans un milieu modeste et « beauf », elles feront tout par la suite pour conquérir une classe sociale plus valorisante à leurs yeux. Elles sont attirées intellectuellement par la misère qui règne dans un quartier, l’instabilité sociale, le monde ouvrier… mais pour les côtoyer de loin, ou s’en approcher juste le temps de la photo ou d’une manif’. « J’étais politiquement du côté des ouvriers, mais je détestais mon ancrage dans leur monde. » (Didier Éribon, Retour à Reims (2010), p. 73) Je vous renvoie à la partie « Riches » du code « Promotion « canapédé » » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels, pour compléter.
Le pauvre, elles l’aiment surtout en musique et en peinture. Pas trop proche. Dans le monde bobo bisexuel élitiste, une grande place est laissée à la culture roots-cabaret, à la musique jazz, étrangère, world, pauvre (jouée par des « p’tits Africains », des « p’tits gitans », des « p’tits aveugles », des « personnes handicapées », des « p’tits drogués », des « gens de la rue » et des illustres inconnus). Du moment qu’elle est (encore) perçue comme inconnue des mass media, minoritaire, non-commerciale et non-populaire, « bio », elle ramasse en général tous les suffrages parmi les communautaires LGBT.
Comment comprendre chez le sujet bobo bisexuel ce mélange paradoxal d’intentions par rapport à la bourgeoisie et par rapport à leur révolution humaniste ? C’est bien simple. La sacralisation aveugle de la différence conduit forcément, à un moment donné, à la (l’auto-)contradiction, à la (l’auto-)trahison… puisqu’un beau jour, une différence viendra forcément s’opposer à la mienne ! « Le dandysme, ce n’est ni l’affection, ni la coquetterie, ni la mode. C’est tout le contraire. C’est la différence absolue. » (Jean-Paul Aron, cité dans le Dictionnaire gay (1994) de Lionel Povert, p. 57) Même si l’individu bobo bisexuel croit échapper à son identité de bourgeois en vivant chichement et en s’autoproclamant « Maître du Bon Goût » (y compris en cultivant le soi-disant « mauvais goût » social), il se choisit une nouvelle forme de marginalité bourgeoise. Il trouve sa fierté à accepter en lui ce qu’il trouverait honteux ou avilissant chez les autres (par exemple, quand il regarde une émission de variété ou de télé-réalité, il s’empresse de trouver sa démarche « géniale », drolatique, décalée, sociologique, limite subversive), car il se donne ainsi à lui-même les signes tangibles de son incroyable ouverture d’esprit. Même quand il fait preuve de mauvais goût, il se persuade qu’il a bon goût parce qu’il choisirait le mauvais goût en connaissance de cause : « Oui, c’est vrai ! Un bon sandwich avec un Coca-Cola. Il n’y a rien de tel ! C’est vrai. Avec une bonne crème glacée, bien sûr. » (Michel Foucault, « Une Interview de Michel Foucault par Stephen Riggins », 1983) Finalement, il n’est pas libre. Il fait l’inverse de ce qu’il croit qu’on attend de lui, mais comme cet « inverse » est souvent le fruit de ses propres fantasmes, il imite et se soumet aux autres/à l’image sans même s’en rendre compte.
L’individu bobo homo est bourré de contradictions : par certains côtés, il se montre réfractaire à la modernité, à la civilisation, et à la consommation… et par d’autres, il ne peut pas vivre longtemps à la campagne, loin de son I-phone (l’outil que les personnes homosexuelles ont possédé avant tout le monde, en exclusivité !) et il se munit des équipements audiovisuels dernier cri (qui ne feront, à ses yeux, « bourgeois » que chez les autres, pas chez lui, évidemment !) : l’écran plat dans le salon design, l’ordinateur portable Mac, le Smartphone, etc. Il passe énormément de temps sur Facebook et les réseaux sociaux, d’ailleurs.
Il a des tas de projets en tête, mais qu’il a du mal à mener à terme : « Depuis des lustres, chaque fois que nous déjeunions dans un restaurant, qu’il s’agisse d’une crêperie, d’une pizzeria ou d’un lieu exotique, il fallait que Martine nous empoisonne le repas à se lamenter que c’était ce commerce-là qu’il lui fallait et non un autre. Au cours des douze dernières années, elle avait eu des velléités d’ouvrir, outre de nombreux restaurants, tous plus branchés les uns que les autres, une carterie et un salon de thé réservé à une clientèle exclusivement féminine et cela à Annecy ! » (Paula Dumont parlant de sa compagne bobo-campagnarde Martine, La Vie dure : Éducation sentimentale d’une lesbienne (2010), p. 118)
En réalité, l’individu bobo bisexuel est un consommateur qui ne veut pas se voir consommer, ni se « pétassiser »… pour mieux consommer en douce : « Elle avait toujours aimé traîner dans les boutiques, même quand elle n’avait pas d’argent à dépenser. » (idem, pp. 152-153) Par exemple, dans le documentaire « Desire Of The Everlasting Hills » (2014) de Paul Check, Paul, un témoin homosexuel, raconte qu’il est resté 24 années avec son compagnon Jeff, avec qui il a vécu 24 ans dans diverses résidences à la campagne aux États-Unis : tout leur quotidien était fondé sur le matériel, les voyages, les maisons.
Boboïtude, jumelle de l’homophobie
Étant donné que l’individu bobo bisexuel a choisi l’indétermination, la marginalité et la contradiction comme identité et amour, il est logique qu’en acte, sa bobo-attitude se traduise tôt ou tard par une homophobie : « Lui, pense-t-il, il n’est pas homo et n’appartient pas à une communauté pré-définie ! Il est excité par des anges amoureux et il touche avec les yeux, c’est bien tout ! ». « Être homo, c’est devenu très commercial. » (François, l’homo fashion, dans la pièce L’un dans l’autre (2015) de François Bondu et Thomas Angelvy)
Cette attitude bobo là, j’ai pu la voir chez toutes les personnes homosexuelles pratiquantes que je connais. En effet, le sujet bobo bisexuel a tendance à développer (et c’est là le paradoxe du désir homosexuel) une forme d’homophobie snobinarde, concomitante à son interminable coming out (qu’il présente comme « exceptionnel », « accidentel », les rares fois où il l’ose) et à sa timide défense d’une culture homosexuelle qu’il n’assume pas vraiment. On découvre chez lui un snobisme anti-« milieu gay » et anti-« folles » qui semble caractériser les anciens combattants désabusés du militantisme LGBT des années 1980-1990 (cf. les programmateurs de la chaîne Canal +, par exemple ; les rédacteurs de journaux alternatifs comme Minorités ; les militants d’Act-Up) tout comme les tenants de la presse gay actuelle (les journalistes de Têtu ou de Yagg en première ligne – Gilles Wullus, Thomas Doustaly, etc. –, les chroniqueurs d’émission comme Homo Micro sur Fréquence Paris Plurielle, les responsables des associations militantes LGBT, et les créateurs de sites d’« événementiel homosexuel » qui jouent les masseurs globe-trotteurs, relax, « bons vivants », pour masquer leur trouille de traiter des vrais problèmes et des sujets qui fâchent concernant l’homosexualité). Le « croquage de pédés » est un sport communautaire bobo très couru dans le « milieu homo » ! Il est porté par les néo-dandys homosexuels underground, bref, autant dire par la très grande majorité des membres de la communauté homosexuelle. Pour l’individu bobo homo, la follasse décervelée (qu’il rêve de sauter quand elle aura un peu mûri…), « c’est le beauf version gay » (cf. un « post » que j’avais lu sur le mur Facebook d’un de mes amis gay, le 20 avril 2011). Idem pour la fem et la butch côté lesbien. Si l’individu bobo devient homo, c’est qu’il acceptera de faire exception au « commun des homos », par « amour » (par dépit, moi je dirais…), qu’il concèdera à appartenir à la vulgarité d’une néo-communauté sexuelle « marchande », « caricaturale », « beauf » en ses fondements.
II – LA DÉPRIME SPIRITUELLE :
L’obsession pour le naturel sensible
D’habitude, pour prouver la force de sa sincérité, l’individu bobo bisexuel se focalise sur la Nature. Il est obsédé par la spontanéité, l’instantanéité des sensations et des pulsions, la recherche des origines, l’authentique « sobre », la création de Nature et des sens (ce n’est pas un hasard si l’une des revues homosexuelles françaises les plus connues après Têtu se soit choisi comme titre Sensitif…) Dans un soubresaut de conscience citoyenne, et surtout pour pallier à son désert affectif intersidéral, il essaie en général de fuir la ville et la société de consommation, pour se mettre au vert (même s’il a souvent la clope au bec) ! Tout ce qui renvoie à l’innocence virginal de l’enfance (Mistral gagnant, ou publicité des jambons Herta), à la nostalgie exotique et lointaine, au typique et à la couleur locale, trouve grâce à ses yeux. D’ailleurs, il aime filmer les plans de tables de cuisine et afficher sur Facebook ce qu’il mange (et encore mieux, ce qu’il a cuisiné !).

Les réalisateurs bobos bisexuels aiment se prendre pour la Nature, et faire évoluer leurs personnages homos dans des cadres complètement sauvages et paradisiaques, qui n’ont pas été touchés par la main des Hommes, afin de prouver que l’homosexualité est belle et naturelle, tout simplement. On retrouve ce parfum naturaliste forcé dans des « films-carte-postale » tels que « L’Homme de sa vie » (2006) de Zabou Breitman, « Le Secret de Brokeback Mountain » (2006) d’Ang Lee, le film « Broderskab » (« Brotherhood », 2009) de Nicolo Donato, « Einaym Pkuhot » (« Tu n’aimeras point », 2009) d’Haim Tabakman, « Les Filles du botaniste » (2006) de Daï Sijie, « Donne-moi la main » (2008) de Pascal-Alex Vincent, et tant d’autres… Le film « Contracorriente » (2011) de Javier Fuentes-León se veut une ode à la Nature, un bal d’émotions, de bruits de mer tout le temps pour bercer la romance homo qui nous est racontée. Je vous renvoie aussi au documentaire « Cet homme-là (est un mille-feuilles) » (2011) de Patricia Mortagne (commençant par des images de photos de famille décomposée suspendues à des fils à linge, avec des pinces, dans un jardin).
L’individu bobo bisexuel a tendance à se choisir comme nouveau Dieu le reflet embellissant de lui-même que lui renverrait la Nature. C’est pour cela qu’il élit souvent résidence dans un cadre bucolique, champêtre, proche de jolis paysages. « Il y avait énormément de femmes qui vivaient dans cette région, et qui avaient des fermes. Il n’y a jamais eu aucun problème. Jamais jamais jamais. » (Catherine, une femme vivant à la ferme avec sa compagne Élisabeth, après avoir fait un grand voyage autour du monde, dans le documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz) ; « Le bonheur, c’est simple… comme une promenade au parc. » (la voix-off parlant des « couples » homos dans le documentaire « Homos, et alors ? » de Florence d’Arthuy diffusé sur la chaîne France 4 le 14 mai 2012 pour l’émission Tel Quel) ; « Je traîne dans les falaises. » (Stéphane Corbin pendant son concert Les Murmures du temps, au Théâtre de L’île Saint-Louis Paul Rey à Paris, en février 2011) ; etc.
Par exemple, dans la pièce autobiographique Ébauche d’un portrait (2008) de Jean-Luc Lagarce, on apprend que le dramaturge, citadin dans l’âme, a cherché à habiter une maison à la campagne. Dans le documentaire « L’Atelier d’écriture de Renaud Camus » (1997) de Pascal Bouhénic, Renaud Camus, issu d’une famille bourgeoise, vit à la campagne et joue à l’écrivain bohème… mais son accent bourgeois et son radicalisme idéologique le trahissent malgré tout. Dans le documentaire « Une Vie de couple avec un chien » (1997) de Joël Van Effenterre, le couple bobo homosexuel, Denis et Bruno, s’achète une grande maison à la campagne avec un labrador pour fuir l’enfer parisien ou strasbourgeois auquel il n’a pourtant pas renoncé.
Allez viens, j’t’emmène au vent !… ou face à la mer
La Nature adulée par l’individu bobo bisexuel a pour particularité d’être prise pour un être humain, et surtout de ne pas être dominée par l’Homme. Autant dire que c’est une conception anti-biblique de la Nature voulue par Dieu (une Nature que les êtres humains sont appelés à soumettre et à respecter). Par exemple, dans son docu-fiction « Le Cimetière des mots usés » (2011), François Zabaleta nous montre les images d’une Nature capricieuse et dévastatrice (celles du tsunami sur Fukushima, au Japon), « le bruit de fond du monde ». Dans les discours bobos-homos, l’Homme doit en général se laisser aller par les éléments naturels, et particulièrement par les forces invisibles que sont le vent ou l’eau. « Depuis ce jour d’hiver précoce, giflé par les rafales d’un vent d’est. » (Stefan Corbin lors de son concert Les Murmures du temps au Théâtre de L’île Saint-Louis Paul Rey, à Paris, en février 2011) ; « J’entends le vent. » (idem) Le vent, c’est le désir qui s’enfuit, c’est la liberté qui se liquéfie et se quitte.
Par exemple, dans le documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz, visant à prouver que l’amour homosexuel est simple et naturel, la nature est filmée longuement (vent dans les arbres, nuages, chèvres, etc.). Idem dès les premières images du film « L’homme de sa vie » (2006) de Zabou Breitman. La Nature y est à la fois personnifiée et vidée d’humanité, puisqu’Elle s’impose à l’Homme et est voulue toute-puissante, incontrôlable, indomptable… alors qu’objectivement, Elle n’a pas été créée ainsi.
L’individu bobo bisexuel a trouvé dans les espaces de l’infini que sont l’océan et le ciel les lieux idéaux où déverser son âme et son désir pour ne plus jamais les retrouver : cf. le vidéo-clip de la chanson « The Edge Of Glory » de Lady Gaga, le documentaire « Le Genre qui doute » (2011) de Julie Carlier, etc. La mer et le vent constituent ces parfaits miroirs narcissiques… et ce qu’ils lui font dire – c’était à craindre –, c’est bien du vent ! des larmes de joie forcée et surtout de déprime !
La simulation de contemplation émue de la mer – et plus globalement l’exposition à la beauté esthétique (un joli film, un paysage grandiose, un grand concert classique, une belle expo, un coucher de soleil…) –, c’est la technique de drague la plus cheap (… et la caution morale la plus navrante) que le libertin bobo ait trouvée lors de sa première rencontre réelle avec l’ami internaute qu’il ne connaît que depuis quelques semaines (ou heures) et sur lequel il va se jeter à corps perdu le soir même, pour ne pas passer pour un chaud lapin … et pourtant, elle marche quasiment à tous les coups ! À croire que la majorité des personnes homosexuelles sont vraiment les proies faciles du romantisme bon marché ! « J’étais déjà amoureux avant même de l’accueillir à sa descente du train. […] Yann était devant moi, beau et aussi gauche que moi. Mon premier réflexe a été de l’emmener contempler la mer Méditerranée. Nous nous sommes promenés, nos doigts s’effleurant comme par mégarde. Nous avons flirté tout l’après-midi comme deux adolescents connaissant leurs premiers émois. » (Jean-Michel Dunand, Libre : De la honte à la lumière (2011), pp. 83-84)
Comme l’individu bobo bisexuel ne se choisit pas d’autre Dieu que lui-même et que son petit bagage de valeurs humanistes politiquement correctes (la tolérance, l’égalité, la différence, la solidarité, l’écologie, … le respect, à la rigueur) qui ne veulent rien dire en soi, il lui arrive très souvent de faire preuve d’un holisme animiste qui spiritualise les objets. Plus clairement, il prête des sentiments aux objets, aux animaux, aux minéraux, aux paysages, bref, à tout ce qui possède très peu de désir et de liberté, contrairement à l’Homme (cf. l’article « Prenez garde aux objets domestiques » de la photographe lesbienne Claude Cahun, dans la revue Cahiers d’art spécial « L’Objet », du 1er février 1936). Il tutoie les étoiles, cause à un arbre, pense que les murs ont des oreilles et des mémoires. « New York me désespérait avec une grâce certaine où, la sereine langueur de la pollution piquée par le bruit et la chaleur, apportait un bonheur furtif et réparateur mais où, planaient irrémédiables, mon angoisse de vivre et l’attente de la mort. Damné jusqu’à la fin des temps, encombré de mes grandes jambes inutiles, j’étais seul, la nuit, plein de désirs inexaucés, sans savoir que mes seuls amis étaient les étoiles, émues, anonymes, de ma présence. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 118)
Par exemple, dans le documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz, on a droit à la séquence « émotion » de la femme lesbienne de 80 ans qui fait parler les murs de la gare de son adolescence : « ‘Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?’. On peut parler à une gare ! Elle m’entend ! La gare voit encore mon père ! »
La bobo-attitude, c’est une forme de « matérialisme vert », d’idolâtrie profane, si vous préférez. Paradoxal de voir cela chez des êtres humains qui se veut détaché du matériel… et beaucoup plus grave qu’on ne le pense, puisqu’à travers une idéologie apparemment alter-mondialiste et généreuse, l’individu bobo cherche à ne plus être libre et devient aussi matérialiste que les matérialistes bourgeois qu’il prétend neutraliser. Amusez-vous par exemple à faire les courses avec lui : il regardera méticuleusement toutes les marques que vous choisissez, vérifiera tous les emballages, et vous traitera d’« égoïste » parce que vous faites vos courses à Leader Price ! Racontez-lui votre voyage humanitaire en terres lointaines : il n’écoutera pas votre récit, et se fixera sur la pollution « inadmissible » de l’avion que vous avez pris pour vous y rendre. Offrez-lui un cadeau, il louchera sur l’étiquette pour savoir comment il a été conçu et par quelles victimes. Même si, en théorie, il défend une noble cause, il a tort sur toute la ligne pour qu’il place cette cause avant l’humain. Et cela le rend inhumain, hyper matérialiste. Si on suit jusqu’au bout sa logique, les arbres coupés hurlent ! Les CDs en aluminium gravables qu’on achète à bas prix, ce sont autant de mineurs chinois qui crient d’être exploités ! En réalité, c’est lui qui rêverait d’hurler ses souffrances, et qui passe sa haine sur les objets. Oui, il existe bien un « fascisme vert », qui cache une forêt de solitude, une carence d’Amour !
Comme il ne veut pas se fixer, et qu’il n’a pas compris que la vraie liberté n’existait que dans un cadre et dans l’acceptation des différences des gens les plus proches de lui, l’individu bobo bisexuel part à la recherche de lui-même en parcourant le monde et en multipliant les voyages sans but. Il voyage davantage pour l’image que pour le Réel et les personnes qu’il pourrait rencontrer : « Les voyages, pour faire bien… » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 121) Il cherche à reproduire l’image d’Épinal romantique de l’électron libre, de l’éternel errant (géographique et désirant), du globe-trotteur sans attache, totalement « free » dans sa tête… et totalement « connecté ».
Il revient de ses voyages humanitaires en ayant un discours appris, en reversant les niaiseries (j’allais dire « aphorismes » ;-)) habituelles concernant la beauté de l’humanisme athée : « On reçoit beaucoup plus que ce qu’on donne. Les pauvres, ils n’ont rien et ils donnent tout » Mais dans les faits, il rentre avec une telle haine des Occidentaux et une telle fatigue d’aimer qu’on est en lieu de douter de la réalité/gratuité de sa démarche altruiste.
À force de se rêver « citoyen du monde » (« Yann Arthus Bertrand’s touch ») et de se projeter/de s’éparpiller sur ses écrans de télé (même s’il dit qu’il ne les possède pas ; c’est Internet, sa nouvelle télé), l’individu bobo bisexuel adopte une vision du monde (et de lui-même) éclatée, narcissique, kaléidoscopique, mercantile, un peu comme dans les publicités actuelles de Benetton, ou les affiches de films nous montrant des mosaïques d’Humanité qui ne sont que des échantillons standardisés d’une diversité lisse, déshumanisée, programmée, attendue, imposée comme unique, avec des quotas précis et des personnages bien stéréotypés (cf. les affiches des films de Cédric Klapisch – « L’Auberge espagnole » (2001), « Les Poupées russes » (2004), « Chacun cherche son chat » (1995) –, de Ferzan Ozpetek – « Saturno Contro » (2007), « Tableau de famille » (2001), « Le Premier qui l’a dit » (2010) –, de François Ozon – « Huit Femmes » (2001) ou de « Potiche » (2010) –, d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau – « Nés en 68 » (2008), « Drôle de Félix » (2000), « Crustacés et coquillages » (2004) –, etc.). Comme il ne veut pas être prêt à affronter sa solitude, ses problèmes personnels, ni ses désirs profonds, qu’il fait tout pour ne pas régler la question de l’Amour et de la place centrale de la foi dans sa vie, il se cherche des dérivatifs, des échappatoires écologistes, humanitaires, artistiques, sentimentales, sexuelles, émotionnelles, dépaysantes.
Par exemple, il veut absolument vivre en groupe. Je connais énormément de personnes homos-bisexuelles qui cherchent à constituer des grandes collocations d’artistes, des troupes de théâtre nomades, des familles de substitution, des clubs de randonnée pédestre, de massage, de sophrologie, ou de naturisme, dans des lofts ou des appartements bohème, à la campagne comme à la ville, parfois le temps d’une université d’été ou d’un camp de vacances. « Angéla était une belle fille d’une trentaine d’années qui voulait former un groupe de goudous. Elle détestait aller traîner en boîte à des heures indues et préférait participer à des petites bouffes entre copines, faire des randonnées, bref vivre au grand jour. Son projet m’a enthousiasmée et je l’ai rassurée que je serais un des piliers de son groupe. Je rêvais, moi aussi, comme beaucoup de mes semblables, d’une grande famille amicale où, peut-être, il me serait possible de rencontrer un jour l’âme sœur. » (Paula Dumont, La Vie dure : Éducation sentimentale d’une lesbienne (2010), p. 208) ; « L’idée nous est venue que nous pourrions, à notre retraite, acheter chacune une maison dans un hameau, et être à l’origine d’une oasis pour goudous. » (idem, p. 239) Le mode de vie hippie, dans la mesure où il banalise la sexualité en général, s’accommode parfaitement de l’homosexualité, et rencontre un véritable succès dans la communauté LGBT.
Mais comme l’individu bobo bisexuel a sa sauvagerie, sa soif d’indépendance, un misanthropie anti-social, il finit par s’éloigner des sous-groupes dont il a voulu faire partie à un moment donné (un groupe, c’est déjà le début du fascisme institutionnel culturel, pour lui !). Pour lui, le communautarisme tout comme la vie de couple se doivent d’être hasardeux et non-institués. Dès qu’ils durent, ça le stresse et le « saoule ». Il revient vite à la Nature et à sa lubie adolescente : la contemplation de lui-même dans la carte postale naturaliste, dans les « petites choses ».
La sacralisation bobo du détail médiocre
D’ailleurs, il nous rejoue régulièrement et par période la comédie de l’ermite-artiste vivant dans des conditions spartiates, ou l’actrice dans son p’tit pull marine, mettant la médiocrité au-dessus de la qualité, l’exceptionnel et le détail au-dessus de l’universel et de l’unité, le dérisoire au-dessus de l’essentiel. Il s’émeut lui-même d’être capable – dans l’adversité et l’avalanche de malheurs que serait sa vie – de s’émerveiller des petites choses du quotidien (« ces petits riens qui font ces petits tout » comme le parodie ironiquement Élie Sémoun) : « Que je m’exprime objectivement ou subjectivement, c’est toujours cette véracité exceptionnelle, à travers la banalité de la condition humaine que je recherche. » (la photographe lesbienne Claude Cahun, citée dans l’Exposition « Claude Cahun » au Jeu de Paume du Jardin des Tuileries, Paris, juin 2011)
Le bobo bisexuel a pour particularité de se complaire dans la médiocrité – lui pense que c’est de la « sobriété », de la «pondération », de la « tempérance »… mais c’est quand même, au final, de la lâcheté et de la médiocrité (cf. je vous renvoie aux codes « Artiste raté », « Faux intellectuels » et « Faux révolutionnaires » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels).
Par exemple, le style littéraire de l’écrivain bobo bisexuel n’est pas très élaboré. Il repose avant tout sur la répétition, la rime « qui fait poétique » mais insensée, les homophonies inversantes (cf. les quiasmes, les oxymores faciles, le paradoxe homophonique, etc.), la succession d’infinitifs ou d’anaphores hasardeuses (« pour voir ce que ça donnera », dans le style « poésie transcendantale ») : « Des idées plein la tête, même dans le sexe, des idées plein le sexe. » (les acteurs anonymes de la pièce Mon cœur avec un E à la fin (2011) de Jérémy Patinier) ; « Tout quitter. Fermer le grand théâtre de Bois-Rouge. Descendre le rideau sur cette comédie avant qu’il ne soit trop tard. Cesser de jouer. Partir. » (Élisabeth Brami, Je vous écris comme je vous aime (2006), p. 88) ; etc. Le « poète » bobo homo aime faire résonner les mots qui ne veulent rien dire, s’étirer les phrases sur un mode apparemment bref et laconique, pour leur donner du volume… genre brushing verbaux, échos d’outre-tombe, voix de Mylène Farmer: « Il n’y avait plus d’attente, plus de rendez-vous, plus de questions. Il n’y avait plus d’espoir. » (idem, pp. 208-209)
Musicalement, l’individu bobo bisexuel joue aussi « au pauvre », en intégrant à ses chansons des éléments de sobriété touchante : des sifflotements humains, des imitations vocales d’instruments de musique, des bâtons de pluie, des orgues de barbarie, des djumbés (tout ce qui fait réaliste, artisanal, ou exotique, ça lui plaît), des xylophones à la Yann Tiersen (le minimaliste des formes sonores et expérimentales qu’il choisit rejoint d’ailleurs le monde de l’enfance), des fanfares (c’est de la « musique bio », non ?), de la musique classique épurée (pour relever in extremis le bas niveau de la première partie du spectacle nullissime qu’il nous a proposé : cf. la pièce Golgota Picnic (2011) de Rodrigo Garcia ; c’est si bobo, la sacralisation des dissonances !), etc.
L’Homme spirituel mais sans Dieu
Il y a clairement derrière les bobos bisexuels gauchistes (et parfois droitistes) d’aujourd’hui, qui ne jurent que par « Les Droits de l’Homme », la « République », l’« Égalité des droits », la « Démocratie », la « Laïcité », et au fond, si on y réfléchit bien, par l’anti-christianisme acharné de Voltaire (1694-1778), une haine contre les religions et surtout l’Institution religieuse catholique. Ça fait un petit bout de temps que ce courant de pensée laïcard (et pas du tout laïc, en réalité, car la laïcité respecte le fait religieux), sentimentaliste, matérialiste, individualiste et peu humaniste, couve dans nos civilisations d’États modernes.
L’idéologie bourgeoise-bohème actuelle, qui s’est toujours présentée comme anti-bourgeois pourtant, se caractérise par sa défense d’un Homme divin sans Dieu-Église, et pourrait bien trouver sa source en France et dans le monde au moment des Lumières (quand ce n’est pas avant, bien entendu, avec le péché d’Adam), quand l’Humanité a voulu nier officiellement l’Incarnation divine de Dieu dans l’Église catholique, et fonder ce déni sur les États-Nations peu à peu républicains, « démocratiques » et populistes que nous connaissons aujourd’hui. Morceaux choisis de cet anticléricalisme bobo techniciste et sentimentaliste, porté par les plus célèbres dictateurs :
Robespierre et Carrier : « Il faut nettoyer la France de tout catholicisme, et la régénérer à notre façon. La république l’exige. »
Staline : « Plus de Dieu en 1937 ! »
Hitler : « Celui qui vit en communion avec la nature entre nécessairement en opposition avec les Églises. Et c’est pourquoi elles vont à leur perte ― car la science doit remporter la victoire. »
Vincent Peillon (ministre de l’Éducation en France, en 2013) : « On a laissé le moral et le spirituel à l’Église catholique. Donc il faut remplacer ça. […] On ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine, qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c’est la laïcité. »
Comment vivre sa spiritualité tout en renonçant au Dieu-Église temporelle ? L’individu bobo bisexuel tente d’opérer ce tour de force impossible en misant toutes ses « forces » et ses espoirs sur lui-même et sur les Hommes (autant dire qu’il se prépare à de grosses déceptions ! car l’Homme sans Dieu devient vite un triste saint, un égoïste relativiste, un goujat sans autre morale que ses envies du moment, un individualiste, un humaniste agressif). Et en plus, c’est le ridicule assuré.
On le voit imiter les rites catholiques sans en assumer l’âme, en les instrumentalisant sous forme de folklore New Age ou bouddhisant pour s’autosacraliser lui-même. Comme le démontre très justement l’historienne Marie Pinsard, « chez le bobo, tout est rituel, rien n’est sacré ». Le bobo bisexuel s’habille tout en blanc, compose des « Chansons du dimanche », adopte un nouveau calendrier avec des fêtes qui ne sont plus festives (la Fête du Sida, la Journée mondiale de la Lutte contre l’Homophobie, la Fête de la Musique, la Marche des Fiertés, etc.), fait brûler les barrettes d’encens dans son salon, s’embaume de toute sorte de crèmes relaxantes et d’huiles essentielles, fait des chemins de saint Jacques non-agréés avec ses amis randonneurs, met des bougies (on y revient tout de suite après) autour de sa baignoire et dans sa chambre à coucher, participe à des ateliers sophrologie ou massages, etc. Il rêve d’une cérémonie de mariage dans une yourte, dans une forêt « celtique », ou face à la mer (fuck les églises : c’est ringard !).
Les individus bobos bisexuels sont la version contemporaine des hypocrites pharisiens du temps de Jésus, des êtres qui sont « croyants » mais « non-pratiquants », qui disent mais ne font qu’à moitié, qui désirent aimer mais n’aiment pas en actes, qui se servent de l’Église (où ils mettent rarement les pieds) pour se regarder le nombril et spiritualiser leurs sens dans une religiosité de la sensiblerie : « Et je prie… » (cf. la fin de la chanson « C’est lui » de Fred Actone) ; « On ne croit plus en Dieu mais on fait comme si. » (Philippe Muray, Festivus festivus : Conversations avec Élisabeth Lévy (2005), p. 171) ; « J’étais maintenant un hayèm, un errant dans le désert, comme dans les poèmes d’Ibn Arabi. Vagabond. Sans le sens. Sans Dieu. » (Abdellah Taïa, Une Mélancolie arabe (2008), p. 92) ; « Chez Marcel, tout était cérémonial. » (Jean Cocteau parlant de Marcel Proust, dans le documentaire « Cocteau/Marais : un couple mythique » (2013) Yves Riou et Philippe Pouchain) ; etc.
« Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. »
Beaucoup de bobos bisexuels jouent même à imiter physiquement le Christ. Le prototype actuel du bobo homo à la mode, trop fashion et trop wild, et qui commence à faire pétasse du Marais (alors qu’il avait été justement créé pour ne pas faire cet effet-là ! Attention, les gars…), c’est le barbu (barbe de 3 jours et plus si affinités). De préférence cheveux longs. On le voit maintenant partout : chez les rédac’ chefs de tous les grands journaux de la presse gay, sur la Une des magazines homos, dans les défilés de mode, chez les DJay et les journaleux-théâtreux, parmi les snobinards péteux (avec la voix de Jean-Marc Lalanne) de Technikart ou des Inrockuptibles, et partout où les bobos homos veulent paraître « branchés et surtout pas gay».

Gilles Wullus (« Têtu »)

Didier Lestrade (« Minorités »)

Joseph Macé-Scaron

Thomas Doustaly (« Têtu »)

Yannick Barbe (« Têtu »)

Glenn Morrison (« The Advocate »)
Il suffit de regarder le trombinoscope de l’équipe de rédaction de Minorités.org pour en avoir le cœur net : par exemple Arlindo Constantino, Vincent Bourseul, Sad Punk, Stéphane Trieulet, Franck Contat, Michel-Ange Vinti, Maxime Journiac, Crame, François Vergne, Matthieu Piffeteau, Olivier Jubin, Mike Nietomertz, Richard Mèmeteau, Florian Chavanon, Renaud Mercier, Nicolas Jacoup, Manuel Atréide, Olivier « Babozor » Chambon, Marc Endeweld, Laurent Chambon.

Justement, Didier Lestrade, le fondateur d’Act-Up Paris et de Minorités, a bien défini ce patron physique et psychologique du bobo-homo-qui-ne-sait-pas-encore-qu’il-est-bobo sous l’appellation subtilement anglo-saxonne de « dude » (c’est même pas « bear » ! C’est – je cite – « le quintessential dude gay ») Dans son article « Moi vs le Roi des Rois », on en a une jolie description : « Il y a le mec hyper bien foutu, le mec intelligent, le mec drôle, le mec wild, le ou les mecs américains. Et puis il y a le dude. On se dit ‘Non, c’est pas possible, pas le dude ! Pas le lad !’. Mais si, c’en est un, de la semelle de ses chaussures à la pointe de ses goûts musicaux, un mec calme mais drôle aussi, qui est prolo sans être malheureux, qui connaît la vie gay même si elle le fait chier un peu, qui aime le reggae et la techno, qui est catho sans que ça soit un problème (yet !), qui est si deep qu’il chantonne tout seul des airs haïtiens en se brossant les dents, qui n’a pas peur de parler et qui est prêt à découvrir la nature, qu’il ne connaît pas assez. Et qui a souffert mais ça, c’est tout le monde, OK ? Et la première fois que vous le voyez à la gare, vous savez que ce sera l’amour, en un regard, juste comment il est dans l’espace. » (Rassurez-vous : je ne comprends pas tous les mots non plus ^^).
Énormément d’acteurs et de comédiens des films actuels racontant des histoires homos peu caricaturales se font pousser la barbe : cf. le film « Boys Like Us » (2014) de Patric Chiha, le film « W imie… » (« Aime… et fais ce que tu veux », 2014) de Malgorzata Szumowska, le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta, le film « Lilting » (« La Délicatesse », 2014) de Hong Khaou (avec Richard, l’homosexuel barbu pratiquant le commerce équitable et cuisinant avec inventivité), le film « Praia Do Futuro » (2014) de Karim Aïnouz (avec Konrad et Donato, les deux ex-amants qui essaient de se faire pousser la barbe), le film « Love Is Strange » (2014) d’Ira Sachs, le vidéo-clip de la chanson « Take Me To Church » d’Hozier, etc. Et ce look hipster n’est qu’un reflet proche du réel : cf. la biopic « Yves Saint-Laurent » (2014) de Jalil Lespert (avec Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé, barbus, en scooter aux États-Unis).

Film « Contracorriente » de Javier Fuentes-León

Film « Tu n’aimeras point » de Haim Tabakman

Film « Week-End » d’Andrew Haigh

Film « La Parade » de Srdjan Dragojevic
Dans sa version féminine, le barbu bobo bisexuel est remplacé par l’ingénue bobo un peu barrée et lunaire : la romanichelle alcoolique Amy Winehouse ou bien Björk et son air de léthargie émerveillée :
Une sorte de femme-à-barbe un peu bi, un peu loufoque, qui s’appelle Lili Rose (ou un truc dans ce goût-là, avec des « L » : Lali, Louane, Loreen, Léa, Lala, Lola, Lilas… ; et puis qui fasse bien végétal, bien asexué et bien areligieux). Comme la fille de Vanessa Paradis.

Caroline-Rose dans l’émission « The Voice 2 », 2013
La folie bobo des bougies
Dernier reliquat pitoyable de religiosité chrétienne visible dans les œuvres de fictions homo-érotiques occidentales : la bougie (voire la guirlande lumineuse dans un lieu improbable : genre dans une forêt ou un lac la nuit). Je me suis amusé à recenser dans les docu-fictions homo-érotiques ou dans les reportages toutes les fois où les figurants se sont filmés et auto-sacralisés autour d’une baignoire encerclée de bougies, ou un lit « nuptial » bordés de torches : cette mise en scène top-bobo est juste omniprésente ! cf. le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta (avec les bougies dans le salon, les barrettes d’encens), le vidéo-clip de la chanson « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion, le vidéo-clip de la chanson « It’s A Sin » des Pet Shop Boys, la performance Golgotha (2009) et le film « To Bring To Light » (« Le Chandelier », 2002) de Steven Cohen (avec l’omniprésence des ampoules électriques et des lampions colorés), etc.
Quand l’Homme moderne « philosophe sur Dieu sans Dieu… », cela donne une pathétique dégoulinade verbale de pensées métaphysiques dénuées d’intérêt (genre le film « Tree Of Life » (2011) de Terrence Malick), un défilé (au ralenti, svp : merci Frédéric Mitterrand) de cartes postales bucoliques où le « je » se raconte avec la fausse pudeur habituelle d’une voix susurrée (François Zabaleta, si tu nous reçois…), un bal de sensations à la « Amélie Poulain » ou à la Philippe Delerme qui n’apporte pas plus de sens et de beauté à l’existence (genre je raconte ma première gorgée de bière, ou bien comment j’aime casser ma crème brûlée avec ma cuillère, mettre ma main dans un bocal à poissons, écouter la pluie, sentir le vent sur ma peau, courir après des bulles de savon, … me masturber – cf. la chanson « La Voie Ferré » de Pascal Obispo – et prendre les autres pour des cons, aussi). Par exemple, l’écriture automatique d’un Guillaume Dustan, expliquant dans le détail ses courses au supermarché, avec le listing complet et passionnant des produits qu’il achète, c’est un grand moment de littérature, vraiment.
Le vide, le silence, la « pudeur », chez le romantique bobo, sont sacralisés, deviennent des absolus en soi (alors qu’il existe des silences bien vides…) : cf. le film « J’aimerais, j’aimerais » (2007) de Jann Halexander (entièrement muet, où tout est chorégraphié, figé dans l’esthétisme mélancolique : d’ailleurs, le sous-titre de ce film, c’est « Amour triste en Vendée »), le film « Métamorphoses » (2014) de Christophe Honoré, le film « Lilting » (« La Délicatesse », 2014) de Hong Khaou,(comme aime et fais ce que tu veux), etc.
Comme un malheur n’arrive jamais seul, l’individu bobo bisexuel, dans sa quête désespérée de palliatifs à son exil de Dieu, a tendance à se piquer au jeu de la psychanalyse de comptoir (attention : il a fait fac de « spychologie », a lu Élisabeth Badinter, Pierre Bourdieu, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Françoise Dolto, Simone de Beauvoir, etc.), de la simulation d’introspection de soi virant à l’analyse jugeante des autres. Il a tout vu, tout connu, tout comprendu de la vie avant tout le monde. Il sait lire dans les âmes. Gonflant sainte Honorine… Et là, le but inavoué est toujours le même : il cherche à justifier par la science son désir de ne plus être libre, de ne plus désirer ; à mépriser l’« Humanité aveugle » pour de « bonnes raisons » ; à camoufler les violences que sa négligence et son relativisme infligent à son entourage.
« Je suis vivant »
Sa déprime se dilue et s’alimente dans une forme d’hédonisme épicurien chronique (« Je suis vivant »), d’optimisme forcé (« Même si ça n’a pas duré, au moins, j’ai aimé, j’ai senti, j’ai joui »), d’élan combatif appris (« Non, rien de rien, non, je ne regrette rien »), qui ne règle absolument pas les problèmes, n’aboutit pas à un changement profond de comportement, et ne constitue que la maigre consolation du perdant (« L’important, c’est d’avoir essayé, c’est d’avoir participé. ») : cf. la chanson « Je suis vivant » d’Yves Jamait, la chanson « Entre nous et le sol » de Christophe Wilhem (« Me sentir en vie »), etc. « Le monde est vivant ! » (le dessinateur Moebius dans sa préface de la B.D. Pressions & Impressions (2007) de Didier Eberlé) ; « Je suis vivant. Le monde n’est pas seulement une chose posée là, extérieure à moi-même. J’y participe, il m’est offert, mais ce n’est plus ma vie. Je suis la vie. » (« C. » en épitaphe du roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 6) ; etc.
Quand l’esprit bobo dit qu’il « est vivant », il faut l’entendre non pas dans son sens positif et altruiste de « Joie vraie » et d’« Amour plein », mais bien de « jouissance » égoïste, de « bien-être » ponctuel. « Être vivant » se limite à « être sensitif », à verser dans la sensiblerie, la superficialité de l’épiderme, l’affectif ou le génital pulsionnel.
Vive les vieux !
Avec le temps, quand le bobo bisexuel est un tantinet philosophe ou qu’il s’assagit « un peu moins négativement que prévu », il décline son désir de mourir en désir de vieillir. Il se la joue alors GPI (Grand Patriarche Infréquentable), qui attend dignement la fin de vie, comme un animal blessé « à la Jean Genet » ou « à la Violette Leduc », qui ne se révoltera pas contre la mort mais bien contre les Hommes et toutes leurs Institutions, qui se laissera mourir (d’alcool, de sexe, de nicotine, de cancer… : « Encore un que les Boches n’auront pas ! ») avant que la Science et l’Église (car le bobo est un « bouffeur de curés » invétéré, ne l’oublions pas) ne lui mettent la main dessus. Il aime s’imaginer à une autre époque que la sienne (surtout les années 1920 ou les années 1960-1970). Il est fondamentalement anti-traditionnaliste mais pourtant passéiste et nostalgique. Il n’aime pas les vieux (en tant que personnes réelles ; rappelez-vous qu’il veut faire table rase de son passé, et qu’il a dit « merde » à ses parents et grands-parents) mais le vieux (= le « style ‘vieux’ », l’idée de « vieux », l’allégorie de vieillesse, les Bidochons et les Deschiens, la vieille aristo qui a la classe, le vioc en peinture, quoi). Par exemple, lors de son concert Les Murmures du temps au Théâtre de L’île Saint-Louis Paul Rey à Paris, en février 2011, le chanteur Stefan Corbin se met dans la peau d’un bicentenaire : « Imaginez quand on a 200 ans. »
D’une part, il développe une passion pour tout ce qui est ancien (les vieilles pierres, le Vieux Campeur, les vieux meubles en bois, les vieilles cheminées, les jouets anciens, les vieux tourne-disques vinyles, etc.), pour le rétro (les vieux cons, Brigitte Fontaine, l’esthétique des années 1960-1980, les chanteurs rebelles des années Saint-Germain, l’ambiance jazzy ou cabaret des « années folles », etc.). Rétro-bobo-homo ! Il se dit fan des chanteurs seventies (excepté peut-être ceux du disco… encore que… il se contredit tellement qu’il peut épisodiquement se payer le luxe d’aimer le kitsch !) tels que François Hardy, Georges Brassens, Jean Ferrat, Anne Sylvestre, Barbara, Marie Laforêt, Jacques Brel, Léo Ferré, etc. C’est le cas, par exemple, de Jann Halexander, de Patrick Loiseau, de Gaël Morel, de Jean-Marc Vallée, de Xavier Dolan, et tant d’autres. Beaucoup de films homo-érotiques bobos actuels adoptent maintenant une esthétique sixties-seventies-eighties dans la veine de films comme « La Ballade de l’impossible » (2011) de Tran Anh Hung, « Potiche » (2010) de François Ozon, « A Single Man » (2009) de Tom Ford, « New Wave » (2000) de Gaël Morel, etc. Ces productions à prétention non-commerciale, qui sont des imitations de films vieillots et maladroits tournés en Super-8, se veulent des reconstitutions historiques réalistes, alors qu’en réalité, les réalisateurs ont cherché à donner un corps vraisemblable et nostalgique à leurs fantasmes présents et à leurs sentiments amoureux mélancoliques. Le sujet bobo homosexuel aime se faire pleurer sur un air rétro (Amélie Poulain, sors de ce corps !) : « Mes goûts se portaient sur les Rolling Stones ou sur Françoise Hardy (dont le ‘Tous les garçons et les filles de mon âge’ semblait avoir été écrit pour évoquer la solitude des gays), puis sur Barbara et Léo Ferré, ou Bob Dylan, Donovan et Joan Baez, chanteurs ‘intellectuels’. » (Didier Éribon, Retour à Reims (2010), pp. 99-100)
… Et vive le vieux marin breton !
D’autre part, l’intellectuel bobo homosexuel adore « le » vieux marin breton, ou le papy qui sera son « pote » (du moment qu’il ne fait pas partie de sa famille de sang, ça va…). « Un des frères de mon père devint voleur, fit de la prison et finit par être ‘interdit de séjour’ à Reims. […] Il avait disparu de ma vie et de ma mémoire depuis longtemps lorsque j’appris par ma mère que, devenu clochard, il était mort dans la rue. Il avait été marin dans sa jeunesse […] et c’est son visage, sa silhouette sur une photo de lui en costume de matelot posée sur le buffet de la salle à manger, chez mes grands-parents, qui reparurent à mon esprit quand je lus pour la première fois Querelle de Brest.» (Didier Éribon, Retour à Reims (2010), pp. 40-41) En général, l’intellect bobo homo se plait à s’extasier devant les vieux clodos ou les papys (« incorrects ») de maison de retraite : cf. le documentaire « Zucht Und Ordnung » (« Law And Order », 2012) de Jan Soldat (avec le couple de vieux qui se torturent et se « fistent » l’un l’autre), etc. Le vieillard duquel il se rapproche a un petit côté « maître spirituel non-agréé » … qui malheureusement remplace et éjecte Jésus… et qui retire, comme le diable, la liberté. « Et un soir un homme m´a sauvé la vie. C´était pas Jésus, c´était pas Dieu, pardi ! Juste un homme de passage qui avait bien vécu : un sage. Il connaissait mon prénom, quel hasard ! Puis il m´a dit : ‘Je t´échange une histoire contre ta liberté.’ Assurément, j´ai accepté ! Et j´ai mis du temps à me rendre compte que, comme m´a dit ce sage à la fin du conte, quand t´as touché le fond du fond, soit tu crèves soit tu remontes. » (cf. la chanson « Contes, vents et marées » des Ogres de Barback)
L’essai El Látigo Y La Pluma (2004) de Fernando Olmeda démarre justement sur le témoignage d’un papy gay de 80 ans, Manuel Granda Terrón. On retrouve la même démarche à travers la description de la rencontre avec « Jean », le montagnard solitaire ermite, dans l’autobiographie Recto/Verso (2007) de Gaël-Laurent Tilium, à travers le vieil homme qui conseille Noor dans le docu-fiction « Noor » (2012) de Guillaume Giovanetti et Cagla Zencirci. Dans l’essai Primera Plana (2007) de Juan A. Herrero Brasas, la rencontre entre l’intellectuel de gauche et le vieux papy « typique » (p. 29) est scénarisée. Dans son documentaire « Les Invisibles » (2012), Sébastien Lifshitz s’extasie sur les histoires de cœurs des petits vieux homosexuels (en couple ou pas). Ceux-là même sont très attirés par les vieilles pierres, les vieilles maisons d’enfance.
Un jour d’hiver en 2011, un de mes amis homos (super méga bobo) m’a sorti cette phrase culte : « Mon rêve quand je serai vieux, c’est d’être un p’tit vieux indigne. » Voilà, je veux mourir la main sur le cœur ! Comme l’Auvergnat de Brassens ! Et gros fuck aux curés et aux bourgeois le jour de mon enterrement ! Pour le bobo, en effet, le temps s’est arrêté aux années 1930. Sans rire. Et il pense que les Édith Piaf et les Coluche (les seuls « saints bons larrons » à ses yeux) l’auraient applaudi dans ses conneries… sans réaliser que ce qui était subversif à une certaine époque ne l’est en général plus du tout à une autre.

Brel, Ferré, Brassens
Le portrait ému du vieux pépé « à la Léo Ferré », anti-conformiste, inflexible, vivant à la campagne, ayant encore une vie sexuelle débridée pour son âge, fumant comme un pompier, alcoolique, illustre bien la maladie du bobo moderne : l’obsession du « faire authentique » par son idée de l’anti-politiquement correct, par son idée de l’opposition… en utilisant si besoin est les exclus, les plus fous, les plus faibles, les plus innocents de la société, et donc parfois les plus susceptibles d’être moqués : cf. les émissions de Canal + raillant les personnes âgées tout en les présentant comme exotiques et sympathiques ; les documentaires de France 3 style Strip-Tease, qui laissent planer le doute sur la frontière entre le foutage de gueule et la compassion envers les gens atypiques portraiturés ; les phrases apprises qu’on fait dire à des vieux couples pour justifier des fantasmes homosexuels (« Le cœur a ses raisons que la raison ignore. » dit une vieille mamie secondée de son mari, dans le docu-fiction « Elena » (2010) de Nicole Conn) ; le docu-fiction « Noor » (2012) de Guillaume Giovanetti et Cagla Zencirci (avec Noor, transsexuel F to M, servant du thé aux conducteurs de camion) ; etc. D’ailleurs, le papy ou la mamie en question ne comprend pas toujours ce qui lui arrive et ce qui lui fait mériter autant d’intérêt.
L’intellectuel bourgeois gauchiste (ou droitiste après tout ! Les extrêmes se rejoignent…) se met démagogiquement en scène en train de se laisser enseigner par des « gens de peu » que tout le monde prendrait pour des fous mais que lui seul serait capable d’approcher et de comprendre (cf. je vous renvoie à l’excellente analyse de Pierre Jourde de la « gaucho attitude » dans son essai La Littérature sans estomac (2002), pp. 161-162). Ces derniers lui offrent leur innocence et leur étiquette de « gêneurs sociaux », et ainsi, le bobo peut s’en retourner chez lui, tout content d’avoir trouvé un masque à son train de vie bourgeois habituel. Et surtout, il se sert d’eux pour leur faire dire ce qu’il a envie d’entendre.
Je crois que cette identification au vieux rebelle, au-delà de la tendresse un peu condescendante, dit quelque chose de l’attitude du bobo bisexuel dans la vie : même s’il se la joue marginal cool, il se comporte en réalité très souvent en vieux gars ou en vieille fille coincé(e) et inflexible. Il fait passer son attitude pour de la pudeur ou un courageux refus des conventions… mais il y a beaucoup de frustration, de complexes, de peur chez lui. Tout Homme qui se rapproche du mythique « bobo » est un handicapé des sentiments, de la relation, et cache sa haine de lui-même derrière une fausse décontraction, une fausse solidarité.
III – LA DÉPRIME ESTHÉTISÉE, PSEUDO «ARTISTIQUE» :
Le bobo bisexuel ne déprime pas qu’autour d’une bougie ou d’un crucifix ou en compagnie d’un vieux. Le plus souvent, ce sera autour d’une toile, d’une œuvre d’art, d’un piano ou d’un disque. Il investit le terrain artistique comme moyen de reconquérir sa « divinité dans la sobriété » (voire dans le désordre et la destruction iconoclaste).
Grâce à l’art underground simulant les « petits moyens » et l’artisanat, il croit échapper à son identité de bourgeois. Il s’autoproclame « Maître du Bon Goût et de la Simplicité » … y compris en cultivant le soi-disant « mauvais goût » social, en posant pour les Inrock, en pratiquant une « incorrection jouissive », en « parlant cul » et en travaillant sa vulgarité verbale.
Mais en dépit de ses efforts pour prouver sa rébellion anarchiste contre la bourgeoisie, on voit bien qu’il fonde une nouvelle élite de bourges (anti-conformistes, mais bourges quand même !). Les cercles bobos homos, revendiquant leur marginalité pour gravir l’échelle sociale et s’assurer une place au soleil, se sont succédées au long des âges et dans tous les continents, et se sont values de l’excuse de l’« Art » afin d’asseoir leur autorité. Par exemple, dans les années 1910-1920, Gertrude Stein et sa clique est plus proche de la bohème artistique que de la grande bourgeoisie nord-américaine. Dans les années 1950-1960 aux États-Unis se développe un mouvement littéraire et culturel très connu, précurseur de la vague queer bobo actuelle : la dénommée Beat Generation, dont les figures de proue sont les artistes homosexuels Hal Chase, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs (ces dandys underground s’adonnaient aux drogues, à l’alcool, au libertinage sexuel, au militantisme alter-mondialiste distant mais rassurant, au jazz, etc.). Dans les années 1980, la Movida madrilène, ou bien le New Wave britannique (un peu punk), sont également d’inspiration bohème. Aujourd’hui, l’élite bobo homosexuelle s’est déplacée vers la musique minimaliste (chanson à textes, un peu cabaret, un peu jazzy ; surtout pas qualifiée de « variété ») ou carrément électro, vers le théâtre contemporain iconoclaste et blasphématoire, vers le docu-fiction au cinéma ou les films expérimentaux.
L’individu bobo homosexuel porte aujourd’hui un nom qui, selon lui, passe mieux et est moins connoté négativement en société : c’est celui de promoteur du queer et du camp, ce courant artistique contemporain flou, néo-baroque, plutôt asexué et sentimental en intentions et bisexuel en actes, défendant un art sale, iconoclaste, marginal, anti-bourgeois, merdique, violent. « Le camp est le dandysme du temps moderne, une variante du snobisme raffiné. Il a résolu ce problème : comment peut-être dandy à l’époque d’une culture de masse ? […] Le dandy du XIXe avait la vocation du ‘bon goût’ et haïssait la vulgarité. Le connaisseur du Camp a découvert des plaisirs plus ingénieux. Il ne s’agit plus d’apprécier la poésie latine, des vins rares et des gilets de velours, mais de goûter aux plus épicés, aux plus communs des plaisirs, aux arts dont se délecte la masse. Il apprécie la vulgarité. » (Susan Sontag, « Le Style Camp », L’Œuvre parle (1968), pp. 421-445)
Le courant artistique kitsch et camp, qui se veut anti-normes bourgeoises, obéit lui aussi à un code bourgeois puisqu’il est à la fois iconoclaste et iconodule (tout bourgeois est contre lui-même, et s’adore !). Comme l’écrit à juste titre Povert, le camp est « héritier du dandysme » (Lionel Povert, Dictionnaire gay (1994), p. 112). Par exemple, dans la pièce My Scum (2008) de Stanislas Briche, les amateurs naïfs (présentés comme « hétéros ») de la merde artistique populaire imposée par les mass médias (appelée « kitsch ») sont décriés comme « nocifs » par les comédiens queer présents sur scène… mais la dénonciation camp qu’ils nous proposent en retour, et qui est supposée faire contrepoids, est tout autant merdique, « trash bourgeoise », et totalitaire que le premier kitsch dénoncé.
Promenade chorégraphique au ralenti
Le bobo bisexuel aime se montrer sensitif, artiste itinérant et sans but, même et surtout quand il déprime façon « roman-photos ». « Se balader seule la nuit dans une rue déserte, sans aucune crainte. C’est être comme deux fois libre. » (la narratrice transgenre F to M dans le one-woman-show Mâle Matériau (2014) d’Isabelle Côte Willems) Il se décrit arpenter la nuit les rues de sa ville en libre penseur (un poète muet en apparence, car on l’entend déverser son flot de pensées poétiques intérieures insignifiantes façon voix-off de Frédéric Mitterrand), parler du monde qui l’entoure (de préférence une jungle urbaine qu’une Nature virginale : il faut quand même qu’il se place en victime des Hommes et de la machine, toujours) avec un souci grotesque du détail, effectuer sa petite ballade chorégraphique de dépressif abasourdi par le triste/beau spectacle d’un monde à la dérive, au ralenti bien sûr, comme dans un film de la « Nouvelle Vague » : cf. le docu-fiction « Le Deuxième Commencement » (2012) d’André Schneider (avec la promenade hivernal au ralenti du couple Laurent/André sous la neige), le docu-fiction « Chandelier » (2002) de Steven Cohen (avec un mannequin queer marchant dans des bidonvilles, sans dire un mot ni aider les pauvres qui sont autour), le docu-fiction « Le Dos rouge » (2015) d’Antoine Barraud (avec la blonde pleurant dans le taxi pendant que le paysage urbain défile), etc.
Dans sa perception et son expression du monde, on a l’impression chez le bobo bisexuel qui se prend pour un artiste qui passera à la postérité, que tout est centré sur les goûts et l’image. Bref. Sur le narcissisme adolescent. Il rêve/règle sa vie (amoureuse, amicale, familiale, professionnelle) comme une partition, comme un concert. « Chacun veut montrer à l’autre les choses qu’il aime. On apprend, on découvre. On découvre tellement qu’on ne peut pas tout faire, on se dit ‘C’est pas la peine de se prendre en photo tout le temps, c’est naff, on fera ça plus tard’. On rencontre ses amis et sa famille et on fait en sorte que ça se passe bien, bordel. On dort ensemble, le plus possible. Skype sert enfin à quelque chose. Tumblr est notre terrain de jeux secret. On s’imagine ensemble aux Nuits Sonores, à Nordic Impact, à Berlin, à Londres, à New York, même si on n’a plus d’argent l’un comme l’autre. Le calendrier devient magique. Il laisse pousser sa barbe. Ses yeux vous regardent au plus profond de votre âme. Il vous rend beau. Vous prenez des forces. Vous lui donnez ce que vous avez. » (Didier Lestrade)
L’individu bobo bisexuel a un côté spectateur passif, oisif, et distant (lui dira « contemplatif ») de son propre confort/de sa propre douilletterie : il aime se portraiturer « attablé à un café » (Stefan Corbin lors de son concert Les Murmures du temps au Théâtre de L’île Saint-Louis Paul Rey, à Paris, en février 2011), observant le monde d’un œil ému, amusé, nostalgique, et jaloux à la fois, dorlotant sa déprime, ou nourrissant son imaginaire libertin et pulsionnel (lui dira « amoureux ») de pensées pudibondes, d’images pieuses, et de violons : « Le 8 décembre 1990, la neige, à gros flocons, blanchissait la ville. […] Je déambulais au milieu des passants qui se délectaient de vins chauds et achetaient des lampions pour les enfants. […] Le contraste entre le souvenir de ma précédente visite à Fourvière et ce que j’expérimentais ce soir-là, seul et désabusé, augmenta mon sentiment d’inutilité et de gâchis de mon existence. » (Jean-Michel Dunand, Libre : De la honte à la lumière (2011), p. 99) ; « Je suis allée m’installer dans un café. J’ai commandé un sandwich et une bière et j’ai mis à profit le temps ainsi gagné pour écrire une longue lettre où j’essayais de coller à ma réalité. J’ai dit mon quotidien, mes émotions, mes sensations, ainsi que les difficultés auxquelles je me heurtais à cause de la jalousie de Martine. Et surtout, j’ai essayé de ne pas me gargariser de romantisme à deux sous. » (Paula Dumont se décrivant en train d’écrire une lettre à son amante Catherine, dans son autobiographie La Vie dure (2010), p. 53) ; « J’ai rêvé un instant (puisque tout le monde rêvait, pourquoi aurais-je dû être la seule à coller à des réalités triviales?) à 8 jours de vacances, en ce lieu, avec Catherine. Je l’ai entrevue, devant son chevalet de peintre, sous le soleil méridional, dans l’odeur du thym, de la menthe et du romarin. Là ou ailleurs, arriverais-je un jour à vivre une semaine entière auprès d’elle ? » (idem, p. 164) ; etc.
Dans la série des créations bobos bisexuelles de l’exhibition émotionnelle narcissique, on trouve tous les docu-fictions où la « tranche de vie », sans but et sans intérêt (en tout cas tel qu’elle est montrée…) est vénérée en soi, comme une œuvre d’art sacrée qui ne doit pas être expliquée (« À quoi ça sert de justifier l’art ?, nous soutient mollement l’individu bobo homo, l’art est sa propre justification ! Et le miracle qu’il offre tous les jours à nos yeux est aussi insignifiant que mon quotidien, que ma vie. »). Je pense par exemple à la série télé-réalité super bobo/bisexuelle – Ceux qui vivaient toujours des soirées parisiennes – qui circulait à un moment sur Youtube, dans laquelle un appartement avec ses jeunes adultes est filmé une minute chaque jour : du quotidien déproblématisé et ronflant, sans autre intérêt que de nous mimer le narcissisme inavoué de ses concepteurs… Je pense également au docu-fiction « Le Deuxième Commencement » (2012) d’André Schneider, dans lequel Gabriel, homo et comédien, raconte ses sensations post-spectacle, le stress et le calme de l’« Artiste » avant/après une pièce. Ça n’apporte rien, mais tant pis : ça fait « posture esthétique ».
L’individu homo bobo trouve la voie de la création de naturel soit par l’écologie « militante », soit par l’art. Il est un homme du terroir, certes,… mais surtout un poète (dilettante) ! Il adore l’acte d’écriture en lui-même, vénère l’art pour l’art, tient le statut d’artiste pour indiscutablement révolutionnaire. Jamais il ne lui vient à l’idée qu’un écrivain puisse parfois écrire de la merde, que tout le monde n’est pas fait pour ça, et qu’écrire n’est pas toujours un acte divin ou militant. Il existe aussi des auteurs lâches et soumis, des gratte-papiers sans idées nobles à défendre, qui ne sont pas à leur place et qui ne méritent pas leur statut d’artistes.
Côté cinéma, on assiste à la même hypocrisie formelle. Le boboïsme est le kitsch de celui qui se la joue pauvre, « petits moyens », faux ratés : techniquement, le réalisateur bobo homo se plaît à rendre ses photos floues, aime filmer en super 8, ou tourner en caméra simple : cf. le film « Homme au bain » (2010) de Christophe Honoré, le film « A Single Man » (2009) de Tom Ford, le film « La Ballade de l’impossible » (2011) de Tran Anh Hung, le film « Queens » (2012) de Catherine Corringer (intégralement tourné en caméra subjective), le film « Hooks To The Left » (2006) de Todd Verow (filmé sur un téléphone cellulaire), etc. Ça tremble, c’est faussement hésitant, et ça flanque la gerbe aux spectateurs… mais on s’en fout : ça fait authentique, ça fait « Nouvelle Vague », ça fait triste et beau à la fois, ça fait profond. C’est d’ailleurs sa prétention à la création d’authentique (tache qui devrait revenir prioritairement à Dieu) qui rend l’individu bobo bisexuel si prétentieux et faux dans la sincérité « sobre ».
Le philosophe Philippe Muray, dans son essai Festivus festivus : Conversations avec Élisabeth Lévy (2005), n’y va pas de main morte pour dénoncer l’imposture des « artistes ébouriffants, plasticiens, directeurs de théâtre, lobbies persécuteurs », des «bien-votants » bobos et « leur mystique droitdel’hommiste », qui « nous invitent à lutter contre les ‘préjugés’ (mais jamais les leurs !) » et qui nous imposent « leurs exhibitions théâtrales ridicules dans des friches industrielles, encore plus leurs installations plasticiennes mortuaires, encore plus leur étalage de leurs états dépressifs, qu’ils prennent pour le nombril artistique du monde et dont personne n’a rien à foutre » (p. 97).
Ce qui est ultra-agaçant chez l’individu bobo bisexuel, c’est en effet sa suffisance dans la nullité. Il dit ou répète des bouts de tirades qu’il croit magnifiquement simples sur un ton ampoulé mais à peine audible (c’est bien cela, la sensiblerie, finalement), enchaîne les syllabes alors que ces associations phoniques ne veulent pas dire grand-chose, ou sont totalement apprises : « La vie sera belle. Les matins seront éclatants. Tout recommencera. Tout recommence toujours. » (Vincent, le héros homosexuel du roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 79) Je pense en particulier au passage du docu-fiction « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta, où Denis, le narrateur homo, va, pendant un quart d’heure, déclamer toute une série de phrases commençant par « Je me souviens… » (moi, je faisais ça dans mes rédactions de classe de 6e au collège… et encore…), saupoudrées de quelques citations d’auteurs connus (on dit « indices d’intertextualité ») censées « faire littéraire » et donner une consistance à ce qui n’est qu’un bric-à-brac bobo de sensations égocentrées : « Je me souviens de t’avoir regardé avec des yeux de labrador. Je me souviens d’avoir pensé à Horace et son Carpe Diem. Je me souviens, en te touchant, d’avoir eu peur de te casser. [etc.] » Le sujet bobo bisexuel nous livre souvent la même scène de sincérité narcissique peu profonde, que l’on peut voir dans les feuilletons-télé ennuyeux de début d’après-midi ou dans les pièces contemporaines homosexuelles (cf. l’excellent sketch parodique « Le Doutage » des Inconnus), dans laquelle deux personnages, derrière une fenêtre vitrée, « philosophent » sur le monde, le paysage qu’ils voient, les passants qu’ils regardent de loin, tout en fixant l’horizon sans s’observer entre eux, et en faisant chier la Terre entière.
Pire encore : comme il désespère de la vanité de son romantisme sans fond et de ses efforts artistiques pour devenir un Créateur d’Authentique, il arrive parfois que l’artiste bobo bisexuel essaie d’atteindre le Vrai par le recours à la violence. En pratiquant un art iconoclaste de la destruction, de la saleté, ou de la dérision « pure », il prétend « questionner » le monde de l’art tout en entier, ébranler nos certitudes et nos normes sociales. Il fait semblant de « réfléchir » sur des problématiques qui ont déjà été bouclées depuis des lustres (« À quoi sert l’art ? Peut-on tout dire et rire de tout ? Qu’est-ce qu’un acteur et qu’est-ce qui le distingue d’un personnage ou du public ? L’art peut-il se supplanter à la politique ? Pourquoi une mouche ? ») et que surtout il ne prétend pas résoudre. Il les fige en posture esthétique narcissique magnifiant le doute nihiliste, feint de réfléchir sur l’acte d’écriture/l’acte scénique, tombe à son insu dans la masturbation intellectuelle. Il se croit hyper profond et intéressant. En réalité, il emmerde tout le monde (y compris lui-même).
La confusion entre esthétique et éthique, entre art plastique et mode de vie, est le propre du boboïsme. L’individu bobo bisexuel s’axe en général sur les goûts en les confondant avec l’Amour pour se dispenser d’être et de penser (ceci ressort particulièrement sur les profils de présentation personnelle des internautes sur les sites chat de rencontres homos). Pour lui, c’est « profond » de confier qu’il aime les voyages, les massages tantriques, le thé aux senteurs exotiques inédites, un parfum particulier, les gants en laine, le vent dans les arbres, la musique classique aussi bien que le jazz manouche, les petits plaisirs simples comme les plaisirs sophistiqués, le fait de cuisiner (… si son copain n’est pas un fin gourmet et ne connaît pas l’art de la table, c’est quasiment une fin de non-recevoir !), etc. Il déverse sous forme de liste ce qu’il croit être, alors que les goûts, c’est ce qu’il y a de plus relatif, de plus superficiel et de plus extérieur à une personne.
Le bobo bisexuel vit sa vie en chanson. C’est un immense clip mélo, qui le transforme en héroïne tragique du pavé, qui rejoue son drame d’amour homo en mode REPEAT. « Il y a bien sûr l’option musicale. 50% des chansons, c’est autour du thème de l’amour perdu, il y a largement le choix. Pendant des années, ces morceaux passent au-dessus de votre tête, comme lorsqu’on frémit intérieurement devant l’entrée des urgences des hôpitaux, en espérant ‘Pourvu que ça ne m’arrive pas tout de suite’. Tout le sens de ces paroles vous échappe, le vrai sens des mots, la poésie du drame. » (Didier Lestrade)
Chez l’individu bobo bisexuel, la musique a une importance centrale dans la mise en scène pathos de sa conception de l’authentique. En gros, il vit son amour comme un clip. « Une fois rentrées à la maison, nous avons écouté Jessye Norman en nous serrant tendrement l’une contre l’autre sur le vieux canapé du salon où nous avions pris place. » (Paula Dumont parlant de son couple – raté – avec Catherine, dans son autobiographie La Vie dure : Éducation sentimentale d’une lesbienne (2010), p. 46) La musique constitue pour lui une coupure esthétique indispensable, un charme inégalable de la vie… qui généralement anticipent le passage au lit, ou parfois l’encadrent.
Quand il parle d’amour, il se focalise tellement sur ses sensations qu’on a parfois l’impression qu’il se masturbe tout seul et qu’il en oublierait presque l’identité de celui avec qui il le fait, ou qu’il se sert de son amant virtuel ou épistolaire pour gommer le caractère pathétique et égoïste de son film intérieur. En d’autres termes, il érotise, sentimentalise, et esthétise la pulsion. Il confond goûts et amour, l’amour avec son enveloppe, l’amour avec la sensation (limitée et auto-centrée) de celui-ci, l’amour avec un roman-photos adulescent : « Disparaissent alors le souvenir de son odeur dans le creux de ses pectoraux, les poils de son ventre, ses mains larges et ses pieds plus forts encore, la barbe pas entretenue, naturelle, lente à pousser mais si douce à caresser, le collier autour du coup, un simple cordon de cuir qui vient d’Éthiopie, une voix douce et masculine sans faire d’effort et tout un lot d’expressions écrites que je notais pour être certain de ne pas rêver. Hay ! Howdi ! À nous ! Je vais courir et après on se skype bébé ! Miss your smell at nite. PTR commence pas hein. Hé ma puce ! Et vous regrettez alors de ne pas avoir pris de photo de tous ces portraits et ces choses banales car on était si humbles qu’on oubliait carrément de le faire. Il n’y a pas de photo de lui dans les rues de sa ville, lui tenant parfois ma main, pas de promenade avec son chien, pas de photo à la gare quand il me raccompagnait. Nothing but heartaches. Le dude vous a mis TKO. Christ wins. » (Didier Lestrade)
La bohème, la bohème… ça voulait dire on est peureux (ça voulait dire on est vieux, aussi !)

Boîte lesbienne « Le Pulp » à la fin des années 1990, Paris
Vous l’aurez compris. L’individu bobo bisexuel, parce qu’il a peur de désirer, est un faux bon-vivant, un faux détendu, un faux « cool » frustré et bourré de complexes. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, dans beaucoup de documentaires et d’interviews, il se dépeint comme un Homme dépressif, désabusé, emporté par sa nonchalance, sa tristesse, et son indifférence : cf. le documentaire « L’Affaire Pasolini » (2013) d’Andreas Pichler.
Souvent, dans la vie réelle, c’est un triste sire, sans beaucoup d’humour : cf. la pièce Le Cabaret des utopies (2008) du Groupe Incognito (où on assiste à la litanie mi-amusée mi-déprimée des trentenaires gauchistes déçus par leurs propres rêves « révolutionnaires »), la pièce Cannibales (2008) de Ronan Chéneau, la pièce Golgota Picnic (2011) de Rodrigo Garcia, le sketch parodique des théâtreux bisexuels « Les Œils en coulisses » interprété par les Inconnus, le film « Les Amours imaginaires » (2010) de Xavier Dolan (avec la chanson « Bang bang » de Nancy Sinatra), etc.
L’individu bobo bisexuel adopte un narcissisme non seulement désenchanté, mais aussi mortel. Par exemple, il dit aimer les « chanteuses réalistes », un peu dark et délire mais quand même écorchées : Fréhel, Édith Piaf, Yvette Guibert, Mélanie Laurent, Rose, Brigitte Fontaine, Catherine Ringer (à la rigueur…), Barbara (évidemment !). C’est un déçu de l’Amour, un blasé des gens et de la société toute entière. Il ne croit plus en la politique ni en la gauche (qu’il a pourtant défendue vaillamment dans ses jeunes années), ni même en la Nature qu’il voit mourir avant l’heure. Il aborde le combat de vie comme un existentialisme, c’est-à-dire une lutte perdue d’avance ; et en partant de ce postulat défaitiste (lui dira « réaliste ») de la condition humaine, il pense que sa seule liberté s’exerce dans les efforts à donner un peu de sens et de beauté à son existence insensée, à travers un engagement politique et artistique, et à travers la recherche des plaisirs qui le consoleront tant bien que mal d’être mortel.
Comme le bobo est un bourgeois (ne l’oublions pas), il aime les sophistications langagières, même « cheap » (oh ! tiens ? un mot anglais !) ou un carrément « vulgos ». Il va trouver ça charmant et original de truffer ses propos de mots étrangers, et surtout anglais, pour se distinguer. Parce que l’anglais, il trouve ça parfait pour « déprimer en beauté » : « Et vous tombez amoureux. Et lui aussi. Cette fois, vous avez décidé de faire un sans faute, c’est comme si vous portiez une pancarte avec marqué dessus DON’T FUCK UP parce que l’expérience sert à ça, pas trop vite, pas trop lentement, one step at a time, vous retenez le flux au maximum jusqu’à ce que ça devienne intenable pour ne rien casser. Vous avez un diamant brut dans les mains et ça ne sert à rien de brusquer les choses, you know the drill, il suffit de tenir sur le cheval et lui montrer que vous lui faites confiance en serrant bien les jambes pour lui montrer que vous êtes bien en équilibre sur la selle et de là-haut vous voyez bien, au loin, vous regardez l’horizon et le cheval vous suit mais en fait c’est lui qui fait tout le travail. Ça vous revient naturellement, après toutes les chutes du passé quand le cheval s’emballe parce qu’il a peur ou qu’il veut vous tester mais là c’est pas la peine car il est sympa et il voulait une promenade lui aussi… » (Didier Lestrade) C’est ridicule, ado, mais sincère. On a juste honte pour lui…
Et quand il veut critiquer une personne d’une manière érudite qui cachera le fait qu’il n’a pas cherché à la comprendre, il sortira à peu près toujours les mêmes expressions qui font bien et qu’il croit rares : « téléphoné », « lénifiant », « logorrhée », « inepties », « éculé », « aphorismes », etc. Quand en revanche il est emballé par une œuvre ou une personne (toujours sans raison valable) et qu’il veut le montrer à tout le monde, il dira par exemple : « C’est lumineux, c’est frais, c’est jubilatoire.»
Derrière son hédonisme optimiste et humaniste de « Jean qui rit cyniquement/Jean qui pleure modestement » se cache en réalité une profonde misanthropie et un désir de mort. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle il a tendance à se mettre à la place des morts, des absents, ou des personnes âgées, souvent dans l’optique pédagogique inconsistante de l’expression d’un « Carpe Diem » (= Profite de la vie avant qu’elle ne passe), dans l’optique narcissique de s’imaginer écrire ses mémoires comme s’il était un génie qui allait mourir prématurément à 25 ans, et surtout dans l’optique existentielle de se suicider à petit feu (cf. tous les documentaires bobos avec la chanson « Bang Bang » de Nancy Sinatra qui revient en boucle). « Il pleurait. De joie. De peur. De déchirement. De Paris. D’être là, pas loin de la tombe de Marcel Proust. » (Abdellah Taïa parlant de lui à la troisième personne, dans son autobiographie Une Mélancolie arabe (2008), pp. 62-63) Par exemple, tous les films du réalisateur Gaël Morel se transforment en clips géants mélos, dans lesquels il se fait plaisir en nous faisant écouter des chansons zen et déprimées.
Même si le l’individu bobo bisexuel a un côté « romantique chaviré » féminisé, il préfère a priori faire preuve de moins d’exubérance de sa peine que prévu (n’oublions pas qu’il veut vénérer avant tout la sobriété). La noirceur fumeuse et alcoolisée à la Patrick Dewaere, Mano Solo, Guillaume Dustan, Patrice Chéreau, Renaud Camus, Thomas Doustaly, Didier Lestrade, Lou Reed, Bernard-Marie Koltès, lui sied davantage que la comédie chagrine de la Drama Queen maraisienne. Pour lui, l’homosexualité noire est plus crédible, plus radicale, plus brute, plus adulte, plus « mâle »… bref, moins théâtral, moins « pédale décérébrée »… moins homosexuel !
IV – LA DÉPRIME SENTIMENTALISÉE ET ÉROTISÉE :
Après la politique, la religion et l’art, parlons d’amour et voyons maintenant comment la boboïtude s’articule au quotidien avec la pratique homosexuelle et les considérations sentimentales. Car comme l’individu bobo bisexuel a une trouille gigantesque d’appartenir, de se donner totalement et de s’engager (alors que l’Amour vrai n’est pas autre chose que le don entier de sa personne à l’Amour dans l’altérité des sexes), il déprime et se contredit fatalement. Et ça donne de belles crises de mélancolie bobo-pédaloïdes !
L’intention d’aimer plutôt que le désir en actes
La prévalence, du désir d’aimer sur l’amour en acte, est importante à prendre en considération dans le fonctionnement du désir homosexuel (« J’ai dans mon autre moi un désir d’aimer comme un bouclier. » cf. la chanson « Tous ces combats » de Mylène Farmer). Pour l’individu bobo bisexuel, l’amour ne se conjugue pas pleinement au présent : c’est une projection, une intention, une sincérité, une franchise, une image d’Épinal, une sensibilité à l’art, plus qu’une réalité. C’est cela qui ne le rend si compliqué, si torturé.
Surtout, je ne drague pas ! Je courtise sans le vouloir…
La particularité de l’individu bobo bisexuel, c’est qu’il désire peu, et qu’il met en veilleuse ses désirs profonds, sa joie, son humour, pour se construire une prison amoureuse de volontarisme ou de hasard, où l’intellectualisme et l’instant passeront avant l’humain. Là où mon désir est absent, dit-il, là seront mon cœur et mon destin !
Quand on traîne un moment sur Internet et les sites de rencontres gay, on finit par être frappé par une chose : l’absence de désir et de foi en l’Amour parmi les inscrits. Ils sont a priori tous là pour l’Amour… et en même temps, concrètement, ils n’y sont. Dès qu’on teste un peu leurs attentes et leur capacité à s’engager vraiment, on tombe de haut. On a envie de se dire en les voyant : quelle tribu de « sans-désir » bobos ! si sincères mais pas vrais !
Être bobo, c’est être ennemi du désir durable et profond. C’est être ennemi de la liberté et de la volonté (même si, paradoxalement, la boboïtude procède de l’idéologie libertaire politisée). Pour le sujet bobo homo, tout plutôt que montrer qu’il désire ! Car à ses yeux, aimer « c’est la honte », c’est une faiblesse et une soumission. S’il passe voir des amis, ce sera, selon ses plans, toujours « à l’improviste », pas programmé. S’il part en voyage, c’est « sur un coup de tête », sans prévenir personne. S’il veut draguer, il préfère proposer de « prendre juste un verre ». Et il croit qu’il n’aime vraiment quelqu’un que s’il ne lui montre pas qu’il l’aime, que si l’amour s’impose à lui sous forme de coup de foudre ou de long silence entendu. Il considère que l’Amour est une question de « moment » (pas de « vie entière »), de hasard ou destin (pas de plan divin laissant libre), de sincérité (pas de vérité), de « feeling » (pas d’invisible incarné). Il adopte la loi de la simultanéité amoureuse parfaite ; bref, de la fusion. L’Amour s’imposerait comme une évidence incontournable, sans que lui et son amant ne s’y attendent et soient libres de Le refuser. Cet « Amour » serait à la fois chimique et divin. Une telle conception totalitaire de l’Amour sent, en arrière-fond, la justification aveugle de la pulsion, et même du viol (« Je sais que tu es fou de moi ; Si tu te refuses à moi, c’est juste que tu n’oses pas encore te l’avouer et que tu nies l’Évidence. » ; « Tout arrive. Nous n’avons pas le choix. En amour, ce qui doit se faire se fait. Nous étions destinés. Si tu me résistes, c’est que tu es un ennemi de l’Amour ! »).
L’individu bobo bisexuel aime se rejouer la comédie de la « premières fois », car c’est précisément lors des premières fois que notre liberté et nos désirs sont les plus menacés : « J’essaie de me rappeler. Le début. Ce qui m’a attiré. La nuit. Une boîte de nuit où je me rendais pour la première fois de ma vie. La foule branchée que je n’aimais pas. […] Il dansait. Seul. […] Plus tard, audacieux, je lui ai parlé, je l’ai complimenté. Il a levé les yeux, a souri et moi je suis tombé amoureux, immédiatement, instantanément. On appelle ça le coup de foudre. Moi, j’appelle ça la reconnaissance mutuelle. […] Je ne l’ai pas quitté. Il ne m’a pas quitté. On a dansé ensemble. Une fois. Un slow. ‘Pull marine’. Isabelle Adjani. » (Abdellah Taïa par rapport à son amant Slimane, dans son autobiographie Une Mélancolie arabe (2008), p. 108)
Il développe l’idée selon laquelle, parce qu’il ne peut logiquement pas rencontrer « l’amour de sa vie » en boîte ou au sauna ou sur Internet – parce que son « éthique » personnelle l’exige, et parce qu’il n’irait jamais dans ce genre de lieux-là habituellement (mon œil, ouais !) –, c’est forcément là qu’il le rencontrera exceptionnellement : cf. la chanson « Mon Fils » de Nicolas Bacchus (où le chanteur raconte comment il a rencontré son copain en boîte). L’improbabilité sera pour lui la preuve que sa pulsion s’est transformée en amour vrai comme par magie : cf. je vous renvoie à la partie « Paradoxe du libertin » dans le code « Liaisons dangereuses » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels).
Comme l’individu bobo bisexuel est un hypocrite et un suiveur sincère, il n’assume pas sa drague même quand il drague vraiment. Par exemple, il considère comme une forme de charité héroïque le fait de ne pas être allé jusqu’au bout dans la consommation sexuelle avec ses amants d’un soir, ou de ne pas avoir « craquer » le premier. Il adopte l’attitude du client qui paye un prostitué sans forcément coucher avec, du dragueur qui se targue de ne pas « niquer » le premier soir (… juste le troisième…), ou de l’adepte des câlins et des moments de tendresse gratuite (soutenant que « le cul pour le cul, ça ne l’intéresse pas » ; que le vocable « homosexualité » est réducteur car il transforme les personnes homosensibles en vulgaires « baiseurs » ; ou que les massages, ça n’a absolument rien d’ambigu). Le fantasme bobo par excellence, c’est de reproduire l’exploit de Richard Gere dans le film « Pretty Woman » (1990) de Gary Marshall : se payer une pute juste pour discuter avec elle, et la convertir magiquement en vierge, en amour de sa vie. Bienvenue dans la « Rue du Franc Bourgeois » !
Face à ses actions sensuelles dictées par ses pulsions, il simule à merveille l’étonnement ou la surprise de la vierge effarouchée, genre « Je ne sais pas ce qui me prend… » ou « Je ne suis pas celle que vous croyez… ». En réalité, il s’agit d’une fausse improvisation, d’un mensonge sur la rigidité/impulsivité mise en place. Chez l’individu bobo bisexuel, tout doit arriver avec le moins de désir possible (paradoxal pour quelqu’un qui se vante de parler d’Amour 24h/24…). Cet hypocrite en puissance est sincère dans sa perversité, inflexible dans sa mollesse ou son relativisme, lâche dans son laisser-faire qu’il fait passer pour héroïque et détendu. Il ne se voit pas faire de comédie tellement il mise tout sur la sincérité, l’intention d’innocence. Il transforme ses viles pulsions en hasard indomptable, puis ce même hasard en évidence d’Amour. Il veut faire passer sa retenue/son abstinence pour noble, alors qu’en réalité il la fera voler très vite en éclat au moment opportun, il refuse lâchement de s’abandonner à l’Amour qu’il considère comme une maladie, un terrible danger. Il a peur de se voir fragilisé par ses passions, de ne pas les contrôler… parce que dans le fond, il ne veut pas les connaître ni les contrôler.
L’individu homo bisexuel a le rêve secret d’être unisexué voire asexué comme un ange, d’être un simple et innocent amoureux (même quand il a été très génital en actes). « Le sexe avec toi avait cessé d’être uniquement du sexe. » (Abdellah Taïa par rapport à son amant Slimane, dans son autobiographie Une Mélancolie arabe (2008), p. 118)

Film « Shortbus » de John Cameron Mitchell
Il se donne bonne conscience en sacralisant une génitalité minimaliste, trop fragile et épurée (la défaillance devient une valeur ajoutée à l’acte de consommation !) pour être vraiment légère et gratuite. Son imaginaire pulsionnel, qui repose prioritairement sur la matérialité corporelle extérieure, va acquérir une dimension sacrée, intérieure, grâce au silence. Le néant amoureux, le vide, ont valeur de Tout, de plénitude indicible, à ses yeux : « On a marché. On ne s’est pas dit grand-chose. C’était bien. Merveilleusement bien. » (Abdellah Taïa, Une Mélancolie arabe (2008), p. 48) Je pense par exemple à l’insupportable et satisfaite voix-off énamourée/marmonnée du film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta.
« Prends soin de toi… Je t’embrasse… Fais de beaux rêves »
L’individu bobo bisexuel adore les au revoir laconiques, les amours impossibles, la symphonie des adieux, les « je t’aime » tus, la sobriété singée (cf. l’album « La Pudeur » d’Oshen), l’Inachevé : c’est si romantique, l’absence ! « Je n’ai jamais répondu aux deux SMS pleins de bisous de Javier. Je n’avais plus rien à dire. » (cf. les dernières lignes du chapitre II de l’autobiographie Une Mélancolie arabe (2008) d’Abdellah Taïa, p. 54)
D’ailleurs, quand il drague et veut à tout prix montrer « discrètement » qu’il est intéressé par l’internaute qu’il vient de connaître il y a à peine 3 heures, et avec qui il veut déjà coucher dans la seconde (… mais patience, patience… simulation de patience), il arrive généralement avec ses gros sabots et sort toujours la même artillerie lourde de la fausse pudeur. Par exemple, il termine souvent ses mails/lettres par des formules laconiques bien appuyées du type « Prends soin de toi », « Je t’embrasse » « Fais de doux rêves, mon cher X… » (J’en garde, croyez-moi, des souvenirs de fin de chat internet enflammé sur les sites de rencontres homos !) Comme il n’assume pas d’aimer, il dit qu’il réserve son « je t’aime » à la personne de sa vie… pour finalement, dans les faits, ne jamais le vivre vraiment, et le distribuer comme un soi-disant cadeau originel à tous ses amants de passage…
L’individu bobo bisexuel veut faire passer sa retenue laconique pour héroïque, alors qu’en réalité, il la fera voler très vite en éclat au moment opportun. Il refuse lâchement de s’abandonner à l’Amour qu’il considère comme une maladie, un terrible danger. Il a peur de se voir fragilisé par ses passions, de ne pas les contrôler… parce que dans le fond, il ne veut pas les connaître ni les contrôler : « Faire court. Moins lyrique. Moins grandiloquent. Moins ridicule. Elle [Gabrielle] ne se pardonne pas les fadaises qu’elle lit sous sa plume. » (Gabrielle, l’héroïne lesbienne du roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami, p. 77)
Il utilise le sexe pour avoir encore la sensation d’être en vie… mais ce qu’il ne dit pas, c’est que pour se réfugier à ce point dans le sensitif, dans les plaisirs faciles, dans les paradis artificiels extatiques, il faut être sacrément drogué, anesthésié, malheureux, hors de sa sphère de conscience, se conduire vraiment en animal ou en minéral. Bref : ne plus se sentir. Il cherche à tout prix à ce que son corps vibre, jouisse, exulte… parce que dans le fond, il ne sent plus son cœur, et a honte d’avouer sa haine de lui-même.
Finalement, le bobo bisexuel impose à la société (et s’impose surtout à lui-même) la rupture et la fusion amoureuses. Autrement dit, selon lui, nous devrions tous être des célibataires en libre service (qui couchons ponctuellement les uns avec les autres) et des femmes-enfants, séductrices et indépendantes. Il rentre (inconsciemment ?) dans la peau de la Mademoiselle ou de la Jeune Fille, véritable topic bobo (souvent entourée, dans ses clips, de boîtes à musique, de coloriages et de dessins animés enfantins) : cf. je vous renvoie à l’excellent essai Premiers matériaux pour une théorie de la Jeune-Fille (2001) de Tiqqun (« Le concept de la Jeune-Fille n’est évidemment pas un concept sexué. Le lascar de boîte de nuit ne s’y conforme pas moins que la beurette grimée en porno-star. […] La Jeune Fille, à chaque instant, s’affirmera comme le sujet souverain de sa propre réification. », pp. 10-14) et aussi à la place prépondérante de la « Mademoiselle » (pseudo-romanichelle, avec des fleurs dans les cheveux, habillée en écolière ou en nuisette, on ne sait pas trop comment décrire son accoutrement) dans la fantasmagorie bourgeoise-bohème (cf. les vidéo-clips d’Olivia Ruiz, Brooke Fraser, Katie Melua, Vanessa Paradis, Mélissa Mars, Yaël Naïm, Mademoiselle K., Clarika, etc.).
D’ailleurs, les Mam’zelles (ZAZ, Mélanie Laurent, Vanessa Paradis, Charlotte Gainsbourg, Olivia Ruiz, Zazie, Juliette Gréco, Sofia Aram, Clémentine Célarié, Amandine Bourgeois, Ariane Ascaride, Dominique Bertinotti, Frigide Barjot et autres Zabou Breitman qui n’y connaissent rien à l’homosexualité même si elles sont toutes contentes de se dire « filles à pédés ») sont d’ailleurs les premières à signer les pétitions pour le « mariage homo ». C’est dire si la femme-enfant asexué(e) est devenu(e) l’horizon esthético-idéologique de mort de nos sociétés qui broient du noir façon « bobo ».

Technikart Mademoiselle
Une chose est sûre : le bobo bisexuel est bien parti pour nous faire chier longtemps (c’est notre Guy Béart mondialisé) ! Pas indécrottable mais presque. Alors courage à vous tous ! L’Église catholique est là et sauve le mieux.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.