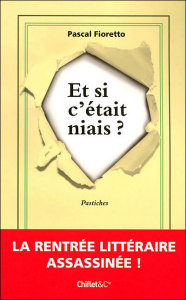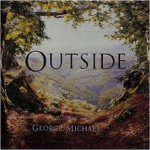Je commencerai à trouver crédible notre Ministre des Droits des Femmes, Madame Vallaud-Belkacem, une fois qu’elle s’emploiera à lutter contre la nudité des femmes dans tous nos arrêts de bus et dans le métro (cette instrumentalisation de la femme, bizarrement, ne semble pas mériter son indignation et son action), plutôt que de s’affairer à ce que les petits garçons aient le droit de jouer à la poupée et que d’installer une loi comme le « mariage pour tous » qui concrètement raye de la carte généalogique de ces mêmes enfants un père ou une mère biologiques.
Archives par mot-clé : gender
Code n°9 – Amoureux (sous-codes : L’important c’est d’aimer / Désir d’aimer / Tu ne sais pas aimer)
Amoureux
NOTICE EXPLICATIVE
La tyrannie homophobe et bisexuelle du discours imposé de l’« Amour »
« L’Important, c’est d’aimer et d’être heureux ». Voilà le gentil discours que nous tient la télégénique Miss France homosexuelle pour expliquer combien l’amour entre deux hommes, ou entre deux femmes, est merveilleux, incontestable, et qu’il vaut le coup d’être vécu (Elle oublie de dire qu’elle est « contre la guerre et pour la Paix dans le monde », mais bon, tant pis… on lui pardonne pour cette fois). Et dans les fictions homosexuelles comme dans les échanges sociaux actuels, les personnages homosexuels/les personnes homosexuelles se qualifient régulièrement de personnes « amoureuses » plutôt que de personnes « homosexuelles », d’ailleurs. L’argument de « l’Amour » arrive au hit parade des justifications de l’homosexualité (même avant celui du plaisir sexuel, c’est dire !). Est-ce efficace et convaincant ? Pas si sûr. Surtout quand il y a si peu d’amour concret derrière la jolie étiquette en forme de cœur ou d’arc-en-ciel que nous collent violemment sur le front les promoteurs de l’« Amour gay irréfutable ».
La différence entre l’amour « adulescent » et l’Amour vrai est exactement à l’image de la différence qui existe entre « sincérité » et « Vérité », ou entre « être amoureux » ( = ressentir des sentiments, une attirance physique, vibrer pour quelqu’un, vivre des instants d’émoi intenses qu’on appelle couramment « coups de foudre », suivre la courbe en dents de scie de son ressenti, …) et « aimer » ( = donner toute sa personne à un être unique et éternel, s’engager le plus totalement possible en faveur de la vie, dire à l’autre « Je te choisis », canaliser ses sentiments vers une seule direction, respecter le Réel et la Nature…). Le binôme « être amoureux/aimer » n’est pas antinomique, même si les deux sont bien distincts : le premier est plus simple que le second (tomber amoureux est à la portée de tout le monde, alors qu’aimer, ce n’est pas donné à tout le monde : cela implique le renoncement, un choix, une liberté posée fermement) ; le second prime toujours sur le premier, même s’il ne se suffit pas à lui-même ; le second canalise et utilise le premier pour transformer la pulsion en énergie vitale (comme l’ellipse de notre ADN). Cette différence entre « être amoureux » et « aimer », le désir homosexuel ne l’a pas faite. C’est pourquoi les personnes homosexuelles confondent très souvent intentions/goûts et Amour, ou bien tiennent un discours complètement cucul pour justifier n’importe quel type de relation dite « amoureuse », y compris les relations qui ne sont pas « d’amour ». En d’autres termes, il est plus juste de les définir comme des personnes amoureuses que comme des personnes aimantes.
Bon, maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Je vais dans un premier temps vous servir la quantité astronomique de guimauve qu’on nous donne habituellement à la Cantine Rainbow. Et après quelques bouchées, vous en serez tellement écœurés que vous allez mieux comprendre d’une part ce que j’ai essayé de vous expliquer rapidement sur l’Amour un peu plus haut, et d’autre part aussi mesurer combien stupide et militaire est la dégoulinade de bien-pensance que s’/nous impose la communauté homo pour ne pas avoir à aimer en actes et en Vérité.
N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Mère gay friendly », « Planeur », à la partie « Films cuculs » du code « Milieu homosexuel paradisiaque », et à la partie « le silence béat » du code « Déni », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.
FICTION
Le personnage homosexuel se qualifie de personne « amoureuse » plutôt que de « personne aimante/aimée » ou de « personne homosexuelle », afin d’éviter de se définir, de regarder ses propres actes, et d’aimer sur la durée :
Dans la série des créations artistiques chantant l’amour homosexuel avec des p’tits cœurs partout (et pas mal de cœurs brisés, du coup), il y a le roman La Tentative amoureuse (1893) d’André Gide, le roman Médianoche amoureux (1985) de Michel Tournier, le film « Deux filles amoureuses » (1995) de Maria Maggenti, le film « Les Amoureux » (1993) de Catherine Corsini, la chanson « Amoureuse » de Véronique Sanson, le film « I’m In Love » (« Je suis amoureux », 2013) de Raphaël de Casabianca, le poème « Amoureux dans la vie » (2008) d’Aude Legrand-Berriot, la pièce Rêveries d’une jeune fille amoureuse (2013) d’Arthur Vernon, la chanson « Nous les amoureux » de Jean-Claude Pascal, la chanson « Les Romantiques » de Catherine Lara, l’album Romantiques pas morts de Patrick Juvet, le film « Beautiful Thing » (1996) d’Hettie Macdonald, le téléfilm « Juste une question d’amour » (2000) de Christian Faure, le film « A Question Of Love » (1978) de Jerry Thorpe, la chanson « L’Innamoramento » de Mylène Farmer, Le Dictionnaire amoureux de l’Espagne (2005) de Michel del Castillo, le poème « Todo Es Por Amor » de Luis Cernuda, le roman Une Soif d’amour (1950) de Yukio Mishima, le film « Les Amoureux » (1964) de Mai Zetterling, le film « L’Important c’est d’aimer » (1974) d’Andrzej Zulawski, le film « L’Incroyable histoire vraie de deux filles amoureuses » (1995) de Maria Maggenti, le film « La Carte du cœur » (1998) de Willard Carroll, le film « Bocage, O Triunfo Do Amor » (1998) de Djalma Limongi Batista, le film « Celui qui aime a raison » (2006) d’Arnold Pasquier, le film « C’est la vie » (2001) de Jean-Daniel Cadinot, la photo Les Amoureux (1998) de Pierre et Gilles, la pièce Un Cœur en herbe (2010) de Christophe Botti, l’album Être amoureux (2005) d’Élisabeth Brami, la chanson « L’amour à l’envers » de Shy’m, etc.
« Je suis amoureux de Julien. Mais ça veut rien dire. J’suis amoureux de tout le monde ! » (Yoann, le héros homosexuel, de la pièce Ma belle-mère, mon ex et moi (2015) de Bruno Druart et Erwin Zirmi) ; « Il y avait des jeunes gens comme moi, amoureux fous de l’opéra, conscients ou non de leur différence, qui scrutaient chaque nouveau visage, beau ou laid, se présentant aux doubles portes d’entrée, à la recherche d’un signe de reconnaissance, d’un regard un tant soit peu insistant, peut-être même d’un sourire. Je tombais moi-même amoureux aux trente secondes, convaincu que tel ou tel spectateur regardait dans ma direction, plantait son regard dans le mien, hésitait à m’aborder. » (le narrateur homo dans le roman La Nuit des princes charmants (1995) de Michel Tremblay, p. 43) ; « Je suis amoureux. » (Chris, le héros homo dans la pièce Happy Birthgay Papa ! (2014) de James Cochise et Gloria Heinz) ; « Il faut être amoureuse. […] Je crois que je suis amoureuse de toi, Clara. » (Zoé s’adressant à Clara, dans le téléfilm « Clara cet été-là » (2003) de Patrick Grandperret) ; « C’est l’amour qui compte. » (le jeune Michael parlant de son émoi pour un de ses camarades, dans le film « Boys Like Us » (2014) de Patric Chiha) ; « Tomber amoureux, c’est l’Âge d’Or ! » (Pierre l’hétéro dans la pièce Sugar (2014) de Joëlle Fossier) ; « Chacun fait c’qu’il veut. » (Pierre n’osant toujours pas se positionner sur l’homosexualité, idem) ; « La vérité, c’est que je suis tombée amoureuse d’Aysla. » (Marie, l’héroïne lesbienne du téléfilm « Ich Will Dich », « Deux femmes amoureuses » (2014) de Rainer Kaufmann) ; « Je ne suis même pas homo. Il y a deux ans, j’ai juste aimé follement l’homme de la vie de l’ancienne femme de la mienne. Depuis, tout est rentré dans l’ordre. » (Rémi évoquant son histoire avec l’hétéro Damien, le copain de son ex Marie, dans la pièce Soixante degrés (2016) de Jean Franco et Jérôme Paza) ; « Dans les bras d’Arthur, je n’étais pas un pédé. » (Jimmy, l’amant d’Arthur, dans le roman Harlem Quartet (1978) de James Baldwin, mis en scène par Élise Vigier en 2018) ; « Ces deux hommes qui s’aimaient, c’est beau, non ? » (Eva parlant de Verlaine et Rimbaud, dans le film « Pédale douce » (1996) de Gabriel Aghion) ; etc.
Par exemple, dans le film « Hoje Eu Quero Voltar Sozinho » (« Au premier regard », 2014) de Daniel Ribeiro, l’obsession de tous les personnages principaux, affichée dès le départ, c’est de « tomber amoureux » et d’embrasser quelqu’un un jour. Dans le film « I Love You Phillip Morris » (2009) de Glenne Ficarra et John Requa, le héros homosexuel Phillip, en s’adressant à son amant, et finalement à tous les membres de la communauté homosexuelle, sort une phrase culte (la seule du film… faut pas la rater) : « On est des cœurs d’artichaut. » Naaaan… tu crois ? Dans son one-man-show Les Bijoux de famille (2015), Laurent Spielvogel reprend en play-back au moment du salut final la chanson « Falling In Love Again ». Dans la pièce L’un dans l’autre (2015) de François Bondu et Thomas Angelvy, Thomas et François concluent leur histoire avec cette phrase creuse : « Tu sais, François, cette histoire n’est pas une question d’orientation sexuelle. Cette histoire, c’est l’histoire d’une personne qui est tombé amoureux d’une personne. » Dans la pièce Les Favoris (2016) d’Éric Delcourt, Camille, l’héroïne invisible que tout le monde croyait hétérosexuelle, sort avec Ninon, elle aussi bisexuelle : « C’est arrivé comme ça. Camille n’est pas plus bisexuelle que lesbienne. On a été dépassées par les événements. »
Généralement, on entend toujours de la part des personnages homosexuels des fictions la même rengaine sur l’amour – une rengaine particulièrement homophobe d’ailleurs puisqu’elle encourage à nier la spécificité du désir homosexuel (en mettant toutes les orientations sexuelles sur le même plan) et à taire l’énonciation et la pratique d’une bisexualité qui paradoxalement est censée s’appliquer à tout le monde universellement. Elle tient en peu de mots : « Je fais ce que je veux en matière de sexe à partir du moment où j’aime, puisque l’important c’est d’aimer. » On préfère baptiser ce poncif contemporain sur la sexualité de « queer » ou d’« amour » pour ne pas voir qu’il exprime une simplification désastreuse de l’Amour vrai (certes, l’Amour est une force sexuée, mais pas nécessairement un acte génital/sensuel), ainsi que notre propre homophobie intériorisée.
Pour être plus clair, je vous laisse lire maintenant la sempiternelle Litanie de la Nullité – et de l’Homophobie homosexuelle, par la même occasion ! – de la Nation gay friendly : « Non. On n’est pas lesbiennes. C’est juste qu’on s’aime. » (Élisa à son amante Mahaut, dans le film « Le Sable » (2005) de Mario Feroce) ; « J’aime un mec. J’aime Cédric. C’est pas une question d’être pédé. C’est juste une question d’amour. » (Laurent à son père, dans le téléfilm « Juste une question d’amour » (2000) de Christian Faure) ; « C’est pas les filles que j’aime. C’est toi, et depuis toujours. » (Zoé s’adressant amoureusement à sa meilleure amie Clara après l’avoir embrassée, dans le téléfilm « Clara cet été-là » (2003) de Patrick Grandperret) ; « Je suis amoureuse ! » (Alba découvrant subitement son amour lesbien face à son amante Yolanda, dans la comédie musicale Se Dice De Mí En Buenos Aires (2010) de Stéphan Druet) ; « Ils s’aimaient, sachez-le. » (cf. le poème « Ils s’aimaient » de Vicente Aleixandre) ; « C’est beau l’amour. » (cf. la chanson « Maman a tort » de Mylène Farmer) ; « Arrête de vouloir comprendre. J’aime Loïc. Un point c’est tout. » (Guillaume dans la pièce Les Amazones, 3 ans après… (2007) de Jean-Marie Chevret) ; « Il faut aimer n’importe qui, n’importe quoi, n’importe comment, pourvu qu’on aime. » (Sébastien dans la pièce Un Mariage follement gai ! (2008) de Thierry Dgim) ; « Tout bien réfléchi, n’importe qui ferait l’affaire. » (Ninette découvrant peu à peu son homosexualité face à Rachel, dans la pièce Three Little Affairs (2010) d’Adeline Piketty) ; « Je suis encore complètement amoureux. » (Hugo le héros homo du film « Como Esquecer » (« Comment t’oublier ?, 2010) de Malu de Martino) ; « On a le droit d’aimer qui on veut, comme on veut. » (cf. la chanson « Entre Elle et Moi » des Valentins) ; « T’aimer parce que c’est aujourd’hui, c’est ce qui compte vraiment. » (cf. la chanson « J’attends » de Mylène Farmer) ; « Aimer les filles ou les garçons, c’est aimer de toute façon » (cf. la chanson « La plus belle fois qu’on m’a dit je t’aime » de Francis Lalanne) ; « On s’en fout qu’on soit hétéro ou homo. Pourquoi les gens ne peuvent pas nous accepter tels que nous sommes ? » (Oscar dans le film « Un de trop » (1999) de Damon Santostefano) ; « Tribu, qu’est-ce que nous voulons ? Paix et liberté maintenant !!! […] Faites l’amour ! » (les comédiens de la comédie musicale HAIR (2011) de Gérôme Ragni et James Rado) ; « Moi, je dis que le vrai défi, c’est d’être soi-même ici et maintenant. » (Vincent dans le téléfilm « À cause d’un garçon » (2001) de Fabrice Cazeneuve) ; « Hétéro, homo, c’est dépassé : je t’aime seulement parce que c’est toi. » (Mécir à Paul, dans le film « Grande École » (2003) de Robert Salis) ; « Quelle est la différence ? Enfin, Suzanne, je ne te reconnais plus. L’amour est toujours l’amour. C’est une femme ? Eh bien tant mieux pour toi ! » (Anne, l’amie gay friendly de Suzanne, quand celle-ci lui annonce avec difficulté son homosexualité, dans le roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, p. 144) ; « Je n’ai rien contre. Ce qui compte, c’est ton bonheur. » (la tante de Dany à son neveu, dans le film « Sexe, gombo et beurre » (2007) de Mahamat-Saleh Haroun) ; « C’est important de faire ce qu’on aime. […] Malik, moi, je ne veux que ton bonheur. » (Sara à son fils homo Malik, dans le film « Le Fil » (2010) de Mehdi Ben Attia) ; « Tu dis : j’avais décidé de ne plus aimer les hommes. Mais toi, c’est différent. » (Vincent à Arthur, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 44) ; « Je ne me sens pas plus hétéro qu’homo. C’est juste toi. » (Bart en s’adressant à son amant Hugo, dans l’épisode 268 de la série Demain Nous Appartient diffusée sur TF1 le 13 août 2018) ; « Qu’on soit tarlouze ou hétéro, c’est finalement le même topo. Seul l’amour guérit tous les maux. » (cf. la chanson « Petit Pédé » de Renaud ; et le pire, c’est qu’avec un discours conventionnel pareil, Renaud arrive encore à s’étonner de ne pas avoir réussi à faire davantage d’émules dans la communauté homo…) ; « Ce n’est pas que je sois lesbienne en quoi que ce soit : ce qui m’attire, c’est la personne. Il se trouve simplement que toutes les personnes qui m’attirent sont des filles. » (Jessica Campbell dans le film « L’Arriviste » (1999) d’Alexander Payne) ; « Le sexe est universel : il se fout de notre genre et de nos préférences. […] [Concernant l’infidélité au sein de notre couple…], on a choisi la voie moyenne de la communication totale avec, au premier chef, le respect des sentiments de l’autre. » (Michael à son compagnon Ben, dans le roman Michael Tolliver est vivant (2007) d’Armistead Maupin, p. 70 puis 78) ; « Il s’agit d’amour ! Alors de quoi est-ce que tout le monde a si peur ?!? » (Steven faisant un coming out larmoyant face à l’assemblée muette de sa High School, dans le film « Get Real », « Comme un garçon » (1998) de Simon Shore) ; « Tout ce qu’on fait, c’est par amour. Ça ne peut pas être mal. » (Kal à Fran, dans le film « Sex Revelations » (1996) d’Anne Heche) ; « C’est pas la vérité qui compte. C’est le bonheur. » (Alice dans la pièce Open Bed (2008) de David Serrano et Roberto Santiago) ; « Être toujours heureux est un commandement d’une importance vitale. » (cf. proverbe hassidique cité en épitaphe du roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, p. 226) ; « Make Love, not War we say : It’s easy to recite ! » (cf. la chanson « Love Makes The World Go Round » de Madonna) ; « ‘Aime et fais ce que tu veux’, disait Augustin. Le vrai combat, il est là ! » (Frère Antoine à Malcolm dans le roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, p. 137) ; « S’il me manque l’amour, je ne suis rien. » (Mark lisant au temple l’Épître de saint Paul aux Corinthiens, dans le film « Save Me » (2010) de Robert Cary ; plus tard, son copain Scott dira : « L’amour est juste. Et l’amour, c’est bien. ») ; « L’essentiel, c’est l’amour. » (Göran dans le film « Patrik, 1.5 », « Les Joies de la famille » (2009) d’Ella Lemhagen) ; « C’est de l’amour finalement. » (cf. la conclusion de l’adjoint au maire pendant la cérémonie d’un mariage gay dans une mairie française, sketch « Le Mariage homosexuel bientôt en France » de l’humoriste Lamide Lezghad, à l’émission On n’demande qu’à en rire sur France 2, le 31 janvier 2011) ; « L’important, c’est que tu sois heureux. » (la mère face à son fils qui fait son coming out, dans un sketch « Coming out du dimanche midi » de l’émission Tout le monde il est beau sur la chaîne Canal +, 2011) ; « L’essentiel, c’est que tu sois heureuse, et que tu reste en vie. » (la mère à sa fille Ariane qui lui annonce qu’elle est lesbienne, dans le film « La Bête immonde » (2010) de Jann Halexander) ; « Je suis heureuse pour vous car l’amour est une chose formidable. » (Yvonne la gouvernante s’adressant à Ednar à propos de son couple avec Dylan, dans le roman Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 74) ; « Aimer un garçon, ça ne veut rien dire. Ce n’est pas pour ça qu’on est homo. D’ailleurs, je ne l’aimais pas. Je le trouvais beau, c’est tout ! » (Bryan en parlant de Kévin, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 32) ; « J’aime France… mais attention ! Je ne suis pas du tout lesbienne ! » (Sharon, qui se décrit comme une « bi », dans la pièce Jupe obligatoire (2008) de Nathalie Vierne ; de son côté, France dit que son homosexualité n’est pas une question d’identité, mais uniquement « de désir, de Moment, d’Amour… ») ; « Ce qui compte, c’est d’être amoureuse. […] C’est pas si grave d’être homosexuelle quand on s’aime. » (Hortense qui, en tombant amoureuse de Raphaël qu’elle avait pris pour une femme pendant toute la croisière, finit par se croire lesbienne, dans le film « La Croisière » (2011) de Pascale Pouzadoux) ; « Il n’y a pas d’homosexualité, ni d’hétérosexualité, il y a la sexualité. » (cf. le film « La Truite » (1982) de Joseph Losey) ; « Quoi que tu sois, garçon ou fille, ça n’a pas d’importance. Je sais que je t’aime. » (Leslie Cheung dans le film « He’s A Woman, She’s A Man » (1994) de Peter Chan) ; « En amour, il n’y a pas de règles. » (Harold, l’un des héros homosexuels du film « The Boys In The Band », « Les Garçons de la bande » (1970) de William Friedkin) ; « Et l’amour dans tout ça ? » (Emad, le frère d’Adineh l’héroïne transsexuelle F to M, s’adressant à son père, dans le film « Facing Mirrors : Aynehaye Rooberoo », « Une Femme iranienne » (2014) de Negar Azarbayjani) ; « J’ai le droit d’être amoureux » (cf. le chanson « J’ai le droit aussi » de Calogero) ; « Aimez ! Aimez ! Tout simplement. Et peu importe comment. » (Dominique, dans la pièce Drôle de mariage pour tous (2019) de Henry Guybet) ; etc. Dans la pièce Angels In America (2008) de Tony Kushner, l’avocat Roy Cohn ne croit pas aux identités « gay » et « lesbienne », mais uniquement « aux relations ».
Par exemple, dans le téléfilm « Ich Will Dich » (« Deux femmes amoureuses », 2014) de Rainer Kaufmann, Aysla et Marie sont deux femmes mariées qui couchent ensemble… (l’une d’elles regrette de s’être mariée avec un homme : « Je n’aurais jamais dû me marier… ») mais elles n’assument absolument pas la réalité de leur pratique amoureuse, et font preuve d’homophobie inconsciente : « Que les choses soient claires : je ne suis pas lesbienne. » prévient Marie. « Et moi non plus. » lui répond Aysla, pour continuer de sortir avec elle en la déculpabilisant. En gros, vous détestez le mariage ainsi que l’homosexualité ? Eh bien raison de plus pour la pratiquer !
Dans le film « Pédale douce » (1996) de Gabriel Aghion, André, homosexuel, se montre très entreprenant en draguant Cyril, un de ses collègues de bureau sur qui il se fait des films. Finalement, Cyril le repousse (« Je ne suis pas branché pédés, en vrai. ») mais André, dans un premier temps, refuse d’outrepasser les limites imposées par un discours homophobe : « Mais moi non plus. On n’est pas obligés de mettre des mots sur tout… ».
Derrière les refrains prônant l’« Amour », on lit souvent chez le héros homosexuel une grande immaturité affective et une profonde angoisse, car l’état amoureux est propre à la passion, à l’adolescence, et fait vivre les montagnes russes émotionnelles à celui qui s’y enchaîne (cf. l’album Être amoureux : Petits bobos, petits bonheurs (2005) d’Élisabeth Brami) : « Il faut admettre que ce comportement d’éternel adolescent me jouait parfois de vilains tours. Effectivement, je tombais amoureux mais cela ne durait pas plus d’une semaine. » (Ednar, le héros homosexuel du roman très autobiographique Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 132) ; « Ainsi, les années défilaient à grands pas ; je vieillissais sans voir venir mes rides ; mes cheveux grisonnants tout autour de mes tempes prouvaient que j’avais atteint un bel âge. Mais comme toujours, j’étais amoureux, car je n’avais jamais pu vivre sans amour. » (idem, p. 184) ; « Malgré les bonheurs que Marie me donnait tous les jours, ce bel amour simple ne me suffisait déjà plus. Cette inclination que j’ai pour la conquête est sans doute le pire. Je me sens toujours amoureuse du plus difficile, de l’impossible même, et donc condamnée à n’être jamais comblée. » (Alexandra, la narratrice lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, pp. 204-205) ; etc.
Par exemple, dans le film « L’Inconnu du lac » (2012) d’Alain Guiraudie, c’est au moment où Franck avoue à son ami Henri qu’il entame une relation « sérieuse » avec Michel (« J’crois que je suis en train de tomber amoureux. ») qu’Henri sent précisément qu’il se jette dans la gueule du loup (« Et c’est ça qui te tracasse ? » lui répond-il immédiatement).
Dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit, Arnaud, le héros homo qui ne s’assume pas, refuse de poser le mot « homosexuel » sur ses propres pratiques amoureuses avec son compagnon : « J’ai des relations sexuelles avec Benjamin, une fois de temps en temps. Comme tout le monde. »
Ce discours pro-« amour », qui se veut humaniste, et incarné dans les Sens (je l’ai bien écrit au pluriel!), ne se dirige en réalité qu’à des corps végétaux, angéliques, non-sexués, immatériels, narcissiques, où l’autre (ou soi-même !) en face n’existe pas. « Je voudrais pouvoir être amoureux. Ma propre personnalité est un poids pour moi. » (Dorian Gray dans le roman Le Portrait de Dorian Gray (1890) d’Oscar Wilde) ; « Et ils s’émeurent. Et ils s’aimèrent. » (le petit homme et Jean-Claude son amant spéculaire, dans le spectacle musical Bénureau en best-of avec des cochons (2012) de Didier Bénureau) ; « J’allais de déceptions en déceptions, et pourtant je ne me lassais pas de tomber amoureux. » (Ednar, le héros homosexuel du roman très autobiographique Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 114) ; « Avec un peu d’amour, beaucoup d’alcool, tout passe toujours. » (Jeanfi, le steward homo dans le one-man-show Au sol et en vol (2014) de Jean-Philippe Janssens) ; etc. À la fois il cache et il traduit une réelle déprime, une haine de soi redoutable.
On retrouve dans les œuvres homosexuelles le refrain de la philosophie légère (et pourtant dangereuse) de « l’amour n’a pas de sexe », et celui – encore pire pour la communauté homosexuelle puisqu’il neutralise son droit à exister – de « l’amour n’a pas d’orientation sexuelle ». « On n’a pas couché ensemble. On a fait l’amour. […] J’ai pas couché avec Quentin. Je l’ai aimé. » (Jules, le héros homo en parlant de son aventure avec Quentin, pour ne pas assumer de dire qu’il est homo ET pour idéaliser son « histoire de cul », dans la pièce Les Sex Friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau) ; « Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas ; mais homo, bi, hétéro c’est pareil, on ne mange pas dans les assiettes cassées. » (le chauffeur du taxi dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 120) ; « On se fout de qui embrasse qui. » (Tori, la lycéenne gay friendly, dans le film « Elena » (2010) de Nicole Conn) ; « Le cœur a ses raisons que la raison ignore. » (une vieille mamie secondée de son mari, idem) ; « De toute façon, le vingt-et-unième siècle sera bi ou ne sera pas ! » (Claude, l’une des héroïnes lesbienne du roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 63) ; « Bien plus que la raison, le cœur est le plus fort. » (une réplique dans la comédie musicale « Les Demoiselles de Rochefort » (1967) de Jacques Demy) ; « Ça vous fait rien de savoir ce que c’est que de faire l’amour avec un garçon, ou avec une fille d’ailleurs ? » (Jacques s’adressant à Anna, la jeune voyante, dans le film « L’Apparition » (2018) de Xavier Giannoli) ; etc.
Menée à son terme, la Queer Theory est homophobe et hyper matérialiste : « Ne me dis pas que tu es pédé et que ça existe d’être pédé. Ça n’existe pas, la seule chose qui existe, c’est des situations sexuelles qui font bander tout le monde, les filles comme les garçons, hétéros ou pédés. » (Cody, le héros homosexuel américain à son pote gay Mike dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 99) ; « Les objets comme des collections de sable, Témoins de nos escales dans le monde amoureux. » (le Comédien, dans la pièce Les Hommes aussi parlent d’amour (2011) de Jérémy Patinier) ; « Un enfant, qu’il soit élevé par deux pédés du cul ou par un père et une mère, l’important, c’est qu’il ait de l’amour. » (Nadia, la mère porteuse hétéro dans le one-man-show Tout en finesse (2014) de Rodolphe Sand) ; « C’est le grand Amour. On ne peut rien y faire. » (Tom, le héros homosexuel, forçant Dick à l’aimer, dans le film « The Talented Mister Ripley », « Le Talentueux M. Ripley » (1999) d’Anthony Minghella) ; etc.
Par des propos lénifiants sur l’amour, c’est toute une censure/indifférence homophobe sur le désir homosexuel qui est imposée. Et ça, c’est très inquiétant pour le futur des personnes homosexuelles, qui ne se verront bientôt plus reconnaître leur désir homosexuel, ni leur culture, ni leur légitimité à exister en tant que personnes homosexuelles, si ça continue. Qu’on ne s’étonne pas de la recrudescence des actes homophobes dans une société pareille où le discours bisexuel asexualisant (qu’on nous ordonne de nommer « amour ») a pignon sur rue !
L’un des points de réflexion que je trouve cependant intéressant dans ce chœur d’agneaux bêlants – même s’il est faux de l’interpréter ensuite comme une essence homosexuelle éternelle –, c’est quand certains personnages ou certains auteurs affirment que « les » homosexuels font partie d’une race à part appelée « les amoureux » : « Nous appartenons à la race d’Eros. » (Le Coryphée dans la pièce Les Oiseaux (2010) d’Alfredo Arias) ; « J’ai grandi dans le romantisme. » (Mme Garbo dans la pièce L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer (1971) de Copi) ; « Le pire, c’est que votre caractère vous pousse à être amoureux. » (D’Albert à Alcibiade, dans le film « Le Chevalier de Maupin » (1965) de Mauro Bolognini) ; « Nous, les lesbiennes, on tombe toujours follement amoureuses. » (Océane Rose Marie dans son one-woman-show La Lesbienne invisible, 2009). À mon sens, ils touchent ici du doigt ce qui est l’une des caractéristiques les plus saillantes de la nature du désir homosexuel : c’est un désir sentimental et amoureux plus qu’un désir aimant. Dans son roman En l’absence des hommes (2001), Philippe Besson a bien choisi les mots qu’il prête à Proust pour illustrer ce que je viens de vous expliquer : « Je ne suis pas un amant, ne l’ai jamais été. Je suis un amoureux, véritablement. » (la figure de Marcel Proust, p. 93)
Dans l’amour homosexuel, le « désir d’aimer » semble l’emporter sur « l’amour en actes ». Par exemple, dans la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H., Matthieu, le héros homosexuel, nous raconte sa love story, et surtout la courbe montante-descendante de ses sentiments ; d’ailleurs, c’est au moment où il se sent le plus in love de Jo (« Le top du ‘Je suis amoureux’. » dit-il) qu’il va finalement le tromper.
On reste sur le terrain des bonnes intentions, ou bien du rêve. C’est particulièrement perceptible dans les chansons de Mylène Farmer (« J’avais rêvé du mot aimer. », cf. la chanson « Rêver » ; « J’ai dans mon autre moi un désir d’aimer, comment l’oublier ? », cf. la chanson « Tous ces combats ») mais également dans d’autres œuvres très appréciées des personnes homosexuelles. Par exemple, c’est ce désir d’aimer que souligne le critique Bernard Urbani dans le discours de la manipulation amoureuse des deux héros bisexuels des Liaisons dangereuses (1782) de Laclos, la Marquise de Merteuil et le Vicomte de Valmont, qu’il décrit comme deux êtres « avides d’aimer », malgré leur cruauté effective (Bernard Urbani, « Le Couple libertin : Valmont, Merteuil », dans Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos, Analyses et Réflexions sur Les Liaisons dangereuses de Laclos (1991), p. 78). Dans un élan très Walt Disney qui stipule que « tous nos rêves sont possibles à partir du moment où on y croit très fort », certaines personnages homos prônent la toute-puissance de la sincérité, sans penser une seule seconde que l’enfer ne fonctionne qu’à coup de bonnes intentions : « Une personne est d’autant plus authentique qu’elle ressemble à ce qu’elle a toujours rêvé d’être intensément. » (le transsexuel Agrado dans le film « Todo Sobre Mi Madre », « Tout sur ma mère » (1998) de Pedro Almodóvar) ; « La sincérité met fin à la paranoïa. » (cf. une phrase de la pièce Howlin’ (2008) d’Allen Ginsberg)
Par exemple, dans le film « La Mante religieuse » (2014) de Natalie Saracco, Greg, le héros homo, s’est fait vider son compte en banque par Igor, son amant qui lui a piqué sa carte de crédit… mais il continue de dire qu’il a aimé pour de vrai : « J’crois en la sincérité et la fidélité. »
Finalement, avec cette rhétorique de l’amour asexué (qui peut être homosexuel… ou pas), on se retrouve face à des personnages homosexuels hypocrites et lâches, qui nient la responsabilité et la réalité des actes sexuels qu’ils posent, ou bien qui mettent sur un piédestal tout désir humain (sans le définir, bien évidemment) à partir du moment où il est exprimé et qu’il est soi-disant individuel. Par exemple, dans le film « Cherchez Hortense » (2012) de Pascal Bonitzer, quand Jean-Pierre Bacri demande à Claude Rich « Papa, est-ce qu’il t’est arrivé de coucher avec des hommes ? », ce dernier lui répond : « Oui. Ça fait de moi un homosexuel ? » Tous les désirs se vaudraient, et donc ne mériteraient même plus d’exister. Quelques rares personnages homosexuels sentent le danger de ce discours bisexuel-asexué niant l’existence du désir homosexuel en eux : « Je sais que l’amour est important, je sais même que l’amour, c’est la preuve que l’homosexualité existe. Je sais tout ça. Non mais si j’y pense, n’importe qui peut baiser une bouche ou un cul, on s’en fout si c’est un mec ou une nana, genre derrière un glory hole. Donc oui, oui, je sais, l’amour c’est ce qui est le plus important. Mais chuis pédé, moi, pas hétéro. Je vais pas draguer quelqu’un. Sauf toi, peut-être ! » (Mike, le narrateur homosexuel s’adressant à Polly sa meilleure amie lesbienne, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 32)
Ce qui se passe en ce moment, c’est que le mot « amour » est sacralisé et préféré à Dieu même, universellement préféré à l’Amour même ! « Pour Bryan, faire l’amour, c’est le huitième sacrement. » (Tom parlant de son amant « catho », dans la pièce Les Vœux du Cœur (2015) de Bill C. Davis) Nous allons être de plus en plus confrontés à cet imbroglio, ce tour de passe-passe, ce décalage fusionnel (ce noeud!) entre mot et réalité, entre intention et amour, entre sincérité et Vérité, entre esprit et corps, entre enfer et paradis. « L’enfer, c’est l’absence d’amour. » (Bryan, idem)
FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION
PARFOIS RÉALITÉ
La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :
En général, la personne homosexuelle se qualifie d’« amoureuse » plutôt que de « personne aimante/aimée » ou de « personne homosexuelle », afin d’éviter de se définir, de regarder ses propres actes, et d’aimer sur la durée :
Dans les documentaires télévisuels, les débats publics, et les échanges sociaux informels, on retrouve sans arrêt cette emphase sur l’amour-sentiment supplantant complètement l’amour-engagement et la réflexion sur le sens du désir homosexuel : je vous renvoie par exemple au titre de l’émission homosexuelle (pardon… « gay friendly », il faut dire maintenant) Ce n’est que de l’amour sur la radio française RCN à Nancy (90.7 FM) ; à l’article « Si nous parlions d’Amour » (1999) de Marie-Jo Bonnet dans la revue Triangul’Ère 1 de Christophe Gendron ; ou bien encore au jeu télévisé français Les Z’Amours qui a accueilli pour la première fois de son histoire (le 11 juin 2009) un couple homosexuel ; etc.
C’est drôle comme beaucoup de personnes homosexuelles se font une obligation de tomber amoureuses, comme pour rentrer bêtement dans le moule social de la princesse et du prince charmants (et surtout pour imiter leurs films !) : « Il fallait que je tombe amoureux. » (Hugo Marsan en parlant de sa jeunesse, lors de la 3e Journée Mondiale contre l’Homophobie, Paris, le 18 mai 2007) ; « Nous allons ensemble rire, pleurer, trembler, tomber amoureux-se-s. » (Antoine Quet dans le catalogue du 19e Festival Chéries-Chéris au Forum des Images de Paris, en octobre 2013, p. 9) ; « C’était un coup de foudre réciproque. » (Élisabeth par rapport à Catherine, dans le documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz) ; etc. Elles n’ont toujours pas compris que le sentiment amoureux, sans la différence des sexes, est éphémère et souffrant par nature. « Tu fonces, tu t’enchaînes aux mêmes arbres qu’autrefois. Et tu sais déjà que tu vas souffrir, parce que tout te dit que ce sera plus compliqué que jamais… En un mot, tu es amoureux. » (Gaël-Laurent Tilium, Recto/Verso (2007), p. 162) L’état amoureux imposé par le capricieux Éros, et que beaucoup de personnes homosexuelles (célibataires, mais pas uniquement célibataires) rêveraient, dans leur incroyable naïveté, de retrouver comme si c’était le seul Nirvana qui existe sur Terre, n’est pas autre chose qu’un calvaire (si et seulement s’il n’est pas vécu dans l’Amour et canalisé par Lui !). Ce n’est pas pour rien que Marcel Proust parle, dans Sodome et Gomorrhe (1921-1933), des épuisantes « intermittences du cœur » (p. 21) que le grand huit des sentiments (homosexuels comme hétérosexuels) nous fait vivre façon looping ! Dans le documentaire « Charles Trénet, l’ombre au tableau » (2013) de Karl Zéro et Daisy d’Errata, quand on demande à Charles Trénet s’il a connu l’amour vrai, il répond : « J’étais trop amoureux pour me fixer. J’ai eu juste DES amours. » En vrai, ce n’est pas une partie de plaisir que d’être amoureux sans être aimant : « Je suis heureux, ce matin. Insatisfait. J’ai retrouvé un état amoureux, l’état brut qui est de front celui de dépit et de révolte. » (le juge Kappus dans le roman Portrait de Julien devant la fenêtre (1979) d’Yves Navarre, p. 13) ; « J’étais aveugle et amoureux. Les gays adorent vivre des histoires d’amour éternelles de trois jours. Alors je fais comme tout le monde, j’adore ça. » (Ashe dans le roman Riches, cruels et fardés (2002) d’Hervé Claude, p. 248). La passion peut même rendre fou, et nous anesthésier partiellement, au point de nous décourager d’aimer vraiment : « J’étais devenu un zombie. Un fou dans la nuit. Un mystique de l’amour. Un amoureux éconduit. » (Abdellah Taïa, Une Mélancolie arabe (2008), p. 53)
La grande majorité des personnes homosexuelles, incapables de faire la différence entre « être amoureux » et « aimer » (car notre société ne les y aide pas, il faut bien le dire !), se qualifient d’« amoureuses » : « Je mets du sentiment partout. » (Frédéric Mitterrand, La Mauvaise Vie (2005), p. 315) ; « Je suis un grand amoureux. » (Étienne Daho dans la revue Têtu, n°127, novembre 2007, p. 32) ; « Le monde me transforme en amoureux. » (Christophe Honoré, Le Livre pour enfants (2005), p. 96) ; « J’aimais tellement être amoureuse. » (une témoin lesbienne de 70 ans, dans le documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz) ; « Moi, je suis une romantique et je suis une grande amoureuse. » (Nina Bouraoui dans l’émission Culture et Dépendances diffusée le 9 juin 2004 sur la chaîne France 3) ; « Elle a fait de moi un être éternellement amoureux. » (Julien Green, en parlant de sa mère, dans l’émission Apostrophe diffusée le 20 mai 1983 sur la chaîne Antenne 2) ; « Je me savais incurablement sentimentale. » (Paula Dumont, La Vie dure : Éducation sentimentale d’une lesbienne (2010), p. 190) ; « Nijinski attache une grande importance aux mots ‘sentiment’, ‘sentir’ et ‘ressentir’. » (Christian Dumais-Lvowski, dans l’avant-propos du journal Cahiers (1919) de Vaslav Nijinski, p. 20) ; « Bonjour je m’appelle Jérémy Patinier, je ne vais pas vous raconter de conneries mais je vais vous parler d’amour. J’ai été amoureux 4 fois déjà. Ça a duré un an et demi, 6 mois et 2 fois 3 mois. Ça fait deux ans et demi en tout. J’ai 27 ans et 6 mois, j’ai calculé ça fait 10 037 jours. Bon j’arrondis à 10 000 jours si on enlève le début, la fin et les jours où on se déteste : ça fait 12% de ma vie à être amoureux. » (L’auteur de la pièce Les Hommes aussi parlent d’amour, 2011, Incipit) ; « Je suis amoureux. Amoureux de l’amour. » (le chanteur Stéphane Corbin, lors de son concert Les Murmures du temps au Théâtre de L’île Saint-Louis Paul Rey à Paris, en février 2011 ; il dit d’ailleurs que son album Les Murmures du temps a été « créé dans l’esprit amoureux, à écouter des chansons nostalgiques ») ; « J’étais déjà amoureux avant même de l’accueillir à sa descente du train. […] Yann était devant moi, beau et aussi gauche que moi. Mon premier réflexe a été de l’emmener contempler la mer Méditerranée. Nous nous sommes promenés, nos doigts s’effleurant comme par mégarde. Nous avons flirté tout l’après-midi comme deux adolescents connaissant leurs premiers émois. » (Jean-Michel Dunand, Libre : De la honte à la lumière (2011), pp. 83-84) ; etc.
L’écrivain Christophe Bigot, lors de la Conférence « Différences et Médisances » autour de la sortie de son roman L’Hystéricon, à la Mairie du IIIe arrondissement, le 18 novembre 2010, affirme qu’il s’est identifié très jeune à la figure romantique du procureur Camille Desmoulins : « Il est jeune, courageux, fougueux, c’est un amoureux. J’ai voué un culte à Camille Desmoulins pendant toute mon adolescence. » À l’occasion, on découvre que l’adjectif « amoureux » n’est en général qu’une pompeuse poétisation/romantisation de la pulsion génitale la plus vile et la plus égoïste (= je bande, je suis excité, DONC je tombe amoureux et j’aime !) : « Selon moi, le rapport que nous devons avoir à l’égard de nous-mêmes, lorsque nous faisons l’amour, est une éthique du plaisir, de l’intensification du plaisir. » (Michel Foucault, « Une Interview de Michel Foucault par Stephen Riggins », 1983, dans Dits et Écrits II, 1976-1988 (2001), p. 1355) Le Bonheur et le Plaisir sont les moteurs du discours libertin : « Il y a un pédagogue chez chaque libertin. En effet le Bonheur, valeur suprême que la philosophie des Lumières substitue au principe traditionnel et religieux de Salut, se définit dans la pensée libertine en termes d’activité et d’intensité. » (Béatrice Bonhomme, « Commentaire de la Lettre XLVIII », dans Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos, Analyses et Réflexions sur Les Liaisons dangereuses de Laclos, Éd. Marketing, Paris, 1991, p. 75). Selon les amoureux homosexuels, l’Homme ne serait qu’une marionnette offerte en holocauste à l’Amour. On ne pourrait pas comprendre l’Amour, puisqu’Il serait inintelligible, inattendu, accidentel, despotique : « L’histoire qu’on se raconte est singulière. Elle tient à peine compte de l’identité des partenaires, des relations que l’on a avec telle personne, du fait que l’on soit ou non amoureuse de quelqu’un de précis à ce moment-là. C’est un état de désir diffus, imprévisible, qui vous tombe dessus parce que le soleil, parce que la vie… » (Cathy Bernheim, L’Amour presque parfait (2003), p. 173) On nous fait croire que l’amour vrai n’est qu’une affaire de jolies intentions (et non d’actes et d’engagement concret), qu’un arrangement privé à deux, et qu’à partir du moment où les deux parties qui se mettent en couple sont apparemment consentantes (mais sont-elles si libres qu’elles le disent ?), adultes, et vaccinées, leur amour serait indiscutable. « Le désir justifie tout, pourvu qu’il soit partagé. » (idem, p. 191) « Ce qui compte, c’est la relation. […] Le critère éthique fondamental, qui relativise les différences, est celui de la qualité intérieure de la relation. » (Isabelle Graesslé, Pierre Bühler et Christoph D. Müller, Qui a peur des homosexuel-les ? (2001), p. 179) Le mythe du consentement mutuel – qui stipule qu’une action devient juste et aimante à partir du moment où elle est voulue par plus d’une personne ( = « on va voir ailleurs… mais c’est rien puisqu’on s’dit tout ») – n’est absolument pas remis en cause, alors que, dans les faits, on peut très bien agir mal à deux, au-delà des sincérités, des promesses, de la communication dans le couple.
L’éloge idolâtre du sentiment amoureux s’accompagne d’ailleurs très souvent d’une forme d’auto-mépris chronique de l’amour-sentiment, forcément. C’est parce qu’on n’y croit trop, et qu’on en fait un mauvais usage, que les sentiments peuvent nous tromper ! : « Je ne veux plus jamais tomber amoureux. » (Alexandre Delmar, Prélude à une vie heureuse (2004), p. 170) Les plus romantiques des sentimentaires homosexuels sont ceux qui dénoncent chez les autres la naïveté et l’idéalisme des contes de fées dans lesquels ils s’enferrent pourtant à pieds joints eux-mêmes, parce qu’ils n’ont rien compris à l’Amour vrai. L’Amour, ce n’est pas comme dans les contes de fée : c’est mieux, et plus grave, que les contes de fées ! C’est par excès de romantisme que nous arrivons à être déçus par ce que nous croyons être « de l’amour » : non parce que nous aimons vraiment.
Dans l’amour homosexuel, le « désir d’aimer » semble l’emporter sur « l’amour en actes » : « C’est vers seize ans que survint le premier flot qui me jeta par dessus bord. Depuis longtemps existait en moi un inconscient désir d’aimer. » (Jean-Luc, 27 ans, homosexuel, dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, p. 80)
Je suis persuadé que c’est parce que les personnes homosexuelles ne croient plus en l’amour qu’elles le chantent à tue-tête. Pour cacher leur dépression et les détournements de l’amour qu’elles opèrent, elles se mettent à défiler sous les bannières de l’optimisme en forme de cœur ou d’arc-en-ciel. Et ce remplacement de l’Espérance (= lire tous les événements concrets de la vie humaine à la lumière de la Victoire de la Vie sur la mort, à travers la Croix du Christ) par l’optimisme ( = voir le monde avec des lunettes roses) est vraiment pathétique. Ça y est ! Je crois qu’on peut le dire : Les Bisounours homosexuels (déprimés mais « optimistes ») sont là ! Ils ne croient pas en l’Amour unique et éternel, mais en l’amour-sentiment, merveilleux et éphémère à la fois. « Aime comme tu veux ! » signalent leurs banderoles de Gay Pride (cf. arborées au défilé parisien de 1986). En réalité, derrière l’argument de l’amour, la motivation de beaucoup de militants homosexuels est prioritairement légaliste et matérialiste, ne nous leurrons pas : « On veut être reconnus comme une famille par la loi, pas que par les cœurs. » (Francine et sa compagne Karen, dans le documentaire « Des filles entre elles » (2010) de Jeanne Broyon et Anne Gintzburger)
La justification de l’homosexualité par « l’amour » est totalement de mauvaise foi, mais semble dans un premier temps, il faut le reconnaître, vraiment efficace et incontestable, d’une part parce qu’elle touche la corde sensible de notre compassion, et d’autre part parce que l’Amour vrai, même s’Il s’éprouve concrètement sur la durée, dans la patience et la persévérance, ne se prouvera et ne s’imposera jamais : Il est l’Amour même (et la Liberté qui va avec) !
Votre attention, s’il vous plaît ! La Miss France homosexuelle a un message capital à nous délivrer : « Vive la liberté, la vie, la différence, la grâce, le respect… » (Clémentine Célarié dédicaçant maternellement la revue Triangul’Ère 3 (2001) de Christophe Gendron, p. 778) ; « Je réclame la liberté générale des mœurs, de tout ce qui ne nuit pas à la tranquillité, à la liberté, au bonheur du prochain. » (Claude Cahun citée par Catherine Gonnard, article « Claude Cahun », dans le Dictionnaire des Cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, p. 91) ; « Seul l’amour peut légitimer les actes sexuels consentis sans violences. » (le docteur Ramón Serrano Vicens, cité dans l’essai El Látigo Y La Pluma (2004) de Fernando Olmeda, p. 160) ; Les militants de l’association gay basque Xente Gai Astur veulent « construire une société plus juste et meilleure pour tous les êtres humains » (cf. Fernando Olmeda, El Látigo Y La Pluma (2004), p. 322) ; « Jocelyne François ne se veut pas la porte-parole d’une quelconque cause. Pour elle, il s’agit de dire l’évidence : l’amour, et sa singularité. Un ton qui rompt définitivement avec tous les poncifs et les stéréotypes d’une homosexualité subie ou transgressive, en se voulant essentiellement à l’écoute d’une histoire personnelle, celle de sa rencontre avec la peintre Marie-Claire Pichaud. Son œuvre reste surtout une invitation à aller jusqu’au bout de soi et de ses bonheurs. » (cf. l’article « Jocelyne François » de Catherine Gonnard, dans le Dictionnaire des Cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, p. 201) « En conclusion, je pense que nous recherchons tous, hétéros ou gays, le bonheur, l’amour, la liberté de vivre la vie que l’on a choisie. Il n’y a donc pas de différence. Je souhaite de tout cœur que les homos puissent vivre leur vie dans la paix, la reconnaissance et la sécurité. » (cf. lu dans la revue Têtu, juillet/août 2002) Oui, en effet, le bonheur, comme le répète le monde magique de la publicité, c’est d’être soi-même, de s’écouter, de penser à soi, … et, comme dirait le bobo, d’« être vivant » et d’« avoir aimé (malgré tout) ». De chanter la vie, de danser la vie (= de vivre pour sa gueule, en gros). Et surtout, surtout, de ne pas juger (comprendre = « faire marcher son sens critique ») : « Pour moi l’homosexualité est une chose normale. Je ne vois pas du tout au nom de quoi est-ce qu’on juge l’autre. Son corps, mon corps est à moi. Votre corps est à vous, j’espère. Nous avons le droit d’en faire… à peu près, ce qu’on veut. La seule chose qui soit interdite, c’est la mauvaise foi, le mensonge et le meurtre. Tant qu’on ne porte pas ombrage à la liberté de l’autre, on a le droit d’être libre. » (Juliette Gréco dans le documentaire « Sex’n’Pop, Part I » (2004) de Christian Bettges) C’est vrai, tout ça. Il ne faut pas oublier non plus de dire que « L’Important, c’est la communication et les échanges ». C’est important, ça. Ben oui : on reçoit beaucoup plus que ce qu’on donne. C’est Lorie, la grande philosophe, qui l’a dit. Et c’est capital de rappeler que l’amour n’a pas de règle ni de limites, parce que l’Amour est transcendant : Il est partout, même là (surtout là !) où on ne s’y attend pas, … où notre désir n’y est pas, où on ne veut pas s’investir librement.
Miss France a encore un mot à nous dire sur le mariage gay, peut-être ? Oui, il faut en effet lutter contre les préjugés sur les homos, c’est vrai (c’est quoi, un « préjugé », au fait ?). Et lancer le Kiss-ing de l’amour obligatoire à la Gay Pride ! pour expliquer au monde entier que « les homos sont faits pour le mariage ! » (dixit Arielle Dombasle dans la revue Têtu, juin 2011) Voilà. Ça, c’est fait. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il aime ! Tout ça, C’EST LA VIE ! « Tu s’ras bien avec tes deux mamans. Avec le p’tit Raphaël, on fonde une famille. On peut tout à fait vivre une relation homo avec un p’tit bébé. Ça me paraît complètement naturel. Voilà, quoi. C’est la vie. » (une maman lesbienne juste après la naissance de son fils, dans l’émission Ça se discute diffusée le 18 février 2004 sur la chaîne France 2) Les couples homos, en résumé, pas besoin de se prendre la tête, « C’est juste de l’amour quoi. » (Jeanne Broyon par rapport à l’amour lesbien, dans le documentaire « Des Filles entre elles » (2010) de Jeanne Broyon et Anne Gintzburger ; d’ailleurs, pendant un kiss-ing parisien, la réalisatrice se ballade justement avec un ballon gonflé en forme de cœur, marqué « Action Bisounours ». CQFD) Euh… Une dernière petite question perso : On est vraiment obligé d’applaudir ?
Quand on regarde les mots de la Miss France tout-sourire d’un peu plus près, on y découvre toujours le même discours homophobe prônant une diversité-rouleau-compresseur égalitiste : « Dès qu’il y a de l’amour, qu’il soit hétéro, homo, bi, trans, c’est une occasion de fête et de joie. Et je trouve ça magnifique ! » (Linda Troller dans le documentaire « 68, Faites l’amour et recommencez ! » (2008) de Sabine Stadtmueller) ; « C’est pas le mariage homo. C’est le mariage tout court. » (Marion, la sœur de Guillaume, son frère homo en couple avec Patrick, dans le documentaire « Homos, et alors ? » de Florence d’Arthuy de l’émission Tel Quel diffusée le 14 mai 2012 sur la chaîne France 4) ; « Homo, hétéro, il n’y a pas fondamentalement de différence. L’amour entre deux personnes, avec un grand A, c’est le même. » (Violaine citée dans la revue Têtu, n°130, février 2008, p. 81) ; « À travers ce film, j’ai essayé de dire que l’amour reste éternel en dépit des difficultés que la société impose aux amoureux. Homos ou pas ! C’est pour moi une façon de rendre hommage à ceux qui s’aiment et expriment leur amour comme ils le sentent. » (Mohamed Camara à propos de son film « Dakan » (1997), dans Arte Magazine, le 15 juillet 2000) ; etc.
Voici le discours typiquement bisexuel de l’irresponsabilité des libertins « gays friendly » : « Tu sais, cariño, un jour, tu vas tomber amoureux. Si c’est un garçon, t’es homo. Si c’est une fille, t’es hétéro. […] Je me suis tapée toutes les filles de ma promo. Ça n’a pas fait de moi une lesbienne ! » (une des tantes de Guillaume, le héros bisexuel, prise en flagrant délit de déni de responsabilité, dans le film « Guillaume et les garçons, à table ! » (2013) de Guillaume Gallienne) Et tout le monde a « adoooré » la « nouveauté » qu’aurait représentée ce film « Guillaume et les garçons, à table ! »… J’avais beau leur dire : « Mais non, c’est pas un film novateur ni positif pour les personnes homosexuelles. Malgré les apparences, il n’est pas un progrès du tout. C’est un film homophobe qui banalise et ignore la pratique homosexuelle en même temps que les personnes. », je n’arrivais pas à me faire entendre…
Les Queer & Gender Studies, derrière un discours évasif sur les bienfaits des différences (qu’elles nient concrètement, à commencer par la différence des sexes !), tentent d’imposer un dangereux flou artistique sur la recherche du sens de la sexualité, des corps naturels, et de l’Amour, une recherche qui, inutile de le rappeler, garantie le respect des personnes et de notre société : « Les contours d’une nouvelle forme de sexualité ne peuvent pas être connus, il appartient, à chacun de nous de le déterminer. […] Les êtres humains s’arrangent à leur façon de la reproduction et de la production, des différences sexuelles et de l’érotisme ; ils font aussi leur propre histoire du plaisir et du bonheur. […] La recherche du bonheur au XIXe siècle dépend de vous. » (Jonathan Ned Katz, L’Invention de l’hétérosexualité (2001), pp. 181-183) ; etc. Leur défense de l’amour est particulièrement sentimentaliste et anti-naturaliste : « Aujourd’hui, la signification de la sexualité ne se situe plus exclusivement dans le corps mais dépend de l’usage que l’on en fait. » (idem, p. 176) Ce sont les instincts et les pulsions animales (les penseurs queer diront « envies » ou « amour » pour édulcorer leur violence) qui sont mis en avant, voire imposés : « Le sexe est une pulsion humaine fondamentale qui ne peut être bridée. Toutes les tentatives pour le contrôler ou le réglementer ont échoué. L’amour ne connaît pas de verrous. » (Terry Sanderson, Gay Kâma Sûtra (2003), p. 8) À travers un réquisitoire archi-appris sur l’amour (l’amour dont paradoxalement on ne dit rien ! on se contente généralement de nous l’exhiber sans légende), derrière des mots énigmatiques et ésotériques berçant notre douilletterie, se cache une redoutable censure sur l’homosexualité : « Le Vatican s’oppose à l’amour ! » (Don Barbero, prêtre gay friendly dénonçant la position de l’Église catholique lors du vote de la loi DICO en Italie en 2003, dans le documentaire « Homophobie à l’italienne » (2007) de Gustav Hofer et Luca Ragazzi) ; « L’homosexualité ne m’intéresse pas comme sujet de cinéma. Ce qui m’intéresse, c’est l’intimité des personnages. » (Gaël Morel cité par Cyril Legann, « Gaël et son clan », dans la revue Illico, 10 juin 2004) ; « Je ne fais aucune différence entre l’hétérosexualité, la bisexualité et l’homosexualité. L’amour, c’est être consumé par un feu intérieur, qui vous emmène loin. Tout le monde a raison, tout le monde fait le bon choix, personne n’a à s’interposer quand il s’agit d’amour. […] Quant à l’homoparentalité, je ne vois pas le problème, si problème il y a. Peu importe la sexualité des parents, l’amour doit être au centre de la famille. Je suis pour le bonheur et la félicité. » (Étienne Daho cité dans la revue Têtu, n°127, novembre 2007, p. 34) ; « Du moment qu’il y a de l’amour et de l’éducation… » (cf. une phrase d’un défenseur du « droit à l’enfant » pour les couples de même sexe, dans la série d’émissions 7 minutes pour une vie, « Homoparentalité : Le Parcours de deux mamans et deux papas » dans Le Magazine de la Santé, diffusé sur la chaîne France 5, décembre 2009) ; « J’ai pas vraiment envie d’en parler. C’est un film d’amour, voilà. Souvent, mes films ne traitent pas directement d’homosexualité. » (François Zabaleta juste avant la projection de son film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta, au 17e Festival Chéries-Chéris d’octobre 2011, au Forum des Images de Paris) ; etc.
Par exemple, dans le documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz, le papy homosexuel fermier de 83 ans compare le fait d’aimer le vin avec l’homosexualité: « Il s’agit d’aimer. », mais on voit qu’il impose une censure sur sa propre homosexualité : « Je suis né comme ça. Je suppose. Je ne me pose pas la question. C’est, je pense, l’intérieur qui commande. »
Certains amants homosexuels, dans un élan d’irresponsabilité puéril et homophobe, vont même jusqu’à nier leur désir homosexuel, leurs actes, leur orientation homosexuelle, leur culture, leurs amis homos, leur communauté sexuelle d’adoption, parfois même renier leur propre compagnon, pour satisfaire ce discours social insipide sur la sexualité : « Si l’on me presse de dire pourquoi je l’aimais, je sens que cela ne peut s’exprimer qu’en répondant : parce que c’était lui, parce que c’était moi. » (Montaigne au sujet de La Boétie, cité dans le roman Parce que c’était lui (2005) de Roger Stéphane, p. 37) ; « La conduite sexuelle entre deux hommes a peu ou rien à voir avec l’identité ‘homosexuelle’. » (Neil McKenna, On The Margins (1996), p. 12, cité dans l’essai Historia De La Literatura gay (1998) de Gregory Woods, p. 312) ; « Je ne pensais pas devoir décrire mon protagoniste en tant qu’homosexuel ou hétérosexuel. Pour moi, il est queer. Dominik n’a pas besoin de se décrire. » (Jan Komasa, le réalisateur du film « Sala Samobójców », « Suicide Room » (2011), s’exprimant sur la plaquette du 17e Festival Chéries-Chéris, le 7-16 octobre 2011, au Forum des Images de Paris) ; « Je ne suis pas lesbienne ; j’aimais Thelma. » (Djuna Barnes à propos de sa relation orageuse avec la sculptrice Thelma Wood, citée dans le Dictionnaire gay (1994) de Lionel Povert, p. 76) ; « Moi je ne lutte pas pour être homosexuel. Je lutte pour être moi et pour être une personne. Moi je crois aux personnes, pas à l’homosexualité. On ne doit pas te coller une étiquette parce que tu te mets avec un mec ou une nana. » (Fernando Olmeda, El Látigo Y La Pluma (2004), p. 265) ; « Ce n’est pas important d’être gay… ou important d’être blanc… ou important d’être noir. L’important, c’est d’être soi. » (James Baldwin en mai 1986, cité dans le Dictionnaire gay (1994) de Lionel Povert, p. 72 ; « J’ose espérer à l’avenir qu’on ne parlera plus d’orientation sexuelle, que ça deviendra juste un fait naturel. » (une femme trentenaire lesbienne dans le documentaire « Coming In » (2015) de Marlies Demeulandre) ; etc.
Pour faire contrepoids à ce discours fleur bleue senteur lavande puant, je ne peux m’empêcher de citer les quelques mots de Pascal Bruckner sur l’individualisme infantile, dans La Tentation de l’innocence (1996) : « L’individualisme infantile est l’utopie du renoncement au renoncement. Il ne connaît qu’un mot d’ordre : sois ce que tu es de toute éternité. Ne t’embarrasse d’aucun tuteur, cultive et soigne ta subjectivité qui est parfaite du seul fait qu’elle est tienne. Ne résiste à aucune inclination car ton désir est souverain. Tout le monde a des devoirs sauf toi. », p. 106).
Le plus fascinant dans tout ce processus contemporain de bisexualisation du concept d’homosexualité, c’est que nous sommes en train de revenir inconsciemment aux fondamentaux historiques homophobes du désir homosexuel, à l’époque (fin du XIXe siècle) où les nomenclatures « les homosexuels » et « les hétérosexuels » s’appliquaient exactement aux mêmes individus : les personnes bisexuelles qui ne voulaient pas s’engager en amour. Une époque, d’ailleurs, où les personnes homosexuelles étaient particulièrement persécutées. Aujourd’hui, c’est la même chanson. On veut, en mettant à mort la réflexion sur le désir homosexuel, faire table rase sur l’horizon symbolique de la sexualité humaine au sens large. Le désir homosexuel est réduit à une pratique génitale (à ne pas analyser), et n’est plus reconnu en tant que désir (la seule chose dont on est sûr qu’il est). On ne doit même plus dire « amour gay », sinon, on se fait taper sur les doigts ! L’« amour gay », c’est de l’Amour-tout-court, voyons ! Pourquoi instaurer des « catégories d’amour », enfin !?! Je perçois cette tyrannie homophobe dans les propos pourtant bateau et désinvoltes d’un écrivain comme Christophe Donner : « Ma nature est d’être amoureux, d’être sensuel, d’être excité, de sucer, d’enculer mais pas d’être homosexuel » (l’écrivain Christophe Donner). La censure actuelle sur l’homosexualité, le refus de se définir comme une personne homosexuelle, ou de seulement parler de l’amour/désir spécifiquement « homosexuel », ne préfigure rien de bon pour la communauté homosexuelle à venir…
Ce phénomène de censure concernant la question gay est extensible à la société entière, malheureusement. C’est sur le sens de la sexualité humaine et de l’Amour qu’il faudrait s’attarder, en réalité ; sur les fondamentaux. On n’a jamais entendu parler autant d’Amour dans nos médias qu’aujourd’hui, … et pourtant, on l’a jamais aussi peu mis en pratique ni expliquer ! « On respecte les façons diverses d’aimer. » (Christian Flavigny, pédopsychiatre « catholique », dans l’émission « Sans langue de buis » consacrée aux États Généraux de la bio-éthique, diffusée le 12 janvier 2018 sur la chaîne KTO) Pour revenir sur le cas de la communauté homo, qui n’est que la partie visible de l’iceberg de l’Ignorance sociale sur l’Amour, ce qui surprend le plus, c’est de voir le degré de violence et de haine que les défenseurs de l’amour gay, qui n’ont pourtant que les mots « amour » et « respect » à la bouche, sont capables de mobiliser pour justement défendre leur conception très personnelle et discutable de l’Amour. Ne voyant leurs actions qu’à travers le prisme de leurs bonnes intentions, il semble difficile à la majorité des personnes homosexuelles de mesurer que ce n’est pas les valeurs en elles-mêmes qu’elles désirent mettre sincèrement en pratique dans leurs amours qu’elles doivent remettre en cause (« s’accepter soi-même », « défendre la diversité », « accueillir la différence », « aimer l’autre de tout son cœur et tel qu’il est », etc.), mais le détournement qu’elles en font. Par exemple, la générosité n’a jamais impliqué de se laisser vider son compte en banque par son amant ; l’amour de la beauté n’a jamais imposé la soumission au sexe ; l’acceptation de soi n’a jamais demandé la caricature du coming out ; etc. La communauté homosexuelle toute entière a du mal à saisir que l’amour n’est pas que l’intention d’aimer, et que, comme le dit le fameux adage, « l’enfer est pavé de bonnes intentions ».
Je vois d’ici certains lecteurs interpréter mon cynisme par rapport à l’amour gay comme une forme d’aigreur personnelle qui relèverait de la jalousie enfouie, ou du refus gratuitement méchant de cautionner le discours social actuel sur la beauté des couples homos. On ne sait pas pourquoi, mais bon, ça me ferait naturellement mal de voir un couple homo vraiment heureux ; ça m’écorcherait la bouche de l’avouer, mais le « bonheur des autres » me débecterait… Je leur réponds tout de suite que, pour l’instant, et depuis un certain moment déjà (surtout depuis que je ne suis plus homosexuellement amoureux, tiens ! comme par hasard ! et que je ne crois plus en cette soupe guimauve qu’on nous force à avaler comme du petit lait), je vais très bien. C’est parce que je ne me fais pas/plus avoir par la chansonnette des amoureux homosexuels que je peux dire haut et fort que ça fait du bien d’être au régime ! 😉 Et que ça fait du bien aussi de dénoncer ce qui se cache de franchement révoltant derrière le vernis de bien-pensance qui recouvre la communauté gay (et pas que la communauté gay : toute la société) D’autres personnes homos, prétendant vivre en ce moment le « Big Love » avec leur partenaire, me soutiendront que c’est plutôt mignon de se définir comme « amoureux ». En apparences, en tout cas. Mais ce qui est gênant, c’est ce que cette méga propagande publicitaire en faveur de l’amour, lancée par la communauté homosexuelle, cache une censure sur les pratiques dites « amoureuses » et sur la réflexion à propos de l’Amour, précisément.
Je le crois de plus en plus. Le désir homosexuel n’aide pas les individus qu’il habite à se poser la question de leurs désirs profonds. Il faut toute une vie à un Homme pour apprendre à aimer. Mais bien souvent, les personnes homosexuelles, en croyant aimer mieux que les autres qui les auraient si mal reconnues, se pensent exemptées du travail d’apprentissage collectif et patient de l’amour, si bien qu’elles arrivent souvent précipitamment sur le terrain des relations amoureuses en ayant grillé certaines étapes et sans connaître les règles de base du jeu aimant respectueux. On le constate très clairement dans les fictions et dans les faits. « Moi, je ne sais plus dire ces choses-là. » (Charlotte incapable d’assurer un « je t’aime » à Mélodie, dans le film « À trois on y va ! » (2015) de Jérôme Bonnell) ; « Moi, j’ai jamais réussi à être en entier à quelqu’un. » (Charlotte à la fin du film, idem) ; « J’ai des difficultés pour aimer. » (Monique, témoin homosexuelle dans le documentaire « Coming In » (2015) de Marlies Demeulandre) ; « Le problème, c’est que tu n’aimes que toi. » (Adrien s’adressant à Louise, le personnage trans M to F, dans le téléfilm « Louis(e) » (2017) d’Arnaud Mercadier) ; « J’connais beaucoup d’hommes qui ont aimé mon frère, enfin… qui croyaient l’aimer. » (Hall par rapport à son frère homo Arthur, dans le roman Harlem Quartet (1978) de James Baldwin, mis en scène par Élise Vigier en 2018) ; etc.
Par exemple, dans le film « Tableau de famille » (2002) de Ferzan Ozpetek, Antonia répète à trois reprises à Michele, l’amant de son mari, une phrase à laquelle celui-ci ne sait pas quoi répondre tellement elle est juste : « Tu ne sais pas aimer ! » Dans le film « Benjamin » (2018) de Simon Amstell, Benjamin, le héros homosexuel, avoue « son incapacité à aimer ». On retrouve cette idée dans la pièce Une Cigogne pour trois (2008) de Romuald Jankow (« Ça ne durera pas, votre histoire à Paul et à toi, parce que toi, tu ne sais pas aimer. » dit Marie à Sébastien), dans la chanson « La Vie continuera » d’Étienne Daho (« Aimer tu ne sais pas. »), dans la pièce Angels In America (2008) de Tony Kushner (« Tu ne sais pas aimer ! » crie Prior à son amant Louis), dans le film « L’Inconnu du lac » (2012) d’Alain Guiraudie (« Vous avez une drôle de façon de vous aimez. » déclare l’Inspecteur à Franck), dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson (« On s’est mal aimés, toi et moi. » constatent Vincent et Stéphane), dans la pièce Mon Amour (2009) d’Emmanuel Adely (« Tu sais rien de l’amour, toi. » signale Franck à son mec), dans la chanson « Tu ne sais pas aimer » de Damia, dans le film « Un Mariage de rêve » (2009) de Stephan Elliot (« Tu ne sais pas aimer. » déclare Larita à John), dans la pièce Quand mon cœur bat, je veux que tu l’entendes… (2009) d’Alberto Lombardo (« Tu ne m’as jamais aimé. T’es incapable de partager une vraie relation. » dit Arnaud à Mario), dans la pièce Sugar (2014) de Joëlle Fossier (« C’est terrible de s’apercevoir qu’on aime si mal la personne qu’on aime. » déclare Georges, le héros homosexuel faisant son autocritique dans sa relation coûteuse avec William), dans le one-man-show L’Arme de fraternité massive ! (2015) de Pierre Fatus (« Pour l’amour, je ne suis pas diplômé. On m’a pas appris à aimer. »), dans le film « La Belle Saison » (2015) de Catherine Corsini (« T’as pas de cœur, Delphine. » déclare Carole à son amante), dans le film « Plaire, aimer et courir vite » (2018) de Christophe Honoré (« Je sais pas être avec quelqu’un. Je ne sais qu’être seul. »dit Jacques à son amant Arthur), etc. Par exemple, dans le film « Facing Mirrors : Aynehaye Rooberoo » (« Une Femme iranienne », 2014) de Negar Azarbayjani, Adineh l’héroïne transsexuelle F to M déclare à Rana la femme mariée qu’elle n’a jamais aimé : « Ça fait quoi d’aimer quelqu’un ? » Question qui étonne Rana : « Tu n’as jamais été amoureuse. » Et dans la vie réelle, même chose. Il suffit de regarder la majorité des individus homosexuels (ou hétérosexuels) gérer leurs aventures sentimentales pour se rendre compte que, quoi qu’ils en disent, il n’y a pas de place pour un conjoint dans leur vie, et qu’ils ne se sont pas encore assez préparés à l’accueil de l’amour. Ils sont d’ailleurs les premiers étonnés de constater, une fois « casés », que non seulement rien n’a changé à leur insatisfaction d’être et d’aimer, mais qu’ils se sentaient mieux célibataires qu’aussi mal accompagnés. Quand nous voyons la plupart d’entre eux s’amouracher de n’importe qui à n’importe quel moment, pour finir déçus ou détruits les trois-quarts du temps, on a de quoi de penser qu’ils n’ont pas suffisamment compris comment il fallait s’y prendre en amour. Je suis certain qu’ils sauraient aimer de manière plus mûre dans d’autres circonstances et structures conjugales que les couples hétérosexuel et homosexuel : ils aiment mal (ou « moyen ») seulement quand ils s’obstinent à vouloir aimer à travers le modèle du couple fusionnel androgynique et en dehors de la différence des sexes.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.
Code n°58 – Ennemi de la Nature (sous-codes : Corps morcelé / Diable au corps)
Ennemi de la Nature
NOTICE EXPLICATIVE
Quand l’idolâtrie homosexuelle pour la Nature vire à la peur, au mépris et à la destruction de Celle-ci
On entend souvent dire par les détracteurs de l’homosexualité qu’elle serait contre-nature (Bible et experts natalistes à l’appui). « Pas du tout ! » s’insurgent les personnes homosexuelles qui pratiquent leur homosexualité : celles-ci soutiennent que leur désir homosexuel n’est pas un choix, que pour le coup leurs actes homosexuels ne seraient pas non plus totalement choisis, voire même qu’ils seraient très naturels pour elles puisqu’ils ne demanderaient aucun effort, seraient très corporels et procureraient un plaisir immédiat et simple. C’est la raison pour laquelle, dans le code « « Plus que naturel » » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels, j’ai expliqué que, même si en soi les actes homosexuels sont contre-nature (car ils rejettent la différence des sexes qui est le socle de notre Humanité), en intentions et dans l’esprit de la plupart des personnes homosexuelles ils ne le sont pas et leur apparaissent même comme une célébration de la Nature. Car le paradoxe, c’est que les personnes homosexuelles pratiquantes détruisent la Nature, leur corps, l’écologie, au nom de la Nature, de l’idolâtrie des corps (asexués), d’une célébration excessive de l’écologie et des sens corporels.
Nous allons voir dans ce chapitre « Ennemi de la Nature » comment, malgré les bonnes intentions (scientifiques, artistiques, humoristiques, militantes, spirituelles), la grande majorité des personnes homosexuelles détruit concrètement la Nature, les Corps, parce qu’elles En ont peur et Les sentimentalisent. Elles pensent naïvement que la Nature domine l’Homme, le transforme en marionnette, qu’Elle est capable de se tromper, de pleurer, de rire, de réagir comme un humain, d’être « méchante » et « injuste ». Et certaines même se permettent alors de Lui en vouloir comme des amantes jalouses, et de se venger sur elles-mêmes de cette soi-disant « Cruelle Maîtresse » qui n’est que le fruit de leur propre anthropocentrisme individualiste et égocentrique.
N.B. : Je vous renvoie aux codes « Amoureux », « Scatologie », « Obèses anorexiques », « Frankenstein », « Extase », « Médecines parallèles », « Cannibalisme », « Jardins synthétiques », « Bobo », « Homme invisible », « Ville », « « Plus que naturel » », « Clonage », « Maquillage », « Pygmalion », « Se prendre pour Dieu », « Différences physiques », « Se prendre pour le diable », « Passion pour les catastrophes », « Miroir », « Moitié », « Fusion », « Poupées », « Main coupée », « Désir désordonné », « Focalisation sur le péché », « Icare », « Substitut d’identité », « Île », « Eau », « Vent », « Un Petit Poisson Un Petit Oiseau », « Animaux empaillés », « Voyage », à la partie « Couteau » du code « Inversion », à la partie « Règles » du code « Mariée », et à la partie « Tatouage » du code « Homosexualité noire et glorieuse », dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.
FICTION
La Nature cruelle à punir
Dans le discours sentimentaliste et anti-naturaliste des personnages gays friendly ou homosexuels des fictions homo-érotiques, la Nature (biologique, animalement domesticable, minérale, humaine) est remplacée par l’idée de « nature humaine » (pulsionnelle, instinctive, bassement animale, ou carrément rationnalisée, sentimentalisée, homosexualisée, spiritualisée). « Quelle étrange nature, la nature d’un homme… » (cf. une réplique de la pièce Les Oiseaux (2010) d’Alfredo Arias) ; « Pourquoi l’avait-on doté d’une telle nature ? » (la conteuse par rapport à Dorian et à son homosexualité, dans le roman Le Portrait de Dorian Gray (1890) d’Oscar Wilde) ; « Accomplir parfaitement notre nature, voilà notre raison d’être. » (Lord Henry, idem) ; etc. C’est en se rabattant sur la défense de la « nature humaine » que certains personnages homosexuels croient défendre la Nature. Dans leur esprit, la nature-Cosmos poétique, sentimentale, va prévaloir sur la Nature réelle : « La terre me pèse un peu, bien sûr, mais j’aime l’idée de ne plus faire qu’un avec elle, de me fondre en elle, d’être envahi par elle, de m’en retourner en elle. » (Luca, le héros homosexuel du roman Un Garçon d’Italie (2003) de Philippe Besson, p. 61) ; « Les liens de l’esprit ont parfois plus de valeur que les liens du sang. » (Georges, un des héros homosexuels de la pièce Sugar (2014) de Joëlle Fossier) ; « Peu importe mon sexe, il s’agit de liberté ! » (Lou, l’héroïne lesbienne de la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; etc.
Cette nature théorique, rattrapée forcément par la Réalité, finit par rentrer en conflit avec elle-même et avec l’Homme (car l’humain n’est pas pur esprit). « Désaccord entre l’âme et le corps… même si la flamme au cœur brûle encore. » (cf. la chanson « La Vie continuera » d’Étienne Daho) ; « Les liens d’Eros tout-puissant sont-ils plus attachants que les liens du sang ? » (cf. la chanson « Les Liens d’Eros » d’Étienne Daho) ; etc. Et l’Homme qui croit en la vérité de cette fausse nature finit par vivre lui aussi un conflit entre ses pulsions et son propre corps anatomique/le monde naturel extérieur.
« Nature, tu n’es pas naturelle. Tu seras donc mon ennemie ! » Voilà le credo paradoxal du héros homosexuel. Comme la Nature et la Réalité n’obéissent pas à tous ses désirs, il se met à En avoir peur et à Les présenter comme de terribles dangers surnaturels à combattre. Dans de nombreux films, ce sont les éléments naturels qui sont montrés comme responsables de la mort ou des malheurs qui surgissent dans la vie des protagonistes homosexuels : cf. le film « L’Ennemi naturel » (2003) de Pierre-Erwan Guillaume (avec la marée montante), les films « Le Temps qui reste » (2005) et « Action Vérité » (1994) de François Ozon (avec la diabolisation des menstruations féminines), le roman Riches, cruels et fardés (2002) d’Hervé Claude (avec les habitants d’une île qui ne leur fait pas de cadeaux et les tue un par un), le film « The Birds » (« Les Oiseaux », 1963) d’Alfred Hitchcock, le roman Un Garçon d’Italie (2003) de Philippe Besson, le roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa (avec la forêt dévorante), le roman Accointances, connaissances, et mouvances (2010) de Denis-Martin Chabot (avec la mort de Saïd, foudroyé par un éclair), le film « Giorgino » (1994) de Laurent Boutonnat, etc.
Par exemple, dans le roman Le Froid modifie la trajectoire des poissons (2010) de Pierre Szalowski, le grand froid paralyse Montréal. Dans le film « Cloudburst » (2011) de Thom Fitzgerald, les nuages sont vus comme des dangers par Stella et Dotty, le couple de femmes âgées lesbiennes… et plus tard, à cause de la montée des eaux sur l’île qu’elles visitent, Dotty manque de se noyer. Dans le film « The Boys In The Band » (« Les Garçons de la bande », 1970) de William Friedkin, la pluie diluvienne et orageuse qui écourte la soirée LGBT en terrasse oblige les occupants homosexuels de l’appartement d’Harold et Michael à vivre la séance de torture que va être le jeu « Action ou Vérité ». Dans le film « Test : San Francisco 1985 » (2013) de Chris Mason Johnson, Frankie, le héros homosexuel, voit son appartement de San Francisco envahi par les souris. Finalement, il s’accoutume à ces rongeurs qui l’angoissaient, puisqu’il finit par s’acheter une cage et une souris. Dans la pièce Soixante degrés (2016) de Jean Franco et Jérôme Paza, Damien, l’un des héros bisexuels, a roulé en voiture sur un hérisson. Le film « 120 battements par minute » (2017) de Robin Campillo Nathan, avec son amant Arnaud, sont pris dans une tempête de neige et sont rendus invisibles dans leur voiture. Nathan s’est imaginé un accident dans lequel une voiture leur rentrait dedans : « S’il y avait une voiture qui rentrait dans la nôtre, on rencontrerait notre voiture calcinée. » Dans le film « Die Mitter der Welt » (« Moi et mon monde », 2016) de Jakob M Erwa, Phil, le jeune héros homo de retour de colonie de vacances, s’étonne de passer devant une forêt dévastée : « On a eu une tempête de folie. J’avais jamais vu ça. » lui dit Tereza, lesbienne, venue le chercher en voiture. Il ne reconnaît plus le jardin familial : « Y’a eu la Troisième Guerre mondiale dans notre jardin ? » « C’est la tempête. Elle a tout ravagé. » lui répond Glass, sa mère. Dans le film « Vita et Virginia » (2019) de Chanya Button, Virginia Woolf a des hallucinations en lien avec une nature qui l’envahit : ça commence par des visions de lierres qui grimpent partout et envahissent son intérieur ; puis elle est attaqué par un groupe de corbeaux.
« Le courant est en train de m’emporter. […] Je me suis laissé entraîner par la marée. Mon corps s’est fracassé contre les rochers. Depuis, on ne me voit plus. » (Santiago s’adressant à son amant Miguel, dans le film « Contracorriente » (2011) de Javier Fuentes-León) ; « Les animaux me font flipper. » (Johnny, l’un des héros homosexuels dans le film « Children Of God », « Enfants de Dieu » (2011) de Kareem J. Mortimer) ; « Élève-toi avant que les chênes ne t’étouffent. […] Toi, tu n’es qu’un arbre banal. » (Négoce, l’un des héros homosexuels de la pièce Hétéro (2014) de Denis Lachaud) ; « Les nuits sans sommeil se faisaient sentir. Jane avait lu quelque part que c’était la façon dont la nature préparait les mères à ce qui allait suivre. Si c’était vrai, la nature était une garce. » (Jane, l’héroïne lesbienne enceinte, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 42) ; « L’Océan est traître, hein, Doni ? » (un collègue secouriste s’adressant à Donato, le héros homo, dans le film « Praia Do Futuro » (2014) de Karim Aïnouz) ; « La Plage du Futur est une plage dangereuse. » (Donato, idem) ; « L’air est si salé qu’il ronge le béton et le fer. » (Donato s’adressant à son amant Konrad, idem) ; « Le vent est parfois si méchant. » (Suki, l’héroïne lesbienne parlant de son billet envolé et qui lui a fait perdre son train, dans la pièce Gothic Lolitas (2014) de Delphine Thelliez) ; « Je vais t’aimer de plus en plus fort, et c’est toi qui vas m’aimer de moins en moins : c’est la nature. » (Diane, la mère s’adressant à son fils homo Steve, dans le film « Mommy » (2014) de Xavier Dolan) ; « La campagne, franchement, j’en ai rien à foutre. » (Carole, l’héroïne lesbienne du film « La Belle Saison » (2015) de Catherine Corsini) ; « Cette foutue météo ! » (c.f. la chanson « La Femme au milieu » d’Emmanuel Moire) ; « Toute ma vie je me suis sentie coincée dans mon propre corps. » (Morgane, héros transsexuel M to F, dans l’épisode 405 de la série Demain Nous Appartient, diffusé sur TF1 le 21 février 2019) ; etc.
En réalité, le personnage homosexuel ne fait que projeter sur la Nature sa propre méchanceté et ses fantasmes (car objectivement, aucun animal ne tue pour le mal ; les tremblements de terre ne sont pas « méchants » ; et la pluie n’est pas le ciel qui pleure) afin de n’assumer ni son identité profonde (d’homme ou de femme, d’Enfant de Dieu), ni l’existence de Dieu, ni la responsabilité de ses actions : « C’est pas de ta faute, c’est la nature. » (cf. la chanson « Petit Pédé » de Renaud) ; « Nul n’a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Et je précise que c’est bien la Nature qui est seule responsable si je suis un homme oh ! comme ils disent. » (cf. la chanson « Comme ils disent » de Charles Aznavour) ; « De façon ravageuse, la Nature est tueuse. » (cf. la chanson « Fuck Them All » de Mylène Farmer) ; « Notre Mère Nature m’a fait porter un sacré coup… en me faisant naître dans une petite ville de l’Indiana. » (Billy, le narrateur homosexuel du film « Billy’s Hollywood Screen Kiss » (1998) de Tommy O’Haver); « Cette Nature toute de feu et de glace ne pouvait admettre le tiède. » (la voix-off de Jean Cocteau dans le film « Les Enfants terribles » (1949) de Jean-Pierre Melville) ; « La Nature est cruelle. Sébastien l’avait toujours su depuis sa naissance. J’ignorais que nous sommes traqués, tous dévorés par l’avide Création. Je refusais d’affronter cette horrible vérité. Quand soudain, l’été dernier, j’ai appris que Sébastien disait vrai, que ce qu’il m’avait montré aux îles Galápagos était l’horrible, l’inéluctable vérité. » (Mrs Venable parlant de son fils homosexuel, tué par des mains d’hommes – la pègre de ses ex-amants –, dans le film « Suddenly Last Summer », « Soudain l’été dernier » (1960) de Joseph Mankiewicz) ; « Vous ne trouvez pas que la Nature fait penser à la mort ? » (Marianne dans le film « L’Arbre et la Forêt » (2010) d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau) ; « Mon corps, il m’a trahie. » (Hadda dans le roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, p. 197) ; « La Nature est injuste ! La Beauté est injuste ! Et bien le corps aussi ! » (cf. une réplique de la pièce Les Gens moches ne le font pas exprès (2011) de Jérémy Patinier) ; « Je suis une femme coincée dans un corps d’homme. » (Mia, le héros transsexuel M to F de la série Hit & Miss (2012) d’Hettie McDonald) ; « À l’avenir, je me violerai sur un tapis dans le pré. » (Anthony, l’un des héros homosexuels du roman At Swim, Two Boys, Deux garçons, la mer (2001) de Jamie O’Neill) ; « Parfois, il arrive que la nature joue un mauvais tour à un homme. » (Joe travesti en Joséphine et s’adressant à Alouette, dans le film « Certains l’aiment chaud » (1959) de Billy Wilder) ; etc.
Par exemple, dans le film « La Robe du soir » (2010) de Myriam Aziza, Juliette, l’héroïne lesbienne, a du mal à accepter son corps : elle ne veut pas aller se baigner, enlever son survêtement quand il fait chaud, etc. Dans le film « Corpo Giusto » (2010) de Jennifer Norton, Antonia est une jeune femme qui croit qu’elle est née dans le mauvais corps.
Le corps sexué est considéré comme un dieu diabolique, et comme une « erreur », une poupée à détruire, à transformer, à reconstruire à sa guise, à déformer, à nier parce qu’il est vivant et bien plus noble que le corps animal : cf. le roman Le Diable au corps (1923) de Raymond Radiguet, la pièce The Dog Beneath The Skin (1935) de Wystan Hugh Auden et Christopher Isherwood, le roman Le petit galopin de nos corps (1977) d’Yves Navarre, le roman Mon corps ce doux démon (1958) de Pierre de Massot, le film « Mysterious Skin » (2004) de Gregg Araki, la chanson « Sans logique » de Mylène Farmer, la chanson « Mon Démon » du Teenager dans la comédie musicale La Légende de Jimmy de Michel Berger, le film « La Chair et le Diable » (1927) de Clarence Brown, le film « Odio Mi Cuerpo » (1975) de Leon Klimovsky, le film « Stranger Inside » (2001) de Cheryl Dunye, le film « Corps perdus » (2012) de Lukas Dhont, etc.
« J’suis mal dans ma peau. » (cf. la chanson « S.O.S. d’un terrien en détresse » de Johnny Rockfort dans l’opéra-rock Starmania de Michel Berger) ; « Le corps est le pire des traîtres. » (la narratrice lesbienne du roman La Voyeuse interdite (1991) de Nina Bouraoui, p. 61) ; « ‘Pourquoi ce corps ? se demandait M. Fruges. Pourquoi l’esprit est-il lié à une chair d’où lui viennent toutes ces convoitises ?’ » (Julien Green, Si j’étais vous (1947), p. 138) ; « Ce pauvre corps dans lequel je me suis tellement ennuyé… » (Fabien, idem, p. 83) ; « Le soleil dort encore, j’ai le diable au corps, la nuit me jette un sort. » (cf. la chanson « Le Diable au corps » de Clara Morgane) ; « Le diable s’est incarné. Il a pris corps en vrai. » (Vincent Byrd Le Sage dans son one-man-show Le Maître des ténèbres : confession d’un ange déçu, 2003) ; « Mourad a le démon de la réussite et le diable au corps. » (Christophe Bigot, L’Hystéricon (2010), p. 23) ; « C’est maman qui avait raison : t’as vraiment le diable au corps. » (Sandrine s’adressant à son petit frère Julien, dans la série Joséphine Ange-gardien (1999) de Nicolas Cuche, l’épisode 8, « Une Famille pour Noël ») ; « J’ai vraiment un corps de base. Si j’étais une voiture, je serais sans option. Mon père m’a eue en soldes. C’est un radin. » (Shirley Souagnon dans son concert Free : The One Woman Funky Show, 2014) ; « Maintenant, mon corps me dit : ‘Fais ta vie. Je fais la mienne.’ » ; « J’ai peur quand on me touche. » (Juna, l’une des héroïnes lesbiennes de la pièce Gothic Lolitas (2014) de Delphine Thelliez) ; « Jane se vit vomir un petit diable dans l’allée centrale, l’horrible créature se tortillant, impuissante, sur les dalles de pierre. » (Jane l’héroïne lesbienne à l’église, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 199) ; « Je suis arrivé au Mexique encore vierge. Je repars en Russie débauché. Mon corps est un étranger. » (la figure de Sergueï Eisenstein, homosexuel, dans le film « Que Viva Eisenstein ! » (2015) de Peter Greenaway) ; etc. Par exemple, dans la comédie musicale Les Divas de l’obscur (2011) de Stéphane Druet, Mercedes, la nymphomane, déclare qu’elle a le diable au corps. Dans la chanson « Burning Dancefloor » de Cassandre, il est question du diable au corps.
On retrouve assez fréquemment le symbole du corps humain morcelé, écartelé ou violé dans les fictions homo-érotiques : cf. le film « Strangers On A Train » (« L’Inconnu du Nord-Express », 1951) d’Alfred Hitchcock, le film « My Own Private Idaho » (1991) de Gus Van Sant, les œuvres de Yan Zhichao, La pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi (avec Fifi, le travesti M to F qui se fait couper une oreille, puis l’autre), le film « Cruising » (« La Chasse », 1980) de William Friedkin (avec des types découpés en dix morceaux), le one-man-show Raphaël Beaumont vous invite à ses funérailles (2011) de Raphaël Beaumont (avec Sofia, la femme-tronc), la chanson « La Femme coupée en morceaux » de la comédie musicale « Les Demoiselles de Rochefort » (1967) de Jacques Demy, la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi (avec le corps du bébé Katia « presque décomposé », en putréfaction), le film « Corps à corps » (2009) de Julien Ralanto, la pièce musicale Arthur Rimbaud ne s’était pas trompée (2008) de Bruno Bisaro, la pièce String Paradise (2008) de Patrick Hernandez et Marie-Laetitia Bettencourt, le film « Queens » (2012) de Catherine Corringer, la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1985) de Copi (avec la femme de ménage bardée de prothèses), la nouvelle « Les Garçons Danaïdes » (2010) d’Essobal Lenoir (avec le corps tranché de Pascal), le concert Le Cirque des mirages (2009) de Yanowski et Fred Parker, le film « Les Corps ouverts » (1998) de Sébastien Lifskitz, le roman Le Corps des anges (2005) de Mathieu Riboulet, le film « Smooth » (2009) de Catherine Corringer (avec le corps pâte à modeler), le film « Corps inflammables » (1995) de Jacques Maillot, le film « Métamorphoses » (2014) de Christophe Honoré, etc. Par exemple, la pièce En panne d’excuses (2014) de Jonathan Dos Santos commence par un flash-info radiophonique annonçant qu’une jeune femme de 25 ans a été retrouvée morte dans un champ de colza, découpée en morceaux par le « Tueur à la Hache ».
Le corps sexué est rendu immatériel, est annulé par la métaphore poétique, spirituelle, sensuelle, métaphorique, érotisée (cf. je vous renvoie au code « Extase » dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels) : « Du bout des doigts je lis l’amour en braille. Ton épiderme me fait sa déclaration. » (le Comédien, dans la pièce Les Hommes aussi parlent d’amour (2011) de Jérémy Patinier, p. 57) ; « Le corps de Pierre, le cul de Pierre, la queue de Pierre. Il faudrait désormais aussi compter avec le cœur de Pierre. » (le narrateur homosexuel de la nouvelle « Cœur de Pierre » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 54) ; « Mon corps est moins pur que mon âme, je le disperse et je l’offre. » (Max Jacob dans le film « Monsieur Max » (2007) de Gabriel Aghion) ; « Je suis un pur esprit. […] Je ne veux pas ré-intégrer mon corps : c’est trop barbant ! » (la figure d’Érik Satie dans la pièce musicale Érik Satie… Qui aime bien Satie bien (2009) de Brigitte Bladou) ; « L’électricité a envahi mon corps. J’ai joui ! » (Nathalie Rhéa parlant de sa rencontre avec Tatiana, dans son one-woman-show Wonderfolle Show, 2012) ; « Que laisserons-nous de nous, moitié anges moitié loups, quand nos corps seront dissous dans la langueur monotone du premier frisson d’automne ? » (Luca dans le spectacle musical Luca, l’évangile d’un homo (2013) d’Alexandre Vallès) ; « Finalement, ils se sont rendus compte qu’elle n’était pas fracturée. » (Joséphine s’adressant au téléphone à Alain Richepin, le rassurant sur l’état de sa fille lesbienne Romane qui n’est pas accidentée, dans l’épisode 68 « Restons zen ! » (2013-2014) de la série Joséphine Ange gardien) ; etc.
Le corps morcelé apparaît particulièrement chez des auteurs homosexuels tels que Copi, et plus largement ceux qui ont confondu le corps avec une marionnette, ou bien la Nature avec l’image fantasmée qu’ils s’En sont faite : « Mais vous êtes en lambeaux ! Venez que je vous ramasse ! Je vous recouds, Linda ! Vous êtes pas belle à voir ! […] Linda, j’explose ! Oh merde, il faut que je me ramasse toute seule ! Ça va être du joli pour recoller tous ces doigts ! Il y a des cheveux collés sur tous les murs ! […] Sans compter que c’est pas facile à scier des hommes aussi grands ! » (Loretta Strong, l’héroïne transgenre M to F, s’adressant à Linda, dans la pièce Loretta Strong (1978) de Copi) ; « Michael et moi nous récupérons les petits corps : Pigg n’a plus de bras, à Moonie lui manque la moitié de la poitrine, Rooney a la figure déchiquetée, nous récupérons aussi la tête de la louve qui flotte près de la plage et ma jambe en métal qui est ramenée par la mer. » (le narrateur homosexuel du roman Le Bal des folles (1977) de Copi, p. 104) ; « Vous pouvez déjà me donner la queue et les cornes. Et les oreilles. En plus elle n’a besoin que d’un œil. » (le Jésuite s’adressant au Rat en parlant de la vache, dans la pièce La Pyramide ! (1975) de Copi) ; « Cachafaz chéri, mon trésor, si tu permets, je vais dehors découper le flic en rondelles. » (Raulito s’adressant à son amant Cachafaz, dans la pièce Cachafaz (1993) de Copi) ; « Son corps en désordre. » (cf. la description d’Arlette dans le roman La Vie est un tango (1979) de Copi, p. 151) ; « Christian vit se confondre devant ses yeux Jacqueline, en tenue sportive, et Linda Davis, habillée en peau de léopard, qui s’acharnaient à coups de canifs sur son visage ; elle lui coupèrent les oreilles, le nez et les lèvres avant de lui arracher la langue et de lui crever les yeux. » (le narrateur homosexuel de la nouvelle « La Césarienne » (1983) de Copi, p. 73) ; « Oh merde, ils m’ont déchiré le bras. » (Maria parlant des chiens, dans la pièce Les Quatre Jumelles (1973) de Copi) ; « J’y prends le rasoir jetable de Marcel et dans le cagibi à bricolage, d’un coup de marteau le brise en miettes contondantes ; du plus gros bout de lame récupéré je me taillade le visage aussi profondément que je peux, ne m’épargnant pas lèvres et paupières, et retourne tout sanguinolent me coucher sur le ventre, la tête dans mon oreiller buvardant larmes et sang. » (Vincent Garbo, le héros homosexuel du roman Vincent Garbo (2010) de Quentin Lamotta, p. 59) ; « Esti [l’un des héroïnes lesbiennes] s’était entaillé le genou. Elle n’arrêtait pas de se faire mal partout ; il lui était pratiquement impossible de sortir indemne d’une heure de gymnastique ou de traverser la cour sans tomber. Ses genoux et les articulations de ses doigts étaient en permanence constellés d’égratignures : fraîches, à demi cicatrisées, anciennes. » (Naomi Alderman, La Désobéissance (2006), p. 214) ; « Vous rêviez toutes de cet homme, et vous l’avez écartelé. » (Magdalena parlant du Prince au corps morcelé, dans la comédie musicale Les Divas de l’obscur (2011) de Stéphane Druet) ; etc. Par exemple, dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta, Daniel, l’un des héros homosexuel, donne sa définition personnelle du verbe « vivre » : « Le sourire aux lèvres, continuer à vivre en pièces détachées. »
Le corps morcelé, à mon sens, est une esthétisation éclatée d’un viol réellement vécu par le héros homosexuel, ou au moins du fantasme de viol (= peur de la sexualité) qu’est le désir homosexuel. « Elle est rentrée en moi. J’ai cru que j’allais exploser. » (Irène après sa première relation lesbienne, dans la pièce Ma première fois (2012) de Ken Davenport)
Au fond, le personnage homosexuel pratiquant méprise le corps humain parce qu’il cède trop souvent à ses pulsions sensuelles et érotiques qui lui retirent la noblesse, la beauté et le caractère sacré de ce dernier, parce qu’il a peur de la (découverte de sa) sexualité. Ce qu’il abhorre dans le corps, c’est uniquement le mauvais usage de ses instincts corporels : « Je comprends pas mon corps. Le plaisir qu’il trouve, et qu’il prend, à savoir les yeux d’Irène dans un coin du miroir. Sa volonté de se soumettre aussi vite à la nécessité qui l’oblige. Ce que sa main droite est en train de faire sous le drap bleu, qui me donne la honte rouge. » (le narrateur du roman Le Crabaudeur (2000) de Quentin Lamotta, p. 86) ; « J’ai l’impression d’être prisonnier de mon corps, de n’avoir aucun contrôle sur les choses. » (Chris, l’un des héros homosexuels du roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 173) ; « Je pense que je suis plus de la bouche et du nez que du corps entier. » (Alexandra, la narratrice lesbienne libertine du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 72) ; « Ma mauvaise nature m’avait appris que mon plaisir était plus grand quand il était pris sans prudence, à l’instant où il se présentait. Voilà maintenant que je pensais contre la réalité, m’imaginant comme une femme qui vivrait avec une autre femme, dans, si j’ose dire, la sécurité d’un couple. J’étais toujours impressionnée par ce rêve que j’avais fait et qui se passait en Grèce, où des femmes ensemble s’adonnaient sans retenue à tous les excès. […] [Une idée m’obsédait :] assouvir cette faim que j’avais du féminin. D’autant que je prenais conscience que seul le corps, chez les femmes, m’intéressait. Je ne me sentais pas capable d’aimer vraiment. Mon désir se manifestait dès que le corps d’une autre me paraissait accessible, me souciant seulement du plaisir que j’en espérais. On ne peut pas appeler cela de l’amour. En société, j’imaginais les femmes qui m’entouraient déshabillées et offertes, et très vite, dans un état presque halluciné, je leur prêtais des postures ou des situations que je n’ose décrire, même dans mon carnet… Ma cruauté, dans ces instants, me préparait à l’idée qu’un jour je n’aurais plus vraiment de limite et que mon « vice » m’avalerait entièrement. Je combinais et raisonnais de plus en plus en fonction de lui, sentant bien que, quand j’étais dans ces étranges dispositions, en crise, comme on dirait, c’était lui qui déterminait tout ce que je pensais et faisais. J’avais imaginé un moment demander à la petite voisine de passer me voir afin de faire ensemble ce que je l’avais obligée à faire seule devant moi, sachant combien j’aimais à outrepasser la pudeur des autres, pour le plaisir que son viol me donnait. Cette envie ne me quittait pas, mais je devais résister, c’était trop risqué. […] J’avais peur de moi. Quand je sentais monter ce besoin de chair, peu m’importaient les moyens et la figure de celle qui me donnerait ce qu’il me fallait. […] Je voulais ma nuit avec une femme, comme l’on veut sa naissance. » (idem, pp. 56-57) ; etc.
Comme le héros homosexuel ne veut pas assumer la gravité des actes homosexuels qu’il pose, il va chercher à détruire la Nature et le corps sexué des humains (à commencer par le sien). « À bas la Nature ! Vive l’art ! » (Michel Blanc en Mr Mosc, dans le film « Musée haut, Musée bas » (2007) de Jean-Michel Ribes) ; « Ce soir-là, elle se contempla dans la glace et, se détaillant, elle détesta son corps avec ses épaules musclées, ses petits seins fermes et ses minces hanches d’athlète. Elle devait toute sa vie traîner ce corps comme une entrave monstrueuse imposée à son esprit […]. Elle eût voulu le mutiler […]. » (Stephen, l’héroïne lesbienne du roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 246) ; etc. Par exemple, dans le roman Portrait de Julien devant la fenêtre (1979) d’Yves Navarre, Julien Brévaille, l’un des héros homosexuels, détruit la Nature par le feu puisqu’il est pyromane. Dans le film « Tu n’aimeras point » (2009) de Haim Tabakman, Ezri et Aaron, les amants homos, travaillent dans une boucherie.
Pour appliquer un vernis efficace de déni et de mauvaise foi sur sa haine et sa destruction effectives de la Nature, le personnage homosexuel a tendance à se réfugier dans la caricature des naturalistes (ou essentialistes) qui lui tendent un miroir relativement justifié de ses pratiques. Cette caricature consiste à imiter des fondamentalistes religieux, des parents familialistes traditionnalistes hétérosexistes, des savants natalistes rapidement scientifiques qui répètent à tue-tête « contre-nature, contre-nature, contre-nature », sans jamais leur permettre de parler d’Amour ni d’expliciter ce qu’ils mettent derrière le mot « Nature »… pour ensuite leur couper radicalement la chique en leur soutenant qu’ils sont réactionnaires, que la pratique homosexuelle est beaucoup plus naturelle que la pratique hétérosexuelle ou que la pratique religieuse, et que ce qui est vraiment « contre-nature » c’est de s’opposer à « l’homosexualité-identité » ou « l’homosexualité-amour » : « Vivre avec une femme n’est pas une chose facile, voire contre-nature. » (Alexeï Kalachnikov dans la pièce Tante Olga (2008) de Michel Heim) ; « Cette fête est contre-nature… mais je vais rendre les choses un peu moins gaies/gays, si tu vois ce que je veux dire… » (Lauren, la peste hétérosexuelle traditionnaliste s’adressant à Shane le héros homosexuel, dans la série Faking It (2014) de Dana Min Goodman et Julia Wolov, cf. l’épisode 1 « Couple d’amies » de la saison 1) ; « En vérité, si la nature ne l’avait pas mise au défi, elle aurait très bien pu devenir semblable à eux : engendrer des enfants […]. » (Stephen, l’héroïne lesbienne du roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 143) ; etc.
FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION
PARFOIS RÉALITÉ
La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :
La Nature cruelle à punir
À l’heure actuelle, dans le discours sentimentaliste et anti-naturaliste des personnes gays friendly ou homosexuelles pratiquantes, la Nature (biologique, minérale, animale, humaine) est remplacée par l’idée de « nature humaine » (pulsionnelle, instinctive, bassement animale, ou carrément rationnalisée, sentimentalisée, homosexualisée) : « It’s human nature » chante par exemple George Michael dans sa chanson « Outside » pour justifier son homosexualité et son attentat à la pudeur dans les toilettes publiques d’un parc de Beverly Hills en 1998. C’est en se rabattant sur la défense de la nature humaine (nature qui se dit en des termes très libéraux et libertaires) que certaines personnes homosexuelles croient défendre la vraie Nature. « Oui, il faut oser le dire, il faut oser l’écrire : l’immense majorité des homophiles accordent au seul corps – à ses apparences, à ses exigences – une importance qu’il ne mérite pas, une importance beaucoup trop grande, une importance sans commune mesure avec ce qu’il peut être, ce qu’il peut offrir et donner, aujourd’hui déjà, à plus forte raison demain. » (André Baudry, fondateur d’Arcadie, cité dans l’autobiographie Libre : De la honte à la lumière (2011) de Jean-Michel Dunand, p. 147) ; « La Nature. Je crois que j’étais vraiment faite pour ça ! » (Catherine, une des témoins homosexuels du documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz) ; etc. L’idolâtrie naturaliste bisexuelle transparaît dans la chanson « Tous les droits sont dans la nature » de Catherine Ribeiro par exemple.
Dans son autobiographie Mauvais Genre (2009), la romancière lesbienne Paula Dumont démontre qu’elle confond sexuation homme/femme et images sociales et culturelles attribuées à la sexuation (réalités beaucoup plus aléatoires et subjectives). Elle parle par exemple de la « symbolisation du sexe de la femme » (p. 54) et non du sexe de la femme. La prévalence pour l’apparence sexuée au détriment de la réalité de la sexuation est induite dans son discours : « Tout en sachant que je suis une femme, je dois impérativement me donner l’apparence d’un homme. » (p. 65) ; « Je me devais d’être la plus virile possible pour être conforme à ma nature profonde. » (p. 81) ; « L’an dernier encore, je justifiais mon genre et mon homosexualité en me bornant à déclarer que tous deux faisaient intrinsèquement partie de moi, que les nier serait me nier moi-même. […] J’ai tenu ce raisonnement tout au long de mon existence. » (p. 113)
Le travestissement bien-intentionné (la destruction en réalité) de la Nature ne concerne pas que l’identité sexuée. Il touche malheureusement aussi la procréation (les enfants + les parents). Par exemple, lors de sa conférence « L’homoparentalité aux USA » à Sciences-Po Paris le 7 décembre 2011, l’avocat nord-américain Darren Rosenblum, qui avec son copain a acheté « leur » petite fille (Mélina) à une mère porteuse (Gestation Pour Autrui), a adopté une discours très poétique et en apparences « positif », quand bien même celui-ci se caractérisait par un fort anti-naturalisme : en effet, concrètement, Rosenblum cachait l’identité du véritable père biologique de Mélina à l’assistance (« Un de nous est le père biologique de Mélina. On ne voulait pas savoir qui était le père biologique. On sait maintenant qui est le père biologique, mais on garde le secret. ») ; il ne faisait de l’identité de mère ou de père qu’une affaire de « rôles » indéfinissable tellement ils seraient étendus (« Le sens des termes ‘père’ et ‘mère’, je pense, va fondre. » ; « Il y a un potentiel de jeux de rôles qui se développe dans les familles homoparentales. ») ; il travestissait la Nature en réalité subjective et relative à la culture mouvante de chaque individu humain (« Je soutiens une interprétation de la biologie. » ; « Je trouve que ces rôles de père ou de mère ne sont pas essentiels. Si dans une famille un homme veut être la mère, il doit pouvoir le faire. » ; « La parentalité, chez nous aux États-Unis, c’est aussi quelque chose de culturel. ») ; il proposait une « philosophie de genres » ; il recherchait une « parentalité androgyne » et parlait de « désexuer la parentalité ». Bref, en clair, il visait à artificialiser la Nature au nom de Celle-ci.
Dans l’esprit des défenseurs du Gender, du Queer et du Camp (tous ces courants « intellectuels », « artistiques », « philosophiques » prônant l’indifférenciation des sexes, et donc une nature bisexualisée, animalisée, angéliste, déshumanisée), dans la tête des promoteurs de la suprématie des sensations amoureuses, la Nature-Cosmos poétique, sentimentalisée, va prévaloir sur la Nature réelle. « Il faut en finir avec la filiation biologique. » (Erwann Binet, député PS et rapporteur de la loi Taubira) ; « Vous ne croyez pas que l’Amour est plus important que la biologie ? » (Jean-Marc Morandini en conclusion de son interview à Albéric Dumont, sur la radio Europe 1 à propos de la GPA et de la PMA, le 16 septembre 2014) ; « Quel est le bénéfice d’imposer un sexe précis à un enfant ? » (le sociologue Sébastien Carpentier lors de sa conférence au Centre LGBT de Paris, à l’occasion de la sortie de son essai Délinquance juvénile et discrimination sexuelle, en janvier 2012) ; etc. Je vous renvoie notamment au documentaire « Naître ni fille ni garçon » (2010) de Pierre Combroux, à l’idéologie pro-choix de Caroline Fourest, aux pressions actuelles au niveau du Parlement Européen pour inscrire l’intersexuation et la trans-identité dans le droit et en tant qu’inexistence de la différence des sexes (inexistence qui est un mensonge, car même les personnes qui naissent intersexuées, ou qui se sentent femme dans un corps d’homme, ou homme dans un corps de femme, restent sexuées).
Comme l’écrit parfaitement François Cusset dans son essai Queer Critics (2002), la pensée queer consiste « à ne désexualiser les organes que pour faire du vaste monde une zone érogène ». C’est une idéologie ultra-sensorielle planante qui paradoxalement ne tient pas compte des corps sexués réels : on y observe « une sorte de totalisation du sexe au détriment de ses parties, un animisme du corps aux dépens de ses organes et de leurs fonctions » (p. 143).
La nature théorique construite mentalement par les personnes homosexuelles pratiquantes, rattrapée forcément par la Réalité, finit par rentrer en conflit avec elle-même et avec l’Homme (car l’humain n’est pas pur esprit). Et l’Homme qui croit en la vérité de cette fausse nature finit par vivre lui aussi un conflit entre ses pulsions-sentiments et son propre corps anatomique/le monde naturel extérieur : « L’homme est en discontinuité avec la nature, et tout ce qui vient de lui est original. » (la philosophe lesbienne Geneviève Pastre, citée dans la revue Triangul’Ère 1 (1999) de Christophe Gendron, p. 75) ; « La position de Judith Butler a connu un immense succès dans les milieux gays et lesbiens car elle légitimait la dissociation entre le corps et le choix d’un comportement sexuel. » (Élizabeth Montfort, Le Genre démasqué (2011), p. 24) ; etc.
Comme notre nature humaine n’est belle, paisible et féconde qu’en s’accordant avec la Nature écologique, environnante et environnementale (puisque tous nos désirs ne sont pas des réalités. Et heureusement ! Les autres existent aussi), un certain nombre de personnes homosexuelles vont, parfois très tôt dans leur jeunesse, nourrir une forme d’amertume voire de plan de vengeance contre la Nature, et notamment la Nature ordonnée que sont la société et l’Église. « Nature, tu n’es pas naturelle. Tu seras donc mon ennemie ! » Voilà le credo paradoxal de beaucoup d’entre elles. Dans leurs discours, ce sont les éléments naturels qui sont montrés comme responsables de la mort ou des malheurs qui surgissent dans leur vie : « Silencieusement, sa nature humaine semble faire horreur à Virginia Woolf. » (cf. l’article « L’Angoisse d’être vivante » de Chantal Chawaf, dans le Magazine littéraire, n°275, mars 1990, p. 45) ; « Je ne suis pas née dans le bon corps et j’ai toujours su que j’étais une femme. Je n’étais pas dans le bon corps. J’étais jalouse des filles. » (Kellie Maloney, homme transsexuel M to F, ex-manager de Lennox Lewis) ; « Ce n’est pas notre faute, si la nature se trompe parfois. » (une des trois tantes gays friendly d’Alfredo Arias, dans l’autobiographie de ce dernier, Folies-Fantômes (1997), p. 114) ; « Le Camp est fondamentalement ennemi du naturel, porté vers l’artifice et vers l’exagération. » (cf. l’article « Le Style Camp » de Susan Sontag, L’Œuvre parle (1968), p. 421) ; « Mais ce qui est sans pitié pour les homosexuels, c’est la nature, Jean, la loi de l’espèce, la terrible réalité de ce qui est. La charité de Dieu, qui est surnaturelle, fait place, elle, à ceux qui portent ce fardeau. » (cf. une lettre de Jacques Maritain adressée à Jean Cocteau, à Paris en 1983) ; « Je regarde les hommes mais je n’ai pas l’impression que c’est leur corps qui m’attirent mais leur énergie. Je ne me reconnais pas en tant qu’homme, comme si je ne savais pas qui j’étais, comme s’il y a un problème d’incarnation en homme, comme si le fait de regarder des hommes hétéros ou homos, m’a poussé vers l’homosexualité pour connaître à quoi ressemble un homme intérieurement dans sa chair, comme si j’avais pas intégré mon propre corps. » (cf. le mail d’un ami homo, Pierre-Adrien, 30 ans, reçu en juin 2014) ; etc. Par exemple, dans le docu-fiction « Le Dos rouge » (2015) d’Antoine Barraud, Bertrand Bonello scrute dans son miroir la tache rouge inquiétante grossissant dans son dos.
En réalité, les personnes homosexuelles ne font que projeter sur la Nature leur propre méchanceté et leurs fantasmes égocentrés (car objectivement, aucun animal ne tue pour le mal ; les tremblements de terre ne sont pas « méchants » ; et la pluie n’est pas le ciel qui pleure) afin de n’assumer ni leur identité profonde (d’homme ou de femme, d’Enfants de Dieu), ni l’existence de Dieu, ni la responsabilité de leurs actions : cf. le documentaire « Crimes Against Nature » (1977) d’Edward Dundas. « Du plus loin qu’il se rappelle, la Nature était contre lui. » (Jean-Paul Sartre se référant à Jean Genet, dans la biographie Saint Genet, comédien et martyr (1952), p. 16) ; « C’est à propos de mon sentiment en face de la Nature que je parle d’espionnage. » (Jean Genet, Journal du voleur (1949), p. 55) ; etc. Elles parlent de la nécessité de « s’affranchir de l’esclavage corporel » (cf. l’article « Procréation Médicalement Assistée » de Marcela Iacub, dans le Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, p. 380)
Le corps sexué est considéré par les personnes homosexuelles pratiquantes comme un dieu diabolique, comme une « erreur », une poupée à détruire, à transformer, à reconstruire à sa guise, à déformer, à nier parce qu’il est vivant et bien plus noble que le corps animal : « Mon seul problème a été l’erreur de la Nature quand elle m’a donné les organes génitaux masculins. » (Humberto Capelli, homme transsexuel M to F, cité dans l’essai El Látigo Y La Pluma (2004) de Fernando Olmeda, p. 250) ; « Dès que je me déshabille, une érection immédiate s’empare de mon sexe sans que je puisse faire quoi que ce soit pour l’éviter. […] Je ne maîtrise absolument rien. Je pourrai comparer ça à un démon qui vient habiter le corps d’un être humain. Comme dans ‘L’Exorciste’. Chez moi, c’est la même chose. » (Alexandre Delmar, Prélude à une vie heureuse (2004), p. 30) ; « Je ressens une forte envie d’aller vers la demoiselle, envie immédiatement annihilée par une force obscure qui me souffle dans le creux de l’oreille que ce n’est pas ce que je veux vraiment. » (idem, p. 52) ; « Je sentais chaque centimètre de mon corps me distendre et m’étirer. Indéfiniment. De me sentir possédé, je me mis à pleurer. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 69) ; « Pendant que mon cousin prenait possession de mon corps, Bruno faisait de même avec Fabien, à quelques centimètres de nous. Je sentais l’odeur des corps nus et j’aurais voulu rendre palpable cette odeur, pouvoir la manger pour la rendre plus réelle. J’aurais voulu qu’elle soit un poison qui m’aurait enivré et fait disparaître, avec comme ultime souvenir celui de l’odeur de ces corps […]. » (Eddy Bellegueule simulant des films pornos avec ses cousins dans un hangar, dans le roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, p. 153) ; « Mon père s’est tourné vers moi, il m’a interpellé ‘Alors Steevy, ça va, c’était bien l’école ?’ Titi et Dédé se sont esclaffés, un véritable fou rire : les larmes qui coulent, le corps qui se tord, comme soudainement possédé par le démon, la difficulté à reprendre sa respiration. » (idem, pp. 116-117) ; « Ednar ne vivait que pour survivre. Il avait tant morflé dans sa jeunesse, qu’il avait fini par se détester lui-même car il ne s’était jamais senti réellement bien dans sa peau. » (Jean-Claude Janvier-Modeste, dans son autobiographie Un Fils différent (2011), p. 141) ; etc.
Par exemple, Raúl Gómez Jattin, le poète colombien, dit qu’il est « fatigué de vivre dans ce corps immonde » (Raúl Gómez Jattin cité sur le site Isla de la Ternura, consulté en janvier 2003). Dans le documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz, Christian, l’un des témoins homos, quinquagénaire, se rappelle son appréhension maladive pour les cours de sport et les douches collectives : « C’est extrêmement difficile à vivre. J’osais à peine regarder les autres. Quand c’était intime, j’étais dans le malaise. » Dans le film biographique « Girl » (2018) de Lukas Dhont, Lara/Victor, garçon trans M to F de 16 ans, « affaiblit son corps » en se droguant, en ne mangeant plus et ne dormant plus (les médecins qui le suivent disent : « Lara ne mange pas et ne dort pas assez. »), en faisant de la danse classique à un rythme effréné. À la fin du film, il tente même de se couper le sexe aux ciseaux.
Au fond, les personnes homosexuelles pratiquantes méprisent le corps humain parce qu’elles cèdent trop souvent à leurs pulsions sensuelles et érotiques qui lui retirent sa noblesse, sa beauté et son caractère sacré, parce qu’elles ont peur de la (découverte de leur) sexualité. Ce qu’elles abhorrent dans le corps, c’est uniquement le mauvais usage de leurs instincts corporels : « L’ultime trahison de mon corps eut lieu une nuit où je me rendais en discothèque avec quelques ‘copains’. » (Eddy Bellegueule dans le roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, p. 175)
On retrouve assez fréquemment le symbole du corps humain morcelé ou écartelé dans les mots des personnes homosexuelles. Dans son essai Le Premier Sexe (2006), Éric Zemmour décrit à juste raison la tendance des créateurs et couturiers homosexuels à disséquer la différence des sexes, hommes et femmes confondus, à « découper la femme en morceaux, en bouts de désir et de fantasmes, les cheveux, les seins, la bouche, le cul, les hanches, les jambes, les chevilles, tout et n’importe quoi, mais surtout pas la femme entière » (p. 59). Et les personnes transgenres (et transsexuelles si elles se font malheureusement opérer) n’hésitent pas à user de la technique scientifique, de l’argent et du bistouri, pour détruire, mutiler leur corps afin qu’il se conforme à comment elles le « ressentent ». « Pour survivre, il fallait que je sois plus fort que le corps. » (la femme transsexuelle F to M, dans le documentaire « Le Genre qui doute » (2011) de Julie Carlier) Dans l’émission Aventures de la médecine spéciale « Sexualité et Médecine » de Michel Cymes diffusée sur la chaîne France 2 le 16 octobre 2018, Léonie, homme transsexuel M to F de 29 ans, en veut à son corps : « Je ne peux pas me sentir à l’aise avec ce corps. » Dans le documentaire « Ni d’Ève ni d’Adam : une histoire intersexe » de Floriane Devigne diffusé dans l’émission Infrarouge sur la chaîne France 2 le 16 octobre 2018, une des témoins intersexes qui se fait appeler « M dit qu’elle « n’aimait pas mon corps » : « Je rêve parfois que je n’ai plus ni hanches, ni fesses, ni jambes. Ma folie ne va pas jusque-là. »
Comme rares sont les individus homosexuels qui veulent assumer la gravité des actes homosexuels qu’ils posent, ils vont chercher à détruire la Nature et le corps sexué des humains (à commencer par le leur). « La loi naturelle est fasciste. » (Caroline Fourest, citée par Erwan Le Morhedec) Par exemple, dans le roman L’Increvable Monsieur Schneck (2006) de Colombe Schneck, l’auteur découvre un après-midi d’ennui (dans Paris-Match) que son grand-père s’est fait coupé en morceaux et mettre dans une malle par son amant… et ce fait divers est basé sur une histoire vraie.
Quand ils ne s’attaquent pas tellement aux corps par les opérations chirurgicales, le maquillage et les crèmes, le sadomasochisme, les tentatives de suicide, les tatouages (ce qui arrive quand même souvent), ils annulent souvent le corps sexué par la métaphore poétique, spirituelle, sensuelle, érotisée, dénégatrice, qui ne respecte pas l’indivisibilité du corps et de l’esprit, et qui rend l’être humain immatériel. Par exemple, l’intellectuelle lesbienne Monique Wittig a soutenu, lors d’une conférence, qu’elle n’avait pas de vagin.
L’idéologie du Genre (qui confond systématiquement « corps sexué » et « image médiatique des corps sexués ») est la parade jargonnante que les intellectuels LGBT ont trouvée depuis les années 1960 pour mépriser le corps humain sans que cela se voie… parce qu’elle se dit en termes artistiques, amoureux, sensoriels, politisés, optimistes (« Mon corps est une construction sociale et culturelle. Je n’ai pas de sexe. Je n’ai que des genres soumis à mes choix et à ma subjectivité du moment, des genres qui ne peuvent être définis et interprétés. »). Mais dans les faits et les mots, ça ne change rien. La peur et le mépris du corps humain sexué et sacré demeurent. Par exemple, dans son essai (au titre ô combien signifiant) Mauvais Genre (2009), Paula Dumont estime que le corps « trahit » (p. 7) : au fond, pour elle, « mauvais genre » rime avec « mauvais corps ».
Comme les personnes homosexuelles pratiquantes consomment parfois des substances hallucinogènes, vivent une relation ou une sexualité sans la différence des sexes (donc sans la sexualité), elles finissent par ne plus sentir leur corps (même si les plus bobos d’entre elles soutiennent quand même qu’elles se sentent « vivantes » quand elles consomment, quand elles font l’amour et quand elles entament une relation amoureuse)… et cette impression d’absence corporelle les fait paniquer, s’agripper à la moindre expérience affective, émotionnelle, sensorielle de l’immédiat qui leur rappellera qu’elles sont encore un peu en vie et qui leur fera souhaiter « posséder leur corps » (cf. l’article « Procréation Médicalement Assistée » de Marcela Iacub, dans le Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, p. 380). Cette possession/dépossession/réappropriation de leur corps (le fameux « Mon corps m’appartient ! » du FHAR dans les années 1960-1970) ne s’exerce pas sans violence puisqu’elle n’est ni libre ni couronnée par la conscience du caractère sacré et sexué de tout corps humain.
À travers l’œillère d’une pensée libertaire mécaniste, le corps est réduit par la communauté homosexuelle à un terrain de potentialité, de « performances » (d’où la prolifération actuelle d’artistes LGBT qui se présentent comme des « performers » : Orlan, Steven Cohen, Golem Low, Andromak, etc.), d’expérimentations scientifico-artistiques (avec des « installations » plus délirantes et glauques les unes que les autres) : « La question de Spinoza : ‘Qu’est-ce que peut mon corps ?’ pourrait être le point de départ du cinéma de Catherine Cooringer. » (cf. l’éditorial de la plaquette du 17e Festival Chéries-Chéris, au Forum des Images de Paris, le 7-16 octobre 2011) ; « J’aime utiliser le corps comme une scène de théâtre. » (Steven Cohen, le performer transgenre M to F, dans le documentaire « Let’s Dance – Part I » diffusé le 20 octobre 2014 sur la chaîne Arte)
Sont amalgamés dans le discours des personnes homosexuelles pratiquantes le lexique de l’acorporel, et celui du corps-carcasse qui ressent tout à l’excès. Cela montre que leurs revendications (même politisantes et scientifiques) concernent avant tout un corps fantasmé, mythique. « La fonction du mythe, c’est d’évacuer le réel. […] Une prestidigitation s’est opérée, qui a retourné le réel, l’a vidé d’histoire et l’a rempli de nature. […] Du point de vue éthique, ce qu’il y a de gênant dans le mythe, c’est précisément que sa forme est motivée. […] L’écœurant dans le mythe, c’est le recours à cette fausse nature, c’est le luxe des formes significatives, comme dans ces objets qui décorent leur utilité d’une apparence naturelle. La volonté d’alourdir la signification de toute caution de la nature provoque une sorte de nausée : le mythe est trop riche, et ce qu’il a en trop, c’est précisément sa motivation. […] Éthiquement, il y a une sorte de bassesse à jouer sur les deux tableaux. » (Roland Barthes, Mythologies (1957), p. 230 puis p. 212) Le plaisir des sens dont elles font l’éloge peut aller s’il le faut jusqu’à l’appropriation brutale de son propre corps et du corps de l’autre (Deleuze, Guattari et Foucault se proposaient carrément, dans leur manifeste de « schizo-analyse » L’Anti-Œdipe (1973) de « forcer le réel à être plus qu’il n’est », en somme de violer le Réel et la Nature !). En même temps qu’elles séparent l’intérieur et l’extérieur pour mieux se protéger du dernier (… et donc du premier), elles en arrivent parfois à agresser leur propre corps, à l’image ou concrètement (scarifications, tatouages, piercing, régimes alimentaires drastiques, chirurgie esthétique, procréation médicalement assistée, bodybuilding, ablation du sexe, etc.) et célèbrent l’extérieur en le réifiant. Elles croient en la toute-puissance des apparences, pensent, comme les personnes transsexuelles, que le paraître modifie l’être, même si ensuite, elles affirmeront que le corps, une fois transformé, a toujours existé tel qu’il est. L’adulation du corps, dans la génitalité notamment, est en réalité un déni de celui-ci dans l’abstraction, comme le montrent ces propos : « C’est très important et très rassurant quand on pratique le sexe à plusieurs. C’est comme si on faisait abstraction de nos corps et qu’il ne restait plus que notre amour ! » (cf. le dossier « Fidélité » dans la revue Têtu, n°65, mars 2002) Beaucoup d’écrivains homosexuels font tout pour neutraliser le corps par la métaphore. Ils laissent de côté le corps réel pour lui préférer le corps poétique, sans organes, asexué, autrement dit mort.
Leur culte du corps est un moyen pour les personnes homosexuelles de se décorporaliser pour se sentir Dieu, et pour mépriser le vrai corps. Tandis qu’elles pensent avoir « le diable au corps », comme l’a écrit Raymond Radiguet, elles s’imaginent qu’elles ont un corps divin qui les appelle à dépasser les limites de leur corps humain. Pour détruire le mythe médiatique du corps parfait auquel elles croient encore (parce qu’en désir, elles prétendent l’incarner !), beaucoup d’entre elles pensent prendre leur revanche en se vengeant sur leur propre physique, soit par la science, soit par l’art (cf. le Body Art dans les années 1970 jusqu’à nos jours). Elles dessinent les corps de leur désir sexuel : des chairs fragmentées, sanguinolentes, brûlées, tatouées, écartelées, diffusées comme un média (cf. l’article « Arts plastiques » d’Élisabeth Lebovici, dans le Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, p. 46), éclatées, mythiques. Plus qu’un traitement du corps, il s’agit d’un travail sur la corporalité, sur l’idée de corps, car elles vident le corps concret de son aspect symbolique, de son âme, de sa Présence sacrée. Un certain nombre de personnes homosexuelles cherchent à éprouver leur corps parce qu’elles ne le/se sentent plus : c’est pourquoi elles empruntent souvent les chemins de la pornographie, de l’hyperréalisme camp, des drogues, et du sadomasochisme. La place des synesthésies dans leurs écrits est d’autant plus intéressante qu’elle montre implicitement que le contact qu’elles établissent avec le monde extérieur est souvent dévitalisé, se fait à travers la vitre du miroir jamesbondien.
Enfin, pour appliquer un vernis efficace de déni et de mauvaise foi sur leur haine et leur destruction effectives de la Nature, la communauté homosexuelle se réfugie dans la caricature des naturalistes/essentialistes qui lui tendent (pas toujours très finement) un miroir relativement justifié de leurs pratiques. Cette caricature consiste à imiter des fondamentalistes religieux, des parents familialistes traditionnalistes hétérosexistes, des chantres du « destin anatomique » ou de la différence des sexes uniquement procréative, des chercheurs natalistes rapidement scientifiques qui répèteraient à tue-tête « contre-nature, contre-nature, contre-nature », sans jamais leur permettre de parler d’Amour ni d’expliciter ce qu’ils mettent derrière le mot « Nature »… pour ensuite leur couper radicalement la chique en leur soutenant qu’ils sont réactionnaires, que la pratique homosexuelle est beaucoup plus naturelle que la pratique hétérosexuelle ou que la pratique religieuse, et que ce qui serait vraiment « contre-nature » c’est de s’opposer à « l’homosexualité-identité » ou « l’homosexualité-amour » : « L’homosexualité n’est pas contre nature. Je n’ai jamais eu à me forcer pour aimer les hommes. Ce qui est contre nature, c’est par exemple la continence sexuelle ou la monogamie… » (Pierre Gripari, Pierrot la Lune (1963), p. 180) ; « Nous ne voulons pas que soient présentées comme tolérables les idées selon lesquelles les femmes seraient naturellement portées vers la grossesse. » (Eddy Bellegueule pour Libé) ; « La théorie du genre comme l’homoparentalité remettent en cause cette représentation ancestrale que les femmes et les hommes disposeraient chacun d’une essence propre, qui leur donnerait des caractéristiques spécifiques et surtout complémentaires. Le féminisme et le combat pour la reconnaissance de l’homoparentalité heurtent de plein fouet cet essentialisme. » (Caroline de Haas sur Le Monde.fr du 24 octobre 2011) ; etc. Alors que bien évidemment, le but de la manœuvre de Dieu et de la Nature qu’Il a créée n’est pas de défendre la Nature en soi, ni de mépriser les sentiments amoureux humains, mais uniquement de les marier tous les deux, d’ordonner les sentiments à la Nature humaine et biologique pour les rendre véritablement aimants, féconds et joyeux. Le meilleur, c’est vraiment la Nature couronnée d’Amour.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.
Code n°157 – S’homosexualiser par le matriarcat
S’homosexualiser par le matriarcat
NOTICE EXPLICATIVE :
Les possibles conséquences désirantes (homosexuelles) d’une maternisation (portée par des femmes ou des hommes) de la société
Existe-t-il un lien entre homosexualité et féminisme agressif/pouvoir des mères dans notre société ? À en croire les créations et les discours de nombreuses personnes homosexuelles, oui… même si ce lien n’est pas causal, et qu’il ne s’agit pas du tout, à travers ce code, de condamner les femmes et les mères réelles, ni même leurs défenseurs. Pour moi, les vrais féministes sont ceux qui se battent pour que les femmes trouvent leur véritable place et identité dans le monde, et non ceux qui veulent en faire un équivalent exact des hommes, des tigresses toutes-puissantes au désir machiste (= des prostituées), des femmes phalliques qui n’ont plus besoin des membres de l’autre sexe.
N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Mère possessive », « Matricide », « Inceste », « Mère gay friendly », « Substitut d’identité », « Symboles phalliques », « Femme-Araignée », « Actrice-Traîtresse », « Grand-mère », « Tante-objet ou Maman-objet », « Femme et homme en statues de cire », « Regard féminin », « Reine f», « Sirène », aux parties « Hamlet » et « Recherche du père avortée par la mère » dans le code « Parricide la bonne soupe », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.
1 – PETIT « CONDENSÉ »
« Change de trottoir ! Le mien est piégé ! Si c’est trop tard, ne reste pas figé ! Sors du trou noir ! Je fais mon métier ! J’ai peur de rien ! Je suis une femme pressée ! » (Claire Litvine, dans la chanson « Une Femme pressée » du groupe L5)
L’influence symbolique que les femmes maternantes (et les hommes maternants ! car le matriarcat et le féminisme agressif, contrairement à l’idée reçue, ne sont pas réservés aux femmes, ni attribuables à toutes les femmes, loin s’en faut) peuvent jouer sur l’homosexualité est notamment observable à travers la place prépondérante que prend la figure maternelle dans la fantasmagorie homosexuelle, et dans les sociétés où grandissent les personnes homosexuelles. Le matriarcat progresse au sein de nos civilisations occidentales couveuses et de nos États-Providence (qui veulent nous éviter tout risque et les limites objectives du Réel), malgré le fait que les femmes réelles soient presque systématiquement présentées comme d’éternelles victimes des hommes, et qu’elles restent tout autant – si ce n’est plus – sous la menace des violences conjugales. Il suffit de nous pencher sur notre système juridique français pour constater que les femmes-mères ont de plus en plus les lois de leur côté : les pères modernes sont fréquemment mis sur le banc de touche, invités à devenir des mamans auxiliaires ou à fuir le domicile familial pour aller se suicider.
Du côté des statistiques sociologiques, dans un pays comme la France où actuellement 39% des mariages se terminent par un divorce (celui-ci étant demandé à 75% par les femmes), et où, dans 9 cas sur 10, l’enfant reste habiter seul chez sa mère, le père n’a pas d’autre choix que de partir (Michel Schneider, Big Mother (2002), p. 363). Le taux de suicide des pères séparés de leur(s) enfant(s) est six fois supérieur à la moyenne nationale, ce qui n’est évidemment pas un petit chiffre !
Il convient ici de bien distinguer la question de la féminisation des pouvoirs dans la société (qui n’est pas en soi problématique : bien au contraire) et celle de la maternisation des liens sociaux. Aujourd’hui, derrière un certain nombre de revendications d’égalité des femmes se cache la conquête d’une domination des mères, celles-ci étant d’ailleurs excessivement bienveillantes, assoiffées de toute-puissance et de vengeance envers les hommes et surtout les pères réels. Et ça, c’est un réel problème.
L’agression iconographique (et parfois réelle) des femmes envers les hommes a très probablement une influence sur l’orientation sexuelle de certains garçons et certaines filles, quand bien même les liens entre homosexualité et matriarcat/féminisme se trouvent toujours rangés dans le cadre de la coïncidence. Si les hommes gays ont eu peur d’emprunter le chemin de la différence sexuelle, ce n’est pas uniquement parce que les femmes ont pris une place prédominante relativement rapide dans nos sociétés occidentales en moins de cinq décennies : une certaine libération de la femme était et reste plus que jamais nécessaire. Mais c’est d’une part en termes de « maternalisme désexualisant » (Michel Schneider, « L’Indifférence au sexe provient de l’indifférence entre les sexes », cité dans la revue Philosophie magazine, « Hommes-Femmes : la Confusion des Genres », n°11, juillet/août 2007, p. 36) et d’infantilisation (dont sont capables même les hommes !) et non de féminisation du pouvoir social, et d’autre part en termes d’images de femmes phalliques irréelles, et donc de fantasme, qu’il faut envisager cette crainte de l’autre sexe.
« L’homosexuel » n’est pas le fils de sang de la femme forte iconographique, mais son fils d’idolâtrie, son enfant spéculaire. N’est-ce pas la femme phallique médiatique qui a initialement demandé aux hommes de décamper de son « trou noir » pour qu’ils la laissent faire son métier de prostituée, et d’aller « sur le trottoir d’en face », autrement dit de se faire homosexuels (cf. la chanson « Une Femme pressée » des L5) ? Dans l’ordre des symboles véhiculés par les media, les hommes ne sont plus ceux qui dominent les femmes ; ils sont en passe de devenir des mauviettes qui s’abaissent au statut d’objet de consommation à disposition du deuxième sexe. Cela peut traduire ou engendrer la réalité fantasmée de l’identité homosexuelle. Force est de constater que certaines femmes lesbiennes, en promouvant l’effacement progressif de la réalité du sexe par le concept flou de « genre », ouvrent la voie au transsexualisme et à l’homosexualité. Elles se félicitent parfois d’avoir permis socialement aux hommes de s’assouplir, de se questionner sur leur virilité, d’être moins machos… alors que l’absence de virilité de ces derniers est justement un concentré de machisme peinturluré de rose. En effet, les femmes qui veulent des hommes faibles ne désirent plus des hommes réels, ni même être femmes, puisque par nature, la première qualité qu’une femme attend d’un homme, c’est la force. En deuxième position vient la tendresse… mais seulement en deuxième (cf. la conférence « Le Célibat » de Denis Sonet, Paray-Le-Monial (France), session 2003). L’homme qui n’est que tendre avec elle lui parait mièvre. Celui qui n’est qu’une brute, elle ne l’aime pas non plus. Pour se faire reconnaître, il faut que l’homme vraiment aimant réunisse le paradoxe de la force tranquille, c’est-à-dire l’essence même de la sexuation des hommes. Au fond, seuls les hommes forts sont doux : les faibles deviennent violents. Leur brutalité trahit leur faiblesse. Les femmes qui veulent émasculer les hommes sont aussi machistes que les machos dont elles se croient éternellement victimes. Jacqueline Shaeffer a bien saisi cette énigme du féminin qui trouve sa victoire et son affirmation dans une forme d’abdication qui n’est pas sujétion mais reconnaissance d’une force masculine qui dépasse les femmes et les honore : « Que veut la femme ? Elle veut deux choses antagonistes : son moi hait la défaite, mais son sexe l’exige. Il veut la chute, la défaite, le ‘masculin’ de l’homme. C’est là le scandale du ‘féminin’. » (Jacqueline Schaeffer, Clés pour le féminin : femme, mère, amante et fille (1999), pp. 37-38) Chez l’homme droitier, la main droite agissante n’a pas de force sans la main gauche, discrètement agissante aussi. Ou, pour prendre un nouvel exemple, il n’y a pas de bon ministre des Affaires étrangères sans bon ministre de l’Intérieur. En quelque sorte, nous nous retrouvons avec les femmes face au mystère de l’action dans l’accueil. Il est souvent mal compris par beaucoup d’Hommes de notre temps puisque les valeurs du service, de l’accueil, et de l’obéissance à une autorité bienveillante sont dénigrées dans notre monde actuel. La prétention de la femme à être comme l’homme et à bénéficier des privilèges de la condition masculine, aussi paradoxal que cela puisse paraître, va dans ce sens de l’irrespect des femmes via la condamnation de l’autorité et de la force des hommes. La sexualité est une force de vie, mais une force quand même, à respecter en tant que telle. « Les violences sexuelles doivent être sanctionnées, mais la violence du sexe ne saurait être éradiquée. Il n’existe pas de sexualité sans violence et ceux qui rêvent du contraire oublient qu’ils ne seraient pas là si un jour, un homme, leur père, n’avait pas pris, avec une certaine violence, une femme, leur mère. Prendre, non au sens de violer son corps mais de désirer son désir. Le désir n’est pas une relation égalitaire accordant deux volontés en un contrat. Psychiquement, pour les hommes qu’il emporte dans la conquête sexuelle comme pour les femmes qui cherchent à le susciter, il comporte toujours une part d’agressivité, de ravalement de l’objet sexuel à côté de son idéalisation. » (Michel Schneider, op. cit., p. 99) ; « Oui, le sexe est dangereux, et le désir est une maladie mortellement transmissible. Est-ce une raison suffisante pour s’en détourner ? » (idem, p. 127)
2 – GRAND DÉTAILLÉ
FICTION
a) La mère phallique ou l’entourage féminin du héros fait tout pour le rendre homosexuel :
On observe une emprise matriarcale sur le personnage homosexuel dans la pièce L’Héritage de la Femme-Araignée (2007) de Christophe et Stéphane Botti, la chanson « Une Femme pressée » du groupe L5, le film « Serial Mother » (1994) de John Waters, le film « Les Damnés » (1969) de Luchino Visconti, la chanson « Seules les filles pleurent » de Lio, le film « Eve » (1949) de Joseph Mankiewicz, le film « Mors Hus » (1974) de Per Blom, le film « Les Frissons de l’angoisse » (1975) de Dario Argento, le film « Working Girls » (1986) de Lizzie Borden, le film « Le Livre de Jérémie » (2004) d’Asia Argento, le film « Girl King » (2001) d’Ileana Pietrobruno, le film « ¿ Por Que As Mulheres Devoram Os Machos ? » (1980) d’Alan Pak, le film « La Fête des mères » (1998) de Chris Van der Strappen, le film « Napolitaines » (1993) de Pappi Corsicato, le film « Singapore Sling » (1990) de Nikos Nikolaidis (avec la mère au pénis), le film « Ma vie est un enfer » (1991) de Josiane Balasko, la pièce Cosmopolitain (2009) de Philippe Nicolitch (avec Marie, la mère de Jean-Luc, tout de mauve vêtue), le film « Chéri » (2009) de Stephen Frears (avec la mère de Fred), le film « Black Swan » (2011) de Darren Aronofsky (avec l’odieuse et écrasante mère de Nina), etc.
Par exemple, dans la pièce Le Fils du comique (2013) de Pierre Palmade, Isabelle, une des potentielles mères porteuses de Pierre (le héros homosexuel), souhaite formater complètement son futur fils, en le prénommant « Superman », en voulant pour lui le « meilleur », la « réussite », la « perfection »… et non le bonheur. Dans le film « Après lui » (2006) de Gaël Morel, Camille, la mère gay friendly, maquille son propre fils Matthieu en femme. Puis, après sa mort, elle espionne le copain de son Matthieu, Franck, en le suivant partout. Dans la pièce La Famille est dans le pré (2014) de Franck Le Hen, Tom, le héros homosexuel, gravite dans des ambiances très féminines qui éjectent les pères et les maris, et qui l’empêchent d’être homme, d’être lui-même, en le confortant dans une pseudo homosexualité : que ce soit dans sa vie passée (avec sa grand-mère et sa mère, des femmes à poigne omniprésentes et machos) que dans sa vie présente (avec sa « fille à pédé » Cindy qui lui sert de couverture hétérosexuelle, ou encore avec son agent Graziella, qui le maintient dans une homosexualité tacite et une hétérosexualité officielle). Dans le film « Mommy » (2014) de Xavier Dolan, Steve, homosexuel, est maltraité par sa mère, qui lui parle très mal, qui le bat (« C’est toujours toi ma préférée, même si tu me bats. »). Celle-ci finit par le placer en hôpital psychiatrique à son insu. Cette femme féminise « son gars » quand il danse sur la chanson « On ne change pas » de Céline Dion. Elle le traite ironiquement de « pétasse ». La voisine de quartier, Kyla, apprend à Steve comment se raser la barbe : « Montre-moi. » lui demande-t-il. Steve n’est absolument pas aidé par les femmes de son entourage à devenir un homme adulte. Dans son one-man-show Fabien Tucci fait son coming-outch (2015), Fabien, le héros homosexuel, revient sur la genèse de son homosexualité : « Ça remonte à l’époque où je feuilletais les 3 Suisses de ma mère. » Dans le téléfilm « Just Like A Woman » (2015) de Rachid Bouchareb, Mona est encouragée au lesbianisme par son acariâtre belle-mère, qui est odieuse avec elle parce qu’elle est stérile, qu’elle ne donne pas d’enfant à son fils. Dans la pièce Soixante degrés (2016) de Jean Franco et Jérôme Paza, Damien, l’un des héros bisexuels, a été fortement influencé par la carrière de théâtre-amateur de sa mère, fan des planches. Elle lui demandait de jouer sa réplique au théâtre. Cette influence semble avoir été anxiogène : « C’est pathologique chez moi. C’est ma mère qui m’a refilé cette superstition, avec son théâtre ! » Dans le film « La Princesse et la Sirène » (2017) de Charlotte Audebram, une tante lesbienne raconte un conte à son petit neveu pour lui faire croire à son histoire d’amour interdite. Dans le film « The Cakemaker » (2018) d’Ofir Raul Graizer, la maman d’Oren, Hanna – exerce un mystérieux pouvoir divinatoire d’homosexualité sur Tomas, le héros homo : elle a compris énigmatiquement le lien érotique qui reliait son fils décédé Oren à Tomas. Dans le film « Jonas » (2018) de Christophe Charrier, la maman de Nathan pousse son fils et Jonas, l’amant de ce dernier, dans les bras l’un de l’autre… notamment par le biais de la mère de Jonas (qu’elle invite chez elle) et par le biais de la cigarette (car elle fume comme un pompier : « Ta mère, elle sait aussi que tu fumes ? Ce sera notre petit secret, alors… » dit-elle à Jonas, comme si elle lui parlait d’homosexualité). Dans la série The Last of Us (épisode 3, 2023) de de Neil Druckmann et Craig Mazin, c’est la maman de Bill qui lui a appris le piano, et notamment des chansons au texte cryptogay de Linda Rondstadt.
Dans le film « Toute première fois » (2015) de Noémie Saglio et Maxime Govare, Clémence, la mère bobo gay friendly de Jérémie, supporte très mal que son fils, qu’elle a toujours cru homosexuel, vire sa cuti avec une femme : « T’es pédé, mon chéri ! » Elle voudrait le forcer à se marier homosexuellement. Le père de Jérémie fait à son fils le même chantage : « T’as changé d’orientation ?!? Eh bien t’as perdu un père ! » lui balance-t-il avant de quitter la table.
Dans la pièce Ma belle-mère, mon ex et moi (2015) de Bruno Druart et Erwin Zirmi, Solange, la mère de Zoé et la belle-mère de Julien le héros bisexuel qui est devenu homosexuel suite à sa rupture avec Zoé, est accusée par son gendre Julien d’avoir provoqué la séparation entre lui et Zoé, et donc son homosexualité : « Voilà. C’est de votre faute si on est séparés. » (Julien) Zoé, sa fille, n’est pas non plus étrangère au virement de cuti de Julien : « L’énorme bêtise, elle l’a faite en me quittant. Elle m’a trop fait souffrir. Elle m’a largué sans aucun état d’âme. » Finalement, Zoé découvre que sa mère est responsable de l’homosexualisation de son ex-mari : « C’est à cause de ma mère que t’es devenu homo ?? »
L’opinion publique a déjà vent d’un lien fort entre maternité possessive et homosexualité, même si, pour se rassurer elle-même, elle fait souvent l’erreur de le causaliser par des raccourcis psychologiques faciles : « Moi, je suis sûre. C’est sa mère… » (la bouchère par rapport à l’homosexualité d’Abram, dans le film « Scènes de chasse en Bavière » (1969) de Peter Fleischmann) ; « J’la sens bien castratrice, cette Catherine… » (Dominique parlant de la femme de Jérôme, soupçonné d’être gay, dans la pièce On la pend cette crémaillère ? (2010) de Jonathan Dos Santos) ; « Ça aurait pu faire de moi un pédé ! » (Malik, le personnage hétéro, qui se décrit entouré d’une mère castratrice et de cinq tantes dès sa petite enfance, dans la pièce Scènes d’été pour jeunes gens en maillot de bain (2011) de Christophe et Stéphane Botti) ; « Les femmes se sont tellement émancipées. » (le Dr Katzelblum, homosexuel, dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit) ; « Tu peux avoir une copine… ou un copain. » (Sam, la mère possessive de Rupert, son fils homo de 10 ans, dans le film « Ma Vie avec John F. Donovan » (2019) de Xavier Dolan) ; etc.
Dans beaucoup de fictions traitant d’homosexualité, la mère du héros homosexuel rêve de changer le sexe de son fils ou de sa fille : « Chère maman, […] j’aimerais me souvenir de ton visage lorsque tu m’as vue pour la première fois. Ce n’est pas mes yeux que tu as regardés, non, tu as vite écarté mes jambes pour voir si un bout de chair pointait hors de mon corps à peine fait. » (Nina Bouraoui, La Voyeuse interdite (1991), p. 35) ; « Enfant d’un géniteur muet mais point sourd, d’une génitrice déguisée en eunuque. » (idem, p. 65) ; « J’aimerais que tu sois une femme. Tu n’iras pas à la rivière… » (la mère au fiancé, dans la pièce Bodas De Sangre (1932) de Federico García Lorca) ; « C’est moi qui t’ai mise au monde ! Je sais bien que tu as un trou à la place d’une banane et que c’est tout ton atout ! » (Solitaire s’adressant à sa fille Lou, dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; etc.
Dans la pièce Bill (2011) de Balthazar Barbaut, la mère de Bill veut profiter de la castration de son chat pour faire par la même occasion castrer son fils. Dans la comédie musicale La Bête au bois dormant (2007) de Michel Heim, les trois fées travestissent Henri en Henriette. Dans le film « Mon fils à moi » (2006) de Martial Fougeron, la mère de Julien exerce sur lui une action émasculante en l’habillant en fille. Dans le roman Papa a tort (1999) de Frédéric Huet, la mère de Julien lui achète des poupées. Dans le film « Los Abrazos Rotos » (« Étreintes brisées », 2009) de Pedro Almodóvar, Ernesto est déguisé en fille par sa mère. Dans le film « Saisir sa chance » (2006) de Russell P. Marleau, Chance, le héros gay, dit avoir vécu son premier émoi homosexuel à 4 ans, quand sa mère l’a amené voir le ballet Casse-Noisette, et qu’il a été fasciné par le danseur. Dans la pièce Le Gai Mariage (2010) de Gérard Bitton et Michel Munz, lorsqu’Henri a eu 8 ans, sa mère a voulu l’inscrire à un cours de danse classique. L’univers éthéré de la mère trouble, capte, et atrophie les sens du personnage homosexuel : « Tu te souviens des photographies de galas d’Opéra dans les revues de ta mère. » (Félix dans le roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 160) ; « Ta chambre est une ode à la couleur mauve : des tapis aux abat-jour, des peintures aux statuettes, des draps aux alaises, le décor couvre chaque nuance du violet. » (idem, p. 169) ; « T’étais beau quand t’étais bébé. T’étais beau, t’avais l’air d’une petite fille. J’m’amusais bien avec toi : t’avais l’air d’une poupée. T’étais mignonne. » (Laurent Spielvogel imitant sa mère s’adressant à lui, dans son one-man-show Les Bijoux de famille, 2015) ; etc.
C’est parfois dans l’interdit maternel (édicté sans amour et dans une rigide fidélité à la différence des sexes) que l’encouragement implicite à l’homosexualité vient. Par exemple, dans le film « Dolls » (2008) de Randy Caspersen, Thomas, un ado un peu secret, supporte mal que sa mère s’apprête à vendre les poupées qui ont accompagné son enfance… Dans le film « Maigret tend un piège » (1958) de Jean Delannoy, Marcel Maurin, l’homosexuel, vit sous la coupe d’une mère castratrice. Dans le roman La Máscara De Carne (1960) de Maxence van der Meersch, Manuel est entouré d’une mère et d’une sœur très masculines. Dans le film « Rafiki » (2018) de Wanuri Kahiu, Mercy, la mère de Kena, l’héroïne lesbienne, est très inquisitrice, catholique de façade, et se met à fliquer sa fille… et elle devine son homosexualité avant cette dernière : « J’ai l’impression que tu as changé, Kena. ». Dans le film « Ma Vie avec Liberace » (2013) de Steven Soderbergh, Liberace, le pianiste virtuose, présente sa mère comme un tyran qui l’a homosexualisé et isolé : « Ma mère m’obligeait à jouer au piano tous les jours. Je n’avais aucun ami. »
Il arrive que cette maman encourage plus ouvertement son fils à s’homosexualiser, et se targue d’avoir participé à la « libération » que serait son coming out : « J’ai fini par accepter ton vice, mon chéri. Tu es la fille que j’aurais voulu avoir. » (la mère à « L. » dans la pièce Le Frigo (1983) de Copi) ; « Aurais-tu peur de t’avouer le garçon que tu es vraiment ? Est-ce que je perdrais la raison parce que t’aimes un garçon ? » (cf. la chanson « Un Garçon » de Lorie) ; « Il n’y a plus d’hommes dans cette famille, il ne reste plus que mon frère, autant dire personne. Quand j’étais petite, […] il prenait soin de moi, comme une mère. » (Cécile dans le roman À ta place (2006) de Karine Reysset, p. 58) ; « Cette sourde inimitié de Fernand contre sa mère fait horreur ; et pourtant ! C’était d’elle qu’il avait reçu l’héritage de flamme, mais en même temps la tendresse jalouse de la mère avait rendu le fils impuissant à nourrir en lui ce feu inconnu. Pour ne pas le perdre, elle l’avait voulu infirme ; elle ne l’avait tenu que parce qu’elle l’avait démuni. Elle l’avait élevé dans une méfiance, dans un mépris imbécile touchant les femmes. » (François Mauriac, Génitrix (1928), pp. 72-73) ; « Pas de femmes ! Que ta petite maman ! » (la mère de Jeanjean, dans le spectacle musical Bénureau en best-of avec des cochons (2012) de Didier Bénureau) ; etc.
Par exemple, dans le film « Mi-fugue mi-raisin » (1994) de Fernando Colomo, la mère envahissante de Pablo veut à tout prix que son fils soit gay. Dans le film « The Family Stone » (« Esprit de famille », 2005) de Thomas Bezucha, Everet, le frère de Ben, le héros homo, avoue en pleine réunion de famille que sa maman « a essayé de rendre ses enfants tous gay » ; celle-ci riposte, avant de lui donner raison : « Mais enfin, de quoi tu parles ? Je n’ai jamais rien fait dans ce sens ! Non, ce qui est vrai, c’est que j’ai espéré, je dois dire, j’ai désespérément espéré que tous vous seriez gays, tous mes fils, et que comme ça vous ne me quitteriez jamais, et je m’en excuse auprès de mes filles. » Dans son one-man-show Tout en finesse (2014) de Rodolphe Sand, la grand-mère de Rodolphe a tout fait pour que son petit-fils Rodolphe devienne homo… et ça a marché : « Je suis soulagée ! Enfin un pédé dans la famille ! ». Et elle veut aussi que le dernier enfant de sa sœur, le petit Alexandre, suive les pas de son oncle (apparemment, Alexandre joue déjà à la majorette avec sa cape de Zorro…). Dans le film « Call me by your name » (2018) de Luca Guadagnino, Annella, la mère de Elio, fait tout pour pousser son jeune fils Elio de 17 ans dans les bras d’Oliver, qui a le double de son âge. « Tu l’aimes bien, hein, Oliver… » s’amuse-t-elle à lui dire, devinant ses sentiments naissants. Elle lui lit également un conte du XVIe siècle d’un prince qui avoue son amour interdit à une princesse… ce qui poussera Elio à oser déclarer sa flamme à Oliver tout de suite après. Elle organise même aux deux amants un séjour d’une semaine en vacances pour qu’ils ne se retrouvent que tous les deux. Hallucinant. Dans le film « Love, Simon » (2017) de Greg Berlanti, La mère de Simon, le héros homo, est psychanalyste, féministe, et passe son temps à analyser son entourage. Une fois que son fils lui fait son coming out, elle lui avoue tacitement qu’elle l’a toujours su : « J’ai souvent voulu t’en parler, mais je ne voulais pas être indiscrète. » Dans l’épisode 98 « Haute Couture » de la série Joséphine ange gardien, Dallas, l’assistant-couturier homosexuel de Cecilia, s’appelle en réalité Claude François. « Ma mère l’adorait. » À la fin, il mime avec Joséphine le coup de griffe de « Baracouda » de la chanson « Alexandrie-Alexandra ».
Dans le film « Die Mitter der Welt » (« Moi et mon monde », 2016) de Jakob M Erwa), Phil, le héros homo, a rencontré Nicholas lorsqu’ils n’avaient que 8 ans… et Glass, la mère narcissique de Phil, juste après leur bousculade, incite déjà son fils à croire en leur idylle : « J’ai vu qu’il te plaisait. » Plus tard, à l’âge quasi adulte (17 ans), pendant la nuit, Phil vient dans la chambre de sa maman, la réveille pour lui demander conseil au sujet de son premier béguin pour un garçon de sa classe, Nicholas : « C’est juste que j’ai un rancard demain et j’arrive pas à dormir. Qu’est-ce que je dois faire ? » Glass l’invite à s’asseoir à ses côtés et dit à son fils d’accepter directement toutes les pratiques homos du premier coup : « Fais tout. » Mais elle lui donne aussi un avertissement faustique (l’interdit d’aimer) : « Mais ne lui demande pas s’il t’aime. Crois-moi, je m’y connais. » Phil remercie sa mère maquerelle : « Merci Mum. Tu m’as bien aidé. » Lorsque Phil présente en chair et en os son amant Nicholas à sa mère bobo, celle-ci est tout émoustillée : « Niveau bon goût, tu tiens de moi, c’est sûr ! » Et c’est limite si elle ne leur file pas des préservatifs… « Amusez-vous bien. Et ne vous déchaînez pas trop. » Par ailleurs, Glass, quand elle est tombée enceinte à l’âge de 16 ans, a quitté définitivement le père de Phil, laissant ce dernier amputé de sa relation filiale avec son père biologique. Cette mise à l’écart a certainement concouru à l’émergence d’un désir homosexuel chez le jeune homme : « Une femme avec deux enfants et pas de mari, ça faisait tache ici. Mais on gérait, même sans homme à la maison. Les copains nous interrogeaient sur notre père. Alors on demandait à Glass, qui disait un truc du genre ‘Un marin en voyage’. Ou bien ‘Un cow-boy dans un ranch’. Et plus tard, quand on ne gobait plus tout ça, ‘Je vous le dirai quand vous serez prêts’. Un jour, on a arrêté de demander, vu que ça ne servait à rien. Et aujourd’hui ? C’est normal de ne rien savoir sur notre père, le mystérieux numéro 3 de la liste. Pour moi, ça restait un vide étrange. Un trou noir. »
Dans le film « Les Garçons et Guillaume, à table ! » (2013) de Guillaume Gallienne, Guillaume, le héros bisexuel, raconte comment, pendant toute son adolescence et au début de sa vie d’adulte, lui et sa mère ont signé un pacte tacite pour s’imiter l’un l’autre (« … même si on a prétendu le contraire parce que ça nous arrangeait bien tous les deux. » révèlera Guillaume), pour s’installer dans la plainte et la douilletterie (« Maman, maman, maman, maman… j’ai un peu mal à la tête. » est la première phrase du film), et comment sa mère, par jalousie et pour garder son fils rien qu’à elle (« C’est elle qui a eu peur que j’aime une autre femme qu’elle. » avouera Guillaume à la fin du film, après avoir fait entrer une femme dans sa vie), lui a fait croire qu’il était homosexuel, qu’il n’avait rien d’un homme (elle le maltraite verbalement : « T’as toujours eu peur des chevaux. » ; « T’as jamais été sportif. » ; etc.), qu’il était devenu elle (« Pourquoi ma mère n’est-elle pas heureuse ? Pourtant, je suis une fille, comme elle. »), qu’il remplacerait son mari ou sa meilleure ami (par exemple, la mère appelle son fils « ma chérie »). La scène du coming out forcé (= outing) est assez parlante : Guillaume vient voir sa mère près de la piscine pour se faire consoler de son chagrin d’amour pour Jeremy (et non pour lui annoncer qu’il se sentirait homosexuel, étant donné qu’il ne se prend que pour une femme, et qu’il ne connaît même pas le mot « homo »). Et là, sa mère, maladroitement et voulant bien faire (ou faire « gay friendly »), lui colle agressivement l’étiquette de « l’homo » dont il aura du mal à se défaire par la suite : « Tu sais, y’en a plein qui vivent très heureux… » Et comme lui ne comprend pas le sous-entendu, elle se met à lui gueuler dessus et à lui demander de ne pas jouer à plus bête qu’il n’est : « Enfin, les pédés, les homos, quoi ! » Guillaume essaie de résister en vain à la prédiction de sa mère : « Mais je suis pas homo parce que je suis une fille attirée par un garçon. C’est on ne peut plus hétéro… »
Cette mère incestueuse qui homosexualise peut tout à fait être un homme : le matriarcat n’a pas de sexe ; c’est un désir machiste et sur-féminin à la fois. « J’ai 22 ans et je vis toujours chez mon père. En plus, il est persuadé que je suis une fille de 2 ans. Du coup bah… je m’appelle Sophie. » (Bill dans la pièce Bill (2011) de Balthazar Barbaut) ; « Ça doit être mon père qui m’a fait ainsi ! Il était trop beau lui aussi ! Comme un gamin-papillon, j’étais fasciné par sa beauté d’homme solitaire. Peut-être que je m’y suis brûlé les ailes ! Je devrais jeter toutes ces photos que j’ai de lui ! Cesser de penser que j’aurais hérité de lui cette attirance pour les garçons. Un désir refoulé qu’il m’aurait transmis en quelque sorte. Et tout cela, parce qu’il nous prodiguait, à moi et à mon petit frère, la tendresse de la mère perdue. » (Adrien dans le roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, p. 60) ; « C’est chose terrible, la sentimentalité d’une mère. Parole de Garbo. Et vraie calamité un père lui-même sirupeux tout lâche à l’heure de se coltiner ce primordial mensonge de l’amour maternel qui vous raconte la vie gentil conte de fée, de sa voix doué vous berce de l’illusion jusqu’à profond sommeil plein de rêves, et au réveil, ensorceleur encore, vous console de l’histoire pas vraie en vous minaudant de pires faussetés à l’oreille. » (le roman Vincent Garbo (2010) de Quentin Lamotta, p. 87) ; etc. Par exemple, dans la pièce Moi aussi, je voudrais avoir des traumas familiaux… comme tout le monde (2012) de Philippe Beheydt, Eddy, le « père » fictif d’Édouard, imagine pour son « fils » une relation homosexuelle avec Michael, un camarade de cour d’école.
Le matriarcat qui rend le héros principal homosexuel peut parfois être porté par la « fille à pédés », la meilleure amie, la tante, ou bien la courtisane post-pubère soucieuse de tester son pouvoir d’attraction sur les garçons : « Tu sais Bruno, ça ne me dérange pas que tu sois homosexuel ! » (Christiane, balançant arbitrairement dans la boîte Number One cette présomption à son ami Bruno, d’une part afin de prêcher le faux pour savoir le vrai, et d’autre part afin de se servir de la beauté physique de ce pote comme appât pour s’attirer un mec pour elle, dans la pièce Célibataires (2012) de Rodolphe Sand et David Talbot) ; « Ah non mais attends, j’suis pas gay ! » (Bernard, le personnage homo qui fera plus tard son coming out à sa meilleure amie Donatienne qui l’insiste régulièrement à cracher le morceau, dans la pièce Nous deux (2012) de Pascal Rocher et Sandra Colombo) ; « Si j’amenais un homme de Gomorrhe à Sodome… » (cf. la chanson « Ma robe » d’Élodie Frégé) ; « T’es ma fofolle à moi ! » (Alice à son meilleur ami homo Fred dans la pièce Coloc’ à taire ! (2010) de Grégory Amsis) ; « Cette fois, c’est toi qui te maquilles, les faux cils et les talons aiguilles. Faut qu’c’ait l’air de te plaire. » (cf. la chanson « Un Garçon facile » d’Élisa Tovati) ; « Je serais si heureuse si tu devenais un pédé ! » (Tante Ida à son neveu Gator, dans le film « Female Trouble » (1975) de John Waters) ; « T’es rien qu’un fils de pute. Et ta mère, elle fait le trottoir. » (une camarade de classe à Franck, un garçon qu’elle traite de pédé, dans la pièce Mon Amour (2009) d’Emmanuel Adely) ; « Olivier jette quelques coups d’œil rapides vers son ami, il ne peut pas s’en empêcher. Au bout d’une demi-heure environ, il se rend compte qu’Alice l’observe. Depuis quand le regarde-t-elle ? A-t-elle compris quelque chose ? Les femmes sont plus rapides que les hommes pour décrypter les signes. Olivier se sent comme pris sur le fait, il n’ose plus fixer autre chose que ses feuilles de cours. » (Jean-Philippe Vest, Le Musée des amours lointaines (2008), p. 92) ; « Tom et Jerry sont un couple gay. » (Veronika face à deux garçons qui la draguent elle et Nina en boîte, et qu’elle cherche à mettre mal à l’aise pour les mettre à l’épreuve de sa drague de femme fatale, dans le film « Black Swan » (2011) de Darren Aronofsky) ; « S’il ne le sait pas, moi, je le sais ! » (Sibylle par rapport à Nelligan Bougandrapeau, le présentateur télé homo, dans la pièce En circuit fermé (2002) de Michel Tremblay) ; « Votre virilité aurait-elle subi des dommages après moi ? » (Merteuil s’adressant à Valmont, dans la pièce Quartett (1980) d’Heiner Müller) ; « En fait, en tant qu’homme, tu sers à rien. » (Ninon s’adressant à Stan, l’hétéro, dans la pièce Les Favoris (2016) d’Éric Delcourt) ; etc.
Par exemple, dans le film « Le Secret d’Antonio » (2008) de Joselito Altarejos, Antonio, à 15 ans, tombe amoureux de son oncle Jonbert ; sa meilleure amie, Mike, est en faveur de son coming out. L’homosexualisation du héros gay par la Lolita allumeuse est parfois le signe d’une vexation féminine de ne pas séduire facilement tous les hommes… Dans le film « Stand » (2015) de Jonathan Taïeb, Anton, en tant qu’assistant à domicile de personnes âgées (ergothérapeuthe), va faire des ménages chez Olga, une grand-mère qui passe son temps devant la télé et l’initie aux jeux télévisés. Celle-ci veut absolument le caser avec une femme, et tente même de le séduire, en maintenant avec lui une relation fusionnelle (elle l’appelle « mon chéri »). Dans le film « La Ballade de l’impossible » (2011) de Tran Anh Hung, Kisuki est poussé au suicide parce que sa « première fois » avec Naoko, sa copine, se révèle désastreuse : cette femme lui fait croire à son impuissance sexuelle. Dans le one-man-show Raphaël Beaumont vous invite à ses funérailles (2011) de Raphaël Beaumont, le héros homosexuel raconte qu’il a croisé une femme dans la rue qui l’a ignoré. Dans le film « Les Garçons et Guillaume, à table ! » (2013) de Guillaume Gallienne, Guillaume, le héros bisexuel, se prend plusieurs fois des vents de la part des femmes fatales de son entourage (« Toi, tu danses comme une fille. Je ne veux pas danser avec une fille. » dira Pilar, la belle Andalouse qui décline l’invitation de Guillaume à danser avec lui), soit parce qu’elles ne le considèrent pas comme un homme, soit parce qu’elles le traitent d’homo (sa mère en premier lieu ; ses tantes en second), soit parce qu’elles le torturent (Ingeborg dans le centre de thalassothérapie). Dans le film « Cloudburst » (2011) de Thom Fitzgerald, Stella, l’héroïne lesbienne, traite Prentice de « Sissy », juste parce qu’il fait des mouvements de danse sur la plage. Dans la pièce Y a comme un X (2012) de David Sauvage, le père de Jean-Charles dit qu’il est devenu homo parce qu’il a été envahi par les femmes. Dans le roman Le Crabaudeur (2000) de Quentin Lamotta, le narrateur est élevé par des femmes : sa mère, sa nanou, etc.
Pour en revenir à la mère, je pense qu’elle ne veut pas tant faire de son enfant une fille (s’il est né garçon) ou un garçon (si elle est née fille), un gay ou une lesbienne, qu’un être asexué (tout-puissant et désincarné), un objet sacré pouvant être vénéré, consommé, mutilé. « Tu aimes les bijoux, hein ? Prends ça aussi. Et le collier. Tiens, tiens, ne me remercie pas. […] Tu aimes l’argent, hein ? » (Evita à l’infirmière dans la pièce Eva Perón (1969) de Copi) ; « L’idéal d’la féminité, c’est d’être née avec du blé ! C’est comm’ ça qu’elle’ pond’ des pédés. […] Ell’ font d’eux des efféminés. » (Cachafaz, le fils de la bourgeoise et donc de la bourgeoisie, dans la pièce Cachafaz (1993) de Copi)
C’est pourquoi on voit tellement de héros homosexuels qui ont une maman transsexuelle ou prostituée dans les fictions. Par exemple, dans la pièce Des bobards à maman (2011) de Rémi Deval, Marina, la « mère » de Fred, le héros homo, se trouve finalement être un homme transsexuel : « Fred, je suis ton père. » Dans le roman Michael Tolliver est vivant (2007) d’Armistead Maupin, Anna, le personnage transsexuel M to F, materne Jake, l’homosexuel, comme une grand-mère : elle lui offre des chocolats, vient le visiter à l’hôpital, etc. Dans le film « Todo Sobre Mi Madre » (« Tout sur ma mère », 1998) de Pedro Almodóvar, Esteban est le fils homosexuel d’un homme transsexuel. Idem dans le spectacle musical Panique à bord (2008) de Stéphane Laporte, où Kevin, l’homosexuel de 17 ans, est le fils de Jenny, le chanteur trans. Dans la pièce Les Sex Friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau, Quentin, le héros homosexuel, a eu une relation avec une prostituée (Martine) avant de s’engager dans l’homosexualité. Dans le film « Little Gay Boy » (2013) d’Anthony Hickling, le héros homosexuel, Jean-Christophe, dont la mère est prostituée (de métier), découvre son homosexualité. Dans le film « Zodiac » (2012) de Konstantina Kotzamani, Peter, un jeune garçon de huit ans, est confié, après la mort subite et mystérieuse de sa mère, à un homme transsexuel M to F nommé Giofa vient prendre soin de lui, contre sa propre volonté.
La mère du personnage homosexuel – mais cela peut être aussi un frère ou un amant – oblige son fils à se prostituer (tout comme elle), à devenir hypersexué/asexué, à travailler pour elle tout en gardant ses distances (car ils sont en concurrence professionnelle directe !) : « Il [Maria-José] fut élevé par son frère aîné qui l’habillait en fille et le prostitua dès l’âge de six ans. » (cf. la nouvelle « Le Travesti et le Corbeau » (1983) de Copi, p. 30) ; « Change de trottoir, le mien est piégé ! Si c’est trop tard, ne reste pas figé ! Sors du trou noir ! Je fais mon métier ! J’ai peur de rien, je suis une femme pressée ! » (cf. la chanson « Une Femme pressée » du groupe L5) ; etc. Par exemple, dans le film « Miss Mona » (1986) de Medhi Charef, Mona engage Samir à se lancer dans la prostitution masculine. Dans le roman Dix Petits Phoques (2003) de Jean-Paul Tapie, Rick s’homosexualise sous la pression d’une actrice porno qui le pousse dans les bras (ou plutôt dans le derrière !) d’un autre acteur. Dans la nouvelle « Madame Pignou » (1978) de Copi, la boulangère laisse sa fille se prostituer sur le trottoir d’en face : « La rue Henri-Monnier était déserte […] Seule la jeune prostituée se tenait en face. » (p. 47) Dans la pièce L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer (1967) de Copi, la mère offre une barrette, des bijoux, à sa fille Irina : elle l’aide à se travestir. Dans le film « Tomboy » (2011) de Céline Sciamma, Lisa maquille Laure (qu’elle pense être Michaël) en fille, en lui disant que ça lui va bien. Dans le one-(wo)man-show Zize 100% Marseillaise (2012) de Thierry Wilson, Zize, le travesti M to F explique qu’il est devenu femme-objet à cause de son meilleur ami Annonciade, travesti et prostitué aussi (« C’est grâce à elle que je suis devenue Miss Pointe-Rouge. ») et qu’il a relooké sa nièce « hideuse » Claire comme une pute pour qu’elle se fasse dépuceler sur un parking et « fasse son apprentissage de la sexualité ». Dans la pièce Les Vœux du Cœur (2015) de Bill C. Davis, Irène la sœur de Bryan, le héros homo croyant, qui est une femme libérée et adultère, défend son frère autant que sa propre luxure : « Bryan, marche donc sur ce trottoir, et moi je vais sur celui d’en face. »
Dans le film « Rosa la Rose : Fille publique » (1985) de Paul Vecchiali, Rosa, la prostituée, se voit courtisée par deux clients qui veulent coucher avec elle séparément. Mais elle fait tout pour les réunir pour un plan à trois :« Si vous voulez, on peut monter tous les trois. ». Au départ, le client 1 rechigne un peu, et finit par se laisser tenter : « Moi, ça me va… du moment qu’il ne me tripote pas. » Après avoir couché ensemble, les deux hommes prennent leur douche ensemble et se comparent leur bite. Rosa s’en amuse, et fait tout pour les homosexualiser : « Vous en avez fait, des folies ! J’espère que j’ai pas suscité une vocation. »
Le personnage homosexuel s’identifie à sa mère phallique, jadis abusée par les hommes, et qui revient, en amazone conquérante et victorieuse, se venger d’eux. Les « nouvelles femmes » (autrement dit les mères célibataires) débarquent ! Elles n’arrivent pas la fleur au fusil, et ne sont pas là pour faire de la couture : elles revendiquent une égalité identitaire avec les hommes. Et que ça saute ! « Les femmes détiennent le pouvoir ! » (cf. la chanson de Madame Mime, dans la pièce Les Divas de l’obscur (2011) de Stéphane Druet) ; « Les pin-up jouent les machos, c’est la folie sous les flambeaux ! » (cf. la chanson « Soca-Party » de la Compagnie Créole) ; « Femme des années, mais femme jusqu’au bout des seins, ayant réussi l’amalgame de l’autorité et du charme… » (cf. la chanson « Être une femme » de Michel Sardou) ; « La plupart des femmes d’aujourd’hui sont devenues des hommes d’autrefois. Le pire, c’est qu’à ce train-là, les hommes d’aujourd’hui risquent de devenir des femmes d’autrefois. » (Dominique et Julie dans le roman Les Julottes (2001) de Françoise Dorin, p. 45) ; « N’oubliez pas que pour le monde, dorénavant, je suis Madame Dubonnet. […] Je serai une Madame Dubonnet insupportable, attendez-vous à subir une tyrannie féminine sans merci. » (Cyrille s’adressant à Hubert, dans la pièce Une Visite inopportune (1988) de Copi) ; « Tu vas dans le sens de l’histoire, maman. Partout les femmes prennent le pouvoir. » (Laurent à sa mère Suzanne, dans le film « Potiche » (2010) de François Ozon) ; « Quand une femme a décidé quelque chose, tout arrive. » (Anamika, l’héroïne lesbienne, dans le roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, p. 85) ; « Je veux de vous. Je suis la société ! » (Tante Eva parlant à Anthony, son neveu homosexuel qui se sent rejeté par la société, et qu’elle essaie de caser avec d’autres hommes, dans le roman At Swim, Two Boys, Deux garçons, la mer (2001) de Jamie O’Neill) ; etc.
Quand le personnage homosexuel décrit sa chère et douce maman, on a l’impression qu’il fait le portrait d’un macho ou de son propre père (cette fois féminisé) : « Ma mère, c’est Schwarzenegger dopé aux OGM ! » (Jarry dans le one-man-show Entre fous émois (2008) de Gilles Tourman) ; « Tu vas trouver sa bête mais j’étais sur le net, j’ai vu ta mère sur Chat Roulette, j’ai appuyé sur ‘next’, j’ai flashé sur sa tête, j’ai vu ta mère sur Chat Roulette. Entre deux quéquettes. […] Je l’ai vue et j’ai tout de suite compris que ma vie prenait un tournant. Je dois reconnaître un petit air de famille et se n’est pas si déplaisant. Bientôt, j’irai là où tu as passé neuf mois. Bientôt, tu m’appelleras Papa. […] Tu m’avais dit que toutes les mères étaient des princesses. La tienne est une reine. Je vais l’aimer comme ma fille, ou ma sœur, ou mon père. » (cf. la chanson « Chatroulette » de Max Boublil)
La mère devient le centre de la famille et prend la place du père : cf. la série Clara Sheller (2005) de Renaud Bertrand (l’épisode 3 : « État secret »), le film « Pôv’ fille ! » (2003) de Jean-Luc Baraton et Patrick Maurin, le film « Ken Park » (2002) de Larry Clark, etc. Les rôles dans le couple hétéro ont été échangés par le héros homo, mais l’inversion n’a pas mis fin à la tyrannie pour autant : c’est juste le despote et son esclave qui ont échangé les masques. « Ma mère c’est mon père ; mon père c’est ma mère. » (une réplique du one-man-show Jérôme Commandeur se fait discret (2008) de Jérôme Commandeur) ; « Je veux un couple comme toi et papa, où tu prends le dessus de suite ! » (Zize, le travesti M to F s’adressant à sa mère, dans le one-(wo)man-show Zize 100% Marseillaise (2012) de Thierry Wilson) ; « Je m’occupe de tout à la maison. On n’a pas besoin d’une fille. » (Laurent Spielvogel imitant sa maman qui rejette la petite copine d’un de ses fils, dans son one-man-show Les Bijoux de famille, 2015) ; « Je l’empêcherai de te toucher. » (la maman de Davide, le héros homosexuel, lui parlant de son père, dans le film « Mezzanotte » (2014) de Sebastiano Riso) ; etc. Par exemple, dans le téléfilm « Prayers For Bobby » (« Bobby : seul contre tous, 2009) de Russell Mulcahy, la mère du héros gay fait totalement écran à son mari. Dans le film « Órói » (« Jitters », 2010) de Baldvin Zophoníasson, le père de Gabriel (le héros homosexuel) n’a aucune autorité : « Elle a toujours tout régenté. » dira-t-il par rapport à sa femme. Dans le film « No Se Lo Digas A Nadie » (1998) de Francisco Lombardi, la mère de Joaquín est ultra-protectrice et diabolise le père devant son fils. Dans le film « Una Giornata Particolare » (« Une Journée particulière », 1977) d’Ettore Scola, Gabriele, le héros homosexuel, avoue que chez lui, pendant son enfance, c’est sa mère qui régentait tout. À cause de cela, son père a quitté le domicile familial. Dans le film « Carol » (2016) de Todd Haynes, Harge, le mari amoureux éconduit, est rejeté comme une merde par sa femme Carol, lesbienne, ainsi que par Abby, l’ex de sa femme. Il n’a que ses yeux pour pleurer.
Non seulement le protagoniste gay nous raconte que sa mère a pris la place de son père, mais en plus, on apprend qu’elle a tué son mari (cf. le film « Volver » (2005) de Pedro Almodóvar) et tous les associés à son sexe de « mâle ». Le personnage homosexuel a assisté au meurtre de l’homme par la femme phallique (cf. le film « Ronde de nuit » (2004) d’Edgardo Cozarinsky, le film « Huit Femmes » (2002) de François Ozon, etc.) : « Les voisines disaient qu’elle était devenue un homme. Elles avaient raison. Ma mère faisait sa révolution. Elle se libérait. Retrouvait sa jeunesse. Et pour cela, elle avait besoin de détruire notre monde, le centre de notre monde : mon père. » (Omar dans le roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, pp. 34-35) ; « Ma mère m’a trop aimé. […] Maman me parlait toujours en mal de papa. » (cf. la chanson « Luca Era Gay » de Povia) ; « Elle s’est mise à insulter l’Innommable, comme d’habitude. » (Dany parlant de sa mère par rapport à son père, dans le film « Xenia » (2014) de Panos H. Koutras) ; « Enlevez le micro des mains de mon idiot de mari. » (Tessa, la mère de Rachel l’héroïne lesbienne, dans le film « Imagine You And Me » (2005) d’Ol Parker) ; « On fait jamais rien avec ton père, tu sais bien. » (Laurent Spielvogel imitant sa mère s’adressant à lui, dans son one-man-show Les Bijoux de famille, 2015) ; « Est-ce que je fais de la dépression, moi ? Pourtant, j’aurais de quoi, avec le mari que j’ai… » (idem) ; etc. Cet assassinat n’est pas dû à une détestation claire et directe de la gent masculine, mais au contraire à une idolâtrie, une jalousie, un fanatisme idolâtre : « Vous rêviez toutes de cet homme, et vous l’avez écartelé. » (Magdalena parlant du Prince démembré par ses groupies, dans la pièce Les Divas de l’obscur (2011) de Stephan Druet)
Ce n’est pas uniquement le père du héros homosexuel qui est tué par la mère. Le prochain sur la liste, c’est le héros lui-même. Elle ne le tue pas nécessairement physique : elle le châtre plutôt, le castre, le mutile, l’anesthésie, brise en lui tout désir. « Mais je garde le meilleur pour la fin, mon petit Yvon. Le produit de la dernière salve du pendu marque aussi la fin de ta propre carrière de don Juan. Grâce à ce cocktail à base de mandragore pilée, tu ne pourras plus nuire à la gent féminine. Je t’ai coupé le sifflet. C’est fini, les prouesses libertines. Tu resteras impuissant jusqu’à la fin de ta vie. Ça t’apprendra à préférer les fillettes remplies de vin aux vraies femmes de chair et de sang. » (Groucha à Yvon le « beauf », dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 267) ; « Tu m’as castré. » (Stéphane à sa copine Lili, dans la pièce Le Clan des joyeux désespérés (2011) de Karine de Mo) ; « Alors oui, j’avoue monsieur le juge : je lui ai vraiment cassé les… Ah oui mais récemment hein, des œufs sur le plat… des œufs brouillés !! C’est arrivé un soir, clak, ahhhh il a hurlé, oui… À force de répéter que j’étais castratrice, et bien voilà oui, je le suis réellement devenu. […] En lui arrachant la bite je l’ai aidé à se transformer en femme, depuis le temps qu’il en rêvait ! » (la femme à propos de son ex-compagnon Jean-Luc, converti en homo, dans la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier) ; « Lui s’était, par accident, fait une irrémédiable mutilation dont on imagine la gravité, puisqu’il ne lui restait entre les jambes qu’un tout petit morceau sans rapport avec ce dont disposent même les plus indigents. » (Alexandra, l’héroïne lesbienne parlant du patron du café, castré par sa femme, dans le roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 216) ; etc. La femme phallique rêve d’avoir un pénis, et est même prête à le couper à son fils pour se le coller sur elle. « Si ma baguette casse, que le grand crick me croque. » (cf. la chanson « L’Histoire d’une fée, c’est… » de Mylène Farmer)
Par exemple, dans le film « New Wave » (2008) de Gaël Morel, la mère de Romain empoisonne son fils gay (elle met une surdose de médicaments dans son café pour l’endormir et le tuer). Dans la pièce La Muerte De Mikel (1984) d’Imanol Uribe, la mère possessive de Mikel finit par assassiner son fils. Dans la comédie musicale Pacific Overtures (1976) de Stephen Sondheim, le spectateur entend une chanson racontant l’histoire d’une mère qui empoisonne son fils lentement et jusqu’à la mort. On retrouve la mère tueuse dans le film « My Own Private Idaho » (1991) de Gus Van Sant, dans la pièce Hamlet, Prince de Danemark (1602) de William Shakespeare, dans le film « Serial Mother » (1994) de John Waters, etc. Dans la chanson « Bohemian Rhapsody » de Queen, Freddie Mercury chante que sa mère l’a tué : « Mama, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he’s dead. » Dans le film « Œdipe (N + 1) » (2001) d’Éric Rognard, la mère de Thomas décide de supprimer l’instance de son fils cloné quand celle-ci ne correspond pas au fils idéal souhaité et qu’elle lui désobéit.
Si le héros homosexuel survit à cette dictature maternelle mortifère, il y laisse en général son désir amoureux et génital pour les êtres du sexe « opposé ». À travers son homosexualité, et son engagement d’adulte en couple homo, il recherche quand même le confort douillet, infantilisant et déréalisant de la mère. Le matriarcat a vaincu, et se perpétue en lui, même si en apparence sa mère n’est plus présente au milieu des amants. Chacun des deux membres du couple homosexuel veut aimer et être aimé de l’autre comme il imagine qu’une mère aime passionnément son petit enfant : « J’avais éveillé sa fibre maternelle – c’est un trait de mon caractère, je semble produire cet effet-là chez tous les gens que je rencontre ! » (Jean-Marc décrivant son amant Gerry, dans le roman Le Cœur éclaté (1989) de Michel Tremblay, p. 100) La lourdeur du matriarcat semble concomitante à beaucoup de relations amoureuses homosexuelles racontées dans les fictions !
FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION
PARFOIS RÉALITÉ
La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :
À force d’être entourées de femmes dans leur famille, certaines personnes homosexuelles ont pu, à leur contact, développer par réaction une homosexualité. « Aujourd’hui, toutes les femmes me font horreur, et, plus que toutes, celles qui me poursuivent de leur amour ; elles sont malheureusement très nombreuses. En revanche, j’aime ma mère et ma sœur, de tout mon cœur. » (lettre de Ernst Röhm, à 42 ans, le 25 février 1929)
Tout au long du XXème siècle, les mouvements féministes, en lutte contre le « patriarcat hétérosexiste », et les mouvements de libération homosexuelle ont marché côte à côte (je vous renvoie en France aux nombreux croisements entre le FHAR – Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire – et le MLF – Mouvement de Libération des Femmes)… à tel point qu’on suspecte encore les associations féministes d’être des « repères de lesbiennes ». Même si le féminisme n’implique pas forcément la défense de l’homosexualité, on voit bien qu’il est une passerelle idéale au lesbianisme, ou du moins à la bisexualité.
Sans forcément en avoir conscience, aujourd’hui, les personnes homosexuelles, en cautionnant leur homosexualité et le couple homo sous les drapeaux du féminisme et du matriarcat social, défendent en réalité une asexualité, une surféminité de femmes phalliques qui ne respecte pas les femmes réelles, un déni de la castration, et donc des limites du Réel. Par exemple, dans le documentaire « Mamá No Me Lo Dijo » (2003) de Maria Galindo, certaines femmes féministes et lesbiennes sont en attente de la castration des hommes ; dans le documentaire « Se dire, se défaire » (2004) de Kantuta Quirós, Beatriz Preciado exprime l’envie d’avoir un pénis.
En janvier 1958, Lacan soutient que la plupart des individus homosexuels ont connu l’inversion des identités et donc des rôles entre leur père et leur mère : « C’est la mère qui se trouve avoir fait loi au père au moment décisif. » (Jacques Lacan, « Les formations de l’inconscient », Le Séminaire V, 1998, p. 210) Et cela est confirmé par certains d’entre eux: « Je suis allé voir une psy qui a voulu me faire comprendre que je suis PD et que je considère plutôt les femmes comme des mamans ou comme un trophée. Voila la résultante. Dans mon cas, c’est la mère sur-protectrice qui a joué le rôle du père. Et les femmes qui m’ont le plus excitées étaient des femmes à poigne, fortes, des femmes qui me disent non qui me résistent, qui sont masculines dans leur façon de penser, des femmes qui renvoient de la perversité – oui c’est le mot ! – ou des femmes qui me renvoient l’image de père. » (cf. le mail d’un ami homo, Pierre-Adrien, 30 ans, reçu en juin 2014) Tout concorde pour montrer que l’homosexualité prend racine dans la politique parricide d’une mère cinématographique abusive, d’une hyène de films pornos… et parfois d’une mère biologique machiste réelle. « J’appartenais à ma mère, selon la logique matriarcale. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 14) ; « Éric est victime de la ‘revendication virile’ de sa mère, celle de posséder le pénis. Chez une femme, cette revendication est d’abord d’ordre narcissique : quand elle découvre qu’elle ne possède pas le pénis, les petites filles se sentent humiliées. La mère a tendance à ‘déviriliser’ son fils, comme si elle s’emparait de sa virilité pour son propre usage, pour devenir l’homme qu’elle n’est pas. » (Virginie Mouseler, Les Femmes et les homosexuels (1996), p. 38) ; « Je sais bien que je suis la mère d’un enfant anormal. » (Estelle, la mère de Stéphane, homosexuel, dans l’autobiographie Et dans l’éternité, je ne m’ennuierai pas (2014) de Paul Veyne, p. 239) ; « J’accuse aujourd’hui ma mère d’avoir fait de moi le monstre que je suis et de n’avoir pas su me retenir au bord de mon premier péché. Tout enfant, elle me considère comme une petite fille et me préfère à ma sœur, morte aujourd’hui. De mon père, j’ai le souvenir lointain d’un officier pâle, doux, presque timide, perpétuellement en butte aux sarcasmes de son épouse. » (Jean-Luc, homosexuel, 27 ans, cité dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, p. 75) ; « Au départ de presque toutes ces lamentables existences, il y a les mères. Les petites vies étriquées de ces êtres qui vivent à deux ou se contentent des sordides aventures d’urinoirs sont les résultats de la bonne éducation, les fruits de leçons trop bien suivies sur la crainte du péché, les dangers de la femme, tout ce qui fait la honte d’une religion mal comprise. Cette haine de la femme et cet excessif attachement à la mère, je les ai connus et je sais qu’ils peuvent, par instants, atteindre à la véritable névrose. Encore aujourd’hui, je ne suis pas tout à fait habitué à l’absence de ma mère et, lorsque je suis loin d’elle, je cherche à la joindre par téléphone et lui écris tous les jours. C’est elle, cependant, qui est en grande partie responsable de mon état misérable, par la façon dont elle m’a obligé à vivre constamment sous son sillage. L’opinion que je me suis formée sur les femmes, je la dois selon moi, à ma mère : elle avait un caractère si malheureux que j’en suis arrivé maintes fois à me dire que mon angoisse vient de la crainte de tomber sur une femme semblable à elle. » (idem, p. 104) ; « Le taux considérablement supérieur d’homosexualité masculine s’explique par le fait que ce sont essentiellement les femmes qui ont la garde des enfants, d’où la difficulté pour le garçon d’acquérir une identité masculine faute d’un modèle à admirer et imiter. » (Thomas Montfort, Sida, le vaccin de la vérité (1995), p. 21) ; etc.
Par exemple, dans l’émission 100% Politique de Patrick Buisson traitant du « communautarisme gay » sur la chaîne LCI en 2003, le romancier homosexuel Guillaume Dustan explique que l’homosexualité masculine vient du fait que les individus gays ont eu « peur de leur mère » : « Je pense que ma mère était beaucoup plus meurtrière à mon égard que mon père. Ma mère, elle voulait vraiment vraiment vraiment ma mort. »
L’action homosexualisante que peuvent avoir certaines mères vis à vis de leur fils ou de leur fille n’est pas tant une homosexualisation qu’une asexuation ou une inversion de sexes (ce n’est qu’après avoir été modifié dans son identité que la personne homosexuelle se posera la question de son désir sexuel) : « Je suis la dernière d’une fratrie de 3 enfants et seule fille. Ma mère m’a toujours considérée comme son ‘troisième fils’. Il en a résulté une garçonnisation volontaire de sa fille : elle m’habillait comme mes 2 frères, me faisait raser les cheveux à la tondeuse chez le coiffeur du village, disait à tout le monde que j’étais un ‘véritable garçon manqué’. Et ce travestissement de mon enveloppe corporelle était si réussi, que les gens qui ne me connaissaient pas me disaient ‘Bonjour mon garçon’. À chaque ‘bonjour garçon’, je sentais le couperet de la guillotine me tomber sur la nuque. J’avais honte de ce à quoi je ressemblais, mais je ne pouvais lutter car ma mère était violente avec moi si je tentais de me rebiffer. Alors, j’ai fini par adopter les codes des garçons : marcher comme un mec, parler comme mon père et mes frères, regarder les filles comme mon père et mes frères les regardaient, me battre avec les copains comme un vrai mâle. Il arrivait même que des filles de mon âge qui me voyaient pour la 1ère fois soient troublées par moi et tombent sous mon charme. Alors, je les séduisais. Ce travestissement a duré jusqu’à l’âge de 12 ans, âge où ma mère m’a mise à l’internat pour filles. Le jour de la rentrée, j’entends encore raisonner en moi la parole méchante et ironique dite avec un rictus moqueur ainsi qu’un léger pouffement de rire de la part du père d’une fille ‘tiens, y’a des garçons dans cet internat ?’. Là, je me suis dit ‘c’en est trop, je veux être une fille’. Quelque mois après, je suis tombée follement amoureuse de ma prof de français à l’internat. Belle femme douce, féminine et ferme. Tout l’opposé de ma mère. Et ça a été le point de départ d’une lutte tenace pour m’affranchir de la méchanceté de ma mère. Mais j’ai réussi à devenir une belle femme. Dans mon entourage, personne ne connaît mon combat et cet attrait si puissant pour les femmes. » (une amie lesbienne, Valérie, 31 ans, qui m’a écrit ce mail en 2012)
Par exemple, dans l’émission Infra-Rouge intitulée « Souffre-douleurs : ils se manifestent » diffusée sur la chaîne France 2 le 10 février 2015, le jeune Lucas Letellier, lycéen se disant « homosexuel », témoigne du harcèlement scolaire qu’il a subi, aux côtés de sa mère, une femme agressivement gay friendly, qui, derrière un soutien expansif, marque bien son territoire (et le fils ne s’en révolte même pas !) : « T’es toujours mon grand bébé quand même ! »
Autre exemple : la mère de Charles Trénet a empêché le mariage de son fils homosexuel avec la femme qu’il aimait, Monique Pointier. Dans le docu-fiction « Le Dos rouge » (2015) d’Antoine Barraud, Bertrand Bonello est obsédé par le monde de la peinture : « Pourquoi cette attirance pour les musées ? Il ne l’a jamais su. » (la voix-off de la mère de Bertrand, parlant de son fils) Il rêve de fuir sa réalité pour pénétrer dans les toiles, et sa mère l’a initié à cette drogue : « C’était comme une maison de poupées. Un théâtre de marionnettes. On passait des heures devant les agneaux à deux têtes. Il était bouleversé. Nous étions en plein syndrome de Stendhal. Ivres de beauté. Il voulait vivre là. À côté. Et moi j’étais là, sans savoir quoi faire. C’est dans un musée que j’ai senti que mon fils était un homme. » (la voix-off de la mère de Bertrand)
L’idéal féminin de nombreuses personnes homosexuelles est une mère symbolique castratrice : « À Vienne, Gustave Klimt, à Paris, Regnault, le jeune prix de Rome ami de Mallarmé, Gustave Moreau dont c’est le cœur de la mythologie intime, à Londres Oscar Wilde et Aubrey Bearsley, en Allemagne von Stuck, en Belgique Delville, Toorop, Mellery ou Ferdinand Knopff : tous ont été obsédés par le thème de la femme destructrice. Ce ne sont qu’Hérodiades, Salomés et Judiths, que femmes thraces déchirant le corps d’Orphée ou contemplant rêveusement sa tête coupée. On retrouve, en costumes 1900, les mêmes redoutables et sataniques amazones dans les romans de l’époque : chez D’Annunzio (Il Triomfo Della Morte), chez Pierre Louÿs (La Femme et le pantin) ou Octave Mirbeau (Le Jardin des supplices). L’homme – ou ce qu’il en reste : la tête, belle, douloureuse et asexuée – est donc chaque fois la victime d’une femme et comme prédestiné à l’être par ses aspirations célestes et sa nature ambiguë. » (Françoise Cachin, « Monsieur Vénus et l’ange de Sodome : L’androgyne au temps de Gustave Moreau », Bisexualité et Différence des sexes (1973), pp. 84-85) ; « Ma mère était assez violente, peut-être plus que mon père, en réalité, et dans la seule confrontation qui, à ma connaissance, les opposa physiquement, ce fut elle qui le blessa, en lançant sur lui le bras du mixeur électrique qu’elle était en train d’utiliser pour préparer une soupe : le choc fut tel qu’il en eut deux côtes fêlées. Elle est assez fière de ce fait d’armes, d’ailleurs, puisqu’elle me l’a raconté comme on raconte un exploit sportif. » (Didier Éribon, Retour à Reims (2010), p. 81)
Il n’est pas exagéré de parler de meurtre symbolique du père ou de l’homme dans notre société. Cela n’a pas exactement à voir avec la question de la « masculinité » (ou même du « genre », cette nouvelle entourloupe idéologique trouvée par les Queer & Gender Studies pour maquiller ce meurtre castrateur de la « domination masculine » orchestrée par une société du « tout génital sans le sexuel » ; c’est pourquoi je ne suis pas complètement d’accord avec Élisabeth Badinter quand elle écrit dans son essai X Y de l’identité masculine (1992) que « les crises de la masculinité naissent dans les pays à la civilisation raffinée, où les femmes jouissent d’une plus grande liberté qu’ailleurs. », p. 25). Il s’agit plus d’une crise de la sexuation que de la masculinité. Cela dit, l’étude que mène Badinter est très pertinente par rapport au thème du parricide et de la misandrie : elle a relevé que dans les romans du XXème siècle, la figure de « l’homme qui pleure » était particulièrement récurrente. Cette tendance au massacre du cœur des hommes via l’humiliation des hommes-objets (= c’est le système des poupées vaudous) s’observe aussi dans les films et les publicités, où les hommes et les pères s’en prennent plein la figure, et sont montrés comme des gros bébés immatures. L’homosexualité sera la proposition sociale fleurie, la méthode douce, pour tuer le père à petit feu, l’air de rien. « Pour nous, les enfants, il y avait entre nos parents comme une cloison étanche. Pour moi, de onze à quinze ans, il y eut deux mondes sans communication possible. Le monde de la mère et le monde du père. Incompatibilité renforcée par la division politique : le monde de la mère gaulliste et le monde du père collabo. Mais la division politique restait secondaire par rapport à la coupure morale décidée par notre mère, veto originel et d’autant plus fort, d’autant plus paralysant qu’il n’était pas exprimé. Affreuse oppression du non-dit.[…] Je m’obligeais en moi-même à rester étranger à celui que ma mère me désapprouvait de continuer à reconnaître pour mon père. » (Dominique Fernandez, Ramon (2008), pp. 36-37) ; « J’avais intériorisé l’interdit maternel. […] Amoureux de mon père, je l’ai toujours été, je le reste. Ma mère, je l’ai admirée, je l’ai crainte, je ne l’ai pas aimée. Lui, c’était l’absent et c’était le failli, l’homme perdu, sans honneur. C’était le paria. » (idem, p. 45)
Par exemple, en me rendant à la projection d’un navet tel que « La Croisière » (2011) de Pascale Pouzadoux, je n’ai pas eu de mal à voir quelle mauvaise pente veulent nous faire prendre beaucoup de productions cinématographiques actuelles. Dans ce film, on ne nous montre que des hommes émasculés : entre les curés frustrés sur le point de se défroquer, les hommes qui reçoivent des bouchons de champagnes dans les couilles, les maris qui délaissent leur femme et oublient leur anniversaire, les types qui s’égarent à tout jamais dans les toilettes, les chefs qui démissionnent de leur poste (Alix dira au capitaine du bateau, Jean Benguigui, qui veut fuir son navire, qu’il « ne sert à rien »), les queutards menottés et réduits au silence, les mecs défigurés sur des civières… le tableau de la gent masculine n’est pas brillant ! Symboliquement, c’est le désir masculin tout entier qui est mis à mort. Et bien sûr, les femmes toutes-puissantes, avec plusieurs maris ou/et célibattantes, ont le dernier mot ! Le seul homme (Raphaël) qui va trouver grâce aux yeux de ces despotes femelles, et qui réussit à tirer son épingle du jeu dans le film, il sera dans l’obligation de se travestir. Mieux : de s’homosexualiser ! Hortense, au moment de tomber amoureuse de lui, conclura : « J’ai envie d’être homosexuelle… avec un homme. » On a là la démonstration par a + b d’une parfaite homosexualisation par le matriarcat !
Dans la pièce Desperate Housemen (2010) de Stéphane Murat, les comédiens évoquent la féminisation de la société et des « auteurs » littéraires actuels, tels que Marc Lévy ou Guillaume Musso, qui, pour leurs titres de romans, ne choisissent que des questionnements très féminins : Seras-tu là ?, Où es-tu ?, Que serais-je sans toi ?, Je reviens te chercher, etc.
On constate, chez les sujets homos, que l’influence maternelle dans l’affirmation future de leur homosexualité, est en général capitale. Par exemple, certains hommes gays ont été habillés dans leur enfance en fille par leur mère : c’est le cas de Gabriele D’Annunzio, Félix Youssoupov, Oscar Wilde, Federico García Lorca, André Gide, etc. « Lors de la naissance d’Oscar, lady Wilde n’a pas voulu accepter l’idée que le destin pût lui donner un autre garçon. Pour elle, ce second enfant est une fille et c’est en fille qu’elle l’élève : elle fait de lui sa compagne ; surtout, elle l’exhibe, le caresse, le guide comme une petite fille. Il n’a pas de jeux de garçon : ondulé, paré, parfumé et pur, il fait de la tapisserie. Pour lui, son père est laid, sale, débraillé, puant l’alcool. Quant à son frère Willie, il n’est qu’un vice incarné. » (Jean-Louis Chardans, Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p. 75) ; « C’est ainsi qu’au plus secret de moi-même, dès mes premières années d’enfance, j’ai voulu imiter ma mère ; par instinct, mais aussi par orgueil, je me suis comporté en femme. » (idem, p. 80)
Le dressage castrateur ne se limite pas aux vêtements. Ce sont l’attitude, la gestuelle, la sociabilité, qui se coulent dans le moule maternaliste. « C’est elle qui souvent rappelait à l’ordre son fils lorsqu’il se servait de sa voix basse. » (Sandor Ferenczi concernant le cas d’une mère de fils homosexuel, « Le Rôle de l’homosexualité dans la pathologie de la paranoïa » (1911), cité dans l’ouvrage collectif L’Homosexualité de Platon à Foucault (2005) de Daniel Borillo et Dominique Colas, p. 413)
Les mères des personnes homosexuelles sont autant celles qui habillent leur fils en fille que celles qui les force à incarner, par purisme sexiste, l’« éternel masculin », qui ne supportent pas le moindre écart de conduite appartenant soi-disant uniquement aux membres de l’autre sexe (ex : « Les garçons, ça ne pleure pas » ; « Les filles, c’est sensible et ça ne cherche pas la bagarre »), qui sacralisent la différence des sexes de manière rigide et bourgeoise : « Elle détestait particulièrement les chochottes. » (Frédéric Mitterrand en parlant de sa mère, dans son autobiographie La Mauvaise Vie (2005), p. 89) ; « La plupart du temps ils me disaient ‘gonzesse’, et ‘gonzesse’ était de loin l’insulte la plus violente pour eux. […] Même ma mère disait d’elle ‘J’ai des couilles moi, je me laisse pas faire’. » (Eddy Bellegueule dans son autobiographie En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, p. 30) ; etc. Et à ce titre, le jugement de Badinter « Les hommes sont plus homophobes que les femmes. » (Élisabeth Badinter, X Y de l’identité masculine (1992), p. 177) mériterait, à mon sens, d’être revu…
Pour continuer dans cette lancée, on observe que l’homosexualité est souvent le fruit d’une castration, d’une humiliation imposée par la maman. Par exemple, dans l’autobiographie d’Abdellah Taïa Une Mélancolie arabe (2008), Slimane, homosexuel, a été battu par sa mère, « une vieille femme autoritaire » (p. 106), durant son enfance. Dans le film « Moonlight » (2017) de Barry Jenkins, la mère de Chiron, le jeune héros homosexuel, se moque de lui et de sa « démarche » efféminée.
Cette mère incestueuse qui homosexualise, choie, et soumet, peut tout à fait être un homme, un père, ou tout simplement jouer à l’homme en s’homosexualisant. Par exemple, toujours dans Une Mélancolie arabe, Taïa se dit « protégé par un père tendre et une mère un peu sorcière. » (p. 31) Le matriarcat n’a pas de sexe ; c’est avant tout un désir machiste, incestueux, qui écoute tout mais qui n’entend rien. Qu’il soit appliqué par un homme ou femme, peu importe, finalement.
Il n’y a pas que les hommes réels qui pâtissent de la propagande des amazones phalliques. Le pire, c’est que ce sont aussi les femmes réelles qui sont victimes des revendications de ceux (les « féministes », les filles à pédés, les femmes lesbiennes, les mères vengeresses, les hommes et des femmes surprotecteurs) qui prétendent les défendre. Le sexisme pro-femmes ou pro-mères fait des dégâts collatéraux, et instille la misogynie dans les veines de nombreux êtres humains (futurs homosexuels ?) : « Durant ce temps, ma mère ne cesse de tisser autour de ma vie d’enfant un véritable cocon de tendresse mais se garde bien de m’élever en garçon. […] Je n’avais aucune pensée sexuelle à l’égard de l’autre sexe car, pour moi, un être féminin était neutre et je n’aurais su que faire avec lui ; toute femme, pour moi, à cette époque, était une mère. Je surpris néanmoins, un soir, à la campagne, une jeune fille qui se baignait dans un ruisseau, n’ayant pour tout vêtement que sa chemise. Je n’eus pas le courage de regarder bien longtemps et je m’enfuis chez moi pour conter, en toute sincérité mon aventure… à ma mère. C’était la première fois, au cours de mes douze années d’existence, qu’il m’avait été donné d’approcher une femme inconnue… surtout dans une tenue aussi sommaire. Ma mère me fit la morale et brossa pour moi un tel tableau physique et moral des femmes que je n’en dormis pas de la nuit : la femme, la jeune fille… êtres abjects, lâches, sans hygiène ; la nudité… quelle horreur !… surtout chez la femme, cet être perpétuellement maudit… C’est ainsi que, par suite des extraordinaires révélations de ma mère, le sexe féminin me fut à jamais interdit alors que cette même occasion aurait pu doucement me le révéler… […] Tout en me chérissant, ma mère me présentait les relations avec l’autre sexe comme un mal immoral. […] Hormis ma mère, la bonne et la cuisinière, je ne voyais jamais de femmes… et encore moins de petites filles. […] Si, dans une famille, la mère est la plus forte, les enfants se disent alors : ‘Je voudrais être une femme, pour dominer et conquérir avec ces mêmes armes.’ » (Jean-Luc, homosexuel, 27 ans, parlant de ses premières années, à 9-12 ans, cité dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, pp. 76-78) ; « Mon père a eu une très mauvaise influence sur mon adolescence. Et ma sœur et moi, nous avons été élevées dans la haine du père. Par ma mère, d’ailleurs, qui nous a montées contre notre père. » (Germaine, femme lesbienne suisse, dans le documentaire « Les Homophiles » (1971) de Rudolph Menthonnex et Jean-Pierre Goretta)
Le problème de cette agression féministe/maternante, c’est qu’elle s’annonce sous les hospices de la douceur, de la mode, de la sensibilité, de l’écoute « participative », de l’amour, de la sécurité. « Toute ma vie des femmes auront monté la garde autour de moi. » (Pascal Sevran, Le Privilège des Jonquilles, Journal IV (2006), p. 41) ; « Les garçons manqués […] sont d’authentiques casse-cou. Moi, bien au contraire, je dois rester tranquille dans mon coin et surtout ne pas remuer trop d’air parce qu’on craint toujours qu’il m’arrive un accident. […] Ma mère est inquiète […] Mon père n’est pas en reste. Quand on se promène, je ne peux pas accélérer un tant soit peu l’allure sans que je l’entende prophétiser derrière moi : ‘Tu vas tomber’, et je tombe, en effet, comme si j’avais à cœur de lui donner raison. […] On m’élève dans du coton comme si je risquais de me briser. On veille constamment à ce qu’il ne m’arrive rien de fâcheux. Et on ne cesse de me répéter que c’est parce qu’on aime beaucoup l’enfant gâtée que je suis qu’on agit ainsi. » (Paula Dumont, Mauvais Genre (2009), p. 51-52) La mère d’enfant homosexuel n’est pas tant violente d’avoir été sciemment méchante que d’être sincère et trop aimante. C’est la violence troublante de l’inceste, celle qu’on n’attend pas étant donné sa proximité, sa familiarité, sa beauté. « La bonne mère est naturellement incestueuse et pédophile. » (Élisabeth Badinter, X Y de l’identité masculine (1992), p. 76) ; « Jocaste a-t-elle su et voulu vivre l’inceste avec son fils ? Les femmes d’aujourd’hui veulent-elles et savent-elles ce qu’elles font en prenant la première place auprès de leur enfant ? Ont-elles connaissance de ce qu’elles déclenchent ainsi chez leurs fils, chez leurs filles ? Ces femmes qui disent le plus naturellement du monde, en parlant de leur fils ‘il fait son Œdipe’, pensent-elles une minute ‘et moi je fais ma Jocaste’ ? Si Œdipe est considéré comme le modèle universel de l’homme, Jocaste ne peut-elle pas être tenue pour le mythe éternel de la femme-mère ? » (Christiane Olivier, Les Enfants de Jocaste (1980), p. 12) Une trop grande sollicitude maternelle peut engendrer plus tard une misanthropie, un rempli narcissique d’ordre sexuel (= l’homosexualité), chez le fils surprotégé : « Lorsque j’étais enfant, nous habitions un quartier appelé Marrac ; ce quartier était plein de maisons en construction dans les chantiers desquelles les enfants jouaient ; de grands trous étaient creusés dans la terre glaise pour servir de fondations aux maisons, et un jour que nous avions joué dans l’un de ces trous, tous les gosses remontèrent, sauf moi, qui ne le pus ; du sol, d’en haut, ils me narguaient : perdu ! seul ! regardé ! exclu ! (être exclu, ce n’est pas être dehors, c’est être seul dans le trou, enfermé à ciel ouvert : forclos) ; j’ai vu alors accourir ma mère ; elle me tira de là et m’emporta loin des enfants, contre eux. » (Roland Barthes, « Un Souvenir d’Enfance », Roland Barthes par Roland Barthes (1975), p. 111)
Michel Schneider, dans son excellent essai La Confusion des sexes (2007), nous parle de la « politique maternaliste du non-sexe » (p. 23) que nos sociétés actuelles mettent insidieusement en place, du « maternalisme désexualisant » (idem, p. 27), celui qui nous prive de désir (du Désir) : « Les familles se structurent de plus en plus autour des femmes (en cas de séparation, l’enfant et la résidence sont presque toujours confiés à la mère). » (idem, p. 82) ; « Les mères feraient-elles des maîtres moins tyranniques que les pères ? Le pouvoir moderne serait-il moins absolu d’être exercé par des femmes ou par des hommes s’inspirant de ce qu’ils pensent être des vertus maternelles ? Mais d’où tire-t-on de l’Histoire l’idée que la politique serait une histoire d’amour, une affaire de cœur ? N’y a-t-il pas là dénégation du lien fondamental entre le pouvoir et la violence, entre la politique et la mort ? » (idem, p. 36) Éric Zemmour va le sens de Schneider quand il écrit que l’uniformisation des rapports femme-homme participe d’un même asexuation sociale à visage maternel : « Il n’y a plus d’hommes, il n’y a plus de femmes, rien que des êtres humains égaux, forcément égaux, mieux qu’égaux, identiques, indifférenciés, interchangeables. […] on suggère la supériorité évidente des ‘valeurs’ féminines, la douceur sur la force, le dialogue sur l’autorité, la paix sur la guerre, l’écoute sur l’ordre, la tolérance sur la violence, la précaution sur le risque. […] La société unanime somme les hommes de révéler la ‘féminité’ qui est en eux. » (Éric Zemmour, Le Premier Sexe (2006), p. 10) ; « Le patriarcat, c’est l’accumulation des petits et grands secrets, pour se forger en dehors de la mère ; le matriarcat, c’est la transparence, la mise à mort de tous les secrets, la fusion placentaire. Comme dans tout régime totalitaire, le secret, voilà l’ennemi. L’homme finit par s’y résoudre. C’est lui qui doit guérir. Qui doit se transformer. Qui doit lier désir et sentiment, sexe et famille, pulsion et fidélité. C’est l’homme qui doit devenir une femme. » (idem, p. 47)
Alain Finkielkraut et Pascal Bruckner, dans Le Nouveau désordre amoureux (1977), évoquent à juste titre le culte moderne non de la « Surfemme » mais plutôt du « Surhomme féminin » (p. 83). Ce n’est pas un hasard si, dans l’esprit et le discours d’un certain nombre de personnes homosexuelles, la mère est confondue avec la femme-objet macho (partiellement incarnée en la personne transsexuelle, la prostituée, ou la femme lesbienne) : « À la fête de l’Huma, j’étais à côté d’une transsexuelle, à la peau bleutée. Rapprochement inconscient avec ma mère. » (Annie Ernaux, Je ne suis pas sortie de ma nuit (1997), p. 42) ; « Lorsque j’ai eu 40 ans, elle m’a dit : ‘Maintenant, tu fais ce que tu veux, mais, surtout, ne dis rien à ton père, ne lui montre jamais que tu es comme ça, il va dire que c’est de ma faute, que je suis une prostituée.’ » (Brahim Naït-Balk citant sa mère, dans son autobiographie Un Homo dans la cité (2009), p. 89) ; « Je t’avais demandé ce que voulait dire le mot ‘pute’. Tu m’avais expliqué que c’était une femme qui se donnait aux hommes contre de l’argent. Et sans que j’insiste, tu as voulu préciser ce que signifiait puto, pute au masculin. Tu m’as dit que c’était de cette façon qu’un homme allait par plaisir avec un homme, mais qu’il devait payer. Je t’ai demandé pourquoi. Tu m’as dit que ces hommes-là étaient généreux. Je ne comprenais toujours pas. » (Alfredo Arias à sa grand-mère, dans son autobiographie Folies-Fantômes (1997), p. 161) ; « Tu me rappelais souvent que le premier mot que j’aie prononcé était ‘pute’. » (idem, p. 164) ; « Lito [une femme transsexuelle transformée en homme] avait fait converger toutes ses forces dans le but unique d’imiter sa mère. Dans l’intimité, il s’habillait comme elle. Il interprétait le répertoire lyrique qui avait fait la gloire de Katia. Elle acceptait volontiers cet hommage filial et le miroir qu’il lui tendait : elle se voyait plus jeune et, grâce à ce subterfuge, elle parvenait à se croire éternelle. » (Alfredo Arias, idem, p. 291) ; « J’avais seize ans quand ma grand-mère est venue voir ma première pièce représentée, avec les meilleures comédiens argentins. Une des vieilles comédiennes avait été sa maîtresse. » (Copi évoquant sa grand-mère lesbienne, dans l’article « Entretien avec Michel Cressole : Un mauvais comédien, mais fidèle à l’auteur » de Michel Cressole, le journal Libération du 15 décembre 1987) ; « Mamie Jeannine a divorcé lorsque mon père avait 3 ans. Elle a quitté son mari pour Jacques Larue, cet homme dont elle est tombée passionnément amoureuse. Mamie était d’une incroyable modernité ! À l’époque, ça ne se faisait pas de divorcer, ni de porter de pantalon, ou d’avoir les cheveux coupés court à la garçonne ! Mais mamie s’est toujours moquée du qu’en-dira-t-on. Elle était libre ! […] Avec mamie, on discute des heures, ‘on blague’, comme elle dit, et on rit. Des bavards invétérés ! Je l’ai convertie à la sitcom britannique hilarante ‘Absolutely Fabulous’. Une mamie branchée, croyez-moi ! D’une incroyable modernité. Parfois, on va au cinéma tous les deux. Je me souviens comme si c’était hier du jour où nous sommes allés ensemble au multiplex voir le film ‘Pourquoi pas moi’. Une comédie kitsch sur le coming out. […] Un nanar totalement oublié mais qui tient une place à part dans mon coeur tant il est lié à un moment crucial de ma vie. Mamie a adoré ! Évidemment, elle a tout compris, pas besoin de mettre des mots. Juste son regard, doux, malicieux et bienveillant, suffit à exprimer tout l’amour qu’elle me porte. Je sais qu’elle m’aime comme je suis. » (c.f. l’autobiographie Fils à papa(s) (2021) de Christophe Beaugrand, Éd. Broché, Paris, pp.36-39) ; etc.
L’homosexualité est bien un désir machiste peinturluré de rose, un rose souvent porté et défendu par les femmes, les mères, et les hommes faibles. « Ma mère m’a soupçonnée d’être lesbienne avant que je ne le sache moi-même. » (Lidwine, femme lesbienne de 50 ans, dans l’essai Se dire lesbienne (2010) de Natacha Chetcuti, p. 67) ; « Elle passait la soirée chez la voisine. Elle rentrait ivre avec la voisine, elles se faisaient des blagues lesbiennes ‘Je vais te bouffer la chatte ma salope’. » (Eddy Bellegueule à propos de sa mère, dans son autobiographie En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, p.66). Et ce désir machiste n’est pas réellement sexué, puisqu’il concerne aussi les femmes lesbiennes, niées dans leur féminité et masculinisées, quelque part : « Nous autres voulons dans notre folie faire de la femme un instrument de pensée logique, nous lui apprenons tout ce qui est possible. Je trouve cela catastrophique. Nous masculinisons les femmes de telle sorte qu’à la longue la différence sexuelle et la polarité disparaissent, que nous voulions tant les masculiniser qu’avec le temps la différence entre les sexes, la polarité disparaîtra. Dès lors, le chemin qui mène à l’homosexualité n’est pas loin. Nous masculinisons également trop notre jeunesse. Il est catastrophique qu’un jeune soit raillé au-delà de la normale parce qu’il est amoureux d’une fille, que pour cette raison on ne le prenne pas au sérieux, qu’on le prenne pour un faible. ‘Il n’y a que des amitiés de garçon. Ce sont les hommes qui décident sur terre’, lui dit-on. L’étape suivante, c’est l’homosexualité. J’estime qu’il y a une trop forte masculinisation dans l’ensemble du mouvement[nazi], et que cette masculinisation contient le germe de l’homosexualité. » (Himmler, cité dans l’essai Le Rose et le Brun (2015) de Philippe Simonnot, pp. 260-263) ; « Je suis arrivée au pensionnat à l’âge de 14 ans. J’étais très naïve. Et je me suis retrouvée très tôt face à ces problèmes. Et j’ai été choquée. Il ne se passait que ça autour de moi, et je ne voulais pas le voir. Et j’en étais choquée. Depuis la surveillante qui couchait avec la surintendante, jusqu’aux élèves qui partageaient ma chambre, il n’y avait que ça autour de moi. » (Germaine, femme lesbienne suisse, dans le documentaire « Les Homophiles » (1971) de Rudolph Menthonnex et Jean-Pierre Goretta) ; etc.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.
Dénoncer le Gender sans le diaboliser
C’est compliqué. À la fois il reste nécessaire de combattre le Genre, mais sans le diaboliser, car il comporte des choses positives, il exprime des gênes justifiées. J’en parlais avec Élizabeth Montfort, qui est tout à fait d’accord avec moi : la dénonciation de l’hétérosexualité, de l’homophobie, de la pratique homo, de l’étiquetage des personnes selon leur apparence physique, selon leurs désirs sexuels et leurs pratiques sexuelles, impulsée par la théorie du Genre, n’est pas à jeter! Vraiment, la seule chose qui doit nous choquer dans le Gender, c’est la confusion entre l’amour femme-homme et l’hétérosexualité (ou entre le genre-paraître et le genre-sexuation).
Lutter contre le Gender : Mais quelle semi-ânerie !
Le Gender est devenu l’ennemi commun facile des anti-Loi Taubira. Or il n’y a pas à lutter contre. Il y a à l’identifier, à savoir qu’il existe, et à reconnaître qu’il s’est choisi les bons ennemis à détruire : l’hétérosexualité en premier lieu, l’homophobie en second. Son seul problème, c’est qu’il attaque ensuite la sexuation humaine et qu’il présente une vision conflictuelle de la différence des sexes ; autrement dit, c’est sa confusion entre l’hétérosexualité et les couples femme-homme aimants. Mais mis à part cet amalgame qui fout tout en l’air, les motivations premières du Gender sont presque justes ! Donc ne tirons pas sur le Gender, ne le diabolisons pas ! Les pro-Gender font de même : ils sont aussi CONTRE le Gender !
Ne combattons pas comme de gros bourrins contre le Gender
NE COMBATTONS PAS COMME DE GROS BOURRINS CONTRE LE GENDER: LUTTONS JUSTE POUR PROMOUVOIR LA DIFFÉRENCE DES SEXES NON-CONFLICTUELLE OU AIMANTE.
Attention, mes amis. Dès qu’un mot inconnu devient à la mode, surtout dans un contexte de violences et de désenchantement croissant vis à vis du gouvernement, surtout en plein combat contre une pieuvre dont les têtes repoussent sous des formes nouvelles, il faut vraiment nous méfier de nous-mêmes… ou bien, dit autrement, ne pas confondre les têtes de la pieuvre avec la pieuvre elle-même ! C’est le risque que je vois dans cette nouvelle croisade de certains anti-mariage-pour-tous excédés contre le « Gender ».
Tenez-le-vous pour dit. Rien ne sert de lutter contre le « Genre » (ou le « Gender »). Car ceux qui appliquent l’idéologie du « Gender » sont eux-mêmes contre le genre (ils confondent genre-image et genre sexué) ! Il faut bien le comprendre. Je lisais tout à l’heure une phrase du document « Éduquer contre l’homophobie dans l’école primaire » qui vient de sortir en mai dernier, et qui illustre tout à fait ce que soutiennent des experts du « Gender » tels qu’Élisabeth Montfort, Michel Boyancé ou moi-même : le « Genre » est une idéologie pour et contre elle-même, qui va se mettre à défendre puis dans le même mouvement à détruire ce « genre » qu’elle substitue à la différence des sexes et qu’elle adore au point de le massacrer à partir du moment où il devient corporel, concret, sexué, défini, singulier, réel, limité, pensé : « Il s’agit de lutter contre les stéréotypes, de promouvoir la diversité. Pas question donc de cultiver le genre à l’école ! Pas question, par exemple, d’écrire les prénoms des filles en rose et ceux des garçons en bleu ! Ni de s’adresser régulièrement de manière collective « aux filles » ou « aux garçons ». Attention aussi à la manière de répartir les tâches et les activités entre les élèves. Différencier, oui, mais pas selon le sexe. » (le « psychologue » Serge Héfez, p. 20)
Donc ne faisons pas comme ces pro-Gender qui nient ce qu’ils défendent. N’aboyons pas dès que nous entendons le mot « Genre » : nous imiterions nos ennemis. Nous avons juste à défendre une conception non-conflictuelle de la différence des sexes, là où les pro-Gender n’associent la différence des sexes qu’à une défense crispée et bourgeoise du rapport de domination de l’homme sur la femme. Le meilleur moyen de lutter contre le « Gender », c’est de ne pas le dénoncer, mais de défendre les couples d’amour homme-femme, la beauté de la différence des sexes. Et malheur à ceux qui défendront l’hétérosexualité !
Ne parlons pas du « Gender ». Ça ne sert à rien. Osons juste parler d’amour incarné !
Je sais que maintenant le « Gender » est la nouvelle bête à abattre après le « mariage pour tous ». Mais quand même : personne ne nous interdit d’être subtils et intelligents après notre « défaite ».
Un conseil. Rien ne sert de s’opposer à la « Théorie du Genre » en l’appelant ainsi. Rien ne sert de s’afficher anti-Gender, d’annoncer ses désastres ou les lobbys qui le promeuvent, de jeter le « Genre » à la vindicte populaire. Car ceux qui croient au Gender, qui le pratiquent et le défendent, n’ont même pas conscience qu’il s’appelle ainsi. Pour eux, c’est l’Amour avec un grand A. Le Gender, c’est l’ « être amoureux ». Ils aiment cette idéologie à partir du moment où elle ne porte pas de nom officiel, où elle ne peut pas être définie. Donc arrêtons de dire qu’il faut combattre les dangers du Gender. Ça ne sert à rien!
Tant que nous ne leur parlerons pas explicitement d’AMOUR (corporel, biologique, incarné, concret, divin), tant que nous ne les rejoindrons pas dans leur discours affectif et émotionnel des « sentiments », tant que nous resterons centrés sur le mot « Gender », nous ne ferons pas avancer les mentalités. Les gens n’ont soif que d’une chose : un discours sur l’AMOUR et sur les IDENTITÉS INATTENDUES !
Les paradoxes de la Théorie du Genre
La théorie du Genre tente inconsciemment de neutraliser par les bons sentiments la réalité (naturelle mais pour autant libre, mouvante, non-évidente, mystérieuse) de la sexuation humaine, et donc de la rencontre heureuse des sexes. Elle postule que la Culture, du fait qu’Elle se supplanterait obligatoirement à la Nature, est à la fois le seul dieu à suivre (temporairement et toujours au pluriel !), mais également le diable en personne à éviter car Elle modèlerait et formaterait tous les êtres humains dès leur naissance. Il y a bien dans la Gender Theory ce double mouvement idolâtre (passionné et haineux) vis à vis de la Culture, confondue avec la Nature (c’est la raison pour laquelle un « sociologue » comme Éric Fassin, par exemple, déclarera à la revue Têtu que « les députés [en s’opposant à la Théorie du genre] confondent genre et sexualité »… car c’est bien lui et ses suiveurs qui font cet amalgame, et qui imposent que l’être humain soit soumis à ses pulsions naturelles !). Le credo des défenseurs du « genre » (et de tous ses dérivés : « la différence des genres », « les identités de genres », etc.), est assez simpliste : comme tout ce qui est humain est culturel, donc forcément relatif, individuel, mobile, secondaire, alors tout, même le naturel, n’est qu’image fausse, que point de vue non-universable. Autrement dit, pour les défenseurs de la Théorie du Genre, les apparences sont toujours trompeuses. Y compris les corps, les réalités terrestres, les actes humains (Exemple de raisonnement queer infantilisant : « Un homme efféminé n’est pas forcément homosexuel… et n’est même pas forcément, pour le coup, un homme non plus. Nos identités profondes, si tant est qu’elles existent, dépendent d’abord des choix et des droits que nous avons à notre disposition. Pas de notre société, de notre corps, de notre apparence extérieure, ni des actes que nous posons. »). Au final, cette idéologie antinaturaliste (mais fortement sensitive, sensibleriste, hédoniste, individualiste) propose une vision de l’existence désenchantée et pessimiste, où le sexe est remplacé par les images médiatique des sexes, des images d’un zapping étourdissant et sans fin/but. Selon les défenseurs du Gender, on ne pourrait jurer de rien dès qu’on parle d’identité sexuée et d’amour, puisqu’on ne peut être sûr de tout : syllogisme totalitaire et capricieux s’il en est ! Il n’y a aucun encouragement à la confiance, à l’engagement d’amour unique, à la recherche collective de Vérité, à la reconnaissance adulte des limites structurantes du Réel, à la responsabilité de ses actes. Derrière un discours apparemment ouvert à la diversité, à l’égalité, à l’invention artistique, à la « construction », se cache une idéologie individualiste très dangereuse niant la réalité des corps, réalité aussi bien anatomique que symbolique (= sens), et détruisant nos repères anthropologiques. La Gender Theory, après avoir déconnecté la sexualité de la fécondité, sépare maintenant la sexualité de l’identité sexuée et du désir, pour la téléporter sur le terrain de l’image, du qu’en dira-t-on, du virtuel uniformisant façon mosaïque. Elle refuse la réalité de la sexuation (nous ne serions plus ni hommes ni femmes mais des anges indéterminés, ayant le choix de leur nature), la réalité des désirs sexuels (nous ne serions plus des personnes « hétéros », « homosexuelles », « bisexuelles », « transsexuelles », mais juste des « amoureux » : on voit ici combien le rouleau compresseur queer/bobo est d’ailleurs inconsciemment cucul ET homophobe), les actes qu’impliquent concrètement notre corps sexué et notre orientation sexuelle (nous ne sommes plus appelés à transmettre la vie à travers la famille réelle et la différence des sexes, mais à élargir nos horizons pour créer des filiations symboliques, sans lien de sang, … sans réalité, en somme ; on nous incite fortement à devenir en actes des bisexuels qui ne doivent surtout pas se définir comme tels, ni analyser/assumer leurs pratiques amoureuses). Qui s’éloigne du Réel, sous prétexte d’amour et d’ouverture, se dispose à être violent sans même s’en rendre compte. Et la rêverie asexuée et sentimentaliste que cet « amoureux de l’amour sans le vivre » nous chante juste avant de nous châtrer ne doit pas nous faire oublier son éloignement délirant du Réel.
Ne pas tuer la reconnaissance du désir homosexuel (Sinon, on suit la logique du Gender)
Je m’oppose fortement à l’étiquetage identitariste et essentialiste actuel des sexualités, qui stigmatise sous forme d’espèces les individus selon leur orientation sexuelle, leur apparence physique, ou leur subjectivité (« les homos », « les lesbiennes », « les bisexuels », « les transsexuels », « les transgenres », etc.). Mais, à la différence des sujets homos « honteuses » méprisant uniquement la visibilité homosexuelle et les clichés de l’homosexualité pour mieux pratiquer les actes homos en toute discrétion sans les remettre en cause, et à la différence des partisans de la Queer & Gender Theory qui certes critiquent le même étiquetage caricatural que moi mais pour mieux nier la réalité de la sexuation, s’éloigner des corps, et mettre sur le même plan tous les désirs humains dans un relativisme effrayant qui évacue toute réflexion sur le sens du désir homosexuel et le Sens de l’existence humaine, je me bats pour qu’en même temps que soient combattues les nomenclatures marchandes et pseudo médicales des sexualités, les clichés de l’homosexualité et la spécificité du désir homosexuel soient préservés,reconnus et expliqués, sans être justifiés, moralisés, essentialisés. Mon approche de la culture homosexuelle n’est donc ni essentialiste ni iconoclaste. Elle est symboliste, et donc réaliste, y compris dans la prise en compte de la probable actualisation des fantasmes humains inconscients.