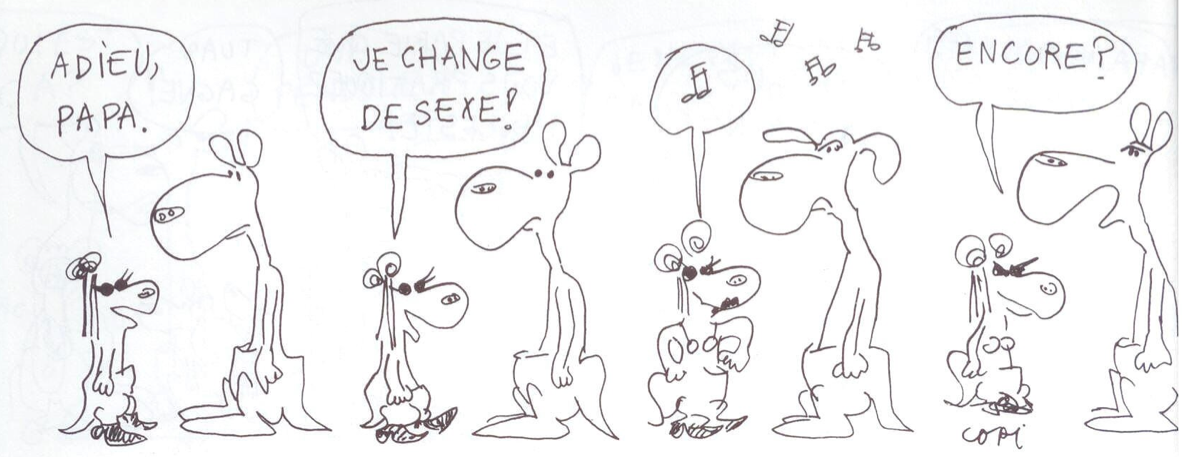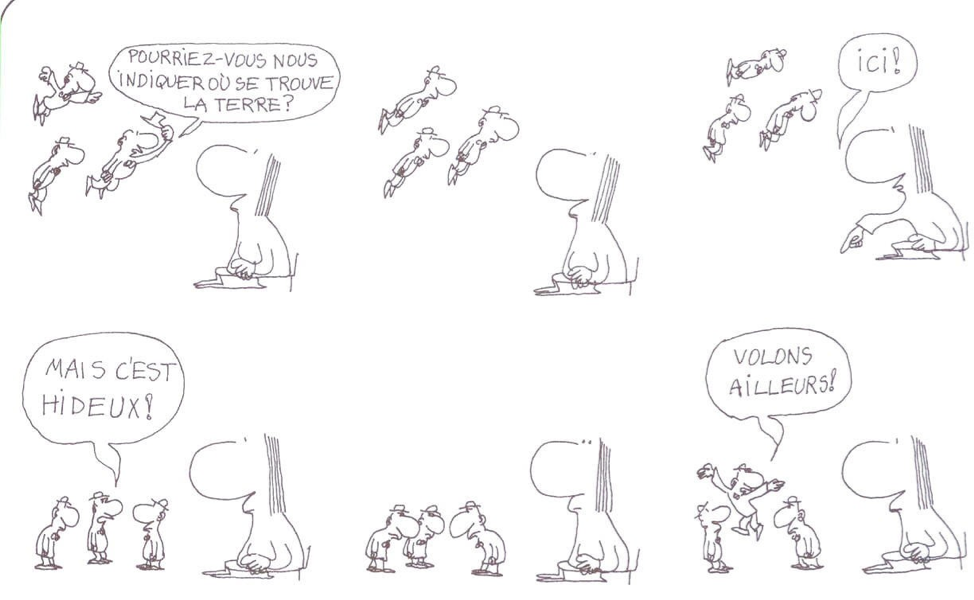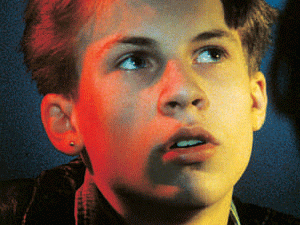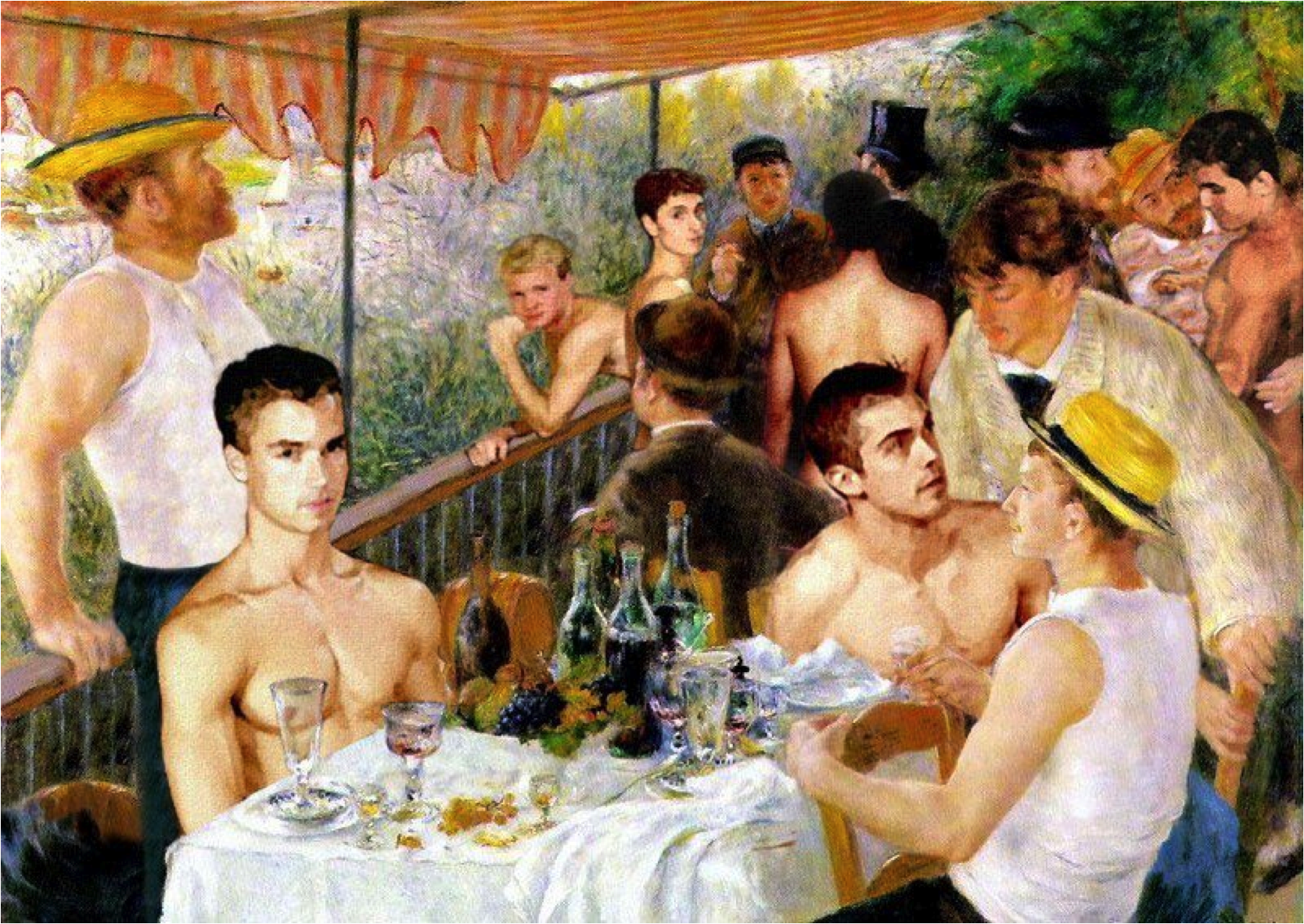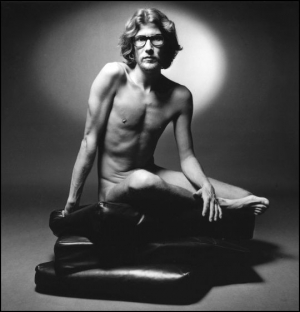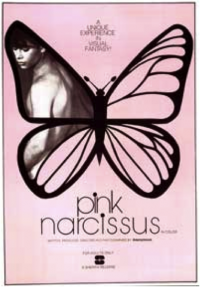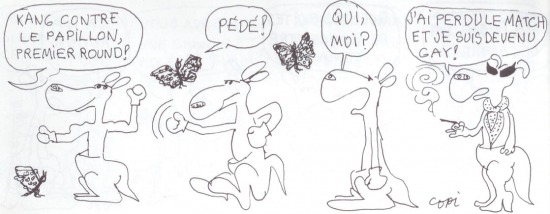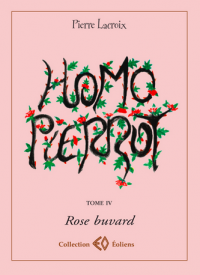Parricide
À mon papa, José Ariño,
que j’aime comme un fils essaie d’aimer son père.
NOTICE EXPLICATIVE :
Homosexualité : la crise mondialisée de paternité
L’homosexualité indique-t-elle un problème relationnel avec le père ? « N’importe quoi ! » me diront les quelques rares personnes homosexuelles qui soutiennent qu’elles s’entendent parfaitement bien avec leur papounet d’amour. Et elles n’auront pas tort : le cliché de la haine homosexuelle du père reste une image qui inclut de nombreuses exceptions humaines. « Sottise ! » sortiront ceux qui pensent que « tout le monde a un problème avec son père, homos et hétéros confondus ». Et ils n’auront pas tort non plus ! Tous les êtres humains ont, universellement, un contentieux à régler avec leur papa, non seulement biologique mais aussi adoptif et symbolique (par « père symbolique », j’entends le Réel, le pouvoir, la Loi, la force, l’effort, la guerre, les limites, la Parole, Dieu). La paternité est un enjeu fort qui se joue, se règle, et s’accomplit sur la durée et la distance. Mais dans la gestion de ce contentieux, certains individus s’en sortent beaucoup mieux que d’autres. Et à l’évidence, le rapport au père, de la part des personnes homosexuelles, est particulièrement blessé, tendu, inexistant, excessivement fusionnel.
Les clichés de l’homosexualité évoquant le père absent ou la haine du père, même si évidemment ils ne sont pas à transformer en causes directes de l’apparition d’un désir homosexuel, sont, je crois, le signe que les individus homosexuels et hétérosexuels ont vécu une rupture avec leur père plus marquée que les personnes non-homosexuelles et non-hétérosexuelles, et ce, de manière quasi générale, comme le prouve l’enquête Spira et tous les témoignages amicaux que je peux entendre : « Le sous-échantillon Spira confirme que les adolescents homosexuels masculins ont des relations beaucoup plus faciles avec leur mère qu’avec leur père, et ce dans des proportions extrêmement significatives, qui le sont encore davantage si on les compare aux hétérosexuels. Le dialogue sur la sexualité avec le père était ‘difficile’ ou impossible pour la quasi-totalité (98%) des adolescents homosexuels. » (Alfred Spira, Les Comportements sexuels en France, 1993) L’aversion homosexuelle pour le père biologique et ses figures symboliques traduit bien plus largement une misandrie sociale, c’est-à-dire un mépris croissant pour les hommes du simple fait qu’ils seraient naturellement, de par leur sexuation, des prédateurs, des bébés immatures, des abrutis vulgaires, violents, et prétentieux. Aujourd’hui, ce mépris anti-mâles passe complètement inaperçu aux yeux de nos contemporains féministes luttant contre le diable de la « domination masculine patriarcale », et retombe de surcroît en violence accrue sur les femmes réelles.
N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Homme invisible », « Haine de la famille », « Frère, fils, père, amant, maître, Dieu », « Ombre », « Inceste », « Matricide », « Homosexuels psychorigides », « L’homosexuel = L’hétérosexuel », « Don Juan », « Femme et homme en statues de cire », « S’homosexualiser par le matriarcat », et « Orphelins », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.
1 – PETIT « CONDENSÉ »
La diabolisation des hommes
par les hommes gays
Beaucoup d’individus gays nourrissent depuis leur enfance une haine viscérale contre la gent masculine. Le « mâle » et le « mal » sont souvent des synonymes dans leur esprit et dans leurs discours. Malgré leur maturité d’adultes, ils restent encore étonnés de trouver chez les garçons les qualités qu’ils n’envisageaient découvrir que chez les femmes (douceur, attention, écoute, grâce, sensibilité, etc.). Par conséquent, à chaque fois qu’ils pensent voir ces dernières chez les hommes, ils se laissent totalement charmer et perdent tous leurs moyens. Ils tombent dans le piège de croire que le seul individu (avec eux !) qui incarne cette autre « nature masculine exceptionnellement raffinée » n’est pas vraiment homme, et qu’ils doivent sûrement l’aimer d’amour. Pour ce qui est du reste de leurs semblables sexués, ils s’en font en général une image particulièrement déshumanisée et machiste de brutes épaisses. Par cette caricature réductrice, ils ne prennent pas conscience qu’ils blessent vraiment les hommes réels non-hétérosexuels (qui n’ont rien à voir avec les personnages masculins des publicités et des films).
Le principal représentant de ces derniers est bien sûr le père. Beaucoup de sujets homosexuels disent avoir une relation très mauvaise voire inexistante avec leur père (biologique, et surtout symbolique). Ils gardent de lui l’image d’un bon à rien qu’ils doivent remplacer et qui a rendu leur mère éternellement malheureuse. À les entendre, le père universel possède tous les défauts qu’un être humain puisse avoir : il est odieux, ridicule, autoritaire, démissionnaire, mort, ou endormi parce qu’il déserte son rôle de géniteur (… un peu comme eux finalement). Beaucoup de réalisateurs homosexuels ont coutume de présenter la recherche de père comme un prétexte au faux voyage, ou bien une quête perdue d’avance. Dans leurs fictions, ils inversent les rapports d’éducation : ce sont les enfants fictionnels qui éduquent leur père, et non l’inverse.
En matière de sexualité, la substitution au père peut se traduire par la composition de couples homosexuels dont l’écart d’âge entre partenaires est assez prononcé. L’homosexualité agit alors comme un meurtre à la fois réel et symbolique du père : nous retrouvons très souvent dans les œuvres homo-érotiques le thème du parricide, et notamment une prédilection pour le personnage d’Hamlet. Comme, en fantasme, certains individus homos ont désiré que leur père meure, ou bien parce qu’ils ont regretté son absence (du fait de sa mort, de son indifférence, de son éloignement géographique…), ils pensent parfois l’avoir réellement tué. La haine du père peut également cacher un désir incestueux refoulé. Par exemple, John, dans le film « Rebel Without A Cause » (« La Fureur de vivre », 1955) de Nicholas Ray, avant d’avouer que son père est toujours vivant et qu’il le déteste à travers l’idéalisation, fait croire qu’il est un héros légendaire de la mer de Chine mort courageusement au combat.
Ces femmes lesbiennes
misanthropes et misandres
Généralement, les femmes lesbiennes ne respectent pas davantage les hommes que les hommes gay. Certaines aiment beaucoup les messieurs, certes, mais pour s’en servir comme paravent de la sexualité. « Les garçons me protégeaient ; j’étais à l’abris avec eux. » (Véronique, femme lesbienne interviewée dans l’essai Les Chrétiens et l’homosexualité (2004) de Claire Lesegretin, p. 258) Elles les regardent comme des objets, étant donné qu’elles disent très souvent qu’elles les préfèrent « vus de dos » (Marie-France, femme lesbienne de 54 ans, dans le documentaire « Une Vie ordinaire ou mes questions sur l’homosexualité » (2002) de Serge Moati) et non de face. Ceci est particulièrement flagrant dans les romans de Colette, où les protagonistes masculins sont quasiment toujours observés de dos ou endormis (Je vous renvoie également à la partie « Dos » du code « Amant comme modèle photographique » dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels).
L’aversion lesbienne pour les hommes n’est pas à prendre totalement au pied de la lettre, dans la mesure où beaucoup de femmes ont confondu l’homme imagé avec l’homme réel. C’est pourquoi, lorsque certaines déclarent très sincèrement que la haine lesbienne des hommes est un « mythe homophobe » (Marie-Jo Bonnet, Qu’est-ce qu’une femme désire quand elle désire une femme ? (2004), p. 152), je crois qu’elles ont en partie raison, du moins dans le monde de l’intention. Mais dans le monde de la réalité concrète et des désirs, comme la distinction entre image et Réalité n’a pas toujours été faite, cette haine peut devenir effective. La butchphobie ou la gayphobie sont des signes tangibles de ce rejet de l’image des hommes, et parfois des hommes réels, exercé par certaines femmes lesbiennes. À entendre beaucoup d’entre elles, l’homme n’aurait jamais fait le bonheur de la femme au cours de l’histoire de l’Humanité. Il ne serait qu’un être lubrique, un obsédé sexuel, un violeur en puissance qui ne penserait qu’à « grimper les femmes ».
Paradoxalement, leur critique virulente du patriarcat s’accompagne d’une idéalisation diabolisée de la gent masculine. Elles pensent que l’homme, parce qu’il possède un pénis, est le seul à pouvoir être rongé par l’orgueil, étant donné qu’elles ont fétichisé le pénis en sceptre magique (qu’elles appellent à tort « phallus », alors que ce dernier ne désigne pas l’organe génital « pénis », mais la puissance narcissique et sexuelle n’appartenant pas plus aux hommes qu’aux femmes : cf. Jacques Lacan, « La Signification du phallus », conférence prononcée en 1958 et publiée pour la première fois dans les Écrits (1966), pp. 685-695) avant d’afficher pour celui-ci un profond mépris : « Ça gêne les hommes de savoir que les femmes lesbiennes puissent avoir du plaisir sans leur pénis ! » disent certaines. Beaucoup de femmes lesbiennes s’opposent au sexisme parce que précisément elles sont en général sexistes et génitalistes.
Enfin, à propos de la relation entre les femmes lesbiennes et leur papa, elle n’est habituellement pas plus pacifiée que chez les garçons gays : le père est tout autant jugé comme un rival (parce qu’il a mis un frein au rapport fusionnel avec la mère) ou un pote trop proche pour créer le mystère générant le désir génital pour l’autre sexe. Dans les deux cas, c’est l’inceste ou un désir incestueux qui se trouve à la racine de la distance/rupture avec le père, et du souhait parricide.
2 – GRAND DÉTAILLÉ
FICTION
a) La misandrie (mépris des hommes-mâles) :
Beaucoup d’œuvres de fiction traitant d’homosexualité expriment nettement une haine des hommes, c’est-à-dire une misandrie. Le portrait des hommes dressé dans les fictions traitant d’homosexualité est tout sauf brillant : leur musculature et leur assurance grotesque sont inversement proportionnelles à leurs qualités humaines intérieures : cf. le film « Baise-moi » (2000) de Virginie Despentes, le one-woman-show Karine Dubernet vous éclate ! (2011) de Karine Dubernet.), le film « Macho Dancer » (1988) de Lino Brocka, le film « Macho » (1994) de Bigas Luna, la chanson « Macho Man » des Village People, la pièce À trois (2008) de Barry Hall, la pièce Hétéropause (2007) d’Hervé Caffin et Maria Ducceschi (avec Gérard, la caricature du gros macho), le film « Fire » (2004) de Deepa Mehta (avec les machos obsédés sexuels), la pièce Coming out (2007) de Patrick Hernandez (avec les hétéros buveurs de bière et gros bébés), le film « Priscilla, folle du désert » (1995) de Stephan Elliot (avec les hétéros gratuitement homophobes), le film « Du même sang » (2004) d’Arnault Labaronne, le film « My Summer Of Love » (2004) de Pawel Pawlikovsky, le film « Get Real » (« Comme un garçon », 1998) de Simon Shore, le film « Boys Don’t Cry » (1999) de Kimberly Peirce, le film « Todo Sobre Mi Madre » (« Tout sur ma mère », 1999) de Pedro Almodóvar, la pièce Les Amazones, 3 ans après… (2007) de Jean-Marie Chevret (avec Pablo, l’hétéro de base, volage et macho), le film « Beignets de tomates vertes » (1991) de Jon Avnet, le film « Les Filles du botaniste » (2006) de Daï Sijie, la pièce Jupe obligatoire (2008) de Nathalie Vierne (avec Bernard), la pièce String Paradise (2008) de Patrick Hernandez et Marie-Laetitia Bettencourt (où la haine des machos est clairement exprimée), la chanson « Viril » d’Oshen, le vidéo-clip de la chanson « Rumour » de Chlöe Howl, le film « Portrait de femme » (1996) de Jane Campion (où les hommes y sont dépeints comme des prédateurs, des manipulateurs), le film « W imie… » (« Aime… et fais ce que tu veux », 2014) de Malgorzata Szumowska (avec un milieu masculin des plus brutaux), le film « In & Out » (1997) de Frank Oz (avec les amis de Howard pendant son enterrement de vie de garçon), etc.
« Et les hommes, tu crois qu’ils ne sont pas cruels ? » (Sophie dans la pièce Nationale 666 (2009) de Lilian Lloyd) ; « Les hommes ne sont-ils pas tous des gros salauds ? » (Steve, le frère hétéro de George le héros homosexuel, dans le film « L’Objet de mon affection » (1998) de Nicholas Hytner) ; « Ahhh… les hommes… » (John, soupirant contre l’aveuglement et le désintéressement de l’homme qu’il aime à son égard, comme le ferait une femme déçue, dans le film « Alone With Mr Carter » (2012) de Jean-Pierre Bergeron) ; « Tu détestes les hommes autant que je les déteste. » (Alba, l’héroïne lesbienne s’adressant à Yolanda dans la comédie musicale Se Dice De Mí En Buenos Aires (2010) de Stéphane Druet) ; « Vous êtes cons, les gars. » (Karina, une fille à pédés, s’adressant à la bande de Fábio, dans le film « Hoje Eu Quero Voltar Sozinho », « Au premier regard » (2014) de Daniel Ribeiro) ; « Les hommes ne savent rien des femmes. Comment peuvent-ils se permettre de parler en notre nom ? » (Junon s’adressant à Jupiter, dans le film « Métamorphoses » (2014) de Christophe Honoré) ; « J’imagine que tu dois souvent avoir envie de tuer Tielo. » (Jane l’héroïne lesbienne s’adressant à Ute, la femme mariée à Tielo son mari, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 33) ; « Depuis toujours, il est mou. » (Vanessa parlant de son mari Franck, dans la pièce L’Héritage était-il sous la jupe de papa (2015) de Laurence Briata et Nicolas Ronceux) ; « ‘Nymphomane’, pour les hommes, ça s’appelle ‘la vie’. » (Shirley Souagnon dans son concert Free : The One Woman Funky Show, 2014) ; « Tous les hommes sont des ignobles soldats allemands avec une cicatrice dans la lèvre. » (Alfonsina, l’ouvreuse dans un ciné porno, dans la pièce Le Cheval bleu se promène sur l’horizon, deux fois (2015) de Philippe Cassand) ; « C’est pas drôle d’être homo. Y’a des mecs dans la salle, ce soir ? Bande de salauds ! C’est vous qui nous faites souffrir ! » (Fabien Tucci, homosexuel, en pleurs, dans son one-man-show Fabien Tucci fait son coming-outch, 2015) ; « C’est son rapport aux hommes qui est compliqué. » (Sandra parlant de Maryline, l’héroïne bisexuelle violée par Gérard, dans la pièce Jardins secrets (2019) de Béatrice Collas) ; « Les hommes, je les comprends pas. » (Maryline, idem) ; « Je ne peux pas être chevalier. Je veux être dentiste ! » (le Prince homosexuel de la pièce La Princesse Rose et le retour de l’ogre (2019) de Martin Leloup) ; etc.
Se cache derrière cette misandrie un viol, une jalousie, une trahison : « Un homme lui avait pris son premier amour. Elle [Marie, une des héroïnes lesbiennes] ne savait pas que l’enfance finissait un jour. » (Alexandra, la narratrice lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 185-186) ; « Ma tante rangeait derrière mon oncle, ma grand-mère derrière mon grand-père. D’un côté, j’en étais indignée. Mais de l’autre, j’aimais être un petit prince. Quand je serais grande j’aurais un harem plein de femmes. » (Anamika, l’héroïne lesbienne du roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, p. 168) ; « Les mecs nous font gerber. On n’aime pas les sucer ! » (la troupe de chanteurs homosexuels du musical Adam et Steve dans le film « The Big Gay Musical » (2010) de Casper Andreas et Fred M. Caruso) ; « Quant à Stephen [l’héroïne lesbienne], elle détestait Roger Antrim, et cette aversion s’augmentait d’un sentiment d’envie des plus humiliants. Car, en dépit de ses imperfections, elle enviait au jeune Roger ses lourds et forts brodequins, ses cheveux ras et sa veste d’Eton ; elle lui enviait son droit de grimper aux arbres, de jouer au cricket et au football : son droit d’être parfaitement naturel ; elle lui enviait par-dessus tout son admirable conviction qu’être un garçon constituait, dans la vie, un privilège. » (Marguerite Radclyffe Hall, The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928), p. 63) ; etc. Par exemple, dans le one-woman-show Mâle Matériau (2014) d’Isabelle Côte Willems, la narratrice transgenre F to M défend une vision vulgaire, beauf, rustre, de la masculinité : elle envie au niveau des attitudes (roter, péter, jurer, etc.) ce qu’elle abhorrerait chez les hommes réels.
Dans le film « The Stepford Wives » (« Et l’homme créa la femme », 2004) de Frank Oz, il y a un club exclusivement masculin dans la ville de Stepford, où on voit les hommes réunis se comporter comme des ados. Dans le film « Circumstance » (« En secret », 2011) de Maryam Keshavarz, tous les hommes sont présentés comme des prédateurs : par exemple, Shirin, l’une des deux héroïnes lesbiennes, est forcée de voir un chauffeur de taxi se masturber avec son pied à elle ; un peu plus tard, en boîte à Téhéran, elle « chauffe » un beau mec pour ensuite avoir le plaisir et l’énergie de l’envoyer balader (« Dégage ! »). Dans le film « Naissance des pieuvres » (2007) de Céline Sciamma, Marie et Floriane partagent leur dégoût des hommes et des autres… et à l’écran, difficile de ne pas les suivre : François est un queutard qui prend son pied sans tenir compte du plaisir des femmes qu’il engrosse, les mecs sont des gros dégueus et des obsédés. Dans le film « La Vie d’Adèle » (2013) d’Abdellatif Kechiche, l’image des hommes est pathétique : ils sont montrés comme des bourrus qui n’ont que la réussite financière en tête (exemple avec le père d’Adèle), de gentils beaufs ignorants et incultes (Thomas), des ennuyeux ou des terres à terre, des profiteurs et des tentateurs (le collègue instit). Les seuls qui trouvent grâce aux yeux du réalisateur sont soit homos (Valentin), soit « artistes » bisexuels (Joachim), soit rebeux et volontairement instables (Samir). Dans le film « Cloudburst » (2011) de Thom Fitzgerald, le couple lesbien Dotty-Stella est particulièrement misandre : elles méprisent tous les mâles de leur entourage (le jeune autostoppeur Prentice, le père de ce dernier, etc.) ; l’homme nu est présenté comme immonde et révulsif ; Dotty chie dans le bidet du père de Prentice.
Dans la pièce Les Favoris (2016) d’Éric Delcourt, Stan, le héros hétérosexuel, est traité comme un chien par ses trois autres partenaires bi-homosexuels. Il a tous les défauts : beauf, vulgaire, infidèle (il a cocufié Camille avec sa secrétaire blonde à gros seins), « radical de droite », raciste, homophobe, capitaliste (il travaille dans les mutuelles), « hermétique aux sentiments ». Guen, le héros homosexuel, avoue qu’il a des envies de meurtres à son égard. Et Ninon nie Stan dans son identité, dans sa virilité : « En fait, en tant qu’homme, tu sers à rien. »
Très souvent, le héros homosexuel dépeint le personnage masculin dit « hétérosexuel » comme une brute épaisse qu’il cherche à détruire : « Y’a que des salauds ! » (Manju, l’héroïne lesbienne parlant des hommes à son amante, dans le film « Flying With One Wing » (2002) d’Asoka Handagama) ; « Tous les hommes sont des porcs. » (Mademoiselle Ott dans le roman L’Autre (1971) de Julien Green, p. 60) ; « Les mecs ils sont tous nuls. » (le personnage travesti M to F de la chanson « Parle à ma main » de Fatal Bazooka) ; « Je déteste les hommes, je ne peux pas les supporter. » (Suzanne, l’héroïne lesbienne du roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, p. 144) ; « Il puait l’homme comme les hommes peuvent puer. Il me prenait comme le taureau prend une vache. […] Les hommes sont tellement bêtes. » (Petra, l’héroïne lesbienne, parlant de son ex-mari Franck, dans le film « Die Bitteren Tränen Der Petra Von Kant », « Les Larmes amères de Petra von Kant » (1972) de Rainer Werner Fassbinder) ; « Un homme nymphomane c’est juste un homme. » (la femme à propos de son ex-compagnon Jean-Luc converti en homo, dans la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier) ; « Juna, pardonne-moi. Non, ne les laisse pas me toucher. » (Rinn, l’héroïne lesbienne s’adressant à son amante Juna, dans la pièce Gothic Lolitas (2014) de Delphine Thelliez) ; etc. Par exemple, dans le roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, le mari de Linde la battait, avant qu’elle ne le quitte… pour une petite jeune. Dans le film « Respire » (2014) de Mélanie Laurent, les hommes sont tous des absents ou des salauds. Dans le roman La Voyeuse interdite (1991) de Nina Bouraoui, la narratrice lesbienne nous parle de « ces hommes toujours en rut » (p. 56) : « J’ai vite compris que je devais me retirer de ce pays masculin, ce vaste asile psychiatrique. » (idem, p. 21) ; « C’est vraiment des biques, les mecs ! » (Gwendoline, l’adolescente travesti M to F, dans le one-(wo)-man show Désespérément fabuleuses : One Travelo And Schizo Show (2013) du travesti M to F David Forgit) ; « Les curés, ce sont des hommes comme les autres : de obsédés. » (Frédérique Quelven dans son one-woman-show Nana vend la mèche, 2009) ; « Un garçon pense au sexe toutes les 30 secondes. Alors vous en mettez deux ensemble… » (Matthieu se justifiant de coucher le premier soir avec Jonathan, dans la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H.) ; « Comme quoi… un garçon ça ne pense qu’au sexe. » (idem) ; etc.
Dans les discours de certains héros homosexuels, « le mâle » devient vite synonyme de « mal » : « Il n’y a pas de mâle à cela. » (la narratrice lesbienne du roman Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train (2005) de Cy Jung, p. 78) Dans le roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, le jeu de mot entre « mal » et « mâle » est également repris par Suzanne. Sur le dessin Et puis, c’est si laid un homme (1891) de J.-L. Forain, deux femmes s’entretiennent, et l’une décourage l’autre de se tourner vers les hommes.
Les hommes sont vus comme des violeurs et des monstres par beaucoup de personnages homosexuels : « Il [le mari de Rani, sa servante] m’apparut en imagination, un type laid au visage grêlé et aux mains sales. Riant et la prenant à son corps défendant. Soulevant son sari pour l’envahir. Poussant un brusque gémissement avant de s’endormir. Exactement comme dans un film que j’avais vu à la télé. Je voulais le tuer. » (Anamika, l’héroïne lesbienne du roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, pp. 58-59) ; « Les hommes n’existent que pour nous faire souffrir. » (cf. une réplique de la pièce Tante Olga (2008) de Michel Heim) ; « Il la violera tous les soirs pendant 7 ans dans sa cave. » (Rodolphe Sand parlant de Rosetta et de « l’homme de sa vie », dans son one-man-show Tout en finesse , 2014) ; « Jane avait détesté la puberté, l’intrusion du sang et des seins, les messes basses entre filles et les invitations des hommes qui les suivaient en voiture en roulant au pas. » (Petra s’adressant à son amante Jane, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 29) ; « C’était comme si certaines filles portaient une marque secrète que seuls les pervers pouvaient voir. Une fois qu’elles avaient été abusées, d’autres salauds parvenaient à le sentir d’une façon ou d’un autre, et ils les pistaient pour prendre leur tour. […] ‘Pourquoi est-ce que tu cherches sans cesse des excuses à ces hommes ? Ils ont cherché à gagner ta confiance pour abuser de toi. Même le prêtre ; il a préféré ignorer quel âge tu avais. Tu ne fais pas du tout dix-sept ans. Au fond de son cœur, il savait que tu étais trop jeune. Tu ne le vois pas ?’ » (Jane, idem, p. 242) ; etc.
La séduction qu’opèrent les hommes vient, selon les héros homosexuels, menacer l’équilibre fragile de l’identité homosexuelle et des « amours » homosexuelles. Elle est donc parfois envisagée comme de l’homophobie. Par exemple, dans la série Faking It (2014) de Dana Min Goodman et Julia Wolov (cf. l’épisode 1 « Couple d’amies » de la saison 1), Liam est suspecté de machisme parce qu’il tombe amoureux de Karma, présentée par la rumeur comme « lesbienne », alors qu’elle aussi est attirée par lui.
Cela arrange alors la population gay friendly ou LGBT des fictions de caricaturer la majorité de la gent masculine en obsédés. Par exemple, dans son one-woman-show Wonderfolle Show (2012) de Nathalie Rhéa, Nathalie réduit les hommes à leur sexe anatomique : « Je n’ai pas besoin d’un homme : j’ai besoin d’un pénis. » Rien d’étonnant qu’après, elle considère tout homme qui vient vers elle comme un violeur (cf. la scène du flic qui l’arrête au volant de sa voiture).
Pourtant, les instincts animaux des « mâles » ont souvent été suscités par la provocation misandre et hétérophobe de certains protagonistes homosexuels, gay friendly, et/ou féministes : « Oui, j’étudie les hommes depuis des années, professionnellement… un peu comme une prostituée en somme… » (la femme à propos de son ex-compagnon Jean-Luc converti en homo, dans la pièce La Fesse cachée (2012) de Jérémy Patinier)
La violence ignorante ou volontaire des hommes est bien souvent une simple projection fantasmée du héros homosexuel qui joue « les mâles hétéros » pour se justifier de ne pas rencontrer les hommes réels. Par exemple, dans la pièce Les Virilius (2014) d’Alessandro Avellis, le groupe d’homosexuels refoulés des Virilius se conduisent comme des gros beaufs hétérosexuels : « On vaincra ! On a un phallus ! »
La vengeance misandre des femmes phalliques ou des hommes honteux d’être des hommes ne s’annonce pas toujours comme menaçante : elle adopte parfois le langage souriant de l’émancipation et de l’éducation libertine ; elle encourage à l’infantilisation et à l’homosexualité. « On devrait permettre le changement de sexe à l’âge de la puberté, avant que les caractères virils ne commencent à s’accentuer. » (le narrateur homosexuel du roman Le Bal des Folles (1977) de Copi, p. 39) Par exemple, dans le film « La Belle Saison » (2015) de Catherine Corsini, les hommes des années 1970 en France sont présentés comme des brutes épaisses et machistes… même si, ensuite, cette haine n’est pas assumée par les héroïnes lesbiennes : « On n’est pas contre les mecs. On est pour les femmes. » dira Carole.
Mais là encore, on cherche à « dresser » et à « mater » les machos, en étouffant à petit feu ce qu’il leur reste de force. Par exemple, dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, tous les personnages masculins sont soit impuissants (quand ils sont hétéros), soit homos. Dans le film « La Croisière » (2011) de Pascale Pouzadoux, l’intégralité des hommes du film sont mis à mort et émasculés : entre les curés pervers complètement frustrés, les pauvres « mâles » qui reçoivent des bouchons de champagne dans les valseuses, les queutards menottés et réduits au silence sur leur lit par des femmes-enfants prostituées et cleptomanes, les maris qui délaissent leur femme et oublient de leur fêter leur anniversaire, ceux qui sont obligés de se travestir (comme Raphaël) pour avoir le droit de s’approcher du carré VIP féminin, ceux qui s’égarent à tout jamais dans les toilettes, ceux qui démissionnent de leur poste de travail (Alix dira au capitaine du bateau Jean Benguigui – souhaitant abandonner son navire – qu’il « ne sert à rien ».), on assiste au procès pur et simple et au meurtre symbolique du pouvoir masculin.
Toute la pièce Sugar (2014) de Joëlle Fossier est orientée vers le parricide : c’est le père de famille bisexuel (Georges), ou encore le bon « hétéro » pas du tout concerné par l’homosexualité (Pierre) et qui devient comme par « magie » homophobe, qui sont placés sur la sellette. On assiste au procès des pères de famille et des mâles en général. Ils s’en prennent plein la figure et sont sommés de faire leur coming out, leur mea culpa gay friendly, ou alors ils méritent les insultes et les coups. C’est le mariage traditionnel, la paternité et la masculinité passant au crible de la coalition fraternelle (et incestuelle) d’une part (celle de William et sa sœur Adèle), et la coalition homosexuelle (celle des deux amants réconciliés William/Georges, liaison clairement incestuelle aussi) d’autre part. Hallucinant. Les incestueux qui font la morale à la paternité et à la conjugalité. On aura tout vu !
Il arrive que le mépris misandre se mute en menace de meurtre, et finisse dans un bain de sang : « La servante aspergeait M. Alphand de gasoil et y mettait le feu. » (cf. la nouvelle « La Servante » (1978) de Copi, p. 75) Par exemple, lors de son concert Tirez sur la pianiste (2011) d’Anne Cadilhac, Olga tente d’étouffer son copain avec un oreiller, et cherche à lui couper le sexe : « Maurice, après l’amour, il s’endort. Je vomis l’odeur de son corps. » Dans le film « Drool » (2008) de Nancy Kissam, le personnage du mari est tué par le couple de lesbiennes. Dans la pièce My Scum (2008) de Stanislas Briche, le programme « Scum » compte se débarrasser des machos. Dans le film « Monster » (2003) de Patty Jenkins, Aileen, lesbienne, et sa copine Selby, tuent des hommes pour se venger des violences qu’ils leur ont fait subir. Dans le film « Thérèse Desqueyroux » (1962) de Georges Franju, Thérèse empoisonne son mari. À la fin du film « Métamorphoses » (2014) de Christophe Honoré, tous les hommes sont dévorés ou abattus au pistolet de chasse par les femmes, les Bacchantes. Par exemple, Panthée est bouffé tout cru. Dans le film « Fried Green Tomatoes » (« Beignets de tomates vertes », 1991) de John Avnet, les hommes sont tous présentés comme des brutes : Evelyne a un mari, Ed, qui la méprise et la traite comme une boniche (avec sa bière devant la télé) ; Idgie (lesbienne) se fait lourdement draguer par Gredy ; et Idgie finit par commanditer le meurtre du mari brutal de Ruth, Bennett, parce qu’elle est en couple secret avec elle.
On constate que le meurtre misandre ou le mépris homosexuel des hommes s’origine dans un sentiment de jalousie et d’adoration mal placée à l’égard de la gent masculine. Par exemple, dans le film « Les Deux papas et la maman » (1995) de Jean-Marc Longval, la femme lesbienne est celle qui va « foutre un coup de boule » à Jérôme parce que celui-ci a osé draguer sa copine. Dans la comédie musicale Les Divas de l’obscur (2011) de Stephan Druet, toutes les héroïnes se disputent le Prince charmant, l’unique protagoniste masculin de l’histoire, au point de le déchirer et de « tuer la beauté même » : « Vous rêviez toutes de cet homme, et vous l’avez écartelé ! » leur reprochera Magdalena, navrée du drame passionnel qui s’est produit.
En réalité, les hommes fictionnels, quand ils se comportent mal, ne sont jamais obsédés tout seuls. La misogynie et l’homophobie sont toujours le signe et le miroir d’une misandrie agressive et d’une homosexualité militante qui leur font face, qui menacent l’identité masculine.
Ceci est particulièrement visible dans le roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, Marie raconte que ce sont ses penchants lesbiens pour sa jeune voisine, qui a eu le mauvais goût de pactiser avec le « mâle » en se mariant à l’âge adulte, qui la rendront misandre : « Un homme lui avait pris son premier amour. […] Elle nourrit vis-à-vis des hommes un ressentiment irrémédiable, d’autant que celui qui avait ravi son amour n’avait pas de visage pour elle. D’instinct, elle se méfia dès lors de tous. » (p. 186). Toujours dans ce même ouvrage, Alexandra, l’héroïne, dresse un portrait sévère des hommes : ils seraient « tous bavards », incapables de « garder un secret » (p. 137), prédateurs (« Ils ont un goût instinctif pour la domination, et souvent, après une longue absence, ils cherchent à se rassurer en ‘prenant’ leur femme. Ils veulent, comme les animaux, marquer à nouveau leur territoire et utilisent cet appendice de leur corps comme une arme, sans se soucier du mal qu’ils peuvent faire. », p. 164) On sent chez elle une claire jalousie des hommes (« Je sentais bien que mes paroles ne pesaient rien face aux arguments et surtout à l’expérience de cet homme [son jardinier]. », p. 138), et notamment par rapport au phallus-pénis (« La nature ayant généreusement doté le jardinier sur le plan qu’on sait, il avait sur elle un avantage qui, connaissant la bonne, n’était pas négligeable. », p. 143) mais plus universellement au phallus-pouvoir (« Ma seule préoccupation était le pouvoir, et je ne ferais rien pour rétablir mon mari dans son privilège de commandement. », p. 190). On l’entend à la fois mépriser l’appareil génital masculin (concernant son mari, elle voudrait « qu’il voie l’inutilité de son masculin », p. 169) et l’idolâtrer (« Je suis bien décidée à ne pas me laisser blesser l’âme par le coup qu’il veut me porter avec ce qu’il a reçu en naissant garçon, de peur que cette blessure ne se referme jamais. », p. 169). Elle joue soi-disant « sexuellement l’homme » avec sa bonne en la prenant par derrière : « Je me mis derrière elle […], adoptant la position des hommes quand ils sont pressés et veulent posséder une femme violemment. Bien que ce fût une impossibilité, étant née femme, je me pressai contre son dos avec la force d’un amant. » (idem, p. 141) Elle couche avec ses domestiques féminines pendant l’absence de son mari, et son homosexualité actée accroît son dégoût des hommes : « Peut-être agit-il comme avant son départ, sauf que maintenant je ne le supporte plus. » (idem, p. 164) Pour pouvoir vivre librement ses aventures lesbiennes sans que son mari l’en accuse, elle tente de pousser ce dernier à l’adultère… comme cela, ils seraient quitte dans le vice : « Le principe de l’action est simple : le pousser à la faute avec une autre femme et le surprendre dans ses ébats. » (idem, p. 165) Les femmes du roman de Dominique Simon atteignent l’orgasme en asservissant les hommes : « Résolument tournée vers le masculin, la marquise prenait un plaisir très particulier, s’évertuant, malgré le goût vif qu’elle avait des hommes, à les réduire à rien. Elle aimait à faire naître une passion qui lui permettait de les faire souffrir. » (p. 211) Chez ces matrones, l’un des moyens les plus employés pour le meurtre symbolique des hommes est l’infantilisation incestueuse : elles traitent les membres de la gent masculine de « bébés » : « Mon pauvre ami, tu es un enfant. » (Alexandra à son mari, p. 196)
Quelquefois, le terme de « misandrie » – peu connu du grand public tellement la réalité à laquelle il renvoie est niée dans nos civilisations contemporaines – sera remplacé par celui de « misanthropie », à savoir la haine du genre humain (« Nous, les lopes, misogynes et misanthropes », déclare par exemple un des héros homosexuels de la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel)… ce qui n’est bien sûr pas exactement la même chose : la misanthropie reconnaît tout autant comme victimes les femmes que les hommes, mais non spécifiquement les hommes, alors que la misogynie, au contraire, reconnaît spécifiquement l’agression faite aux femmes. À nouveau, on nie aux hommes-mâles leurs fragilités et leur objective statut de victimes dans certains cas.
La misandrie des personnages homosexuels a bien évidemment pu être maquillée par un coming out, ou impulser l’« amour » homosexuel. Dans le téléfilm « Clara cet été-là » (2003) de Patrick Grandperret, Clara et Zoé, les deux meilleures amies, trouvent les mecs « très cons », craignent de connaître leur premier acte sexuel avec un homme, et tentent de se décourager l’une l’autre : « Tu crois encore au prince charmant ?? » Même le père de Clara va dans leur sens : « Il faut se méfier des garçons. » Elles finissent par sortir ensemble… à cause de Zoé, qui aboutit pourtant dans les bras d’un garçon, Sébastien, en laissant sa copine Clara en proie à des questionnements plus sérieux sur son homosexualité. Au bout du compte, Zoé identifie la source misandre de l’homosexualité de son amie : « J’t’aime plus, Clara. J’ai fait l’amour avec Sébastien. À cause de toi, j’ai failli faire une croix sur les garçons. C’est toi qui as un problème avec les mecs. Pas moi. »
b) Mépris pour le père :
Le principal représentant des hommes, c’est évidemment le père. Beaucoup de personnages homosexuels disent avoir une relation très mauvaise voire inexistante avec leur père (biologique, et surtout symbolique). « Tout part d’un mauvais rapport au père ! » (Mr Alvarez, l’huissier face au travestissement en femme de son client Damien, dans le pièce Brigitte, directeur d’agence (2013) de Virginie Lemoine)
La lettre salée qu’adresse Bernard, le héros du roman Les Faux-Monnayeurs (1925) d’André Gide, à son « géniteur », va nous servir d’excellente introduction pour illustrer cette omniprésente inimitié anti-paternelle exprimée indirectement dans les fictions homo-érotiques :
« Monsieur, J’ai compris […] que je dois cesser de vous considérer comme mon père, et c’est pour moi un immense soulagement. En me sentant si peu d’amour pour vous, j’ai longtemps cru que j’étais un fils dénaturé ; je préfère savoir que je ne suis pas votre fils du tout. Peut-être estimez-vous que je vous dois la reconnaissance pour avoir été traité par vous comme un de vos enfants ; mais d’abord j’ai toujours senti entre eux et moi votre différence d’égards, et puis tout ce que vous en avez fait, je vous connais assez pour savoir que c’était par horreur du scandale. […] Je préfère partir sans revoir ma mère, parce que je craindrais, en lui faisant mes adieux définitifs, de m’attendrir et aussi parce que devant moi, elle pourrait se sentir dans une fausse situation ce qui me serait désagréable. Je doute que son affection pour moi soit bien vive ; comme j’étais le plus souvent en pension, elle n’a guère eu le temps de me connaître, et comme ma vue lui rappelait sans cesse quelque chose de sa vie qu’elle aurait voulu effacer, je pense qu’elle me verra partir avec soulagement et plaisir. Dites-lui, si vous en avez le courage, que je ne lui en veux pas de m’avoir fait bâtard ; qu’au contraire, je préfère ça à savoir que je suis né de vous. […] La décision que je prends de vous quitter est irrévocable. […] Il va sans dire que je préfère ne rien recevoir de vous à l’avenir. L’idée de vous devoir quoi que ce soit m’est intolérable et je crois que, si c’était à recommencer, je préférerais mourir de faim plutôt que de m’asseoir à votre table. […]. Je signe du nom ridicule qui est le vôtre, que je voudrais pouvoir vous rendre, et qu’il me tarde de déshonorer. Bernard Profitendieu. » (pp. 25-26)
Il est très fréquent dans les créations artistiques homosexuelles que le personnage homosexuel déclare détester son père : c’est le cas dans le film « Strangers On A Train » (« L’Inconnu du Nord-Express », 1951) d’Alfred Hitchcock (avec le personnage de Bruno), la pièce L’Anniversaire (2007) de Jules Vallauri (quand on écoute Vincent), la chanson « Papa Don’t Preach » de Madonna, le film « My Father Is Nothing » (1992) de Leone Knight, le film « Celui par qui le scandale arrive » (1960) de Vincente Minnelli, le film « Festen » (1998) de Thomas Vinterberg (avec le père maltraité), le film « Niño Pez » (2009) de Lucía Puenzo, le roman Papa a tort (1999) de Frédéric Huet, etc.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que les pères fictionnels ne sont pas portés dans le cœur de leur fils ou fille homosexuel-le : « J’la déteste. J’le déteste aussi ! » (Cal – interprété par James Dean – par rapport à son père et sa mère biologiques, dans le film « East Of Eden », « À l’est d’Éden » (1955) d’Elia Kazan) ; « My father was always wrong. » (Mr Farnsworth dans le film « The Man Who Fell To Earth », « L’Homme qui venait d’ailleurs » (1976) de Nicolas Roeg) ; « Je ne pourrai jamais aimer mon père. » (Môn, l’un des héros homos du film « Satreelex, The Iron Ladies » (2003) de Yongyooth Thongkonthun) ; « Papa papa papa, t’es plus dans l’coup papa. » (cf. la chanson « Papa t’es plus dans l’coup » de Sheila, reprise dans le film « Huit Femmes » (2002) de François Ozon) ; « Il n’aimait pas son père. » (Michel del Castillo, Tanguy (1957), p. 20) ; « Son père sentait le lâche. » (idem, p. 244) ; « Nos pères sont des salauds. » (une réplique de la pièce Cannibales (2008) de Ronan Chéneau) ; « Il était une fois un petit garçon qui avait honte de son père… » (Jean-Marc lisant sa propre histoire à son amant Luc, à la fin de la pièce Parfums d’intimité (2008) de Michel Tremblay) ; « Mon père a été le déclencheur de ma violence. Le responsable que j’accuse ! Complice secret de Satan […] » (la narratrice lesbienne du roman La Voyeuse interdite (1991) de Nina Bouraoui, p. 66) ; « Je n’aime pas mon père – ou aussi peu que toi ta mère. » (Ahmed à la lesbienne Lou, dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « Je ne sais ce qui s’est passé, mais un jour, j’l’ai détesté. » (Hervé Nael chantant une chanson sur son père, lors de son concert au Sentier des Halles, le 20 novembre 2011) ; « Il m’énerve… mais je l’aime… mais il m’énerve. » (Bill par rapport à son père, dans la pièce Bill (2011) de Balthazar Barbaut) ; « Tu n’as pas idée des disputes que j’ai eues avec mon père. » (Petra s’adressant à son amante Jane, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 54) ; « Il est exactement comme notre père, mais il le déteste. » (SDF parlant de son frère homo, dans le bâti Norén Lars (2011) d’Antonia Malinova) ; « J’ai seize ans et je sais parfaitement ça, que d’avoir seize ans, c’est un triomphe. […] Le père […] est l’homme de l’autre siècle, du passé. Il est vieux. » (Vincent, l’un des héros homosexuels du roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, pp. 14-15) ; « Il ne m’a jamais réellement compris et je ne suis pas certain de l’avoir réellement aimé. » (idem, p. 55) ; « Je n’ai jamais eu de père. » (Rosa dans la pièce musicale Rosa La Rouge (2010) de Marcial Di Fonzo Bo et Claire Diterzi) ; « Dans toutes les cours d’Europe, on avait surnommé le père de la duchesse d’Albe, Don José Ignacio, ‘El Conde del Horror’, tant sa laideur était repoussante. » (cf. la nouvelle « L’Autoportrait de Goya » (1978) de Copi, p. 10) ; « Mon père pleure. Mon père marocain pleure. Ce n’est pas un bon exemple pour moi, cette conduite. Il ne faut pas que je devienne comme lui. Apparence d’un homme. Déchéance d’un homme. » (Omar, le héros homosexuel du roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, p. 31) ; « Autour de lui, une atmosphère d’Apocalypse. » (idem, p. 39) ; « Un martyr, mon père ? Je vois son calvaire. Il est en route. Il marche. En traînant lourdement les pieds. Il porte toujours la djellaba de son mariage. Il a à la main gauche une bouteille de vin rouge bon marché… Et, à la main droite, un paquet de cigarettes La Marquise. » (idem, p. 158) ; « Mon grand-père n’était pas de ces hommes dont un petit-fils peut être fier. Il a forcément fait des choses terribles. C’est un salaud. » (Théo parlant de son papy nazi, dans le roman À mon cœur défendant (2010) de Thibaut de Saint-Pol, p. 58) ; « Je veux mettre [ma grand-mère] en garde : celui qu’elle aime est un monstre. » (idem, p. 166) ; « Ce grand-père oublié des siens, les miens, était-il ce monstre entouré de mystère ? » (idem, pp. 189-190) ; « Marie ne connaissait des hommes que son père, qui, sans qu’elle sût bien pourquoi, lui faisait un peu peur. […] De lui, elle avait appris le silence. » (Marie, une des héroïnes lesbiennes du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon) ; « Ça me dégoûte et je voudrais ne plus jamais voir ou entendre ça, le sacrifice permanent des femmes à cette race que je méprise, et à laquelle mon (gentil) père appartenait pourtant. Adorable comme père, mais affichant une virilité répugnante : tout pour que la gamine que j’étais n’ait pas envie, plus tard, de coucher avec ces choses immondes qui ne font que du mal, qui mentent en plus, et qui nous prennent pour des connes. […] Et je suis très satisfaite de ne pas être devenue cette pauvre victime consentante qu’est la femelle hétérosexuelle. » (Karin Bernfeld, Apologie de la passivité (1999), p. 49) ; « Papa est un gros mangeur de viande rouge. » (Claire, l’héroïne lesbienne s’adressant à sa compagne Suzanne, dans la pièce Le Mariage (2014) de Jean-Luc Jeener) ; « Vous êtes un vrai salaud. » (Suzanne, idem) ; « Mon père et moi, c’était pas le grand amour. » (Jézabel, l’héroïne bisexuelle du film « La Mante religieuse » (2014) de Natalie Saracco) ; « Mon père, il est réac, conservateur. Il comprend pas. […] Avec mon père, je n’ai jamais pu parler. » (Chris, le héros homosexuel parlant de son père, un chasseur-trappeur avec mitraillette, dans la pièce Happy Birthgay Papa ! (2014) de James Cochise et Gloria Heinz) ; « Mon père… j’avais un an quand il m’a reconnue. » (Nina, l’héroïne lesbienne dans la pièce Géométrie du triangle isocèle (2016) de Franck d’Ascanio) ; « Si tu crois que c’est facile d’avoir un connard homophobe comme père ?! » (Nathan s’adressant à son père Stéphane, dans le téléfilm « Baisers cachés » (2017) de Didier Bivel) ; « On est comme deux étrangers. » (idem) ; « Il est complètement dingue. » (Louis, le héros homo, parlant de son père, idem) ; « De toute façon, j’ai pris ma décision. Je vais couper net avec lui, il m’empêche de vivre. À chaque fois que je me retrouve devant lui, j’arrive pas à aligner deux mots. Je suis comme paralysée. » (Romane, l’héroïne lesbienne, à propos de son père, Alain, dans l’épisode 68 « Restons zen ! » (2013-2014) de la série Joséphine Ange gardien) ; « Mais tu m’écoutes jamais ! À chaque fois que je dis quelque chose, ça va pas ! Écoute papa, franchement, tu me fais pitié. » (Romane condescendante par rapport à son père) « Je suis là en train de t’expliquer ce que je veux, avec qui j’ai envie d’être. Et toi, tu n’écoutes pas. Comme toujours. Tu te défiles, comme à chaque fois. On n’a plus rien à se dire toi et moi. Ici, t’es chez moi. Et je veux plus te voir, d’accord ? Tu t’en vas ! Vas-t’en, j’te dis ! Dégage d’ici ! » (Romane face à son père, idem) ; « Avec mon père, c’est plus compliqué. C’est quelqu’un qui exprime pas beaucoup, qui a du mal à échanger. On n’est pas toujours sur la même longueur d’ondes. » (Victor, le héros homo, euphémisant la relation désastreuse qu’il a avec son père devant l’assistante sociale de qui il veut obtenir l’agrément pour l’adoption d’un enfant, dans le téléfilm Fiertés (2018) de Philippe Faucon, diffusé sur Arte en mai 2018) ; « Plus jamais je t’appellerai papa ! Et à partir de maintenant, on s’adresse la parole le moins possible ! » (idem) ; « Ta gueule, connard ! » (Frida, l’héroïne lesbienne, s’adressant à son père Mario, dans le film « C’est ça l’amour » (2019) de Claire Burger) ; « Va te faire foutre ! » (Ritchie, le personnage homo, s’adressant à son père, dans la série et téléfilm It’s a Sin (2021) de Russell T. Davies); etc.
Dans la série Sex Education (2019) de Laurie Nunn, les héros homosexuels ont tous une relation très conflictuelle avec leur papa. Adam ne supporte pas d’être le fils du directeur de son lycée Monsieur Groff. Et en plein bal de l’établissement (c.f. épisode 7 de la saison 1), il l’empoigne devant tout le monde en lui déclarant publiquement sa haine : « Je te déteste !! ». Quant à Éric, son futur amant, ce n’est guère mieux avec son propre daron. Il se travestit et défie les interdits paternels en le narguant (alors qu’il va se faire violer parce qu’il est sorti travesti en femme) : « Salut papa ! » (c.f. épisode 5 de la saison 1). Il reproche aussi à Adam sa dureté « paternelle » : « T’étais déjà une brute quand t’es né ou t’as décidé d’imiter ton père ? » (c.f. épisode 8 de la saison 1).
Dans la pièce The Importance To Being Earnest (L’Importance d’être Constant, 1895) d’Oscar Wilde, Jack n’a que mépris pour son père (« Il n’y a bien sûr rien à redire sur les mères. […] Je ne connais personne au club qui adresse la parole à son père. »), ce à quoi Algernon, qui n’honore pas plus le sien (« Nous ne nous sommes même jamais adressé la parole. Il est mort avant que j’aie un an. »), rajoute : « C’est vrai. Les pères n’ont pas très bonne presse en ce moment. » Gwendolen tient également un discours parricide cherchant à materniser la figure paternelle : « En dehors du cercle familial, papa, je suis ravie de le dire, est un parfait inconnu. Et je crois que c’est très bien ainsi. Le foyer me paraît être le cadre idéal pour un homme. Et il ne fait pas de doute que dès qu’un homme se met à négliger ses devoirs domestiques, il devient péniblement efféminé, n’est-ce pas?» Dans le one-man-show Jefferey Jordan s’affole (2015) de Jefferey Jordan, le héros homosexuel présente son père comme un gros beauf.
Dans son concert Free : The One Woman Funky Show (2014), Shirley Souagnon surnomme son propre père « Vooouin » tellement il est un homme qui passe vite, un être absent, un courant d’air, ou bien un individu qui l’a prise pour un objet et qui l’a violentée : « J’ai vraiment un corps de base. Si j’étais une voiture, je serais sans option. Mon père m’a eue en soldes. C’est un radin. » Elle finit par le renier : « Je ne sais même pas quel est le prénom de mon père. »
Dans la pièce Les Vœux du Cœur (2015) de Bill C. Davis, Bryan, homosexuel, ne supporte pas son père. Et quand il apprend que son amant Tom a pu être physiquement puni par son père, il déclare solennellement à Tom – comme une preuve d’amour – qu’il n’hésitera pas à aller casser la gueule à son « beau-père ».
Dans le film « A Moment in the Reeds » (« Entre les roseaux », 2019) de Mikko Makela, Leevi, le héros homosexuel, a une relation conflictuelle avec son père Jouko qu’il accuse d’avoir tué sa mère. Ce dernier le devine : « Je sais que tu me tiens responsable de la mort de ta mère. Tu ne crois pas que je me sens responsable, moi aussi ? » Leevi finit par quitter son papa, en suivant ainsi les pas de sa mère qui avait quitté aussi son mari : « Tu fais vraiment fuir tout le monde. »
Il arrive que le père du héros homosexuel soit présenté comme malade, un monstre, un clown : cf. le roman La Dette (2006) de Gilles Sebhan, la pièce La Pyramide ! (1975) de Copi (avec Rodrigo, le père aveugle), le roman Quand as-tu vu ton père pour la dernière fois ? (2014) d’Alex Taylor, etc. Dans le roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, le père de Félix a la tuberculose. « Qui croire ? et si je devenais folle, à l’image de mon père dont le cerveau se détériore lentement. » (Émilie s’adressant à son amante Gabrielle, dans le roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami, pp. 186-187) ; « Les vieux nobles qu’elle recevait étaient des amis de son père, aussi laids qu’elle. Le vieux comte des Asturies était couvert de verrues et le duc de Castille, son parrain, était bossu. » (Copi, la nouvelle « L’Autoportrait de Goya » (1978), p. 12) ; « J’ai grandi en coulisses. Mon grand-père était un clown. » (le Machiniste dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1986) de Copi) ; « L’homme se frotta les yeux et gémit. Il avait un crâne chauve constellé de taches de vieillesse ; sa bouche, large avec des lèvres fines, aurait été une bénédiction pour un clown. » (Jane décrivant le vieux Karl Becker, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 62) ; etc.
Par exemple, dans le film « Festen » (1998) de Thomas Vinterberg, le père incestueux de Christian est désigné comme un monstre. Dans la pièce My Scum (2008) de Stanislas Briche, la haine des pères biologiques ou des pères politiques est très prégnante : « papa » est qualifié de « débile affectif » ; et on nous parle de « la face stupide et répugnante du président ». Dans le film « New Wave » (2008) de Gaël Morel, le père de Romain est traité de « pauvre con ». Dans le film « Tous les papas ne font pas pipi debout » (1998) de Dominique Baron, les pères sont giflés. Dans la pièce À toi pour toujours, ta Marie-Lou (2011) de Michel Tremblay, Manon ne supporte pas d’être le portrait craché de son père. Elle le juge « écœurant », au point que sa grande sœur, Carmen, lui reproche de se poser en victime et de ré-écrire la relation entre leurs parents de manière excessivement manichéenne : « T’es complètement folle ! Notre mère, c’était pas une martyre, et notre père, c’était pas le diable, bon Dieu ! »
Le mépris pour le père s’explique très souvent par les réactions odieuses et les actions violentes que ce dernier montre à l’écran. Par exemple, toujours dans la pièce À toi pour toujours, ta Marie Lou (2011) de Michel Tremblay, le portrait du père, Léopold, est catastrophique : c’est un gros beauf scotché devant la télé (« Si la télévision portative sort de la chambre, je sors de la chambre aussi ! » déclare-t-il), qui a violé sa femme (« Comme les trois autres fois où tu m’as violée, tu m’as fait un autre petit. » dit sa femme Marie Lou), qui conduit sa famille à la mort dans un accident de voiture. Dans le film « Respire » (2014) de Mélanie Laurent, le père de Charlène (l’héroïne lesbienne), bat sa femme. Dans la pièce En ballotage (2012) de Benoît Masocco, Gérard Couret, le père d’Édouard (le héros homosexuel), est un homme politique froid, odieux avec son fils (il le traite de « néant »), bureaucrate, homophobe. Dans le film « Beautiful Thing » (1996) d’Hettie Macdonald, le film « Le Cercle des poètes disparus » (1989) de Peter Weir, le film « Billy Elliot » (1999) de Stephen Daldry, le film « Todo Sobre Mi Madre » (« Tout sur ma mère », 1998) de Pedro Almodóvar, le roman Le Jardin d’acclimatation (1980) d’Yves Navarre, le roman All-American Boys (1983) de Frank Mosca, le roman Dream Boy (1995) de Jim Grimsley, le film « Los Abrazos Rotos » (« Étreintes brisées », 2009) de Pedro Almodóvar, le one-man-show Les Bijoux de famille (2015) de Laurent Spielvogel, etc., l’image du père est particulièrement catastrophique. Dans la pièce Hétéro (2014) de Denis Lachaud, les « pères » homosexuels de Gatal sont de véritables despotes avec leur fils unique : ils téléguident sa vie à sa place : « Ça ne peut plus durer. Ça rime à quoi ?? » s’excite l’un d’eux parce qu’il ne comprend pas que son fils en soit pas en couple avec un homme. Ils ne lui disent jamais qu’ils l’aiment : « Comment n’ai-je que ce fils de rien ? » (le Père 2) Dans le film « Stand » (2015) de Jonathan Taïeb, Anton, le héros homosexuel, vient rendre visite à son père qui ne lui ouvre pas la porte. Et il est dit qu’il a été « enfoncé » par ce dernier. Dans le film « Faut pas penser » (2014) de Raphaël Gressier et Sully Ledermann, le père bobo d’Arthur passe du mépris à l’indifférence gay friendly sans qu’on ne comprenne pourquoi. Dans le film « Plaire, aimer et courir vite » (2018) de Christophe Honoré, Jacques, le héros homo, n’a que mépris pour ses parents (« Je les emmerde tous. Mes parents les premiers. ») ainsi que pour son propre statut de père puisqu’il est père du petit Louis : « J’aimerais que mon fils soit fier de son papa. C’est complètement con ce que je dis. On n’a pas à être fier de son père. »
c) Père absent ou indifférent :
Dans les fictions homo-érotiques, quand il n’est pas montré comme le grand méchant loup, le père est au mieux dépeint comme un être éteint, absent, lointain, lunaire, lointain, figé, allongé, voire mort : cf. le film « Le Refuge » (2010) de François Ozon, le sketch de « La Fermeture du salon de coiffure » de Muriel Robin (avec le mari complètement indifférent, et qui finit la tête grillée dans le casque chauffant), le film « L’Arbre et la forêt » (2010) d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau (avec Frédérick, le père absent homosexuel, qui n’est même pas là pour l’enterrement de son fils Charles), etc.
Par exemple, dans la pièce Frères du bled (2010) de Christophe et Stéphane Botti, une immense photo de Maurice, le père de François, trône dans le salon ; mais c’est le seul personnage absent de la famille. Dans la pièce Soixante degrés (2016) de Jean Franco et Jérôme Paza, Rémi, parlant de son père à son ami-amant Damien, dit que c’était un homme « lunaire » qui a cessé de le considérer comme son fils à partir de la mort de son épouse (et de la mère de Rémi) : « Moi, il ne me voyait même plus. J’étais invisible. » Il décide, à l’âge adulte, de renoncer à être père à son tour, et de tuer le papa en lui : « Je n’ai même pas été le fils de mon père. Alors comment voulais-tu que je sois le père d’un fils ? » Dans le film « Moonlight » (2017) de Barry Jenkins, Chiron, le jeune héros homosexuel, ne répond pas quand on lui parle de son père. Il est élevé seul par sa mère (qui se drogue), et le père est totalement absent. Dans le film « The Cakemaker » (2018) d’Ofir Raul Graizer, Tomas, le héros homo allemand, déclare qu’il a à peine connu son père : ce dernier est parti de la maison quand il était petit. Dans l’épisode 268 de la série Demain Nous Appartient diffusée sur TF1 le 13 août 2018, Bart et son amant Hugo se trouvent « un point commun » : ils ont tous les deux manqué de père, Bart parce qu’il ne l’a jamais connu, Hugo parce qu’il a été abandonné à 6 ans par son père. Dans le film « Plaire, aimer et courir vite » (2018) de Christophe Honoré, Arthur a perdu son père dans un accident de voiture et dit qu’il n’a jamais réalisé sa mort : il l’a attendu longtemps. Dans le film « Ma Vie avec John F. Donovan » (2019) de Xavier Dolan, Rupert, le jeune héros homo de 10 ans, déclare que comme point commun fort qu’il partage avec John, lui-même homo, est « le fait qu’ils aient des rapports compliqués avec leur père » Dans la série Sex Education (2019) de Laurie Nunn, Monsieur Groff, le proviseur du lycée de Moordale, est le père d’Adam, l’un des héros homosexuel : il est très froid avec son fils, ne lui témoigne aucune affection, et lui rappelle sans cesse l’ordre : « Tu connais les règles. » (c.f. épisode 1 de la saison 1). Dans le film « Les Crevettes pailletées » (2019) de Cédric le Gallo et Maxime Govare, pendant l’enterrement de son fils gay Jean, le père de Jean reste glacial, ne semble pas affecté.
Dans le film « Die Mitter der Welt » (« Moi et mon monde », 2016) de Jakob M Erwa, Phil, le héros homo, vit seul avec sa mère et sa sœur. Elle les a eus à 16 ans. Glass a été mise enceinte à 16 ans aux États-Unis et vit désormais en Allemagne. Phil est fruit de ce viol, et raconte le vide existentiel qu’il expérimente du fait de ne pas connaître son père biologique : « Une femme avec deux enfants et pas de mari, ça faisait tache ici. Mais on gérait, même sans homme à la maison. Les copains nous interrogeaient sur notre père. Alors on demandait à Glass, qui disait un truc du genre ‘Un marin en voyage’. Ou bien ‘Un cow-boy dans un ranch’. Et plus tard, quand on ne gobait plus tout ça, ‘Je vous le dirai quand vous serez prêts’. Un jour, on a arrêté de demander, vu que ça ne servait à rien. Et aujourd’hui ? C’est normal de ne rien savoir sur notre père, le mystérieux numéro 3 de la liste. Pour moi, ça restait un vide étrange. Un trou noir. Comme si le vide en moi prenait des couleurs. » Le trou noir (on comprend que c’est le vide paternel et le vide généalogique) obsède Phil : « Pourquoi ce foutu trou noir me mine à ce point ?!? Comment quelqu’un peut te manquer, alors que tu ne le connais pas ? » À la fin du film, Phil part à la recherche son père aux States.
Si le père s’absente, ce n’est en tous cas pas pour les bonnes raisons. Il est volage, démissionne de son rôle de père, se présente comme un handicapé de la relation, incapable d’instaurer un dialogue profond avec son fils ou sa fille homosexuel(-le) : « Je ne suis pas ton père, ma fille. » (Bacchus s’adressant à Europe, dans le film « Métamorphoses » (2014) de Christophe Honoré) ; « Henri, mon père, peu présent, partait souvent en ‘voyage d’affaires’. Mais en ce début de siècle, en cette année 2000, la situation s’aggrava : il ne rentrait plus du tout à la maison… Il vivait avec une autre femme ! » (Bryan dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 19) ; « Mon père, je l’ai jamais vraiment connu. Il est parti quand j’étais petit. » (Fred, le héros homosexuel de la pièce Des Bobards à maman (2011) de Rémi Deval) ; « Soleil : de plus en plus de taches. Notre astre suprême serait-il malade ? » (la Comédienne dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1986) de Copi) ; « Je le hais. De pas savoir, jamais, être là. Simplement là. » (le narrateur parlant de son père, dans le roman Le Crabaudeur (2000) de Quentin Lamotta, p. 11)
Par exemple, dans le film « Le Secret d’Antonio » (2008) de Joselito Altarejos, Antonio, à 15 ans, a été abandonné par son père. Dans la pièce Le Gai Mariage (2010) de Gérard Bitton et Michel Munz, le père d’Henri fait son coming out alors qu’il est prêtre et qu’il a renié son fils caché pendant toute sa vie. Dans le film « Todo Sobre Mi Madre » (« Tout sur ma mère » (1999) de Pedro Almodóvar), la jeune sœur Rosa (Penélope Cruz) n’est même pas reconnue par son propre père (Fernando Fernán Gómez), qui la prend pour une simple passante dans la rue. Dans le film « Potiche » (2010) de François Ozon, Robert Pujol est chef d’entreprise et mari volage, souvent montré prostré dans un lit. Dans le film « Get Real » (« Comme un garçon », 1998) de Simon Shore, le père de Steven est déguisé en cosmonaute et délaisse totalement son fils homosexuel. Dans le film « Gun Hill Road » de Rashaad Ernesto Green, Michael, le héros trans M to F, a un père absent, Enrique, qui est allé en taule, et qui ne l’a pas élevé ; les vols et les crimes du père font miroir à la transsexualité du fils, qui prétend détester son père et en arrive à souhaiter qu’il retourne en prison. Dans le film « Little Gay Boy » (2013) d’Anthony Hickling, Jean-Christophe a été abandonné par son père à la naissance (sa mère prostituée l’a eu avec un client). Dans le troisième volet, « Little Gay Boy 3, Holy Thursday (The Last Supper) » (2013), le héros, la vingtaine, rencontre son géniteur pour la première fois : c’est la désillusion totale. Dans le film « East Of Eden » (« À l’est d’Éden », 1955) d’Elia Kazan, le père de Cal a fait croire à son fils que sa mère était morte, alors que ce n’est pas le cas. Dans le roman Accointances, connaissances, et mouvances (2010) de Denis-Martin Chabot, Marcel n’a pas été un enfant désiré par ses parents ; Georges, son père, avait même suggéré l’avortement à sa mère. Georges est le stéréotype du père absent. Il trompe sa femme Brigitte, la bat, et se moque complètement de son fils homo : « Marcel était déjà mort à ses yeux. Il avait abandonné tout espoir. Il avait rejeté ce fils dont il ne voulais plus, dont il n’avait finalement jamais voulu, et qu’il ne voudrait certainement plus jamais –, telle une serviette jetable après usage. » (p. 15) Et Bertrand, qui a fait faire à un couple lesbien un enfant, a tout du père démissionnaire : « Mais ce dernier ne s’implique pas beaucoup dans la vie du garçonnet et des deux lesbiennes, préférant un appel téléphonique hebdomadaire et quelques visites chaque année. » (p. 29) Dans le roman A Boy’s Own Story (1982) d’Edmund White, à plusieurs reprises, le petit garçon appelle son père à l’aide pour rompre le cordon ombilical ; et à chaque fois, le père fait la sourde oreille et le rejette. Dans le one-man-show Entre fous émois (2008) de Gilles Tourman, Jarry regrette que son père, qui l’avait jadis érigé en fétiche (« Mes fils, c’est ce que j’ai de plus précieux. »), le délaisse : « J’avais beau lui dire : ‘Papa, ouh ouh, j’suis là ! On peut communiquer ?’… » ; « Papa, oui, c’est moi, ton fils » ; « Mon père m’a ignoré pendant toute l’après-midi… » Dans le film « Dallas Buyers Club » (2014) de Jean-Marc Vallée, Rayon, le trans M to F, se rend chez son père, homme politique riche qu’il n’a pas vu depuis très longtemps, pour lui demander de l’argent… et « un peu » pour lui réclamer de l’attention : « As-tu honte de moi ? » Dans l’épisode 363 de la série Demain Nous Appartient diffusé le 25 décembre 2018, André Delcourt, le père de Chloé l’héroïne, fait son coming out, après un « mensonge » et une disparition de plus de 35 ans, pendant lesquels il a abandonné femme et enfants (Anna et Chloé) : « À l’époque, je n’ai pas trouvé d’autre solution que de disparaître. »
Le père démissionnaire dément sa réputation de père invisible. Par exemple, dans le film « Footing » (2012) de Damien Gault, Marco, le héros homosexuel, reproche à son père son indifférence ; et ce dernier trouve ça déplacé. Mais parfois, il la reconnaît quand même : « Rakä et moi […] nous nous dîmes que nous nous connaîtrions probablement pas nos enfants, mais nous-mêmes non plus ne connûmes pas nos pères et cela nous nous empêcha pas d’avoir une vie dont nous tirions orgueil par la diversité de l’aventure. » (Gouri et Rakä, les deux rats mâles du roman La Cité des Rats (1979) de Copi, p. 102) Par exemple, tout le film « Lilting » (« La Délicatesse », 2014) de Hong Khaou s’attaque aux pères, au profit d’une glorification des mères et des homosexuels. Même Junn, l’héroïne hétéro, finit par répudier son prétendant Alan, vieillard certes mignon mais vicelard et père démissionnaire : « J’ai pas été un très bon père. »
Il est fréquent que le personnage homosexuel reproche à son père son indifférence, son absence, sa froideur. Je vous renvoie à la chanson « Papa Can You Hear Me ? » de Lara Fabian, la chanson « Un père passe et manque » de Mélissa Mars, le film « Where’s Poppa ? » (1970) de Carl Reiner, la chanson « Un Homme qui passe » de Ronan dans la comédie musicale Cindy (2002) de Luc Plamondon, la pièce Où va le cœur des filles quand ils sont partis ? (2008) d’Annelise Uhlrich, etc. « Tu t’es jamais préoccupé de moi ! » (Dany à son père, dans le film « Sexe, gombo et beurre » (2007) de Mahamat-Saleh Haroun) ; « À seize ans, moi, j’étais encore seulement un fils. Le fils d’un très grand médecin, le saviez-vous ? L’agrégation, la faculté, l’Académie, la faculté, l’Académie, toutes ces choses en imposent à un fils. Je me souviens d’une ombre portée sur nos vies, d’un homme plus grand que nous tous, sans que nous sachions véritablement si cette grandeur était une aubaine ou un malheur pour notre futur d’homme. Aujourd’hui, avec le recul, sans doute, je dirais que notre indifférence réciproque était plus feinte que réelle, et qu’au final j’aurai appris de mon père. » (Vincent, le héros homo s’adressant à la figure de Proust, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 54) ; « Alors, sans que j’aie rien demandé, tu évoques le père inconnu et donc forcément absent, la blessure de cette absence. […] Tu évoques l’imagination qu’il faut déployer pour tenter de constituer une image du père, et le désespoir ravageur au bout de ces tentatives forcément vaines, de ces essais nécessairement voués à l’échec. […] Tu évoques cette filiation unijambiste. Tu dis : quelquefois, j’aurais préféré un père mort, plutôt que pas de père du tout. Tu ajoutes : non. Pas quelquefois. Souvent. […] Tu évoques les années de l’enfance, quand les autres à l’école se moquaient de toi, quand il fallait inventer l’histoire d’un père aventurier, voyageur, disparu ou mort au cours de je ne sais quel hasardeux combat […] » (idem, pp. 98-99) ; « Ça ne m’étonne pas que je te déteste tellement, tu n’écoutes jamais rien ! » (Ronit, l’héroïne lesbienne, à son père, dans le roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, p. 266) ; « Voilà trois ans qu’on ne s’est pas vus, trois ans qu’on n’existe plus pour toi et que tu n’existes plus pour nous… Alors à quoi ça sert de se revoir ? » (Bryan à son père dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 226) ; « Pourquoi tu ne m’as jamais aimé ? » (p. 412) ; « Elle éprouve l’angoisse d’une petite fille qui n’a pas été aimée par sa mère et qui, quoi qu’elle dise, s’est sentie abandonnée par son père. » (Suzanne à propos d’Erika, une de ses amantes, dans le roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, p. 200) ; « Deux ans. Deux ans déjà qu’il ne me parle pas. […] Je reste sale et indigne de sa parole ; je suis une femelle au sexe pourri qu’il faut absolument ignorer afin d’échapper à la condamnation divine ! » (la narratrice lesbienne du roman La Voyeuse interdite (1991) de Nina Bouraoui, p. 31) ; « Mon père, indifférent, comme d’habitude. Il regardait la télé… » (Bernard, le héros homosexuel, dans la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Ceglia) ; « Il est vrai que, dans mon enfance, j’ai reçu très peu de ces marques d’affection que sont les caresses, mes parents étaient trop occupés et n’ayant aucun goût pour ça. » (Alexandra, la narratrice lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 96) ; « Il ne veut rien accepter de moi. » (Cal – interprété par James Dean – par rapport à Will, son père, avec qui il a du mal à communiquer, dans le film « East Of Eden », « À l’est d’Éden » (1955) d’Elia Kazan) ; « Mon père, il se contrefoutait de moi à la naissance. […] J’ai grandi sans référent masculin, ou peut-être trop, ce qui revient finalement au même. Des hommes de passage. » (Jean-Louis dans la pièce Y a comme un X (2012) de David Sauvage) ; « Pour lui, vous n’existez pas. » (Jean-Charles, qui en travesti M to F se fait appeler « Jessica », parle de son père en se vouvoyant lui-même, idem) ; « J’craignais déjà qu’il ne m’aime pas. » (cf. la chanson « papapapapapa » lors du concert d’Hervé Nahel le 20 novembre 2011) ; etc.
Par exemple, dans le téléfilm « Le Clan des Lanzacs » (2012) de Josée Dayan, Barthélémy, le jeune héros homosexuel, communique très peu avec son père, et le lui reproche : « C’est difficile de te parler. »
Le père indifférent et démissionnaire, c’est souvent le héros homosexuel lui-même. Par exemple, dans le film « Free Fall » (2014) de Stéphane Lacant, Marc, le père de famille secrètement homo, abandonne sa femme est enceinte, et la trompe avec Engel. Elle lui dira d’ailleurs qu’elle se sent traitée « comme mère-célibataire » par lui. Dans la série Joséphine Ange-gardien (1999) de Nicolas Cuche (épisode 8, « Une Famille pour Noël »), Martin est l’homo laissant femme et enfants sur le carreau pour vivre avec un homme. Dans le film « The Boys In The Band » (« Les Garçons de la bande », 1970) de William Friedkin, certains héros homosexuels (Alan, Hank, etc.) sont pères avec plusieurs enfants et ont laissé leur famille pour vivre « librement » leur homosexualité. « La première fois que je l’ai fait, c’était pendant la grossesse de ma femme. IL y avait une réunion de professeurs, à New York. Ma femme ne se sentant pas bien, j’y suis allé seul. Et dans le train, j’y ai pensé. J’y pensais, j’y pensais pendant tout le voyage. Et peu après mon arrivée, j’avais emballé un mec dans les toilettes de la gare. » (Hank)
d) Le souhait parricide naissant d’un désir incestuel frustré :
Il se peut que le reproche que le héros homosexuel fait à son père soit justifié, si en effet ce dernier a vraiment manqué d’amour et de présence envers lui. Mais bien souvent, au lieu de dénoncer ce premier manquement, il en rajoute un second qui cette fois vient de lui : la revendication d’un rapprochement au père ou d’une inversion des rôles, qui tient de l’inceste (cf. la chanson « Papa m’aime pas » de Mélissa Mars).
Certains héros (souvent les héroïnes lesbiennes) détestent leur père biologique d’avoir cru que ce dernier était un dieu ou leur amant secret. « Je ne suis pas un de tes supers-méchants de tes B.D. Je n’ai pas le pouvoir dont tu parles. » (le père de Danny à son fils homo dans le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza) ; « Vos parents sont des zéros/z’héros. » (le Dr Katzelblum, homosexuel, s’adressant à son patient homo Arnaud, dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit) ; « J’ai eu honte j’ai souffert. Je ne vais pas sortir les violons même si pour mon père c’est l’instrument de prédilection. […] Mais j’ai toujours eu en tête d’un jour lui reconnaître que j’aime profondément son dos pour rendre justice aux mots. » (cf. le poème « Un autre dos » (2008) d’Aude Legrand-Berriot, p. 46) ; « Elle aimait son large dos, elle avait toujours aimé ce dos très bon, rassurant et protecteur. » (Stephen, l’héroïne lesbienne, dans le roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 115) ; « Ça doit être mon père qui m’a fait ainsi ! Il était trop beau lui aussi ! Comme un gamin-papillon, j’étais fasciné par sa beauté d’homme solitaire. Peut-être que je m’y suis brûlé les ailes ! Je devrais jeter toutes ces photos que j’ai de lui ! Cesser de penser que j’aurais hérité de lui cette attirance pour les garçons. Un désir refoulé qu’il m’aurait transmis en quelque sorte. Et tout cela, parce qu’il nous prodiguait, à moi et à mon petit frère, la tendresse de la mère perdue. » (Adrien, le narrateur homosexuel, dans le roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, p. 60) ; « Mon père était quelqu’un d’exceptionnel. » (Daniel, en boucle face au tombeau de son père homosexuel, dans le film « Joyeuses Funérailles » (2007) de Franz Oz) ; etc. Par exemple, dans la pièce Mi Vida Después (2011) de Lola Arias, l’héroïne lesbienne Vanina se qualifie comme la fille chérie de son père, « l’homme qui posait comme un play-boy ». Dans le film « Le Maillot de bain » (2013) de Mathilde Bayle, le jeune Rémi, 10 ans, ressent son premier émoi pour un beau papa de 35 ans. Dans la pièce Hétéro (2014) de Denis Lachaud, Négoce, homosexuel, se présente comme le « voyou de feu son papa ». Dans le film « Mon Père » (« Retablo », 2018) d’Álvaro Delgado Aparicio, Segundo enterre son père homosexuel, Noé, et met dans son cercueil le retable qu’il a confectionné pour lui et où il s’est représenté en plâtre avec lui : « Papa, voici notre retable. »
Le personnage homosexuel applique la vieille vengeance de l’enfant capricieux qui n’aurait pas été assez écouté… et surtout qui veut être aimé pour un peu plus que ce qu’il est, à savoir un substitut marital. Comme ce souhait n’est pas possible, il va nourrir envers son père adoré un projet de destruction.
Par exemple, dans le film « Xenia » (2014) de Panos H. Koutras, Ody et son petit frère homo Dany haïssent leur père – biologique et fantasmé – qui les a abandonnés à la naissance, mais que Dany idéalise physiquement (il se rêve endormi sur son torse velu) : « On n’a pas de père ! Oublie-le ! » (Ody) ; « Je m’endormais sur son torse. Il était hyper poilu. » (Dany à propos de son père) ; « J’avais deux ans quand t’es parti. » (Dany à son père) ; « C’est toi le branleur. » (idem) ; « Ton erreur, c’est de m’avoir fait. » (idem) ; etc. Leur mère les a encouragé à détruire celui qu’ils nomment « L’Innommable » : « Elle s’est mise à insulter l’Innommable, comme d’habitude. » (Dany) Ils finissent par retrouver ce père tant détesté, qui est/serait devenu un homme politique remarié. Ils essaient de le faire chanter pour lui soutirer de l’argent. À la fin du film, Dany pointe son pistolet contre lui et le fait se déshabiller, avant de prendre ses clics et ses claques.
Le fantasme de parricide, c’est donc tout simplement le désir incestueux : le personnage fait mourir le lien filial avec son père en le considérant comme un amant. Par exemple, dans le film « The Parricide Sessions » (2007) de Diego Costa, Diego tente de convaincre son papa de jouer devant sa caméra le rôle de ses différents amants. Dans la pièce Happy Birthday Daddy (2007) de Christophe Averlan, le père est détesté d’avoir refusé de se prêter au rôle de l’amant : le personnage homosexuel lui reproche son indifférence à son égard : « Ça me fait bander de te voir impuissant. »
On retrouve le lien entre désir incestueux et parricide avec le dialogue entre « L » et sa mère dans la pièce Le Frigo (1983) de Copi (pp. 30-31) :
L. – « Si papa savait ce que tu es devenue, il en mourrait une deuxième fois !
Mère – Et s’il savait que c’est toi qui l’a tué, il en mourrait une troisième fois !
L. – Tu sais très bien que je n’ai pas tué papa ! Pourquoi est-ce que j’aurais tué papa ?
Mère – Parce qu’il te sodomisait ! Je t’ai vu l’assommer à coups de talon aiguille avant de l’étrangler avec des bas de soie ! »
Le parricide fictionnel s’opère symboliquement par une inversion des rapports père/fils et la violation de la différence des sexes, autrement dit par le fantasme incestueux : « Si t’es un bon papa, alors tu fais qu’est-ce que je veux… » (l’enfant à son père dans la nouvelle « L’Histoire qui finit mal » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 5) ; « Je suis ma propre mère. Mon propre frère. Ma propre sœur. Je suis la famille entière, éclatée, réunie. » (Hadda dans le roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, p. 199). Dans le film « Rafiki » (2018) de Wanuri Kahiu, John Mwauras, le père de Kena l’héroïne lesbienne, est volage et a un enfant avec une autre femme que la mère de Kena. En fait, Kena apprend qu’elle va avoir un petit frère (et demi-frère), à cause des infidélités de leur père, en même temps qu’elle fait son coming out.
En plus, les hommes volages, qui vont voir ailleurs ou qui fuient leur paternité, ce sont finalement les héros homosexuels eux-mêmes : par exemple Didier, qui va tromper sa femme avec Bernard, dans la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Ceglia. Dans le film « Tu n’aimeras point » (2009) de Haim Tabakman, Aaron, le héros homosexuel, commence à devenir agressif avec son fils Nataniel, précisément au moment où il est sur le point de pratiquer son homosexualité.
e) Mépris homosexuel du père inspiré de la misandrie de la mère (réelle ou cinématographique) :
Tiens, tant qu’on parle d’inceste, restons-y… Parfois dans les fictions homo-érotiques, l’absentéisme ou l’effacement paternel résulte d’un parricide opéré par la mère : cf. le film « Treading Water » (2001) de Lauren Himmel, le film « Por Que As Mulheres Devoram Os Machos ? » (1980) d’Alan Pak, le film « Anne Trister » (1985) de Léa Pool, le film « À travers le miroir » (1961) d’Ingmar Bergman, le film « The Others » (« Les Autres », 2001) d’Alejandro Amenábar, la pièce Carla Forever (2012) de Samira Afaifal et Yannick Schiavone, etc. « Ne me pose plus de questions sur ton père. » (la mère de Smith, le héros homo, dans le film « Kaboom » (2010) de Gregg Araki) ; « Dad hits mum / Mum hates dad / Family’s done / Growing ou sad / Dad is fool / Mum is crying / Deep in my soul / Something’s breaking / Dad has stopped to hurt mum / A strange shot when dad is gone / Mummy’s head leaning over / Dad is Dead / Game over. » (cf. la chanson « Snowball » de Zazie) ; « Je suis laminé, Joëlle. Ta mère m’a achevé. » (Robert Pujol à sa propre fille Joëlle, dans le film « Potiche » (2010) de François Ozon) ; « Papa est un boulet ! » (Grany devant sa fille, dans le one-man-show Comme son nom l’indique (2008) de Laurent Lafitte) ; « Il était arrivé déjà le même doute pour les corps de son père, il est possible que les deux cadavres qui cohabitent dans cette tombe minuscule ne se soient jamais rencontrés de leur vie. » (Pietro, le personnage homosexuel, face à la tombe de ses deux parents ayant péri dans un incendie, dans le roman Le Bal des Folles (1977) de Copi, p. 14) ; « Comprendre quoi ? Que t’as tué mon père ? » (Gabriel, héros homo s’adressant à Morgane, sa mère transgenre M to F, dans l’épisode 402 de la série Demain Nous Appartient, diffusé le 18 février 2019 sur TF1) ; etc.
Par exemple, dans la pièce La Famille est dans le pré (2014) de Franck Le Hen, toutes les femmes entourant le « couple » homo Tom/Louis ont bazardé leur mari ou ont eu une aventure extra-conjugale cachée : la mère de Tom a quitté son mari (elle répète sans cesse : « Il m’appelle. J’réponds pas. », et sa mère lui dit : « Tu as viré le seul homme qui pouvait te rendre heureuse. ») ; la grand-mère de Tom a été adultère pendant la Seconde Guerre mondiale ; Graziella, la présentatrice-télé, est une femme-tigresse qui fait du jardinier gay un chippendale ; Cindy, la « fille à pédé », se sert de Tom pour s’assurer une visibilité en jouant sa copine. Dans le film « Ma Vie avec John F. Donovan » (2019) de Xavier Dolan, Sam, mère capricieuse, coupe son fils Rupert, le jeune héros homo de 10 ans, de son père biologique : « T’es un menteur, comme ton père. »
Certaines mères prétendent se substituer aux pères, quitte à les détruire : « Fred, je suis ton père. » (Marina, la mère de Fred s’adressant à son fils homo, avec une voix parodique à la « Star Wars », lui expliquant qu’elle est un homme transsexuel F to M, dans la pièce Des Bobards à maman (2011) de Rémi Deval) ; « Les voisines disaient qu’elle était devenue un homme. Elles avaient raison. Ma mère faisait sa révolution. Elle se libérait. Retrouvait sa jeunesse. Et pour cela, elle avait besoin de détruire notre monde, le centre de notre monde : mon père. » (Omar, le héros homosexuel du roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, pp. 34-35) ; « Elle avait, mon père n’avait pas cessé de le répéter, ce par quoi il était irrésistiblement attiré. Ce qui le rendait jaloux, possessif, fou. Elle avait en elle cette part de lui qu’il ne comprenait pas et qu’il ne comprendrait jamais. Elle avait le sexe sur sa figure, à en croire mon malheureux père. Elle avait le pouvoir. Et c’est pourquoi il l’avait emprisonnée les premières années de leur mariage. » (idem, p. 56.)
Par exemple, dans le film « Órói » (« Jitters », 2010) de Baldvin Zophoníasson, la mère de Greta cache à sa fille le nom de son père. Dans le film « Les Frissons de l’angoisse » (1975) de Dario Argento, Carlo, le héros homosexuel, a vu sa mère tuer son père sous ses yeux. Dans le film « My Own Private Idaho » (1991) de Gus Van Sant, la mère de Micke tire sur son mari dans une salle de cinéma où était projeté un western de John Wayne. Dans la comédie musicale Se Dice De Mí En Buenos Aires (2010) de Stéphan Druet, la mère de Yolanda a tué son mari. Dans la pièce La Pyramide ! (1975) de Copi, le père de la Reine est mangé par la Reine et sa petite-fille : « Palalalo, écoute-moi ! Mangeons le Jésuite ! Il a toujours été mauvais père pour toi ! » (la Reine s’adressant à sa fille Palalalo, dans la pièce La Pyramide ! (1975) de Copi) Dans le one-(wo)-man show Désespérément fabuleuses : One Travelo And Schizo Show (2013) du travesti M to F David Forgit, la mère-prostituée travestie M to F tue un de ses clients octogénaire en lui faisant atteindre l’orgasme. Dans le film « East Of Eden » (« À l’est d’Éden », 1955) d’Elia Kazan, la mère de Cal (interprété par James Dean), a tiré un coup de revolver sur son mari, Will.
Il arrive que le fils homosexuel encourage sa mère à tuer le père : « Je veux un couple comme toi et papa, où tu prends le dessus de suite ! » (Zize, le héros travesti M to F s’adressant à sa mère, dans le one-(wo)man-show Zize 100% Marseillaise (2012) de Thierry Wilson) Par exemple, dans la pièce Le Frigo (1983) de Copi, la mère de Loretta et sa fille partage un gâteau pour fêter le meurtre du mari/père ensemble : « Faisons la paix, ouvrons ce frigo pour manger une fois pour toutes ce gâteau d’anniversaire ! Je meurs de faim ! Je n’ai rien mangé de sucré depuis ton dernier anniversaire ! » Dans le film « Mommy » (2014) de Xavier Dolan, Steve, le héros homo, empêche sa mère Diane de former un couple avec Paul, homme qu’il dénigre : « P’tain de beauf ! » En réalité, le fils et la mère se sont ligués contre la gent masculine : « Ils sont tous pareils, putain. » (Steve). Steve, comme par hasard, se retrouve sans père car ce dernier est mort. Il n’a que mépris pour lui : « Ça devait être un enfoiré de touriste, mon père. » Sa mère le confirme dans son élan parricide : « Le père crève ! Le fils l’achève ! »
Quand la mère ne tue pas son mari, en tous cas elle l’anesthésie et le transforme en mauviette émasculée. « C’est chose terrible, la sentimentalité d’une mère. Parole de Garbo. Et vraie calamité un père lui-même sirupeux tout lâche à l’heure de se coltiner ce primordial mensonge de l’amour maternel qui vous raconte la vie gentil conte de fée, de sa voix doué vous berce de l’illusion jusqu’à profond sommeil plein de rêves, et au réveil, ensorceleur encore, vous console de l’histoire pas vraie en vous minaudant de pires faussetés à l’oreille. » (Vincent Garbo, le héros homosexuel du roman éponyme (2010) de Quentin Lamotta, p. 87) ; « Tu m’emmerdes ! Tu nous fais chier avec tes préjugés ! » (Françoise, la mère gay friendly d’Antoine son fils homo, s’adressant à son mari « homophobe » et « rétrograde » pendant le « mariage » de leur fils, dans le téléfilm « Le Mari de mon mari » (2016) de Charles Nemes) ; etc. C’est le cas par exemple dans le film « Mon Fils à moi » (2006) de Martial Fougeron, dans lequel la possessivité maternelle est la conséquence de l’apathie paternelle. Dans le film « Hôtel Woodstock » (2009) d’Ang Lee, le faible père d’Elliot baisse la culotte devant sa femme. Dans le film « Órói » (« Jitters », 2010) de Baldvin Zophoníasson, le père de Gabriel (le héros homosexuel) n’a aucune autorité : « Elle a toujours tout régenter. » dira-t-il par rapport à sa femme. Dans le film « No Se Lo Digas A Nadie » (1998) de Francisco Lombardi, la mère de Joaquín, le héros homosexuel, est ultra-protectrice et diabolise le père devant son fils.
Ou bien la mère du héros homosexuel fait son possible pour que son fils ne puisse pas retrouver son père disparu ou n’arrive pas à se rendre à l’enterrement de ce dernier : cf. le film « 510 mètres sous la mer » (2008) de Kerstin Polte, la pièce Frères du bled (2010) de Christophe Botti (tous les personnages se retrouvent un jour de Toussaint autour des secrets de la mère, pour l’anniversaire de la mort de leur père), le film « Donne-moi la main » (2008) de Pascal-Alex Vincent (avec le voyage vers l’enterrement de la mère, qui finit en escapade champêtre), le film « Comme des voleurs » (2007) de Lionel Baier, le film « La Traversée » (2001) de Stéphane Bouquet, le film « Burlesk King » (1999) de Mel Chionglo, le film « Violet’s Visit » (1995) de Richard Turner, le film « Le Secret d’Antonio » (2011) de Joselito Altarejos, le roman Le Cimetière de Saint Eugène (2010) de Nadia Galy, etc. La recherche de père est souvent avortée, présentée comme utopique et irréfléchie : « J’aime bien d’ailleurs cet aspect-là de Nino : qu’il ne soit pas à la recherche du père mais qu’au contraire, il cherche presque à être père de lui-même. » (Michaël Cohen à propos du personnage de Nino, dans le film « Le Héros de la famille » (2006) de Thierry Klifa, sur l’essai Le Cinéma français et l’homosexualité (2008) d’Anne Delabre et de Didier Roth-Bettoni, p. 281) Par exemple, dans le film « Drôle de Félix » (1999) d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau, la vieille Mathilde dénigre la recherche paternelle de Félix : « Votre père, ce n’est qu’un prétexte. Il ne vous manque pas plus que moi mon mari : vous vous en foutez. » Le film « La Mante religieuse » (2014) de Natalie Saracco commence précisément par l’enterrement du père de Jézabel, l’héroïne bisexuelle : « C’est mon père : il est mort. » Jézabel arrive en retard et se fait engueuler par sa mère. Dans le film « Tous les papas ne font pas pipi debout » (1998) de Dominique Baron, Grany décourage son petit-fils Simon à retrouver son père. Dans le film « Todo Sobre Mi Madre » (« Tout sur ma mère », 1998) de Pedro Almodóvar, Manuela ne veut pas qu’Esteban retrouve la trace de son père et découvre le secret de sa conception. Dans le film « Intrusion » (2003) d’Artémio Benki, l’auto-stoppeuse lesbienne, Florence, empêchera Clara de revoir son père à Gibraltar. Dans le film « Yossi » (2012) d’Eytan Fox, Yossi Hoffman, un jeune homosexuel part à la recherche de sa mère. Dans le film « Navidad » (2009) de Sebastian Lelio, Alicia fait croire qu’elle recherche son père, mais elle ne le verra jamais. Dans le film « Xenia » (2014) de Panos H. Koutras, depuis l’Albanie, Dany et Ody cherchent à retrouver leur père en Thessalonique… mais pour le fric, et finalement sans être sûrs que c’est vraiment leur père : leur voyage est un prétexte pour réussir un concours de télé-crochet grec. Dans le film « L’Art de la fugue » (2014) de Brice Cauvin, au moment de l’enterrement de son père où il devrait pourtant être présent, Antoine, le héros homosexuel, fuit sa famille et décide de partir loin, en avion.
Je vous renvoie également à la partie « Politique du non-dit de la mère » du code « Matricide » dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels.
Parfois, c’est en cherchant à tuer l’imitation du père – vue comme un signe de lesbianisme -, que la mère du héros homosexuel tente d’anéantir son mari. « Stephen [l’héroïne lesbienne] profitait, semblait forte, et quand ses cheveux poussèrent, on découvrit qu’ils étaient auburn comme ceux de Sir Philip [le père de Stephen]. Il y avait aussi une petite fente à son menton, si petite qu’elle sembla d’abord une ombre ; et quelques temps après […], Anna [la mère de Stephen] vit que ses yeux devenaient pers et pensa que leur expression était celle du père. » (Marguerite Radclyffe Hall, The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928), p. 20) ; « Anna croyait devenir folle car cette ressemblance avec son mari la frappait comme un outrage. Elle haïssait la façon dont Stephen se mouvait. » (idem, p. 23)
f) Hamlet :
Rien d’étonnant, dans ces contextes fictionnels de parricide opéré par la mère du héros homosexuel, que ce dernier s’identifie fréquemment à la figure tragique d’Hamlet, l’emblématique personnage shakespearien dont la mère a tué le père (et celui-ci apparaît d’ailleurs devant son fils sous forme de spectre prononçant la fameuse phrase « Remember me… ») : cf. la pièce Hamlet, Prince du Danemark (1602) de William Shakespeare, le film « Hamlet » (1990) de Franco Zeffirelli, le téléfilm « Hamlet » (1972) de David Giles, l’opéra Hamlet (1888) de Piotr Ilitch Tchaïkovski, le film « L’Ange bleu » (1930) de Josef von Sternberg (avec la référence à Hamlet), la chanson « L’Horloge » de Mylène Farmer (et le lancinant « Souviens-toi… »), la série des tableaux Hamlet (1875) de Gustave Moreau, la pièce Le Jour des meurtres dans l’histoire d’Hamlet (1974) de Bernard-Marie Koltès, la pièce Hamlet (1988) de Patrice Chéreau, la pièce Hamlet (1925) de John Gielgud, le film « Hamlet » (1921) de Sven Gade, le film « Hamlet » (1976) de Celestino Coronado, le film « Hamlet » (1976) de Jack Smith, le film « Hamlet » (1948) de Laurence Olivier (où le thème du travestissement traverse toute l’intrigue), le film « Lucky Luke » (2009) de James Huth (avec la scène où Jessie James – Melvil Poupaud – interprète Hamlet en grande drama queen drapée), etc.
Le héros homosexuel entend une voix qui lui dit qu’il a perdu son père : « Une voix m’accompagne dans cette chute interminable, cette mort seul. Vers l’enfer éternel. ‘Bye-bye… Tu n’es plus marocain… Bye-bye… Tu n’as plus de père… bye-bye… Tu n’as plus de Roi…’ Je suis toujours dans la chute. J’ai peur. J’ai peur. » (Khalid, le héros homosexuel du roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, pp. 21-22)
« Pourquoi les yeux de mon tonton nous dévisagent fixement ? » (Raulito à son amant Cachafaz, dans la pièce Cachafaz (1993) de Copi) ; « Cette histoire avec Malcolm, c’était aussi fort que si le fantôme de son père, mort quelques années auparavant, était réapparu. » (Adrien parlant de son amour fini pour son ex, Malcolm, dans le roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, p. 95) ; « Pourquoi cet héritage empoisonné ? » (le fiancé de Gatal, se dirigeant à ses parents qu’il nomme « les fantômes du passé », dans la pièce Hétéro (2014) de Denis Lachaud) ; etc.
Par exemple, dans le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza, le gardien du lycée apparaît comme un spectre du passé. Dans la pièce À toi pour toujours, ta Marie Lou (2011) de Michel Tremblay, Léopold, le père, est décrit comme un « fantôme » effrayant, qui, selon ses propres mots, « a la gueule en sang ». Dans la pièce Doris Darling (2012) de Ben Elton, Doris, l’héroïne lesbienne, critique le jeu de l’acteur Lawrence Olivier dans Le Fantôme d’Hamlet. Dans le film « And Then Came Summer » (« Et quand vient l’été… », 2000) de Jeff London, David parle à son amant Seth de Hamlet. Dans la pièce Eva Perón (1969) de Copi, le dictateur Perón est représenté comme un spectre stoïque. Dans la pièce Une Visite inopportune (1988) de Copi, Cyrille, le personnage homosexuel principal, a joué plusieurs fois le rôle d’Hamlet au théâtre : « Je n’ai pas joué Hamlet depuis un siècle ! Je ne me souviens même plus du texte… » ; « Montrez-lui ma photo dans le rôle d’Hamlet. » Dans la pièce Le Frigo (1983) de Copi, la Mère critique son mari devant sa fille « L. », en le qualifiant de spectre (« ton fantôme de père »). Dans la pièce La Cité des Rats (1979) de Copi, le Diable des Rats apparaît à son fils Gouri pour lui révéler qu’il est l’enfant du viol : « Je suis ton père que tu n’as pas connu ; j’ai violé ta pauvre souris blanche de mère vierge dans le caniveau de la rue de l’Ancienne-Comédie un soir de folie. » Dans le film « La Belle Saison » (2015) de Catherine Corsini, Maurice, le père de Delphine, fait une crise cardiaque qui le rend tétraplégique, pile au moment où sa fille se lesbianise à la capitale. C’est face à ce « beau-père » grabataire, qui ne bouge pas mais qui entend, que Carole, la copine cachée de Delphine, fait son coming out.
Parfois même le père devient un dangereux (ou ignorant) Minotaure : cf. la nouvelle « À l’ombre des bébés » (2010) d’Essobal Lenoir (et le père avec « ses épaisses moustaches en forme de cornes de taureau », p. 29) Dans le one-man-show Anthony Kavanagh fait son coming out (2010) d’Anthony Kavanagh, quand le héros essaie de faire son coming out à son père, ce dernier évite sans cesse le sujet, fait semblant de ne pas comprendre, et répond à son fils qui lui dit « Papa, j’suis homo » : « Eh bien moi, j’suis taureau et ta mère est balance ! »
Du père viendraient un héritage et un destin maudits. « Ces enfants étaient maudits de par leur race. C’est à cause de ça qu’ils sont morts de façon accidentelle, ils devaient expier le péché de leur père noir qui était par ailleurs trafiquant de drogue. » (le narrateur homosexuel dans le roman Le Bal des Folles (1977) de Copi, p. 88)
g) Meurtre du père :
Plus souvent, c’est le héros homosexuel lui-même (au lieu de sa mère) qui achève fictionnellement son père. Le motif de l’assassinat du père est récurrent dans la fantasmagorie homosexuelle : cf. le film « Ken Burns » (2011) d’Adrienne Alcover, le film « Insects In The Backyard » (2010) de Tanwarin Sukkhapisit, la sculpture La Destruction du père (1974) de Louise Bourgeois, le roman Tuer le père (2011) d’Amélie Nothomb, la pièce Happy Birthday Daddy (2007) de Christophe Averlan (où le héros homosexuel ligote son père et le bat à mort), le film « Huit Femmes » (2002) de François Ozon (qui se termine par le suicide du père, l’unique protagoniste masculin de l’histoire), les chansons « L’Innamoramento » et « L’Amour naissant » de Mylène Farmer, les films « Kika » (1993) et « Volver » (2006) de Pedro Almodóvar (dans lesquels les pères sont frappé mortellement), le film « Tu marcheras sur l’eau » (2005) d’Eytan Fox (avec le meurtre du grand-père), le film « Sitcom » (1997) de François Ozon, le film « Infernal Affairs » (2003) d’Andrew Lau et Alan Mak, le film « My Own Private Idaho » (1991) de Gus Van Sant (qui s’achève par l’enterrement du père), le film « Alice et Martin » (1998) d’André Téchiné, le film « Les Filles du botaniste » (2006) de Daï Sijie (dans lequel le père est mortellement assommé par le couple de lesbiennes), le roman Adrienne Mesurat (1927) de Julien Green (avec le père poussé dans les escaliers), le film « Ostia » (1970) de Sergio Citti, le film « Merci… Dr Rey ! » (2001) d’Andrew Litvack, le film « Ken Park » (2002) de Larry Clark (avec les deux grands-parents assassinés par leur petit-fils homo dans leur chambre à coucher), le film « Ghost Of Mars » (2001) de John Carpenter, le film « Regarde les hommes tomber » (1993) de Jacques Audiard, le film « Le Soleil assassiné » (2003) d’Abdelkrim Bahloul, le film « Je veux seulement qu’on m’aime » (1975) de Rainer Werner Fassbinder, le film « Jin Nian Xia Tian » (« Fish And Elephant », 2001) de Yu Li, la chanson « Papa m’aime pas » de Mélissa Mars (où le père se fait flinguer : « Papa m’aime pas. Au nom du père, fais ta prière, les mains en l’air. Papa m’aime pas. J’ai verrouillé toutes les issues. Il est foutu. […] Adieu papa ! »), le roman Le Garçon sur la colline (1980) de Claude Brami, le film « Diferente » (1961) de Luis María Delgado (où on fait mourir le père d’Alfredo accidentellement), la série The Borgias (2011-2012) de Neil Jordan (épisode 5 de la saison 2, où on découvre que le père du sodomite qui est mort a été tué par ce dernier), etc.
« J’vais vous briser ! » (Jules, le héros homosexuel parlant avec son père au téléphone, dans une discussion particulièrement houleuse, dans la pièce Les Sex Friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau) ; « Il ne dira pas qu’il a tué son père, sa mère, son frère, ses chats. » (cf. la chanson « Il ne dira pas » d’Étienne Daho) ; « J’ai tué mon père par deux fois. » (cf. la chanson « Je t’écris » des Valentins) ; « Mon père m’a engendré pour que je le fasse souffrir, pour que je sois son tortionnaire. » (le héros du roman La Dette (2006) de Gilles Sebhan) ; « D’ailleurs, j’ai tué mes parents. […] Je n’ai jamais aimé trop mes parents. » (Pretorius, le vampire gay de la pièce Confessions d’un vampire sud-africain (2011) de Jann Halexander) ; « S’il le fallait, je les tuerais. Allongé sur mon lit j’envisage calmement le parricide. » (Vincent Garbo, le héros homosexuel du roman éponyme (2010) de Quentin Lamotta, pp. 50-51) ; « Va falloir vite se résoudre à couper l’affectif cordon qui me rattache à cette pantomime sentimentale. Depuis longtemps, ce père a failli. » (idem, p. 87) ; « Résultat, aujourd’hui il est mort… et ça me laisse complètement indifférent. » (Bryan, le héros homo parlant de son grand-père, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 406) ; « J’aurais voulu être Superman pour l’éclater. Mais un soir, il s’en est pris à moi. J’étais en CP, j’avais ramené un bulletin de notes un peu moins bon que d’habitude. Il m’a mis tout nu, m’a allongé sur le lit… j’étais terrifié. Il a défait sa ceinture et a commencé à me frapper, sans tenir compte de mon âge, comme si j’étais un adulte ou un criminel. Mais le bulletin, ce n’était qu’un prétexte. Il trouvait que j’avais l’air efféminé. À six ans ! Il me traitait de petit pédé, qu’il allait faire de moi un homme. » (Kévin, l’amant de Bryan, op. cit., p. 422) ; « Mes parents, ils sont morts. » (Henri, le héros homosexuel répondant à un de ses plans cul qui lui demande s’il a des parents, dans le film « L’Homme blessé » (1983) de Patrice Chéreau) ; « Pour moi, mon père est mort. Je vais vivre ma vie d’adulte. » (Édouard, le héros homosexuel de la pièce En ballotage (2012) de Benoît Masocco) ; « Mon grand-père le clown s’est suicidé en cours de spectacle. Il s’est pendu au trapèze, tout le monde croyait à un numéro comique ! Il a eu quinze minutes d’applaudissements avant qu’on s’aperçoive qu’il était mort ! » (le Machiniste dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1986) de Copi) ; « Tu vois ton papa. Son haleine te dégoûte. Tu l’aurais bien tué. Ou t’avais rien sous la main pour faire ça. » (Bacchus parlant à Europe, dans le film « Métamorphoses » (2014) de Christophe Honoré) ; « Les parents, c’est des connards. » (Willy, le gamin transgenre M to F qui se prend pour une fille, dans le film « Le Tout Nouveau Testament » (2015) de Jaco Van Dormael) ; etc.
Par exemple, dans le film « Navidad » (2009) de Sebastian Lelio, Lala, l’une des héroïnes lesbiennes, après avoir nié la présence de son père (« Mon père n’existe pas. »), le tue concrètement. Dans la pièce Les Oiseaux (2010) d’Alfredo Arias, Ornithoman veut tuer son père. Dans le roman Le Bal des Folles (1977) de Copi, le narrateur assomme et tue son éditeur. Dans la pièce Mi Vida Después (2011) de Lola Arias, Vanina, l’héroïne lesbienne, raconte comment elle a découvert, une fois adulte, que son père avait été un militaire qui avait pris part à la dictature argentine des années 1970-1980 ; elle décide de le rayer de la carte : « Le pire, c’est qu’il sera toujours mon père, même si je ne le reverrai plus jamais. » Dans le film « Les Noms du père » (1974) de Geneviève Hervé, trois actrices (diva, star, anti-star), trois générations (grand-mère, mère, fille), tuent théâtralement leur mari. Dans le film « Hazel » (2012) de Tamer Ruggli, le père est délicatement recouvert au Tipp-Ex sur toutes les photos de famille. Dans le one-(wo)man-show Zize 100% Marseillaise (2012) de Thierry Wilson, Zize, le travesti M to F, essaie de se débarrasser de son beau-père lors de l’enterrement du père de son meilleur ami transsexuel Annonciade. Dans la comédie musicale Amor, Amor, En Buenos Aires (2011) de Stéphane Druet, le père de Yolanda la prostituée a été « assassiné à coups de talons aiguilles » Dans le film « East Of Eden » (« À l’est d’Éden », 1955) d’Elia Kazan, Cal (interprété par James Dean) provoque la crise cardiaque de son père, crise qui lui sera fatale. Dans le film « L’Objet de mon affection » (1998) de Nicholas Hytner, Nina, la « fille à pédés » enceinte de Vince, un homme hétéro qu’elle n’aime pas, décide d’élever son futur enfant avec son meilleur ami gay, George, qui fera office de père de substitution. George et elle décident de confisquer à Vince, le père de sang et de droit, son rôle de père : « Vince, je veux élever mon enfant avec George. » annonce solennellement Nina. Et Vince, blessé et agressif, lui rétorque : « Tu sais quoi ? moi, je veux l’élever avec l’Homme invisible. »
Dans le film « Mezzanotte » (2014) de Sebastiano Riso, Davide, le héros homosexuel, rejette l’appel téléphonique de son père et abandonne carrément son portable dans la rue. Plus tard, le père détruit au marteau le grenier où Davide vit son monde secret avec ses miroirs et ses photos d’actrices. Il tente de « guérir » son fils en le piquant avec une seringue aux fesses. À la fin du film, alors qu’il tente de le ramener de force à la maison, Davide se saisit d’un éclat de verre juste avant de monter dans la voiture paternelle. Le spectateur pense que le héros va trancher la gorge de son père avec l’arme de fortune. Finalement, il la retourne contre lui, sous les cris d’horreur de son père qui l’amène d’urgence à l’hôpital.
Dans la pièce L’Héritage était-il sous la jupe de papa ? (2015) de Laurence Briata et Nicolas Ronceux, Vanessa et Nicolas, la sœur et le frère (homosexuel), assistent à l’enterrement de leur père, Richard, après le tragique suicide de leur mère Christiane survenu un an auparavant. Le père avait une maîtresse, Rose, avec qui il a eu un fils caché, Vincent, qui n’est autre que l’amant de Nicolas ! Au moment de l’enterrement, Vanessa et Nicolas apprennent que Rose et Vincent recevront seuls tout l’héritage, ce qui provoque l’ire de Vanessa sur la tombe de son défunt père (qu’elle porte responsable du suicide de sa femme) : « Sale porc ! Vicieux ! T’es qu’un gros dégueulasse ! Assassin ! Oser faire ça à maman ! » Plus tard, Géraldine, la femme de Nicolas, accuse Vincent d’avoir conduit son père (caché) à la mort : « C’est Vincent qui l’a tué ! » Quant à Nicolas, en couple avec son demi-frère, il rend responsable son père décédé de leur homosexualité à tous les deux (et, du coup, à tous les trois !) : « Tu vas voir tes deux fils s’aimer. Mais tu ne peux t’en prendre qu’à toi-même ! »
h) Le parricide porté comme une culpabilité plus ou moins fondée :
Le meurtre parricide dans les fictions n’est pas nécessairement effectif ou prémédité : il se limite parfois à un cauchemar fait par le héros homosexuel, à une culpabilité (dénégatrice) ressentie face à la radicalité et à la brutalité de la mort naturelle/accidentelle du père (ou de la mère), à une impression honteuse d’avoir été pris à son insu la main dans le sac de l’inceste. Beaucoup de héros revêtent le deuil de leur papa au point de s’y identifier : « Mon père ne bougeait pas. Son visage était caché. On eût dit qu’il était mort. » (le petit Justin, découvrant à 5 ans son père mystérieusement mort dans le salon familial dans le film « Les Voleurs » de Téchiné) ; « Je sais pas comment j’ai compris que maman était morte. […] Peut-être c’est moi qui l’ait tuée. […] Comment leur dire que maman est pas vraiment morte et que papa a jamais existé ? » (le narrateur du roman Le Crabaudeur (2000) de Quentin Lamotta, pp. 10-11) ; « Adieu papa ! Lalalala. Papa m’aime pas. Je pourrai jamais dire papa. Je n’en ai pas. » (cf. la chanson « Papa m’aime pas » de Mélissa Mars) ; « Là, le monsieur couché, c’est qui ? C’est papa ? Il est mort ? » (la psy parlant à Auriane, une petite fille qui croit avoir tué son père en rêve, et qui commente son dessin, dans la pièce Psy Cause(s) (2011) de Josiane Pinson) ; « Ma mère est morte quand elle m’a donné le jour. » (Dicky Teyer, le héros homo de la comédie musicale Le Cabaret des hommes perdus (2006) de Christian Siméon) ; « Ma mère est morte quand j’étais petit. » (Gabriel, l’un des deux héros homos du film « Hoje Eu Quero Voltar Sozinho », « Au premier regard » (2014) de Daniel Ribeiro) ; « Comme m’a dit mon père avant de mourir dans mes bras : ‘Je ne comprends rien. Je n’ai jamais rien compris.’ » (Michael, l’un des héros homosexuels du film « The Boys In The Band », « Les Garçons de la bande » (1970) de William Friedkin) ; « Je l’ai démolie. Elle est là. Morte. Elle suffoque. Je devrais pourtant m’extraire. » (le narrateur de la performance Nous souviendrons-nous (2015) de Cédric Leproust) ; « Je me demande si mon père est mort parce que je lui faisais honte. » (Arthur, le héros homo, dans le roman Harlem Quartet (1978), mise en scène par Élise Vigier en 2018, de James Baldwin) ; « Écoute, t’as changé depuis la mort de maman. Je sais que tu culpabilises et je sais que ça a été difficile pour toi comme pour moi. Mais ça te donne pas le droit de tout contrôler dans ma vie. Tu comprends, ça ? Je n’en peux plus, j’ai besoin de respirer. » (Romane, l’héroïne lesbienne, s’adressant à son père dans l’épisode 68 « Restons zen ! » (2013-2014) de la série Joséphine Ange gardien) ; etc.
Dans le film « Le Fil » (2010) de Mehdi Ben Attia, Bilal culpabilise de la mort de sa mère, même s’il n’a conservé aucun souvenir de sa maladie ; et Malik se sent coupable de la mort de son père dont il est l’un des seuls à connaître le cancer. Dans le film « Collateral » (2004) de Michael Mann, Vincent fait croire qu’il a tué son père quand il avait 12 ans. Dans la pièce Une Cigogne pour trois (2008) de Romuald Jankow, Sébastien est hanté par le souvenir de sa mère suicidée. Dans le film « Nocturne » (1990) de Jacqui Duckworth, ou bien dans le roman Deux Femmes (1975) d’Harry Muslisch, la mort de la mère est portée comme une faute. Dans la pièce Parfums d’intimité (2008) de Michel Tremblay, Luc culpabilise de la mort de son père.
i) Lien causalisé entre parricide et homosexualité:
Est-ce le meurtre (réel ou symbolique) du père qui a provoqué l’homosexualité, ou le désir homosexuel qui incite à l’assassinat du père ? Ni l’un ni l’autre. Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’il existe un lien fort, souvent signifiant, mais non-causal, entre homosexualité et parricide dans les fictions homo-érotiques. Loin de renvoyer à un désir de meurtre qui va toujours s’actualiser, il indique plutôt chez le héros homosexuel un éloignement du Réel, une fuite de sa famille/de sa propre paternité, une gémellité incestueuse entre homosexualité et homophobie.
Le héros homosexuel est lui-même très mal à l’aise avec sa propre homosexualité, qui trahit une relation incestuelle/incestueuse avec son père, et qu’il envisage parfois comme un parricide. Par exemple, dans le film « Mourir comme un homme » (2009) de João Pedro Rodrigues, au moment où le héros homosexuel Ze María tue son petit copain d’une balle, il dira bizarrement que « son père est mort » ; ensuite, tout fier de son crime passionnel, il déclarera à son père transsexuel : « J’ai tué un pédé comme toi qui ne méritait pas de vivre. » Dans le film « Je t’aime toi » (2004) d’Olga Stolpovskay et Dmitry Troitsky, Uloomji, face au cadavre de son père veillé par sa famille Kamoulk, se fait accuser de parricide (« C’est toi qui a tué ton père ! »), officiellement pour son éloignement géographique (il a quitté sa famille pour vivre à Moscou), officieusement parce que son homosexualité a été découverte. Dans le film « Ander » (2009) de Roberto Castón, quand la mère d’Ander meurt, ce dernier culpabilise énormément (« C’est de ma faute. ») : il croit que c’est son homosexualité qui a mystérieusement tué sa mère, même si elle est morte sans l’avoir apprise. Dès l’incipit du roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman (qui traite de l’homosexualité féminine dans sa globalité), on assiste à la mort du père de Ronit (l’héroïne lesbienne), Rav Krushka le grand ; plus tard dans le livre, Dovid, le « gentil » mari d’Esti, fait un malaise au moment de découvrir que sa femme le trompe avec une autre : « J’ai observé Dovid affalé sur le sol de la chambre dans une posture étrange, une jambe tordue sous lui. » (p. 243) Dans le film « Poltergay » (2006) d’Éric Lavaine, Marc, le héros, assomme presque mortellement à la pelle le père de sa femme Emma en croyant se débarrasser d’un des nombreux fantômes homosexuels habitant sa maison. Dans le film « Les Filles du botaniste » (2006) de Daï Sijie, le père botaniste se fait tuer par le couple de lesbiennes Min et An dans la serre, juste au moment où il découvre leur liaison. Dans le sketch « Le Mariage homosexuel bientôt en France » de l’humoriste Lamide Lezghad, à l’émission On n’demande qu’à en rire sur France 2 du 31 janvier 2011, le mariage gay de Rachid provoque le suicide de son père. Dans le film « 510 mètres sous la mer » (2008) de Kerstin Polte, tout concoure à ce que Simone, la protagoniste lesbienne, reste bloquée dans un aéroport, fasse une rencontre amoureuse homosexuelle, et ne puisse pas se rendre à l’enterrement de son père (la première phrase de ce court-métrage est d’ailleurs « Mon père est mort. »).
Il est parfois explicitement dit que le coming out a provoqué la mort du père, ou bien que la mort du père a révélé chez le héros une homosexualité : « Je n’exclus pas que son absence brutale de ma vie, à un moment peut-être crucial pour moi, n’ait été responsable du fait que je sois devenue homosexuelle. » (Suzanne en évoquant sa mère qui est morte quand elle avait 11 mois, dans le roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, p. 19) Par exemple, dans la nouvelle « La Césarienne » (1983) de Copi, Jean-Paul, le jeune homo, reçoit un colis des États-Unis, contenant la tête de son père : « Après un instant de stupeur, Jean-Paul se sentit pour la première fois de sa vie coupable de son homosexualité. » (p. 73) Dans la pièce Moi aussi, je voudrais avoir des traumas familiaux… comme tout le monde (2012) de Philippe Beheydt, Eddy (jouant le rôle fictif du père) offre à son pseudo fils Édouard Père manquant, fils manqué dès qu’il le suspecte d’être homo. Dans le film « Mine Vaganti » (« Le Premier qui l’a dit », 2010) de Ferzan Ozpetek, Vincenzo, le père, fait un infarctus suite au coming de son fils Antonio.
Le père est haï surtout parce qu’il exprime son malaise ou son refus de l’homosexualité de son fils/de sa fille. Par exemple, dans le film « K@biria » (2010) de Sigfrido Giammona, Giovanni, le père de Francesco, est politicien et se montre incapable d’accepter l’homosexualité de son fils. Dans le sketch « Sacha » de Muriel Robin, Bruno, le fils homosexuel, s’est fait surnommer « la chochotte » par son père quand il était petit. Dans le sketch « Le Papa Zonard » de Bruno Salomone, le fils se fait soupçonner de « dalepé » par son père parce qu’il écoute la comédie musicale Roméo et Juliette. Dans le film « No Se Lo Digas A Nadie » (1998) de Francisco Lombardi, le père de Joaquín force son fils homosexuel de 15 ans à s’endurcir, en le faisant jouer à la boxe ; voyant qu’il est impossible de l’endurcir, il finit par le maltraiter et par exprimer tout haut son homophobie.
L’homosexualité pratiquée devient, pour certains héros, l’instrument de la punition filiale. Par exemple, dans le roman La Dette (2006) de Gilles Sebhan, le héros homosexuel méprise son père colonisateur d’Algérie, et cherchent, en couchant avec les Algériens, à rembourser « la dette sans fin, la dette infinie qu’il lui faudrait payer en se livrant à des Arabes, en livrant son cul à des Arabes, pour déshonorer son sang, sa race, la dette contractée à travers son père à travers la Guerre d’Indépendance, à travers le renoncement au sol arabe, à travers ce supplice du sexe violé ».
Dans le film « Facing Mirrors : Aynehaye Rooberoo » (« Une Femme iranienne », 2014) de Negar Azarbayjani, le père d’Adineh l’héroïne transsexuelle F to M veut la forcer à se marier avec un homme (son cousin à elle) pour que sa fille ne déshonore pas la famille. Il aurait voulu qu’elle ne vienne pas au monde : « Je regrette de l’avoir fait. » Rana, une mère de famille et amie d’Adineh, essaie de faire entendre raison au père d’Adineh, en le rabaissant : « Vous ne l’avez jamais comprise. » Le père de cette femme intersexe s’acharne à la marier avec un homme pour la faire rentrer dans le rang : « Ou sinon, elle devra me considérer mort, comme sa mère. » assure-t-il.
On devine que le père du héros homosexuel est très mal à l’aise avec l’attrait homosexuel de son fils, au point qu’il essaie au départ de l’éradiquer à tout prix. Par exemple, dans le film « Le Fils préféré » (1993) de Nicole Garcia, Francis, le héros homosexuel, est rejeté par le père qui voulait en faire un boxeur. Dans le film « Saisir sa chance » (2006) de Russell P. Marleau, le père de Chance, le héros homosexuel, essaye de faire de son fils un soldat (ses enfants l’appellent même « chef ») ; et le père de Lévi, aussi homosexuel, veut transformer contre son gré son fils en champion de foot, et Lévi n’ose pas lui tenir tête.
C’est sans doute l’effet-miroir désirant entre le père et le fils qui pose problème. Par exemple, dans la pièce La Mort vous remercie d’avoir choisi sa compagnie (2010) de Philippe Cassand, Jean-Loup, le héros homo, est en conflit avec son père (qui se trouve être aussi homosexuel !). Cet effet-miroir, indiquant un viol ou un événement ressenti comme tel, peut faire des étincelles et avoir une issue dramatique.
Par exemple, dans le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza, le père de Danny s’oppose au film que son fils homosexuel a réalisé sur leur histoire houleuse (on devine qu’il l’a soit violé soit battu) : « Mon père est un salopard et un manipulateur. Il a trompé ma mère même la dernière année de sa vie. Il a baisé ma prof de théâtre et il m’a… » Chacun reproche à l’autre la maladie (cancer) puis la mort de la mère/femme : « Tu ne comptes plus, depuis que tu as fait souffrir maman jusqu’à la tuer ! » (Danny à son père, dans le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza) Le père de Danny renie l’existence de son fils.
Dans la pièce Gouttes dans l’océan (1997) de Rainer Werner Fassbinder, Franz, le héros homosexuel, raconte qu’il a rêvé deux fois que l’amant de sa mère (son beau-père) pénétrait dans son lit pour le violer : « Puis il est venu dans mon lit. J’avais l’impression de devenir de plus en plus petit. Comme une fille. Puis il est rentré en moi. » Dans le one-man-show Cet homme va trop loin (2011) de Jérémy Ferrari, le père Vert, curé gay et pédophile, a jadis été violé par son père et par ses profs.
La haine homosexuelle du père est plus largement une attitude anti-sociale, car souvent, c’est toute la société qui est hétérosexualisée et patriarcalisée par les héros gays friendly bisexuels. « Tout le monde s’en fout de votre vieille tradition patriarcale. » (Shane, le héros homo s’adressant au couple hétéro réac de droite Loren/Tommy, dans la série Faking It (2014) de Dana Min Goodman et Julia Wolov, cf. l’épisode 1 « Couple d’amies » de la saison 1)
FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION
PARFOIS RÉALITÉ
La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :
a) La misandrie (mépris des hommes-mâles) :
Le XXe siècle a-t-il signé la mort à petit feu de la paternité, de la valorisation des pères, et plus globalement des hommes ? Tout porte à croire que oui. « Les hommes aujourd’hui sont sur la sellette. » (Meret Becker dans le documentaire « 68, Faites l’amour et recommencez ! » (2008) de Sabine Stadtmueller) Si on regarde dans l’Histoire humaine, en France par exemple, en 1935, le droit de correction paternelle est supprimé. Les progrès de la contraception ont rendu de plus en plus les femmes responsables des engendrements, et les pères sont devenus des objets annexes, des guichets automatiques. Peu à peu, le père a été réduit à la fonction symbolique de la nomination. En 1970, l’expression « chef de famille » a été supprimée. Est arrivée l’égalité des droits sociaux et politiques, la légalisation de l’avortement. La psychanalyse a basculé du père freudien à la maternalisation par l’intermédiaire de Mélanie Klein, Ferenczi, Winnicott… Dans Passeurs de vie : essai sur la paternité (1997), Xavier Lacroix explique comment actuellement les pères ne sont quasiment plus protégés par la loi et le droit en cas de divorce (il indique d’ailleurs les chiffres alarmants du taux de suicide des pères : les hommes divorcés se suicident dans une proportion de 3 à 6 fois supérieures aux hommes mariés).
Socialement, l’éloignement-rupture avec le père, et la fonction symbolique de ce dernier – à savoir le rappel du Réel, de la structuration humaine et des normes communes pour un mieux vivre ensemble – indique un glissement de nos civilisations vers des rapports humains qui se virtualisent, s’uniformisent, se fragilisent, deviennent violents, paradoxalement au nom du confort et d’une béatification des victimes féminines/féminisées : « Il n’y a plus d’hommes, il n’y a plus de femmes, rien que des êtres humains égaux, forcément égaux, mieux qu’égaux, identiques, indifférenciés, interchangeables. […] on suggère la supériorité évidente des ‘valeurs’ féminines, la douceur sur la force, le dialogue sur l’autorité, la paix sur la guerre, l’écoute sur l’ordre, la tolérance sur la violence, la précaution sur le risque. […] La société unanime somme les hommes de révéler la ‘féminité’ qui est en eux. » (Éric Zemmour, Le Premier Sexe (2006), p. 10) Comme l’explique parfaitement Philippe Muray dans son essai Festivus festivus : Conversations avec Élisabeth Lévy (2005), il existe une corrélation forte entre misandrie et destruction du Réel. Notre monde douillet et maternant, qui veut nier la mort et la souffrance pour mieux les laisser gagner, diabolise la force et le pouvoir en les affublant de doux surnoms tels que « patriarcat », « domination masculine », « hétérosexisme », « homophobie » : « De la domination masculine, comme on sait, procède tout les maux. » (p. 14)
Plusieurs années de féminisme idéologique et de libertarisme bisexualisant/homosexualisant ont rendu la misogynie moralement et légalement inacceptable dans la sphère publique, alors qu’à l’inverse la misandrie est maintenant justifiée, banalisée et excusée par la grande majorité de nos contemporains. Certains vont même jusqu’à nier agressivement son existence ! « La misandrie, ça n’existe pas ! Un homme agressé : IMPOSSIBLE ! Il ne peut être que l’agresseur de la femme ! Seules les femmes et les homosexuels sont des victimes ! » entend-on à longueur de temps. Dans nos sociétés occidentales gynocentriques – c’est-à-dire centrées sur les problèmes et les besoins des femmes – et misandriques – mettant en évidence la méchanceté et les imperfections des hommes –, les hommes, les maris, les grands-pères, ont de moins en moins droit de cité. Et ce mépris a parfois pour conséquence une radicalisation des camps hommes/femmes, et un accroissement des violences faites aux deux ! Dommages collatéraux logiques.
La communauté homosexuelle suit docilement le sillon anti-mecs (et donc, au final, anti-femmes) tracé par les militantes féministes agressives (expression pléonastique…). Ses membres dépeignent les hommes dits « hétérosexuels » comme des brutes épaisses, et cherchent à les détruire. « On s’en fout des hommes ! » (une des clientes lesbiennes d’une boîte parisienne, dans le documentaire « Les Femmes entre elles » de l’émission Dans les yeux d’Olivier (2011) d’Olivier Delacroix et Mathieu Duboscq, diffusée sur la chaîne France 2, le 12 avril 2011) ; « J’aime les femmes. Je n’aime pas les garçons. Ils sont trop brutaux. Ils ne sont pas beaux. Ils sont machos. » (Anne, femme lesbienne interrogée dans l’essai L’Homosexualité dans tous ses états (2007) de Pierre Verdrager, p. 87) ; « Je m’appliquais à me rapprocher le plus possible des garçons pour apaiser mes parents. En vérité, je m’ennuyais beaucoup en leur compagnie. » (Eddy Bellegueule dans le roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, p. 105) ; « Je suis arrivé dans le salon. Et je les ai accusés de m’avoir fait homosexuel. Je leur ai dit que c’était de leur faute. » (Alexandre, jeune témoin homo de 24 ans, parlant de lui à 14 ans en 2001, dans l’émission Temps présent spéciale « Mon enfant est homo » de Raphaël Engel et d’Alexandre Lachavanne, diffusée sur la chaîne RTS le 24 juin 2010) ; « J’ai défoncé mon placard, et maintenant je vais te détruire. » (par rapport au « mâle dominant ») (Linn, jeune homme brésilien travesti en femme, dans le documentaire « Bixa Travesty » (2019) de Kiko Goifman et Claudia Priscilla) ; etc. Je vous renvoie également au documentaire « Elula, les hommes on s’en fout » (2000) de Josée Constantin et Catherine Gonnard, ainsi qu’à l’essai Le Musée de l’Homme : Le Fabuleux Déclin de l’Empire masculin (2005) de David Abiker. Dans le documentaire « Regarde, elle a les yeux grand ouverts » (1978) de Yann Lemasson ou « La Domination masculine » (2007) de Patric Jean, on nous présente la caricature du macho comme un portrait fidèle de la réalité masculine. La haine des hommes est aussi exprimée par certaines femmes lesbiennes dans le documentaire « Mamá No Me Lo Dijo » (2003) de Maria Galindo.
« Nul mari ni amant ne m’approchera en érection ! » (Lise et Clara, le couple lesbien du documentaire « La Grève des ventres » (2012) de Lucie Borleteau) ; « Les mecs sont interdits… non… en fait, j’dis en déconnant. C’est une affaire de proportion. Il nous faut une part des garçons comme il nous faut une part d’handicapés dans les entreprises. (rires) » (Charlotte et Marion, un « couple » lesbien, dans le documentaire « Homos, et alors ? » de Florence d’Arthuy, diffusée dans l’émission Tel Quel, sur la chaîne France 4, le 14 mai 2012) ; « Pendant ce temps, paradoxe du sexe, paranoïa de l’amour, mes relations avec les garçons déchiffraient une sorte de partition où participaient une attraction-répulsion, un jeu d’amour-haine. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 58)
Par exemple, dans le documentaire « Le Bal des Chattes sauvages » (2005) de Véronika Minder, un groupe de femmes lesbiennes décrit le torse velu des hommes comme le summum de l’horreur.
C’est la domination sur les hommes plutôt que la domination masculine que beaucoup de personnes homosexuelles (et leurs icônes-chanteuses) promeuvent et font semblant de dénoncer. Par exemple, lors de son (très décrié) concert de l’Olympia en juillet 2012, la chanteuse Madonna bâillonne lentement un de ses choristes sur l’air de la chanson « Je t’aime moi non plus », en simulant la scène SM de correction sexuelle.
Même si c’est mal compris et reçu, le mépris homosexuel des hommes s’origine majoritairement dans un sentiment de jalousie et d’adoration mal placée à l’égard de la gent masculine. « La jalousie dirigée contre les hommes n’est que la projection de sa propre attirance érotique pour les hommes. » (cf. l’article « Le Rôle de l’homosexualité dans la pathologie de la paranoïa » (1911) de Sandor Ferenczi, cité dans l’essai L’Homosexualité de Platon à Foucault (2005) de Daniel Borillo et Dominique Colas, p. 406)
Les personnes homosexuelles pratiquantes (et en particulier les femmes lesbiennes) nient en général leur misandrie par le fait (souvent avéré) qu’elles sont jalouses des hommes et qu’elles ne pourraient donc pas les détester (c’est bien mal connaître l’ambiguïté violente et fusionnelle de l’idolâtrie). « Je n’ai aucun problème avec les hommes. La preuve : j’ai un mec à l’intérieur de moi. » (Shirley Souagnon, lesbienne, dans l’émission Bref à Montreux (Suisse), sur la chaîne Comédie +, diffusée en décembre 2012) Par exemple, dans l’autobiographie Mauvais Genre (2009) de Paula Dumont, celle qui demandait à sa mère pourquoi elle n’avait pas de pénis et qui s’habillera plus tard en cow-boy dira, comme par amnésie, qu’« elle n’a jamais considéré les hommes comme des rivaux » (p. 115) et qu’« en aucune façon elle aurait voulu être un homme » (p. 117)… ce qui est en partie faux et en partie vrai, car l’hyper-masculinité cinématographique n’est pas le sexe masculin véritable mais a été considérée comme telle par l’écrivaine.
b) Mépris pour le père :
Le principal représentant des hommes, c’est évidemment le père.
Génétiquement, c’est le père qui détermine le sexe de l’enfant. Étant donné que beaucoup de personnes homosexuelles n’acceptent pas leur sexuation biologique de naissance, il est logique qu’elles s’en prennent à leur papa. Par ailleurs, dans leur enfance, le ressentiment contre leur géniteur a pu être renforcé par la relation fusionnelle avec la mère. En général, les personnes homosexuelles n’ont pas résolu leur complexe d’Œdipe, c’est-à-dire un désir incestueux pour la mère et un désir homicide envers le père. « Mes expériences m’ont également appris, de façon toujours renouvelée, que lors de l’attitude œdipienne négative les garçons ne font pas que haïr leur mère, mais qu’ils sont envieux et jaloux de son rôle auprès du père. […] Les hommes sont jaloux d’une rivale dans tous les cas où des motions homosexuelles latentes ou manifestes apparaissent en eux. » (Félix Boehm, « Le Complexe de féminité chez l’homme », dans l’essai Bisexualité et différence des sexes (1973), p. 435)
Nombreuses sont les personnes homosexuelles qui ont une relation mauvaise voire inexistante avec leur père (biologique, et surtout symbolique)… même si, avec le temps, le conflit d’adolescence a parfois fini par se tasser ou par devenir cordial : on peut penser à Lord Alfred Douglas, Marlon Brando, François Ozon, James Baldwin, André Gide, Julien Green, Federico García Lorca, Rupert Everett, Cary Grant, Abraham Ángel, Serguei Esenin, Gus Van Sant, Peter Weir, Frank Mosca, Bai Xianyong, Yves Navarre, Oscar Wilde, Havelock Ellis, Jean Le Bitoux, Dominique Fernandez, Élia Kazan, Bruce Chatwin, John Cheever, Jim Grimsley, Andy Warhol, Tennessee Williams, Fritz Lang, Frédéric Lopez, etc. « Je ne l’aimais pas. Je ne l’avais jamais aimé. » (cf. les propos d’ouverture de l’essayiste français Didier Éribon, dans sa biographie Retour à Reims (2010), p. 15) ; « Mon père ivre » (Eddy Bellegueule dans le roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, p. 14) ; « Habitué au silence entre lui et moi » (idem, p. 58) « ‘Faut que je te dise aussi un truc, c’est que je t’aime et que t’es mon fils, quand même, mon premier gamin.’ Je n’avais pas trouvé ça, comme on pourrait le penser, beau et émouvant. Son ‘je t’aime’ m’avait répugné, cette parole avait pour moi un caractère incestueux. » (idem) ; « Lui et moi n’avons jamais eu de véritable conversation. Même des choses simples, ‘bonjour’ ou ‘bon anniversaire’, il avait cessé de me les dire. » (idem, pp. 111-112) ; « Je n’étais pas un enfant désiré et mon père n’incarnait pas la bienveillance, expliquait-il. Il n’était que dans le dénigrement et les coups. […] Pour un fou rire qui l’agaçait, je pouvais me retrouver puni, enfermé dans un cagibi. J’étais terrorisé! Mon père n’était qu’une menace. » (Frédéric Lopez, présentateur français sur France 2 de Rendez-vous en terres inconnues, novembre 2016 pour TV Magazine) ; etc. Par exemple, Edmund White décrit son père comme un homme haineux. Lors de sa conférence en janvier 2012 au Centre LGBT de Paris, à l’occasion de la sortie de son essai sociologique Délinquance juvénile et discrimination sexuelle, Sébastien Carpentier tourne en dérision la « mode de revalorisation de l’image du père ». Dans son autobiographie Notes Of A Native Son (1955), James Baldwin raconte qu’il a repoussé le plus longtemps possible les visites à son père mourant, alors que toute leur vie, ils se sont menés une guerre sans merci : « J’avais dit à ma mère que c’était parce que je le haïssais. Mais ce n’était pas vrai. La vérité, c’est que je l’avais haï et que je tenais à conserver cette haine. Je ne voulais pas voir la ruine qu’il était devenu : ce n’est pas une ruine que j’avais haïe. » (p. 98) Dans son autobiographie Le Flamant noir (2004), Berthrand Nguyen Matoko parle, concernant son père, d’« une aversion qu’il vouait à son égard » (p. 49). Dans le film documentaire « Louise Bourgeois : l’araignée, la maîtresse, la mandarine » (2009) de Marion Cajori , Amei Wallach, la sculptrice raconte les disputes de ses parents, les infidélités de son père volage, et dit qu’elle n’aime pas ce dernier et qu’elle n’est pas « réconciliée » avec lui.
Il arrive que le père soit présenté comme malade, un monstre, un clown, une brute : « L’homme que j’avais connu, vociférant à tout propos, stupide et violent, […] dans les mois, les années peut-être, qui avaient précédé sa mort, il avait cessé d’être la personne que j’avais détestée pour devenir cet être pathétique : un ancien tyran domestique déchu, inoffensif et sans forces, vaincu par l’âge et la maladie. » (Didier Éribon, Retour à Reims (2010), p. 31) ; « Tu ne m’avais jamais dit que mon grand-père faisait des masques de carnaval en papier mâché. » (Alfredo Arias s’adressant à sa grand-mère, dans l’autobiographie de ce dernier, Folies-Fantômes (1997), p. 156) ; « Une autre fois, ma mère dut s’absenter quelques jours pour se rendre au chevet de sa mère malade. J’ignorais tout à cette époque de la vie que pouvait mener mon père. Un soir, entrant dans la chambre de mes parents, que je croyais vide, j’eus la surprise d’y trouver mon père tenant dans ses bras notre cuisinière à demi dévêtue… Mon père m’administra un soufflet, pour me punir d’être entré sans frapper ; c’était la première fois qu’il me giflait… » (Jean-Luc, 27 ans, homosexuel, dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, p. 79) ; « Mon père m’a fait souffrir. » (Arnaud, femme F to M, dans l’émission Zone interdite spéciale « Être fille ou garçon, le dilemme des transgenres » diffusée le 12 novembre 2017 sur la chaîne M6) ; etc.
c) Père absent ou indifférent :
Quand il n’est pas montré comme le grand méchant loup, le père est au mieux dépeint comme un être éteint, absent, lointain, lunaire, lointain, figé, allongé, voire mort. Il est fréquent que les individus homosexuels lui reprochent son indifférence, son absence, sa froideur : « Je ne sais si j’aimais ou non ce monsieur de haute taille, affectueux sans cajoleries, qui ne m’adressait jamais de remontrances et parfois de bons sourires. Il était pour moi la grande personne autour de laquelle tournait la mécanique de ma vie. » (Marguerite Yourcenar à propos de son père, dans sa biographie Quoi ? L’Éternité, citée sur le Magazine littéraire, n°283, décembre 1990, p. 18) ; « Je n’ai pas beaucoup de souvenirs d’enfance avec mon père ; je garde de lui l’image d’une figure absente. Parfois, j’ai même l’impression d’avoir grandi sans père. » (Brahim Naït-Balk, Un Homo dans la cité (2009), p. 16) ; « Abandonnée par son père, élevée pas sa tante. » (Linn, jeune homme brésilien travesti en femme et parlant de lui-même, dans le documentaire « Bixa Travesty » (2019) de Kiko Goifman et Claudia Priscilla) ; etc. Comme le retranscrit Emilio Barón dans la biographie Luis Cernuda Poeta (2002), le poète espagnol Luis Cernuda n’avait que mépris pour sa mère qui « ne cherchait jamais à le comprendre et se moquait de lui », et pour son père : « Je me rappellerai toujours mon père enfermé dans son bureau. […] Ma présence le gênait. » (p. 18) ; « Mon père a énormément de difficulté à écouter. » (l’un des témoins homosexuels du documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz) ; « Membre d’un parti qui prenait de l’ampleur, il devint rare à la maison. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 12) ; « Mon père n’est pas présent dans ma vie. » (Marvin, jeune témoin homo, dans l’émission Toute une histoire spéciale « Quand ils ont renoncé leur homosexualité, leurs proches les ont rejetés » diffusée sur France 2 le 8 juin 2016) ; etc. Dans le documentaire « Cocteau/Marais : un couple mythique » (2013) d’Yves Riou et Philippe Pouchain, le comédien Jean Marais est décrit comme « un fils élevé avec une image paternelle absente ». L’écrivaine bisexuelle Lucía Etxebarría évoque l’absence de son père. Charles Trénet n’a vu son père qu’à l’âge de 6 ans. Et en 1920, quand il n’avait que 7 ans, ses deux parents se séparèrent. « C’est un enfant de divorcés. » (Serge Hureau dans le documentaire « Charles Trénet, l’ombre au tableau » (2013) de Karl Zéro et Daisy d’Errata) Dans l’émission Toute une histoire spéciale « Quand ils ont renoncé leur homosexualité, leurs proches les ont rejetés » diffusée sur France 2 le 8 juin 2016, les deux invités homosexuels ont eu un père qui est parti quand ils avaient 3 ans.
Le père indifférent et démissionnaire, c’est souvent les personnes homosexuelles elles-mêmes, soit parce qu’elles fuient leur paternité/maternité, soit parce qu’elles fuient leurs devoirs parentaux et l’amour de leur géniteur du sexe complémentaire qu’elles auraient pu offrir à leurs progénitures. Par exemple, dans l’émission Toute une histoire spéciale « Mon père est parti avec un homme » diffusée sur la chaîne France 2 le 5 décembre 2013, c’est bien lui, Jacques Viallatte, le père démissionnaire, qui s’est séparé de sa femme après 23 ans de mariage, en quittant 4 enfants, pour aller vivre avec un homme.
d) Le souhait parricide naissant d’un désir incestuel frustré :
Il se peut que les reproches que formulent certains sujets homosexuels à leur père soit justifiés, si en effet ce dernier a vraiment manqué d’amour et de présence. Mais bien souvent, au lieu de dénoncer ce premier manquement, ils en rajoutent un second qui cette fois vient d’eux : la revendication d’un rapprochement au père ou d’une inversion des rôles, qui tient de l’inceste. Le fantasme de parricide, c’est aussi simplement le désir incestueux : l’individu fait mourir le lien filial avec son père en le considérant comme un amant : « Mon père a toujours été très tendre envers mon grand frère et moi, mais pour nous, ses câlins étaient des moments de dégoût. De dégoût puis de honte. » (Christophe Honoré, Le Livre pour enfants (2005), p. 34) ; « Au lieu de trouver un équilibre entre son amour et sa haine, en s’identifiant avec son père et en se représentant soi-même comme le futur père de ses enfants, l’enfant se dresse contre son père et devient l’amant potentiel de sa mère. Ne pouvant envisager des relations incestueuses avec elle, il se détournera de toutes les autres femmes (c’est ce qu’on appelle un phénomène de ‘compensation’). » (Jean-Louis Chardans, Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p. 48)
Dans la biographie Ramon (2008), Dominique Fernandez fait la prouesse de retracer la vie de son père qui « a été un collabo, des plus notoires », jusqu’à ses funérailles : « Cette tête est celle de la mort. Cette photographie a été prise sur le lit de mort de cet homme. Cet homme qui est mon père, que je retrouve 62 ans après l’avoir vu pour la dernière fois. […] De temps en temps, dans les journaux, je voyais un visage lourd, massif, d’une virilité agressive. […] Force épaisse et butée, sans aucun rapport avec cette finesse de traits que j’ai maintenant sous les yeux, avec cette pureté d’expression, cet air de n’y être pour personne… Personne sauf peut-être pour son fils, qu’il a connu à peine, dont il ne s’est guère soucié, mais qui se trouve être aujourd’hui le dépositaire de cette vie et se heurte à un mystère insoutenable. Si beau dans la mort, si blâmable dans l’action : est-ce possible ? » (pp. 13-14) ; « Je suis né de ce traître, se dit-il, je porte son nom, son œuvre, sa honte, je suis son héritier. » (idem, p. 18) Dominique Fernandez nourrit une ambiguïté incestuelle vis-à-vis de son père qui ne fait aucun doute : « J’avais intériorisé l’interdit maternel. […] Amoureux de mon père, je l’ai toujours été, je le reste. Ma mère, je l’ai admirée, je l’ai crainte, je ne l’ai pas aimée. Lui, c’était l’absent et c’était le failli, l’homme perdu, sans honneur. C’était le paria. » (idem, p. 45)
Certains sujets (souvent lesbiens) détestent leur père biologique d’avoir cru que ce dernier était un dieu ou leur amant secret. « J’ai longtemps eu le sentiment de n’être qu’un ersatz de mon père. » (Paula Dumont, Mauvais Genre (2009), p. 15) ; « Tout Louhoua estimait mon père. Star-patriarche du coin, charismatique, c’était un homme très séduisant, très adulé par les femmes. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 17) ; « Aujourd’hui, c’est le 19 juin, la fête des Pères, et comme tu es mon Miam, mon papa Miam, je ne t’oublie pas. » (Julien à son amant Pascal Sevran, dans l’autobiographie de ce dernier Le Privilège des jonquilles, Journal IV (2006), p. 169)
Par exemple, dans le documentaire « Cet homme-là est un mille-feuilles » (2011) de Patricia Mortagne, Xavier est montré comme un père absent, coureur de jupons, et finalement homosexuel ! : « Ton père, il aimait bien plaire en société. » Dans le docu-fiction « Christine de Suède : une reine libre » (2013) de Wilfried Hauke, Christine, la reine pseudo « lesbienne », porte aux nues son père auquel elle s’identifie même physiquement, et qu’elle perd très jeune, à l’âge de 5 ans et onze mois : « C’était vraiment la petite fille à son papa. Elle adorait son père. » (la biographe Karin Borgkvist). Finalement, une fois arrivée à l’âge adulte, elle le descend de son piédestal : « Mon omniscient père avait tort. » Par ailleurs, l’ancien chroniqueur de Quotidien, Panayotis Pascot, a sorti un livre en août 2023 (La prochaine fois que tu mordras la poussière), qui est une autobiographie où il fait son coming out, tout en réglant ses comptes avec son père, pourtant décédé, en disant qu’il l’a écrite pour tuer une seconde fois son géniteur : « Ce livre me fait peur. Il a été douloureux à pondre. Mon père nous a annoncé qu’il n’allait pas tarder à mourir et je me suis mis à écrire. Trois années au peigne fin, mes relations, mes pensées paranoïaques, mon rapport étrange avec lui, crachés sur le papier. […] Je me suis donné pour but de le tuer avant qu’il ne meure. Ce que je ne savais pas c’est que j’allais traverser un épisode dépressif si intense que j’allais frôler la mort moi aussi… »
e) Mépris homosexuel du père inspiré de la misandrie de la mère (réelle ou cinématographique) :
Tiens, tant qu’on parle d’inceste, restons-y… Il est fort probable que la haine du père, observable chez une majorité de personnes homosexuelles, soit le fruit d’une imitation/soumission au discours misandre d’une mère cherchant à diviser le père et le fils pour, après un cuisant divorce, mieux régner amoureusement sur le second. La maman castratrice s’avance, un fusil à la main, pour tuer symboliquement son mari, et le ridiculiser auprès de son enfant homosexuel : « J’ai toujours eu l’impression que mon père n’était pas à la hauteur. » (Éric, homosexuel, dans l’essai Les Femmes et les homosexuels (1996) de Virginie Mouseler, p. 38) ; « C’est un homme plutôt doux, et surtout effacé, qui a abdiqué son autorité au profit de la mère. » (idem, p. 37) ; « Maman me parlait toujours mal de papa. Mon père ne prenait pas de décision et ma mère prenait trop de place. » (cf. la chanson « Luca Era Gay » de Povia) ; « Elle a distillé en moi une sorte de rancœur à l’égard de ce père toujours absent. Elle a ainsi contribué à faire germer en moi une culture d’affrontement avec le père. » (Jean Le Bitoux concernant sa mère, dans l’essai Citoyen de seconde zone (2003), p. 26) ; « Triomphe de la femme dominant un carnage de victimes masculines. Les héroïnes de Moreau sont fatales : les Érinnyes, Hélène de Troie, Salomé, inlassablement repeinte, Dalila, Circé, Lucrèce, Messaline, Lady Macbeth. » (Françoise Cachin, « Monsieur Vénus et l’ange de Sodome : L’androgyne au temps de Gustave Moreau », Bisexualité et différence des sexes (1973), p. 88) ; « Tu en as tellement bavé avec papa et tu voudrais que je répète le même schéma ? » (Brahim Naït-Balk à sa mère, dans son autobiographie Un Homo dans la cité (2009), p. 89) ; « De mon père, j’ai le souvenir lointain d’un officier pâle, doux, presque timide, perpétuellement en butte aux sarcasmes de son épouse. » (Jean-Luc, homme homosexuel de 27 ans, dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, p. 75) ; « Je crois que pour Fanon, ce qui est important, c’est le conflit avec le père. C’est ce qui est au centre du texte : le conflit entre le fils noir et le père colonisateur. C’est cette relation Noir-Blanc / père-fils qui donne cette profonde masculinité à sa vision d’ensemble, qui génère le rôle ambigu des femmes dans le texte, et explique pourquoi ses sentiments sur les relations homosexuelles sont porteurs comme souvent aux Caraïbes, du même genre d’ambiguïtés. On est donc très près du complexe d’Œdipe. » (Stuart Hall parlant du héros du roman Peaux noires, masques blancs (1952) de Frantz Fanon) ; « Tu sais, je n’ai rien fait de méchant. C’est plutôt ton père qui était un peu con, il faut l’avouer. Il faut remercier Dieu de l’avoir rappelé à ses côtés aussi rapidement. » (la mère d’Ernestino à son fils homosexuel, dans l’autobiographie Folies-Fantômes (1997) d’Alfredo Arias, p. 177) ; « Ce sont les impressions de l’enfance qui marquent l’individu au point de vue sexuel. Si elles ont été désastreuses, l’individu cherche souvent refuge dans l’homosexualité. C’est l’histoire banale des foyers désunis, où la mère, malheureuse et terrorisée par un père brutal, étouffe son enfant sous des manifestations d’affection anxieuse. Elle le retient dans son développement et tend à le conserver pour elle, comme un bébé. L’enfant, dans ces circonstances, témoin d’un rapport sexuel entre ses parents, l’interprète comme une attaque contre sa mère, une brutalité. » (Jean-Louis Chardans, Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p. 48) ; « Mon père (présent/absent, toujours fatigué) a essayé de jouer son rôle de père malgré lui. Mais aucune affinité entre nous. Pas beaucoup de conversation car je le trouvais superficiel. Il cherchait à bien se faire voir auprès des autres alors qu’il n’avait pas les moyens de se payer les choses ou qu’il promettait des choses qu’il ne tenait jamais. C’était ses parents qui l’aidaient pour acheter de jolies voitures. Il se vantait auprès des autres de trucs qu’il faisait pour nous alors que il filait juste la pension et de quoi couvrir le manger pas les vêtements. Et encore… il disait que c’était lui qui payait presque tout. […] J’ai eu une enfance heureuse avec une mère qui me surprotégeait en dévalorisant à mes yeux mon père et un père présent absent qui n’a jamais été un pilier exemplaire. La mère a joué le rôle du père, je me rappelle que j’ai dit a ma mère que je voulais lui faire l’amour vers les 4 ans et elle a rigolé et ça m’a blessé comme si elle m’avait rejeté dans ma sexualité, castré. […] Mon père me considère toujours comme un gamin et j’ai remémoré des émotions en moi auprès de ma mère de lui et ma gorge m’a fait tousser presque à ne plus pouvoir parler une bonne partie de l’après midi. […] J’ai vu des médiums et énergéticiens qui me disent que c’est la colère envers la figure paternelle, l’absence du père qui me détruit, l’absence d’un père qui m’a bloqué dans mon évolution, ma construction d’homme auprès des femmes, professionnellement et médicalement et une mère poule qui me saoule, qui a toujours besoin de moi, toujours sur mon dos et qui fait tout à ma place. » (cf. le mail d’un ami homo, Pierre-Adrien, 30 ans, reçu en juin 2014); etc.
Par exemple, dans ses Mémoires (1995), l’écrivain nord-américain Gore Vidal raconte comment sa mère a méprisé son mari devant lui : « Ton père est un raté, ou du moins l’était jusqu’à ce qu’il m’épouse. » (p. 105) Dans le film « Guillaume et les garçons, à table ! » (2013), Guillaume Gallienne laisse entendre que son père n’est pas fidèle à sa mère : « Maman, j’adore quand tu parles espagnol. T’es encore plus belle que les secrétaires de papa. » Et il lui en veut d’avoir voulu le transformer en garçon, et donc de l’éloigner de sa mère : « Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas que je sois une fille. C’est à cause de lui que ma mère m’habille en garçon. »
Beaucoup de personnes homosexuelles ont fini par intégrer dans leur cœur le discours binaire, démagogique, et parricide de leur maman : « Comment les pères surnomment-ils leur fils ? Idiot-bête. Glandu. Dorenchiant. L’imbécile. Une mère dit mon chéri, ma puce, Christ. » (Christophe Honoré, Le Livre pour enfants (2005), p. 52) ; « J’ai étudié la psycho sur les origines de mon homosexualité. Cela est dû au fait que ma mère dénigrait tous les hommes, à commencer par mon père. Ils étaient divorcés. » (un ami en octobre 2013 sur Facebook) ; etc.
Certaines mères de personnes homosexuelles prétendent se substituer aux pères, quitte à les détruire : « Dans les cas d’homosexualité, c’est la mère qui se trouve avoir fait loi au père au moment décisif. » (Jacques Lacan, « Les formations de l’inconscient », Le Séminaire V, en janvier 1958, p. 210) ; « Ma mère était assez violente, peut-être plus que mon père, en réalité, et dans la seule confrontation qui, à ma connaissance, les opposa physiquement, ce fut elle qui le blessa, en lançant sur lui le bras du mixeur électrique qu’elle était en train d’utiliser pour préparer une soupe : le choc fut tel qu’il en eut deux côtes fêlées. Elle est assez fière de ce fait d’armes, d’ailleurs, puisqu’elle me l’a raconté comme on raconte un exploit sportif. » (Didier Éribon, Retour à Reims (2010), p. 81) ; etc.
f) Hamlet :
Rien d’étonnant, dans ce contexte discursif de parricide ou d’indifférence entretenu par certaines mères d’enfant homosexuel, que des individus homosexuels s’identifient à la figure tragique d’Hamlet, l’emblématique personnage shakespearien dont la mère a tué le père : « Mon drame, c’est celui d’Hamlet, mais lui n’avait pas la chance d’enregistrer des disques. » (Mylène, Charlie Hebdo, 1984, citée dans la biographie Mylène Farmer, L’Ange blessé (2003) de Caroline Bee, p. 7) ; « Mon rôle favori était celui d’Hamlet. » (Luchino Visconti, le réalisateur homosexuel italien, cité dans l’article « Biographie de Visconti » d’Olivier Bombarda, sur le site www.arte-tv.com) ; etc. Hamlet est un personnage qui fascine les membres de la communauté homosexuelle, car inconsciemment, il est le porte-parole d’un mépris social des pères. Par exemple, dans l’histoire du théâtre, Hamlet a souvent été joué travesti ou par des femmes (pensons à Sarah Bernhardt, la rebelle, ayant osé au début du XXe siècle la transgression en composant un Hamlet androgyne). En 1975, Elton John travaille aux côtés de Ken Russel à un projet de film-opéra-rock d’après le Hamlet de Shakespeare, avec David Bowie pour interpréter le rôle d’Ophélie (projet qui ne verra jamais le jour). L’écrivain espagnol Vicente Molina Foix a collaboré auprès de José Carlos Plaza pour la pièce Hamlet (1989). Dans son essai Para Enterdernos (1999), Alberto Mira fait longuement référence à Hamlet (p. 22). Dans le téléfilm « Hamlet » (1972) de David Giles, comme par hasard, c’est l’acteur homosexuel Ian Murray McKellen qui joue le rôle titre.
Hamlet représente tous ces maris, ces pères, ces frères, ces hommes, rendus invisibles par le peu d’attention qu’on leur prête : « En quelque sorte, ma vie quotidienne est désormais hantée par le spectre d’Alzheimer. Un spectre qui vient du passé pour m’effrayer en me montrant l’à-venir. C’est ainsi que mon père continue d’être présent dans mon existence. » (Didier Éribon, Retour à Reims (2010), p. 17) ; « La fille unique que je suis n’a jamais eu à se mesurer à un frère, donc à un garçon. Elle ne s’est heurtée qu’à un fantôme. » (Paula Dumont, Mauvais Genre (2009), p. 40) ; « Les hommes n’ont pas de corps. » (Oshen, la « lesbienne invisible », lors de son concert à L’Européen, à Paris, le 6 juin 2011) ; « En sortant de la brasserie, j’ai observé longuement la façade de la gare du Nord, et j’ai pensé que mon père était une des statues, boulonnées sur la corniche, et qu’il me regardait, et j’ai pensé : est-ce qu’il me regarde ou est-ce qu’il me surveille ? » (Christophe Honoré, Le Livre pour enfants (2005), p. 91)
g) Meurtre du père :
Loin de renvoyer à un désir de meurtre qui va toujours s’actualiser (je vous rassure, je ne connais, à ce jour, aucune personne homosexuelle qui ait tenté d’assassiner vraiment son père !), l’expression claire de la part d’un certain nombre de sujets homosexuels d’une profonde aversion pour leur père, indique plutôt un éloignement du Réel, une fuite de sa famille/de sa propre paternité, une gémellité incestueuse entre homosexualité et homophobie… Ce qui n’empêche pas, cela dit, que cet oubli des pères, relégués au statut de moins que rien, puisse engendrer à plus ou moins long terme des suicides, des meurtres, de vrais parricides. « Parallèlement à tous ces évènements brièvement décrits, notre vie familiale était très difficile à vivre suite à une grande difficulté conjugale entre mes parents : je ne reprendrai pas tous les détails de ces difficultés mais finalement, mon père se suicida le 25 août 1995. » (un ami homosexuel quinquagénaire, dans un mail datant du 19 octobre 2013) ; « Elles [le « couple » lesbien Charlotte et Marion] cherchent à couper le cordon, à se libérer enfin de l’emprise de leurs parents. » (la voix-off du documentaire « Homos, et alors ? » de Florence d’Arthuy dans l’émission Tel Quel, diffusée sur la chaîne France 4, le 14 mai 2012) ; etc.
Par exemple, le réalisateur italien Pier Paolo Pasolini a quitté définitivement son père qui était très violent. Rayé de la carte ! Le 26 janvier 2017 en Suisse, un jeune gay de 19 ans comparaissait devant un tribunal zurichois du district de Hinwil (campagne zurichoise) pour avoir tenté un an plus tôt de poignarder à mort son père, après des années d’insultes et de souffrances psychologiques.
Lors de l’avant-première de la pièce En ballotage (2012) de Benoît Masocco au Théâtre Clavel de Paris en février 2012, un des spectateurs homos, à l’issue du spectacle, s’en est pris à l’acteur qui jouait le rôle du père homophobe d’Édouard, le héros homo, en cherchant à le tabasser, tellement il s’était identifié à la fiction !
Ensuite, il existe beaucoup de parricides homosexuels parallèles : pensons à ces hommes gays qui font tout pour ne pas imiter leur père et ne pas être pères eux-mêmes ; à ces femmes lesbiennes qui s’affairent à rentrer dans la peau de leur père idolâtré/fantasmé afin de tuer par la substitution leur vrai père ; à ces hommes transsexuels M to F qui se châtrent et se mutilent chirurgicalement pour tuer le père en eux. « Quand j’était cet homme que j’ai tué… » écrivait l’Américain transsexuel M to F Patricia Ann Morgan, à 24 ans, dans ses mémoires. Difficile d’être plus clair !
Dans l’essai Le Rose et le Brun (2015) de Philippe Simonnot, on nous raconte la rencontre entre Nicolaus Sombart et son amant beaucoup plus âgé que lui Carl Schmitt. Nicolaus Sombart semble utiliser l’homosexualité et son amant âgé comme parricide : « De toute ma vie, personne n’a plus occupé mes réflexions que Carl Schmitt. Pas même mon père. » (p. 273)
J’observe également un parricide symbolique (et malheureusement réel parfois) à chaque fois que j’entends les membres de la communauté homosexuelle rayer le père biologique de la carte du Réel, pour parfois prendre sa place, comme c’est le cas dans le discours des promoteurs de la « famille » homoparentale. Ainsi, lors de sa conférence « L’homoparentalité aux USA » à Sciences-Po Paris le 7 décembre 2011, Darren Rosenblum, jeune professeur de droit qui a acheté avec son compagnon « leur » petite fille à une mère porteuse (GPA), tient un discours qui tend à effacer les parents biologiques pour les remplacer par des rôles qui peuvent être tenus par des personnes asexués ou de tous les sexes. Face au public, il nie ouvertement qu’il ne dira pas à « sa » fille Myriam qui est son père, mais on le comprend puisque lui et son compagnon se le cachent déjà à eux-mêmes ! « Un de nous est le père biologique de Mélina. » ; « On ne voulait pas savoir qui était le père biologique. On sait maintenant qui est le père biologique, mais on garde le secret. » ; « Je soutiens une interprétation de la biologie. Je trouve que ces rôles de père ou de mère ne sont pas essentiels. Si dans une famille un homme veut être la mère, il doit pouvoir le faire. » De son propre aveu, Darren recherche une « parentalité androgyne » et parle de « désexuer la parentalité ». À propos des qualificatifs « père » et « mère », il dit : « Le sens de ces termes, je pense, va fondre. » Et il fait passer sa censure et son éloignement du Réel pour une incroyable créativité, en se valant du relativisme culturel : « Il y a un potentiel de jeux de rôles qui se développe dans les familles homoparentales. […] La parentalité, chez nous aux États-Unis, c’est aussi quelque chose de culturel. »
Un discours parricide semblable est tenu par Thierry Morisseau lors de l’émission Le Magazine de la Santé sur la chaîne française France 5, en décembre 2009 (ce documentaire fait partie de la série d’émissions 7 minutes pour une vie avec le titre « Homoparentalité : Le Parcours de deux mamans et deux papas ») : « La question de la disparition de la mère/du père doit exister » soutient-il. D’ailleurs, dans ce même reportage, quand on écoute le témoignage de Pascale et Julie, deux femmes en couple ayant réussi à « avoir un enfant » grâce à une insémination par don anonyme, on voit très clairement que l’existence du père est niée : « On est deux, pas un trio. […] On a fait le pari de construire nos propres références. » Elles refusent de connaître l’identité du donneur. Le père est assassiné, en quelque sorte.
Dans le documentaire « Zwei Mütter » (« Two Mothers, 2013) d’Anne Zohra Berrached, Katja et Isabella, à 43 et 37 ans, désirent un enfant. Mais il n’est pas question pour elles qu’une troisième personne vienne s’immiscer dans la vie de leur « couple heureux », amoureux et marié : « Les femmes ne veulent pas de père, juste du sperme » (cf. le catalogue du 19e Festival Chéries-Chéris au Forum des Images de Paris, en octobre 2013, p. 42). Et après, les critiques de ce film ont le culot de se demander « pourquoi un amour qui semble si profond peut-il malgré tout être mis en danger » (idem) et souffrir des résistances. Et la misandrie ou l’effacement des origines des enfants, ce n’est pas violent, peut-être ?
h) Le parricide porté comme une culpabilité plus ou moins fondée :
Le meurtre parricide opéré par certains individus homosexuels n’est pas nécessairement réel ou conscient, comme je viens de le dire : il se limite parfois à une impression, à une culpabilité ressentie face à la radicalité et à la brutalité de la mort naturelle/accidentelle du proche parent, à une impression honteuse d’avoir été pris à son insu la main dans le sac de l’inceste. Il n’est absolument pas rare, par exemple, de voir que certaines personnes homosexuelles, à la mort de leurs parents, revêtent le deuil de leur papa, et surtout de leur maman, au point de s’y identifier, de s’en rendre malades, et de penser qu’elles ont commis un parricide irréparable… alors que bien évidemment, il n’y a pas eu assassinat. Notamment dans son article « La Douleur pour destin » (sur le Magazine littéraire, n°350, janvier 1997), Pietro Citati décrit « l’acharnement avec lequel Proust s’est poignardé lui-même, avec ses remords, surtout à l’égard de sa mère, au point de croire l’avoir tuée » (p. 24) On les a parfois tenu responsables d’un crime qu’elles se sont senties obligées de porter. René Crevel n’a que 14 ans quand sa mère le conduit devant le corps de son père pendu dans le salon familial. Dans son autobiographie Mémoire d’un nomade (1972), Paul Bowles raconte que son père l’a porté responsable de la maladie de sa mère : « Ta mère est très malade, et tout cela par ta faute, mon petit. Ne l’oublie pas. » (cf. le site www.islaternura.com). Quand sa mère meurt, Maurice Rostand sombre dans la démence parce qu’il croit l’avoir assassinée. Lorsque le père de Virginia Woolf décède, cette dernière pense l’avoir tué : « Sa vie eût entièrement mis fin à la mienne » rédige-t-elle dans son Journal, le 28 novembre 1928. La mère de Truman Capote, ou bien encore le père de Jean Cocteau, se sont suicidés alors que ces derniers n’étaient encore que des enfants. On peut penser également au désespoir qui s’abat sur Roland Barthes à la mort de sa mère, une insurmontable souffrance.
Parfois, cette culpabilité du parricide bascule en fausse indifférence. « On m’en veut parce qu’elle a voulu se suicider, mais, puisqu’elle a fait ça, c’est qu’elle est folle et moi je n’y suis pour rien. » (Stéphane, jeune homme qui se prostitue homosexuellement, parlant de sa propre mère, dans l’autobiographie Et dans l’éternité, je ne m’ennuierai pas (2014) de Paul Veyne, p. 234) Par exemple, la mort de la mère de Marguerite Yourcenar survient quelques jours après la naissance de l’écrivaine ; à l’âge adulte, celle-ci dira : « Je crois que le manque a été absolument nul. Car enfin, il est impossible, à moins d’avoir un caractère extrêmement romanesque, de s’éprendre, de s’émouvoir d’une personne qu’on n’a jamais vue. » (Marguerite Yourcenar, citée dans l’essai Qu’est-ce qu’une femme désire quand elle désire une femme ? (2004) de Marie-Jo Bonnet, p. 213)
L’idéalisation des parents, mis concrètement à distance, peut agir également comme un parricide symbolique : par exemple Arthur Rimbaud écrit Lettres aux siens (1881) alors qu’il a passé toute sa vie à les fuir. L’épigraphe-crachat « À personne » qu’Hervé Guibert choisit de mettre en tête de sa biographie Mes Parents (1986), qu’il dédie pourtant à son père et sa mère, est particulièrement parlante ! De son côté, Colette fait de sa maman Sido l’héroïne principale de ses romans (surtout à partir de La Naissance du jour, 1928), mais en réalité, elle adore une mère éloignée et la déteste dans la proximité puisqu’elle ne répond pas à ses lettres, ne va jamais la voir, lui cache les scandales de sa vie tumultueuse, dissimule son divorce d’avec Willy, ne l’accompagne pas aux derniers jours de sa maladie (alors qu’elle la sait pourtant à l’agonie), et refuse même d’assister à son enterrement (cf. l’article « Sido, Colette, portraits croisés » de Michèle Sarde, dans le Magazine littéraire, n°266, juin 1989, pp. 30-32).
i) Lien causalisé entre parricide et homosexualité:
Est-ce le meurtre (réel ou symbolique) du père qui a provoqué l’homosexualité, ou le désir homosexuel qui incite à l’assassinat du père ? Ni l’un ni l’autre. Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’il existe un lien fort, souvent signifiant, mais non-causal, entre homosexualité et parricide : « Je demande pardon pour avoir tué ma mère. » (Alfredo Ormando dans la lettre testamentaire qu’il a rédigée juste avant son suicide par le feu sur la place saint Pierre en 1998, pour dénoncer la condamnation des actes homosexuels par l’Église, cité dans le documentaire « Les Règles du Vatican » (2007) d’Alessandro Avellis) ; « Sans la mort de mon père, sans la culpabilité que j’ai portée de cette mort, le mal ne se serait pas répandu en moi. […] La mort de mon père ne m’a pas fait devenir glorieux ou infamant, elle a ranimé mon sang, elle m’a baptisé. » (Christophe Honoré évoquant la mort de son père survenue juste au moment de sa première expérience sexuelle homo-érotique à 15 ans, dans Le Livre pour enfants (2005), pp. 86-87) ; « Lucien a fait son coming out à 19 ans, depuis la mort de son père. » (la maman de Lucien, un jeune témoin homosexuel suisse, dans l’émission Temps présent spéciale « Mon enfant est homo » de Raphaël Engel et d’Alexandre Lachavanne, diffusée sur la chaîne RTS le 24 juin 2010) ; etc.
La seule chose qu’on peut assurer de manière générale, c’est que nombreux sont les psychanalystes ou médecins psychiatres qui dénoncent les ravages psychiques que l’absence de père provoque, plus particulièrement sur les garçons.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.