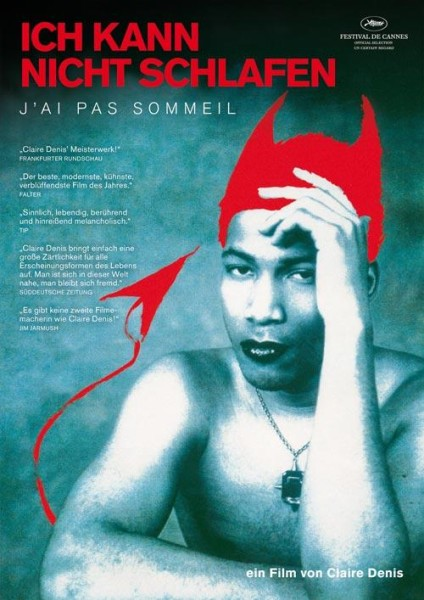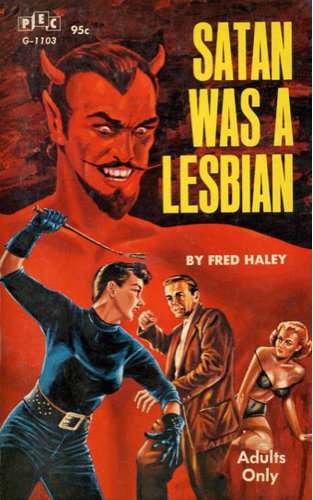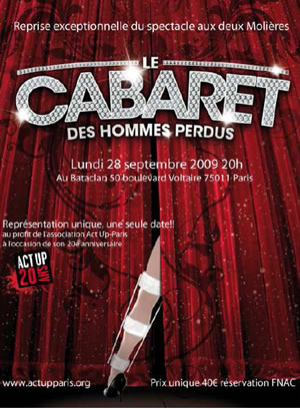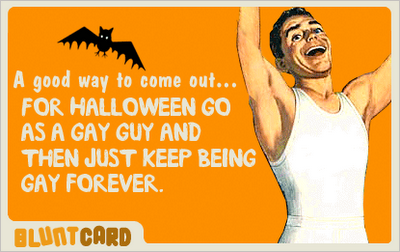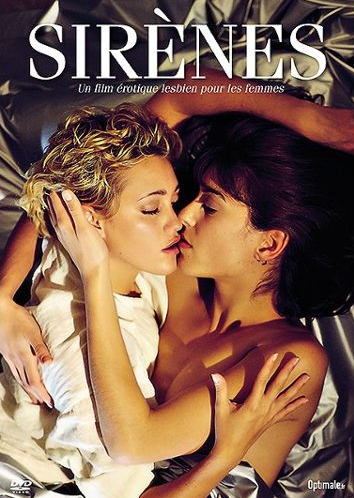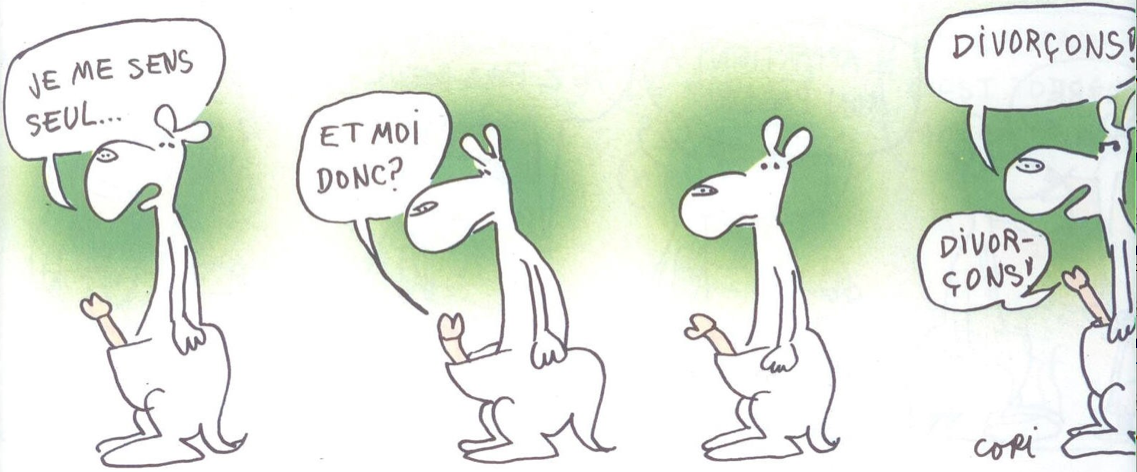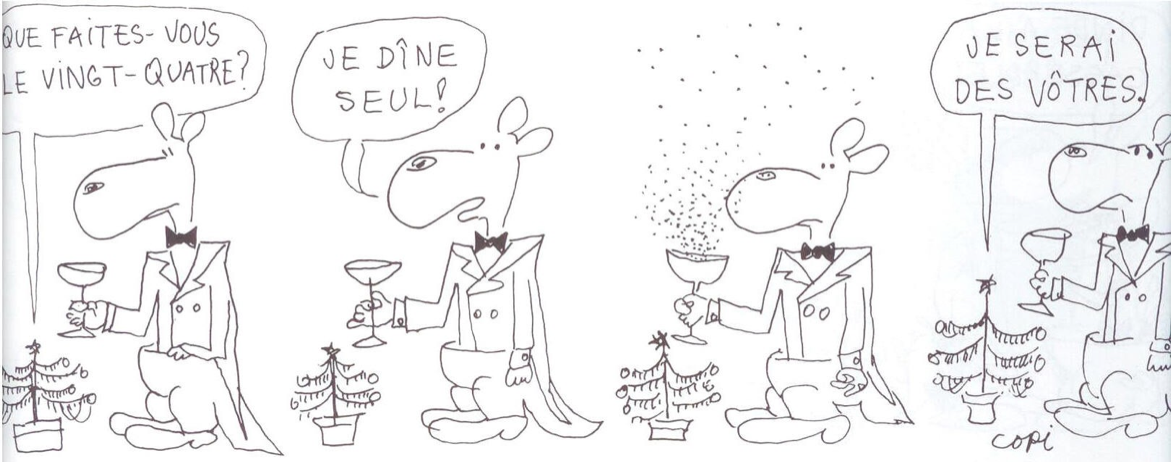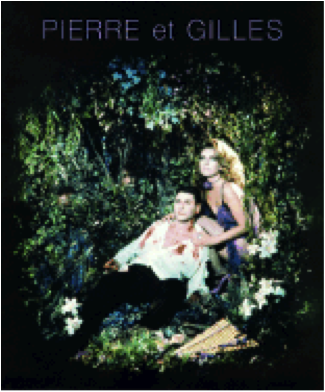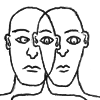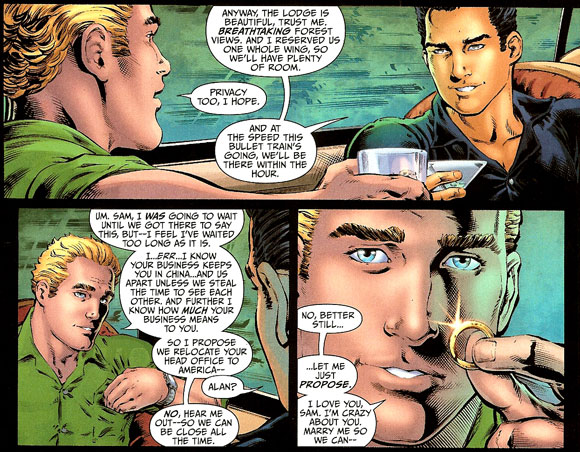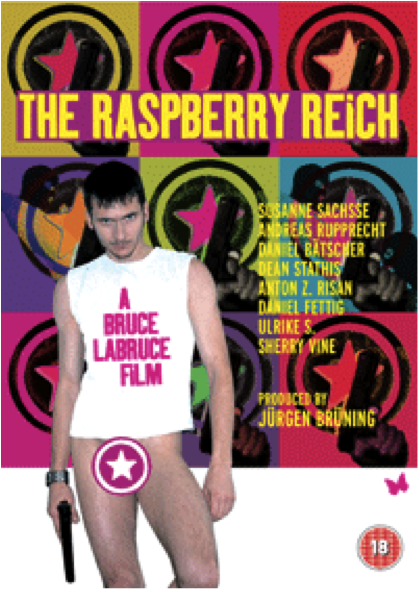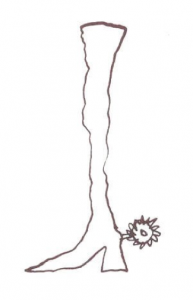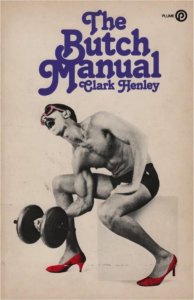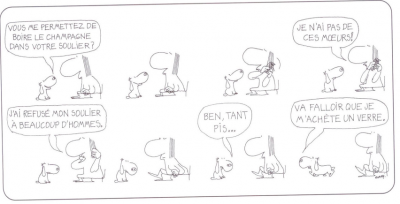S’homosexualiser par le matriarcat
NOTICE EXPLICATIVE :
Les possibles conséquences désirantes (homosexuelles) d’une maternisation (portée par des femmes ou des hommes) de la société
Existe-t-il un lien entre homosexualité et féminisme agressif/pouvoir des mères dans notre société ? À en croire les créations et les discours de nombreuses personnes homosexuelles, oui… même si ce lien n’est pas causal, et qu’il ne s’agit pas du tout, à travers ce code, de condamner les femmes et les mères réelles, ni même leurs défenseurs. Pour moi, les vrais féministes sont ceux qui se battent pour que les femmes trouvent leur véritable place et identité dans le monde, et non ceux qui veulent en faire un équivalent exact des hommes, des tigresses toutes-puissantes au désir machiste (= des prostituées), des femmes phalliques qui n’ont plus besoin des membres de l’autre sexe.
N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Mère possessive », « Matricide », « Inceste », « Mère gay friendly », « Substitut d’identité », « Symboles phalliques », « Femme-Araignée », « Actrice-Traîtresse », « Grand-mère », « Tante-objet ou Maman-objet », « Femme et homme en statues de cire », « Regard féminin », « Reine f», « Sirène », aux parties « Hamlet » et « Recherche du père avortée par la mère » dans le code « Parricide la bonne soupe », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.
1 – PETIT « CONDENSÉ »
« Change de trottoir ! Le mien est piégé ! Si c’est trop tard, ne reste pas figé ! Sors du trou noir ! Je fais mon métier ! J’ai peur de rien ! Je suis une femme pressée ! » (Claire Litvine, dans la chanson « Une Femme pressée » du groupe L5)
L’influence symbolique que les femmes maternantes (et les hommes maternants ! car le matriarcat et le féminisme agressif, contrairement à l’idée reçue, ne sont pas réservés aux femmes, ni attribuables à toutes les femmes, loin s’en faut) peuvent jouer sur l’homosexualité est notamment observable à travers la place prépondérante que prend la figure maternelle dans la fantasmagorie homosexuelle, et dans les sociétés où grandissent les personnes homosexuelles. Le matriarcat progresse au sein de nos civilisations occidentales couveuses et de nos États-Providence (qui veulent nous éviter tout risque et les limites objectives du Réel), malgré le fait que les femmes réelles soient presque systématiquement présentées comme d’éternelles victimes des hommes, et qu’elles restent tout autant – si ce n’est plus – sous la menace des violences conjugales. Il suffit de nous pencher sur notre système juridique français pour constater que les femmes-mères ont de plus en plus les lois de leur côté : les pères modernes sont fréquemment mis sur le banc de touche, invités à devenir des mamans auxiliaires ou à fuir le domicile familial pour aller se suicider.
Du côté des statistiques sociologiques, dans un pays comme la France où actuellement 39% des mariages se terminent par un divorce (celui-ci étant demandé à 75% par les femmes), et où, dans 9 cas sur 10, l’enfant reste habiter seul chez sa mère, le père n’a pas d’autre choix que de partir (Michel Schneider, Big Mother (2002), p. 363). Le taux de suicide des pères séparés de leur(s) enfant(s) est six fois supérieur à la moyenne nationale, ce qui n’est évidemment pas un petit chiffre !
Il convient ici de bien distinguer la question de la féminisation des pouvoirs dans la société (qui n’est pas en soi problématique : bien au contraire) et celle de la maternisation des liens sociaux. Aujourd’hui, derrière un certain nombre de revendications d’égalité des femmes se cache la conquête d’une domination des mères, celles-ci étant d’ailleurs excessivement bienveillantes, assoiffées de toute-puissance et de vengeance envers les hommes et surtout les pères réels. Et ça, c’est un réel problème.
L’agression iconographique (et parfois réelle) des femmes envers les hommes a très probablement une influence sur l’orientation sexuelle de certains garçons et certaines filles, quand bien même les liens entre homosexualité et matriarcat/féminisme se trouvent toujours rangés dans le cadre de la coïncidence. Si les hommes gays ont eu peur d’emprunter le chemin de la différence sexuelle, ce n’est pas uniquement parce que les femmes ont pris une place prédominante relativement rapide dans nos sociétés occidentales en moins de cinq décennies : une certaine libération de la femme était et reste plus que jamais nécessaire. Mais c’est d’une part en termes de « maternalisme désexualisant » (Michel Schneider, « L’Indifférence au sexe provient de l’indifférence entre les sexes », cité dans la revue Philosophie magazine, « Hommes-Femmes : la Confusion des Genres », n°11, juillet/août 2007, p. 36) et d’infantilisation (dont sont capables même les hommes !) et non de féminisation du pouvoir social, et d’autre part en termes d’images de femmes phalliques irréelles, et donc de fantasme, qu’il faut envisager cette crainte de l’autre sexe.
« L’homosexuel » n’est pas le fils de sang de la femme forte iconographique, mais son fils d’idolâtrie, son enfant spéculaire. N’est-ce pas la femme phallique médiatique qui a initialement demandé aux hommes de décamper de son « trou noir » pour qu’ils la laissent faire son métier de prostituée, et d’aller « sur le trottoir d’en face », autrement dit de se faire homosexuels (cf. la chanson « Une Femme pressée » des L5) ? Dans l’ordre des symboles véhiculés par les media, les hommes ne sont plus ceux qui dominent les femmes ; ils sont en passe de devenir des mauviettes qui s’abaissent au statut d’objet de consommation à disposition du deuxième sexe. Cela peut traduire ou engendrer la réalité fantasmée de l’identité homosexuelle. Force est de constater que certaines femmes lesbiennes, en promouvant l’effacement progressif de la réalité du sexe par le concept flou de « genre », ouvrent la voie au transsexualisme et à l’homosexualité. Elles se félicitent parfois d’avoir permis socialement aux hommes de s’assouplir, de se questionner sur leur virilité, d’être moins machos… alors que l’absence de virilité de ces derniers est justement un concentré de machisme peinturluré de rose. En effet, les femmes qui veulent des hommes faibles ne désirent plus des hommes réels, ni même être femmes, puisque par nature, la première qualité qu’une femme attend d’un homme, c’est la force. En deuxième position vient la tendresse… mais seulement en deuxième (cf. la conférence « Le Célibat » de Denis Sonet, Paray-Le-Monial (France), session 2003). L’homme qui n’est que tendre avec elle lui parait mièvre. Celui qui n’est qu’une brute, elle ne l’aime pas non plus. Pour se faire reconnaître, il faut que l’homme vraiment aimant réunisse le paradoxe de la force tranquille, c’est-à-dire l’essence même de la sexuation des hommes. Au fond, seuls les hommes forts sont doux : les faibles deviennent violents. Leur brutalité trahit leur faiblesse. Les femmes qui veulent émasculer les hommes sont aussi machistes que les machos dont elles se croient éternellement victimes. Jacqueline Shaeffer a bien saisi cette énigme du féminin qui trouve sa victoire et son affirmation dans une forme d’abdication qui n’est pas sujétion mais reconnaissance d’une force masculine qui dépasse les femmes et les honore : « Que veut la femme ? Elle veut deux choses antagonistes : son moi hait la défaite, mais son sexe l’exige. Il veut la chute, la défaite, le ‘masculin’ de l’homme. C’est là le scandale du ‘féminin’. » (Jacqueline Schaeffer, Clés pour le féminin : femme, mère, amante et fille (1999), pp. 37-38) Chez l’homme droitier, la main droite agissante n’a pas de force sans la main gauche, discrètement agissante aussi. Ou, pour prendre un nouvel exemple, il n’y a pas de bon ministre des Affaires étrangères sans bon ministre de l’Intérieur. En quelque sorte, nous nous retrouvons avec les femmes face au mystère de l’action dans l’accueil. Il est souvent mal compris par beaucoup d’Hommes de notre temps puisque les valeurs du service, de l’accueil, et de l’obéissance à une autorité bienveillante sont dénigrées dans notre monde actuel. La prétention de la femme à être comme l’homme et à bénéficier des privilèges de la condition masculine, aussi paradoxal que cela puisse paraître, va dans ce sens de l’irrespect des femmes via la condamnation de l’autorité et de la force des hommes. La sexualité est une force de vie, mais une force quand même, à respecter en tant que telle. « Les violences sexuelles doivent être sanctionnées, mais la violence du sexe ne saurait être éradiquée. Il n’existe pas de sexualité sans violence et ceux qui rêvent du contraire oublient qu’ils ne seraient pas là si un jour, un homme, leur père, n’avait pas pris, avec une certaine violence, une femme, leur mère. Prendre, non au sens de violer son corps mais de désirer son désir. Le désir n’est pas une relation égalitaire accordant deux volontés en un contrat. Psychiquement, pour les hommes qu’il emporte dans la conquête sexuelle comme pour les femmes qui cherchent à le susciter, il comporte toujours une part d’agressivité, de ravalement de l’objet sexuel à côté de son idéalisation. » (Michel Schneider, op. cit., p. 99) ; « Oui, le sexe est dangereux, et le désir est une maladie mortellement transmissible. Est-ce une raison suffisante pour s’en détourner ? » (idem, p. 127)
2 – GRAND DÉTAILLÉ
FICTION
a) La mère phallique ou l’entourage féminin du héros fait tout pour le rendre homosexuel :
On observe une emprise matriarcale sur le personnage homosexuel dans la pièce L’Héritage de la Femme-Araignée (2007) de Christophe et Stéphane Botti, la chanson « Une Femme pressée » du groupe L5, le film « Serial Mother » (1994) de John Waters, le film « Les Damnés » (1969) de Luchino Visconti, la chanson « Seules les filles pleurent » de Lio, le film « Eve » (1949) de Joseph Mankiewicz, le film « Mors Hus » (1974) de Per Blom, le film « Les Frissons de l’angoisse » (1975) de Dario Argento, le film « Working Girls » (1986) de Lizzie Borden, le film « Le Livre de Jérémie » (2004) d’Asia Argento, le film « Girl King » (2001) d’Ileana Pietrobruno, le film « ¿ Por Que As Mulheres Devoram Os Machos ? » (1980) d’Alan Pak, le film « La Fête des mères » (1998) de Chris Van der Strappen, le film « Napolitaines » (1993) de Pappi Corsicato, le film « Singapore Sling » (1990) de Nikos Nikolaidis (avec la mère au pénis), le film « Ma vie est un enfer » (1991) de Josiane Balasko, la pièce Cosmopolitain (2009) de Philippe Nicolitch (avec Marie, la mère de Jean-Luc, tout de mauve vêtue), le film « Chéri » (2009) de Stephen Frears (avec la mère de Fred), le film « Black Swan » (2011) de Darren Aronofsky (avec l’odieuse et écrasante mère de Nina), etc.
Par exemple, dans la pièce Le Fils du comique (2013) de Pierre Palmade, Isabelle, une des potentielles mères porteuses de Pierre (le héros homosexuel), souhaite formater complètement son futur fils, en le prénommant « Superman », en voulant pour lui le « meilleur », la « réussite », la « perfection »… et non le bonheur. Dans le film « Après lui » (2006) de Gaël Morel, Camille, la mère gay friendly, maquille son propre fils Matthieu en femme. Puis, après sa mort, elle espionne le copain de son Matthieu, Franck, en le suivant partout. Dans la pièce La Famille est dans le pré (2014) de Franck Le Hen, Tom, le héros homosexuel, gravite dans des ambiances très féminines qui éjectent les pères et les maris, et qui l’empêchent d’être homme, d’être lui-même, en le confortant dans une pseudo homosexualité : que ce soit dans sa vie passée (avec sa grand-mère et sa mère, des femmes à poigne omniprésentes et machos) que dans sa vie présente (avec sa « fille à pédé » Cindy qui lui sert de couverture hétérosexuelle, ou encore avec son agent Graziella, qui le maintient dans une homosexualité tacite et une hétérosexualité officielle). Dans le film « Mommy » (2014) de Xavier Dolan, Steve, homosexuel, est maltraité par sa mère, qui lui parle très mal, qui le bat (« C’est toujours toi ma préférée, même si tu me bats. »). Celle-ci finit par le placer en hôpital psychiatrique à son insu. Cette femme féminise « son gars » quand il danse sur la chanson « On ne change pas » de Céline Dion. Elle le traite ironiquement de « pétasse ». La voisine de quartier, Kyla, apprend à Steve comment se raser la barbe : « Montre-moi. » lui demande-t-il. Steve n’est absolument pas aidé par les femmes de son entourage à devenir un homme adulte. Dans son one-man-show Fabien Tucci fait son coming-outch (2015), Fabien, le héros homosexuel, revient sur la genèse de son homosexualité : « Ça remonte à l’époque où je feuilletais les 3 Suisses de ma mère. » Dans le téléfilm « Just Like A Woman » (2015) de Rachid Bouchareb, Mona est encouragée au lesbianisme par son acariâtre belle-mère, qui est odieuse avec elle parce qu’elle est stérile, qu’elle ne donne pas d’enfant à son fils. Dans la pièce Soixante degrés (2016) de Jean Franco et Jérôme Paza, Damien, l’un des héros bisexuels, a été fortement influencé par la carrière de théâtre-amateur de sa mère, fan des planches. Elle lui demandait de jouer sa réplique au théâtre. Cette influence semble avoir été anxiogène : « C’est pathologique chez moi. C’est ma mère qui m’a refilé cette superstition, avec son théâtre ! » Dans le film « La Princesse et la Sirène » (2017) de Charlotte Audebram, une tante lesbienne raconte un conte à son petit neveu pour lui faire croire à son histoire d’amour interdite. Dans le film « The Cakemaker » (2018) d’Ofir Raul Graizer, la maman d’Oren, Hanna – exerce un mystérieux pouvoir divinatoire d’homosexualité sur Tomas, le héros homo : elle a compris énigmatiquement le lien érotique qui reliait son fils décédé Oren à Tomas. Dans le film « Jonas » (2018) de Christophe Charrier, la maman de Nathan pousse son fils et Jonas, l’amant de ce dernier, dans les bras l’un de l’autre… notamment par le biais de la mère de Jonas (qu’elle invite chez elle) et par le biais de la cigarette (car elle fume comme un pompier : « Ta mère, elle sait aussi que tu fumes ? Ce sera notre petit secret, alors… » dit-elle à Jonas, comme si elle lui parlait d’homosexualité). Dans la série The Last of Us (épisode 3, 2023) de de Neil Druckmann et Craig Mazin, c’est la maman de Bill qui lui a appris le piano, et notamment des chansons au texte cryptogay de Linda Rondstadt.
Dans le film « Toute première fois » (2015) de Noémie Saglio et Maxime Govare, Clémence, la mère bobo gay friendly de Jérémie, supporte très mal que son fils, qu’elle a toujours cru homosexuel, vire sa cuti avec une femme : « T’es pédé, mon chéri ! » Elle voudrait le forcer à se marier homosexuellement. Le père de Jérémie fait à son fils le même chantage : « T’as changé d’orientation ?!? Eh bien t’as perdu un père ! » lui balance-t-il avant de quitter la table.
Dans la pièce Ma belle-mère, mon ex et moi (2015) de Bruno Druart et Erwin Zirmi, Solange, la mère de Zoé et la belle-mère de Julien le héros bisexuel qui est devenu homosexuel suite à sa rupture avec Zoé, est accusée par son gendre Julien d’avoir provoqué la séparation entre lui et Zoé, et donc son homosexualité : « Voilà. C’est de votre faute si on est séparés. » (Julien) Zoé, sa fille, n’est pas non plus étrangère au virement de cuti de Julien : « L’énorme bêtise, elle l’a faite en me quittant. Elle m’a trop fait souffrir. Elle m’a largué sans aucun état d’âme. » Finalement, Zoé découvre que sa mère est responsable de l’homosexualisation de son ex-mari : « C’est à cause de ma mère que t’es devenu homo ?? »
L’opinion publique a déjà vent d’un lien fort entre maternité possessive et homosexualité, même si, pour se rassurer elle-même, elle fait souvent l’erreur de le causaliser par des raccourcis psychologiques faciles : « Moi, je suis sûre. C’est sa mère… » (la bouchère par rapport à l’homosexualité d’Abram, dans le film « Scènes de chasse en Bavière » (1969) de Peter Fleischmann) ; « J’la sens bien castratrice, cette Catherine… » (Dominique parlant de la femme de Jérôme, soupçonné d’être gay, dans la pièce On la pend cette crémaillère ? (2010) de Jonathan Dos Santos) ; « Ça aurait pu faire de moi un pédé ! » (Malik, le personnage hétéro, qui se décrit entouré d’une mère castratrice et de cinq tantes dès sa petite enfance, dans la pièce Scènes d’été pour jeunes gens en maillot de bain (2011) de Christophe et Stéphane Botti) ; « Les femmes se sont tellement émancipées. » (le Dr Katzelblum, homosexuel, dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit) ; « Tu peux avoir une copine… ou un copain. » (Sam, la mère possessive de Rupert, son fils homo de 10 ans, dans le film « Ma Vie avec John F. Donovan » (2019) de Xavier Dolan) ; etc.
Dans beaucoup de fictions traitant d’homosexualité, la mère du héros homosexuel rêve de changer le sexe de son fils ou de sa fille : « Chère maman, […] j’aimerais me souvenir de ton visage lorsque tu m’as vue pour la première fois. Ce n’est pas mes yeux que tu as regardés, non, tu as vite écarté mes jambes pour voir si un bout de chair pointait hors de mon corps à peine fait. » (Nina Bouraoui, La Voyeuse interdite (1991), p. 35) ; « Enfant d’un géniteur muet mais point sourd, d’une génitrice déguisée en eunuque. » (idem, p. 65) ; « J’aimerais que tu sois une femme. Tu n’iras pas à la rivière… » (la mère au fiancé, dans la pièce Bodas De Sangre (1932) de Federico García Lorca) ; « C’est moi qui t’ai mise au monde ! Je sais bien que tu as un trou à la place d’une banane et que c’est tout ton atout ! » (Solitaire s’adressant à sa fille Lou, dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; etc.
Dans la pièce Bill (2011) de Balthazar Barbaut, la mère de Bill veut profiter de la castration de son chat pour faire par la même occasion castrer son fils. Dans la comédie musicale La Bête au bois dormant (2007) de Michel Heim, les trois fées travestissent Henri en Henriette. Dans le film « Mon fils à moi » (2006) de Martial Fougeron, la mère de Julien exerce sur lui une action émasculante en l’habillant en fille. Dans le roman Papa a tort (1999) de Frédéric Huet, la mère de Julien lui achète des poupées. Dans le film « Los Abrazos Rotos » (« Étreintes brisées », 2009) de Pedro Almodóvar, Ernesto est déguisé en fille par sa mère. Dans le film « Saisir sa chance » (2006) de Russell P. Marleau, Chance, le héros gay, dit avoir vécu son premier émoi homosexuel à 4 ans, quand sa mère l’a amené voir le ballet Casse-Noisette, et qu’il a été fasciné par le danseur. Dans la pièce Le Gai Mariage (2010) de Gérard Bitton et Michel Munz, lorsqu’Henri a eu 8 ans, sa mère a voulu l’inscrire à un cours de danse classique. L’univers éthéré de la mère trouble, capte, et atrophie les sens du personnage homosexuel : « Tu te souviens des photographies de galas d’Opéra dans les revues de ta mère. » (Félix dans le roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 160) ; « Ta chambre est une ode à la couleur mauve : des tapis aux abat-jour, des peintures aux statuettes, des draps aux alaises, le décor couvre chaque nuance du violet. » (idem, p. 169) ; « T’étais beau quand t’étais bébé. T’étais beau, t’avais l’air d’une petite fille. J’m’amusais bien avec toi : t’avais l’air d’une poupée. T’étais mignonne. » (Laurent Spielvogel imitant sa mère s’adressant à lui, dans son one-man-show Les Bijoux de famille, 2015) ; etc.
C’est parfois dans l’interdit maternel (édicté sans amour et dans une rigide fidélité à la différence des sexes) que l’encouragement implicite à l’homosexualité vient. Par exemple, dans le film « Dolls » (2008) de Randy Caspersen, Thomas, un ado un peu secret, supporte mal que sa mère s’apprête à vendre les poupées qui ont accompagné son enfance… Dans le film « Maigret tend un piège » (1958) de Jean Delannoy, Marcel Maurin, l’homosexuel, vit sous la coupe d’une mère castratrice. Dans le roman La Máscara De Carne (1960) de Maxence van der Meersch, Manuel est entouré d’une mère et d’une sœur très masculines. Dans le film « Rafiki » (2018) de Wanuri Kahiu, Mercy, la mère de Kena, l’héroïne lesbienne, est très inquisitrice, catholique de façade, et se met à fliquer sa fille… et elle devine son homosexualité avant cette dernière : « J’ai l’impression que tu as changé, Kena. ». Dans le film « Ma Vie avec Liberace » (2013) de Steven Soderbergh, Liberace, le pianiste virtuose, présente sa mère comme un tyran qui l’a homosexualisé et isolé : « Ma mère m’obligeait à jouer au piano tous les jours. Je n’avais aucun ami. »
Il arrive que cette maman encourage plus ouvertement son fils à s’homosexualiser, et se targue d’avoir participé à la « libération » que serait son coming out : « J’ai fini par accepter ton vice, mon chéri. Tu es la fille que j’aurais voulu avoir. » (la mère à « L. » dans la pièce Le Frigo (1983) de Copi) ; « Aurais-tu peur de t’avouer le garçon que tu es vraiment ? Est-ce que je perdrais la raison parce que t’aimes un garçon ? » (cf. la chanson « Un Garçon » de Lorie) ; « Il n’y a plus d’hommes dans cette famille, il ne reste plus que mon frère, autant dire personne. Quand j’étais petite, […] il prenait soin de moi, comme une mère. » (Cécile dans le roman À ta place (2006) de Karine Reysset, p. 58) ; « Cette sourde inimitié de Fernand contre sa mère fait horreur ; et pourtant ! C’était d’elle qu’il avait reçu l’héritage de flamme, mais en même temps la tendresse jalouse de la mère avait rendu le fils impuissant à nourrir en lui ce feu inconnu. Pour ne pas le perdre, elle l’avait voulu infirme ; elle ne l’avait tenu que parce qu’elle l’avait démuni. Elle l’avait élevé dans une méfiance, dans un mépris imbécile touchant les femmes. » (François Mauriac, Génitrix (1928), pp. 72-73) ; « Pas de femmes ! Que ta petite maman ! » (la mère de Jeanjean, dans le spectacle musical Bénureau en best-of avec des cochons (2012) de Didier Bénureau) ; etc.
Par exemple, dans le film « Mi-fugue mi-raisin » (1994) de Fernando Colomo, la mère envahissante de Pablo veut à tout prix que son fils soit gay. Dans le film « The Family Stone » (« Esprit de famille », 2005) de Thomas Bezucha, Everet, le frère de Ben, le héros homo, avoue en pleine réunion de famille que sa maman « a essayé de rendre ses enfants tous gay » ; celle-ci riposte, avant de lui donner raison : « Mais enfin, de quoi tu parles ? Je n’ai jamais rien fait dans ce sens ! Non, ce qui est vrai, c’est que j’ai espéré, je dois dire, j’ai désespérément espéré que tous vous seriez gays, tous mes fils, et que comme ça vous ne me quitteriez jamais, et je m’en excuse auprès de mes filles. » Dans son one-man-show Tout en finesse (2014) de Rodolphe Sand, la grand-mère de Rodolphe a tout fait pour que son petit-fils Rodolphe devienne homo… et ça a marché : « Je suis soulagée ! Enfin un pédé dans la famille ! ». Et elle veut aussi que le dernier enfant de sa sœur, le petit Alexandre, suive les pas de son oncle (apparemment, Alexandre joue déjà à la majorette avec sa cape de Zorro…). Dans le film « Call me by your name » (2018) de Luca Guadagnino, Annella, la mère de Elio, fait tout pour pousser son jeune fils Elio de 17 ans dans les bras d’Oliver, qui a le double de son âge. « Tu l’aimes bien, hein, Oliver… » s’amuse-t-elle à lui dire, devinant ses sentiments naissants. Elle lui lit également un conte du XVIe siècle d’un prince qui avoue son amour interdit à une princesse… ce qui poussera Elio à oser déclarer sa flamme à Oliver tout de suite après. Elle organise même aux deux amants un séjour d’une semaine en vacances pour qu’ils ne se retrouvent que tous les deux. Hallucinant. Dans le film « Love, Simon » (2017) de Greg Berlanti, La mère de Simon, le héros homo, est psychanalyste, féministe, et passe son temps à analyser son entourage. Une fois que son fils lui fait son coming out, elle lui avoue tacitement qu’elle l’a toujours su : « J’ai souvent voulu t’en parler, mais je ne voulais pas être indiscrète. » Dans l’épisode 98 « Haute Couture » de la série Joséphine ange gardien, Dallas, l’assistant-couturier homosexuel de Cecilia, s’appelle en réalité Claude François. « Ma mère l’adorait. » À la fin, il mime avec Joséphine le coup de griffe de « Baracouda » de la chanson « Alexandrie-Alexandra ».
Dans le film « Die Mitter der Welt » (« Moi et mon monde », 2016) de Jakob M Erwa), Phil, le héros homo, a rencontré Nicholas lorsqu’ils n’avaient que 8 ans… et Glass, la mère narcissique de Phil, juste après leur bousculade, incite déjà son fils à croire en leur idylle : « J’ai vu qu’il te plaisait. » Plus tard, à l’âge quasi adulte (17 ans), pendant la nuit, Phil vient dans la chambre de sa maman, la réveille pour lui demander conseil au sujet de son premier béguin pour un garçon de sa classe, Nicholas : « C’est juste que j’ai un rancard demain et j’arrive pas à dormir. Qu’est-ce que je dois faire ? » Glass l’invite à s’asseoir à ses côtés et dit à son fils d’accepter directement toutes les pratiques homos du premier coup : « Fais tout. » Mais elle lui donne aussi un avertissement faustique (l’interdit d’aimer) : « Mais ne lui demande pas s’il t’aime. Crois-moi, je m’y connais. » Phil remercie sa mère maquerelle : « Merci Mum. Tu m’as bien aidé. » Lorsque Phil présente en chair et en os son amant Nicholas à sa mère bobo, celle-ci est tout émoustillée : « Niveau bon goût, tu tiens de moi, c’est sûr ! » Et c’est limite si elle ne leur file pas des préservatifs… « Amusez-vous bien. Et ne vous déchaînez pas trop. » Par ailleurs, Glass, quand elle est tombée enceinte à l’âge de 16 ans, a quitté définitivement le père de Phil, laissant ce dernier amputé de sa relation filiale avec son père biologique. Cette mise à l’écart a certainement concouru à l’émergence d’un désir homosexuel chez le jeune homme : « Une femme avec deux enfants et pas de mari, ça faisait tache ici. Mais on gérait, même sans homme à la maison. Les copains nous interrogeaient sur notre père. Alors on demandait à Glass, qui disait un truc du genre ‘Un marin en voyage’. Ou bien ‘Un cow-boy dans un ranch’. Et plus tard, quand on ne gobait plus tout ça, ‘Je vous le dirai quand vous serez prêts’. Un jour, on a arrêté de demander, vu que ça ne servait à rien. Et aujourd’hui ? C’est normal de ne rien savoir sur notre père, le mystérieux numéro 3 de la liste. Pour moi, ça restait un vide étrange. Un trou noir. »
Dans le film « Les Garçons et Guillaume, à table ! » (2013) de Guillaume Gallienne, Guillaume, le héros bisexuel, raconte comment, pendant toute son adolescence et au début de sa vie d’adulte, lui et sa mère ont signé un pacte tacite pour s’imiter l’un l’autre (« … même si on a prétendu le contraire parce que ça nous arrangeait bien tous les deux. » révèlera Guillaume), pour s’installer dans la plainte et la douilletterie (« Maman, maman, maman, maman… j’ai un peu mal à la tête. » est la première phrase du film), et comment sa mère, par jalousie et pour garder son fils rien qu’à elle (« C’est elle qui a eu peur que j’aime une autre femme qu’elle. » avouera Guillaume à la fin du film, après avoir fait entrer une femme dans sa vie), lui a fait croire qu’il était homosexuel, qu’il n’avait rien d’un homme (elle le maltraite verbalement : « T’as toujours eu peur des chevaux. » ; « T’as jamais été sportif. » ; etc.), qu’il était devenu elle (« Pourquoi ma mère n’est-elle pas heureuse ? Pourtant, je suis une fille, comme elle. »), qu’il remplacerait son mari ou sa meilleure ami (par exemple, la mère appelle son fils « ma chérie »). La scène du coming out forcé (= outing) est assez parlante : Guillaume vient voir sa mère près de la piscine pour se faire consoler de son chagrin d’amour pour Jeremy (et non pour lui annoncer qu’il se sentirait homosexuel, étant donné qu’il ne se prend que pour une femme, et qu’il ne connaît même pas le mot « homo »). Et là, sa mère, maladroitement et voulant bien faire (ou faire « gay friendly »), lui colle agressivement l’étiquette de « l’homo » dont il aura du mal à se défaire par la suite : « Tu sais, y’en a plein qui vivent très heureux… » Et comme lui ne comprend pas le sous-entendu, elle se met à lui gueuler dessus et à lui demander de ne pas jouer à plus bête qu’il n’est : « Enfin, les pédés, les homos, quoi ! » Guillaume essaie de résister en vain à la prédiction de sa mère : « Mais je suis pas homo parce que je suis une fille attirée par un garçon. C’est on ne peut plus hétéro… »
Cette mère incestueuse qui homosexualise peut tout à fait être un homme : le matriarcat n’a pas de sexe ; c’est un désir machiste et sur-féminin à la fois. « J’ai 22 ans et je vis toujours chez mon père. En plus, il est persuadé que je suis une fille de 2 ans. Du coup bah… je m’appelle Sophie. » (Bill dans la pièce Bill (2011) de Balthazar Barbaut) ; « Ça doit être mon père qui m’a fait ainsi ! Il était trop beau lui aussi ! Comme un gamin-papillon, j’étais fasciné par sa beauté d’homme solitaire. Peut-être que je m’y suis brûlé les ailes ! Je devrais jeter toutes ces photos que j’ai de lui ! Cesser de penser que j’aurais hérité de lui cette attirance pour les garçons. Un désir refoulé qu’il m’aurait transmis en quelque sorte. Et tout cela, parce qu’il nous prodiguait, à moi et à mon petit frère, la tendresse de la mère perdue. » (Adrien dans le roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, p. 60) ; « C’est chose terrible, la sentimentalité d’une mère. Parole de Garbo. Et vraie calamité un père lui-même sirupeux tout lâche à l’heure de se coltiner ce primordial mensonge de l’amour maternel qui vous raconte la vie gentil conte de fée, de sa voix doué vous berce de l’illusion jusqu’à profond sommeil plein de rêves, et au réveil, ensorceleur encore, vous console de l’histoire pas vraie en vous minaudant de pires faussetés à l’oreille. » (le roman Vincent Garbo (2010) de Quentin Lamotta, p. 87) ; etc. Par exemple, dans la pièce Moi aussi, je voudrais avoir des traumas familiaux… comme tout le monde (2012) de Philippe Beheydt, Eddy, le « père » fictif d’Édouard, imagine pour son « fils » une relation homosexuelle avec Michael, un camarade de cour d’école.
Le matriarcat qui rend le héros principal homosexuel peut parfois être porté par la « fille à pédés », la meilleure amie, la tante, ou bien la courtisane post-pubère soucieuse de tester son pouvoir d’attraction sur les garçons : « Tu sais Bruno, ça ne me dérange pas que tu sois homosexuel ! » (Christiane, balançant arbitrairement dans la boîte Number One cette présomption à son ami Bruno, d’une part afin de prêcher le faux pour savoir le vrai, et d’autre part afin de se servir de la beauté physique de ce pote comme appât pour s’attirer un mec pour elle, dans la pièce Célibataires (2012) de Rodolphe Sand et David Talbot) ; « Ah non mais attends, j’suis pas gay ! » (Bernard, le personnage homo qui fera plus tard son coming out à sa meilleure amie Donatienne qui l’insiste régulièrement à cracher le morceau, dans la pièce Nous deux (2012) de Pascal Rocher et Sandra Colombo) ; « Si j’amenais un homme de Gomorrhe à Sodome… » (cf. la chanson « Ma robe » d’Élodie Frégé) ; « T’es ma fofolle à moi ! » (Alice à son meilleur ami homo Fred dans la pièce Coloc’ à taire ! (2010) de Grégory Amsis) ; « Cette fois, c’est toi qui te maquilles, les faux cils et les talons aiguilles. Faut qu’c’ait l’air de te plaire. » (cf. la chanson « Un Garçon facile » d’Élisa Tovati) ; « Je serais si heureuse si tu devenais un pédé ! » (Tante Ida à son neveu Gator, dans le film « Female Trouble » (1975) de John Waters) ; « T’es rien qu’un fils de pute. Et ta mère, elle fait le trottoir. » (une camarade de classe à Franck, un garçon qu’elle traite de pédé, dans la pièce Mon Amour (2009) d’Emmanuel Adely) ; « Olivier jette quelques coups d’œil rapides vers son ami, il ne peut pas s’en empêcher. Au bout d’une demi-heure environ, il se rend compte qu’Alice l’observe. Depuis quand le regarde-t-elle ? A-t-elle compris quelque chose ? Les femmes sont plus rapides que les hommes pour décrypter les signes. Olivier se sent comme pris sur le fait, il n’ose plus fixer autre chose que ses feuilles de cours. » (Jean-Philippe Vest, Le Musée des amours lointaines (2008), p. 92) ; « Tom et Jerry sont un couple gay. » (Veronika face à deux garçons qui la draguent elle et Nina en boîte, et qu’elle cherche à mettre mal à l’aise pour les mettre à l’épreuve de sa drague de femme fatale, dans le film « Black Swan » (2011) de Darren Aronofsky) ; « S’il ne le sait pas, moi, je le sais ! » (Sibylle par rapport à Nelligan Bougandrapeau, le présentateur télé homo, dans la pièce En circuit fermé (2002) de Michel Tremblay) ; « Votre virilité aurait-elle subi des dommages après moi ? » (Merteuil s’adressant à Valmont, dans la pièce Quartett (1980) d’Heiner Müller) ; « En fait, en tant qu’homme, tu sers à rien. » (Ninon s’adressant à Stan, l’hétéro, dans la pièce Les Favoris (2016) d’Éric Delcourt) ; etc.
Par exemple, dans le film « Le Secret d’Antonio » (2008) de Joselito Altarejos, Antonio, à 15 ans, tombe amoureux de son oncle Jonbert ; sa meilleure amie, Mike, est en faveur de son coming out. L’homosexualisation du héros gay par la Lolita allumeuse est parfois le signe d’une vexation féminine de ne pas séduire facilement tous les hommes… Dans le film « Stand » (2015) de Jonathan Taïeb, Anton, en tant qu’assistant à domicile de personnes âgées (ergothérapeuthe), va faire des ménages chez Olga, une grand-mère qui passe son temps devant la télé et l’initie aux jeux télévisés. Celle-ci veut absolument le caser avec une femme, et tente même de le séduire, en maintenant avec lui une relation fusionnelle (elle l’appelle « mon chéri »). Dans le film « La Ballade de l’impossible » (2011) de Tran Anh Hung, Kisuki est poussé au suicide parce que sa « première fois » avec Naoko, sa copine, se révèle désastreuse : cette femme lui fait croire à son impuissance sexuelle. Dans le one-man-show Raphaël Beaumont vous invite à ses funérailles (2011) de Raphaël Beaumont, le héros homosexuel raconte qu’il a croisé une femme dans la rue qui l’a ignoré. Dans le film « Les Garçons et Guillaume, à table ! » (2013) de Guillaume Gallienne, Guillaume, le héros bisexuel, se prend plusieurs fois des vents de la part des femmes fatales de son entourage (« Toi, tu danses comme une fille. Je ne veux pas danser avec une fille. » dira Pilar, la belle Andalouse qui décline l’invitation de Guillaume à danser avec lui), soit parce qu’elles ne le considèrent pas comme un homme, soit parce qu’elles le traitent d’homo (sa mère en premier lieu ; ses tantes en second), soit parce qu’elles le torturent (Ingeborg dans le centre de thalassothérapie). Dans le film « Cloudburst » (2011) de Thom Fitzgerald, Stella, l’héroïne lesbienne, traite Prentice de « Sissy », juste parce qu’il fait des mouvements de danse sur la plage. Dans la pièce Y a comme un X (2012) de David Sauvage, le père de Jean-Charles dit qu’il est devenu homo parce qu’il a été envahi par les femmes. Dans le roman Le Crabaudeur (2000) de Quentin Lamotta, le narrateur est élevé par des femmes : sa mère, sa nanou, etc.
Pour en revenir à la mère, je pense qu’elle ne veut pas tant faire de son enfant une fille (s’il est né garçon) ou un garçon (si elle est née fille), un gay ou une lesbienne, qu’un être asexué (tout-puissant et désincarné), un objet sacré pouvant être vénéré, consommé, mutilé. « Tu aimes les bijoux, hein ? Prends ça aussi. Et le collier. Tiens, tiens, ne me remercie pas. […] Tu aimes l’argent, hein ? » (Evita à l’infirmière dans la pièce Eva Perón (1969) de Copi) ; « L’idéal d’la féminité, c’est d’être née avec du blé ! C’est comm’ ça qu’elle’ pond’ des pédés. […] Ell’ font d’eux des efféminés. » (Cachafaz, le fils de la bourgeoise et donc de la bourgeoisie, dans la pièce Cachafaz (1993) de Copi)
C’est pourquoi on voit tellement de héros homosexuels qui ont une maman transsexuelle ou prostituée dans les fictions. Par exemple, dans la pièce Des bobards à maman (2011) de Rémi Deval, Marina, la « mère » de Fred, le héros homo, se trouve finalement être un homme transsexuel : « Fred, je suis ton père. » Dans le roman Michael Tolliver est vivant (2007) d’Armistead Maupin, Anna, le personnage transsexuel M to F, materne Jake, l’homosexuel, comme une grand-mère : elle lui offre des chocolats, vient le visiter à l’hôpital, etc. Dans le film « Todo Sobre Mi Madre » (« Tout sur ma mère », 1998) de Pedro Almodóvar, Esteban est le fils homosexuel d’un homme transsexuel. Idem dans le spectacle musical Panique à bord (2008) de Stéphane Laporte, où Kevin, l’homosexuel de 17 ans, est le fils de Jenny, le chanteur trans. Dans la pièce Les Sex Friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau, Quentin, le héros homosexuel, a eu une relation avec une prostituée (Martine) avant de s’engager dans l’homosexualité. Dans le film « Little Gay Boy » (2013) d’Anthony Hickling, le héros homosexuel, Jean-Christophe, dont la mère est prostituée (de métier), découvre son homosexualité. Dans le film « Zodiac » (2012) de Konstantina Kotzamani, Peter, un jeune garçon de huit ans, est confié, après la mort subite et mystérieuse de sa mère, à un homme transsexuel M to F nommé Giofa vient prendre soin de lui, contre sa propre volonté.
La mère du personnage homosexuel – mais cela peut être aussi un frère ou un amant – oblige son fils à se prostituer (tout comme elle), à devenir hypersexué/asexué, à travailler pour elle tout en gardant ses distances (car ils sont en concurrence professionnelle directe !) : « Il [Maria-José] fut élevé par son frère aîné qui l’habillait en fille et le prostitua dès l’âge de six ans. » (cf. la nouvelle « Le Travesti et le Corbeau » (1983) de Copi, p. 30) ; « Change de trottoir, le mien est piégé ! Si c’est trop tard, ne reste pas figé ! Sors du trou noir ! Je fais mon métier ! J’ai peur de rien, je suis une femme pressée ! » (cf. la chanson « Une Femme pressée » du groupe L5) ; etc. Par exemple, dans le film « Miss Mona » (1986) de Medhi Charef, Mona engage Samir à se lancer dans la prostitution masculine. Dans le roman Dix Petits Phoques (2003) de Jean-Paul Tapie, Rick s’homosexualise sous la pression d’une actrice porno qui le pousse dans les bras (ou plutôt dans le derrière !) d’un autre acteur. Dans la nouvelle « Madame Pignou » (1978) de Copi, la boulangère laisse sa fille se prostituer sur le trottoir d’en face : « La rue Henri-Monnier était déserte […] Seule la jeune prostituée se tenait en face. » (p. 47) Dans la pièce L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer (1967) de Copi, la mère offre une barrette, des bijoux, à sa fille Irina : elle l’aide à se travestir. Dans le film « Tomboy » (2011) de Céline Sciamma, Lisa maquille Laure (qu’elle pense être Michaël) en fille, en lui disant que ça lui va bien. Dans le one-(wo)man-show Zize 100% Marseillaise (2012) de Thierry Wilson, Zize, le travesti M to F explique qu’il est devenu femme-objet à cause de son meilleur ami Annonciade, travesti et prostitué aussi (« C’est grâce à elle que je suis devenue Miss Pointe-Rouge. ») et qu’il a relooké sa nièce « hideuse » Claire comme une pute pour qu’elle se fasse dépuceler sur un parking et « fasse son apprentissage de la sexualité ». Dans la pièce Les Vœux du Cœur (2015) de Bill C. Davis, Irène la sœur de Bryan, le héros homo croyant, qui est une femme libérée et adultère, défend son frère autant que sa propre luxure : « Bryan, marche donc sur ce trottoir, et moi je vais sur celui d’en face. »
Dans le film « Rosa la Rose : Fille publique » (1985) de Paul Vecchiali, Rosa, la prostituée, se voit courtisée par deux clients qui veulent coucher avec elle séparément. Mais elle fait tout pour les réunir pour un plan à trois :« Si vous voulez, on peut monter tous les trois. ». Au départ, le client 1 rechigne un peu, et finit par se laisser tenter : « Moi, ça me va… du moment qu’il ne me tripote pas. » Après avoir couché ensemble, les deux hommes prennent leur douche ensemble et se comparent leur bite. Rosa s’en amuse, et fait tout pour les homosexualiser : « Vous en avez fait, des folies ! J’espère que j’ai pas suscité une vocation. »
Le personnage homosexuel s’identifie à sa mère phallique, jadis abusée par les hommes, et qui revient, en amazone conquérante et victorieuse, se venger d’eux. Les « nouvelles femmes » (autrement dit les mères célibataires) débarquent ! Elles n’arrivent pas la fleur au fusil, et ne sont pas là pour faire de la couture : elles revendiquent une égalité identitaire avec les hommes. Et que ça saute ! « Les femmes détiennent le pouvoir ! » (cf. la chanson de Madame Mime, dans la pièce Les Divas de l’obscur (2011) de Stéphane Druet) ; « Les pin-up jouent les machos, c’est la folie sous les flambeaux ! » (cf. la chanson « Soca-Party » de la Compagnie Créole) ; « Femme des années, mais femme jusqu’au bout des seins, ayant réussi l’amalgame de l’autorité et du charme… » (cf. la chanson « Être une femme » de Michel Sardou) ; « La plupart des femmes d’aujourd’hui sont devenues des hommes d’autrefois. Le pire, c’est qu’à ce train-là, les hommes d’aujourd’hui risquent de devenir des femmes d’autrefois. » (Dominique et Julie dans le roman Les Julottes (2001) de Françoise Dorin, p. 45) ; « N’oubliez pas que pour le monde, dorénavant, je suis Madame Dubonnet. […] Je serai une Madame Dubonnet insupportable, attendez-vous à subir une tyrannie féminine sans merci. » (Cyrille s’adressant à Hubert, dans la pièce Une Visite inopportune (1988) de Copi) ; « Tu vas dans le sens de l’histoire, maman. Partout les femmes prennent le pouvoir. » (Laurent à sa mère Suzanne, dans le film « Potiche » (2010) de François Ozon) ; « Quand une femme a décidé quelque chose, tout arrive. » (Anamika, l’héroïne lesbienne, dans le roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, p. 85) ; « Je veux de vous. Je suis la société ! » (Tante Eva parlant à Anthony, son neveu homosexuel qui se sent rejeté par la société, et qu’elle essaie de caser avec d’autres hommes, dans le roman At Swim, Two Boys, Deux garçons, la mer (2001) de Jamie O’Neill) ; etc.
Quand le personnage homosexuel décrit sa chère et douce maman, on a l’impression qu’il fait le portrait d’un macho ou de son propre père (cette fois féminisé) : « Ma mère, c’est Schwarzenegger dopé aux OGM ! » (Jarry dans le one-man-show Entre fous émois (2008) de Gilles Tourman) ; « Tu vas trouver sa bête mais j’étais sur le net, j’ai vu ta mère sur Chat Roulette, j’ai appuyé sur ‘next’, j’ai flashé sur sa tête, j’ai vu ta mère sur Chat Roulette. Entre deux quéquettes. […] Je l’ai vue et j’ai tout de suite compris que ma vie prenait un tournant. Je dois reconnaître un petit air de famille et se n’est pas si déplaisant. Bientôt, j’irai là où tu as passé neuf mois. Bientôt, tu m’appelleras Papa. […] Tu m’avais dit que toutes les mères étaient des princesses. La tienne est une reine. Je vais l’aimer comme ma fille, ou ma sœur, ou mon père. » (cf. la chanson « Chatroulette » de Max Boublil)
La mère devient le centre de la famille et prend la place du père : cf. la série Clara Sheller (2005) de Renaud Bertrand (l’épisode 3 : « État secret »), le film « Pôv’ fille ! » (2003) de Jean-Luc Baraton et Patrick Maurin, le film « Ken Park » (2002) de Larry Clark, etc. Les rôles dans le couple hétéro ont été échangés par le héros homo, mais l’inversion n’a pas mis fin à la tyrannie pour autant : c’est juste le despote et son esclave qui ont échangé les masques. « Ma mère c’est mon père ; mon père c’est ma mère. » (une réplique du one-man-show Jérôme Commandeur se fait discret (2008) de Jérôme Commandeur) ; « Je veux un couple comme toi et papa, où tu prends le dessus de suite ! » (Zize, le travesti M to F s’adressant à sa mère, dans le one-(wo)man-show Zize 100% Marseillaise (2012) de Thierry Wilson) ; « Je m’occupe de tout à la maison. On n’a pas besoin d’une fille. » (Laurent Spielvogel imitant sa maman qui rejette la petite copine d’un de ses fils, dans son one-man-show Les Bijoux de famille, 2015) ; « Je l’empêcherai de te toucher. » (la maman de Davide, le héros homosexuel, lui parlant de son père, dans le film « Mezzanotte » (2014) de Sebastiano Riso) ; etc. Par exemple, dans le téléfilm « Prayers For Bobby » (« Bobby : seul contre tous, 2009) de Russell Mulcahy, la mère du héros gay fait totalement écran à son mari. Dans le film « Órói » (« Jitters », 2010) de Baldvin Zophoníasson, le père de Gabriel (le héros homosexuel) n’a aucune autorité : « Elle a toujours tout régenté. » dira-t-il par rapport à sa femme. Dans le film « No Se Lo Digas A Nadie » (1998) de Francisco Lombardi, la mère de Joaquín est ultra-protectrice et diabolise le père devant son fils. Dans le film « Una Giornata Particolare » (« Une Journée particulière », 1977) d’Ettore Scola, Gabriele, le héros homosexuel, avoue que chez lui, pendant son enfance, c’est sa mère qui régentait tout. À cause de cela, son père a quitté le domicile familial. Dans le film « Carol » (2016) de Todd Haynes, Harge, le mari amoureux éconduit, est rejeté comme une merde par sa femme Carol, lesbienne, ainsi que par Abby, l’ex de sa femme. Il n’a que ses yeux pour pleurer.
Non seulement le protagoniste gay nous raconte que sa mère a pris la place de son père, mais en plus, on apprend qu’elle a tué son mari (cf. le film « Volver » (2005) de Pedro Almodóvar) et tous les associés à son sexe de « mâle ». Le personnage homosexuel a assisté au meurtre de l’homme par la femme phallique (cf. le film « Ronde de nuit » (2004) d’Edgardo Cozarinsky, le film « Huit Femmes » (2002) de François Ozon, etc.) : « Les voisines disaient qu’elle était devenue un homme. Elles avaient raison. Ma mère faisait sa révolution. Elle se libérait. Retrouvait sa jeunesse. Et pour cela, elle avait besoin de détruire notre monde, le centre de notre monde : mon père. » (Omar dans le roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, pp. 34-35) ; « Ma mère m’a trop aimé. […] Maman me parlait toujours en mal de papa. » (cf. la chanson « Luca Era Gay » de Povia) ; « Elle s’est mise à insulter l’Innommable, comme d’habitude. » (Dany parlant de sa mère par rapport à son père, dans le film « Xenia » (2014) de Panos H. Koutras) ; « Enlevez le micro des mains de mon idiot de mari. » (Tessa, la mère de Rachel l’héroïne lesbienne, dans le film « Imagine You And Me » (2005) d’Ol Parker) ; « On fait jamais rien avec ton père, tu sais bien. » (Laurent Spielvogel imitant sa mère s’adressant à lui, dans son one-man-show Les Bijoux de famille, 2015) ; « Est-ce que je fais de la dépression, moi ? Pourtant, j’aurais de quoi, avec le mari que j’ai… » (idem) ; etc. Cet assassinat n’est pas dû à une détestation claire et directe de la gent masculine, mais au contraire à une idolâtrie, une jalousie, un fanatisme idolâtre : « Vous rêviez toutes de cet homme, et vous l’avez écartelé. » (Magdalena parlant du Prince démembré par ses groupies, dans la pièce Les Divas de l’obscur (2011) de Stephan Druet)
Ce n’est pas uniquement le père du héros homosexuel qui est tué par la mère. Le prochain sur la liste, c’est le héros lui-même. Elle ne le tue pas nécessairement physique : elle le châtre plutôt, le castre, le mutile, l’anesthésie, brise en lui tout désir. « Mais je garde le meilleur pour la fin, mon petit Yvon. Le produit de la dernière salve du pendu marque aussi la fin de ta propre carrière de don Juan. Grâce à ce cocktail à base de mandragore pilée, tu ne pourras plus nuire à la gent féminine. Je t’ai coupé le sifflet. C’est fini, les prouesses libertines. Tu resteras impuissant jusqu’à la fin de ta vie. Ça t’apprendra à préférer les fillettes remplies de vin aux vraies femmes de chair et de sang. » (Groucha à Yvon le « beauf », dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 267) ; « Tu m’as castré. » (Stéphane à sa copine Lili, dans la pièce Le Clan des joyeux désespérés (2011) de Karine de Mo) ; « Alors oui, j’avoue monsieur le juge : je lui ai vraiment cassé les… Ah oui mais récemment hein, des œufs sur le plat… des œufs brouillés !! C’est arrivé un soir, clak, ahhhh il a hurlé, oui… À force de répéter que j’étais castratrice, et bien voilà oui, je le suis réellement devenu. […] En lui arrachant la bite je l’ai aidé à se transformer en femme, depuis le temps qu’il en rêvait ! » (la femme à propos de son ex-compagnon Jean-Luc, converti en homo, dans la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier) ; « Lui s’était, par accident, fait une irrémédiable mutilation dont on imagine la gravité, puisqu’il ne lui restait entre les jambes qu’un tout petit morceau sans rapport avec ce dont disposent même les plus indigents. » (Alexandra, l’héroïne lesbienne parlant du patron du café, castré par sa femme, dans le roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 216) ; etc. La femme phallique rêve d’avoir un pénis, et est même prête à le couper à son fils pour se le coller sur elle. « Si ma baguette casse, que le grand crick me croque. » (cf. la chanson « L’Histoire d’une fée, c’est… » de Mylène Farmer)
Par exemple, dans le film « New Wave » (2008) de Gaël Morel, la mère de Romain empoisonne son fils gay (elle met une surdose de médicaments dans son café pour l’endormir et le tuer). Dans la pièce La Muerte De Mikel (1984) d’Imanol Uribe, la mère possessive de Mikel finit par assassiner son fils. Dans la comédie musicale Pacific Overtures (1976) de Stephen Sondheim, le spectateur entend une chanson racontant l’histoire d’une mère qui empoisonne son fils lentement et jusqu’à la mort. On retrouve la mère tueuse dans le film « My Own Private Idaho » (1991) de Gus Van Sant, dans la pièce Hamlet, Prince de Danemark (1602) de William Shakespeare, dans le film « Serial Mother » (1994) de John Waters, etc. Dans la chanson « Bohemian Rhapsody » de Queen, Freddie Mercury chante que sa mère l’a tué : « Mama, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he’s dead. » Dans le film « Œdipe (N + 1) » (2001) d’Éric Rognard, la mère de Thomas décide de supprimer l’instance de son fils cloné quand celle-ci ne correspond pas au fils idéal souhaité et qu’elle lui désobéit.
Si le héros homosexuel survit à cette dictature maternelle mortifère, il y laisse en général son désir amoureux et génital pour les êtres du sexe « opposé ». À travers son homosexualité, et son engagement d’adulte en couple homo, il recherche quand même le confort douillet, infantilisant et déréalisant de la mère. Le matriarcat a vaincu, et se perpétue en lui, même si en apparence sa mère n’est plus présente au milieu des amants. Chacun des deux membres du couple homosexuel veut aimer et être aimé de l’autre comme il imagine qu’une mère aime passionnément son petit enfant : « J’avais éveillé sa fibre maternelle – c’est un trait de mon caractère, je semble produire cet effet-là chez tous les gens que je rencontre ! » (Jean-Marc décrivant son amant Gerry, dans le roman Le Cœur éclaté (1989) de Michel Tremblay, p. 100) La lourdeur du matriarcat semble concomitante à beaucoup de relations amoureuses homosexuelles racontées dans les fictions !
FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION
PARFOIS RÉALITÉ
La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :
À force d’être entourées de femmes dans leur famille, certaines personnes homosexuelles ont pu, à leur contact, développer par réaction une homosexualité. « Aujourd’hui, toutes les femmes me font horreur, et, plus que toutes, celles qui me poursuivent de leur amour ; elles sont malheureusement très nombreuses. En revanche, j’aime ma mère et ma sœur, de tout mon cœur. » (lettre de Ernst Röhm, à 42 ans, le 25 février 1929)
Tout au long du XXème siècle, les mouvements féministes, en lutte contre le « patriarcat hétérosexiste », et les mouvements de libération homosexuelle ont marché côte à côte (je vous renvoie en France aux nombreux croisements entre le FHAR – Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire – et le MLF – Mouvement de Libération des Femmes)… à tel point qu’on suspecte encore les associations féministes d’être des « repères de lesbiennes ». Même si le féminisme n’implique pas forcément la défense de l’homosexualité, on voit bien qu’il est une passerelle idéale au lesbianisme, ou du moins à la bisexualité.
Sans forcément en avoir conscience, aujourd’hui, les personnes homosexuelles, en cautionnant leur homosexualité et le couple homo sous les drapeaux du féminisme et du matriarcat social, défendent en réalité une asexualité, une surféminité de femmes phalliques qui ne respecte pas les femmes réelles, un déni de la castration, et donc des limites du Réel. Par exemple, dans le documentaire « Mamá No Me Lo Dijo » (2003) de Maria Galindo, certaines femmes féministes et lesbiennes sont en attente de la castration des hommes ; dans le documentaire « Se dire, se défaire » (2004) de Kantuta Quirós, Beatriz Preciado exprime l’envie d’avoir un pénis.
En janvier 1958, Lacan soutient que la plupart des individus homosexuels ont connu l’inversion des identités et donc des rôles entre leur père et leur mère : « C’est la mère qui se trouve avoir fait loi au père au moment décisif. » (Jacques Lacan, « Les formations de l’inconscient », Le Séminaire V, 1998, p. 210) Et cela est confirmé par certains d’entre eux: « Je suis allé voir une psy qui a voulu me faire comprendre que je suis PD et que je considère plutôt les femmes comme des mamans ou comme un trophée. Voila la résultante. Dans mon cas, c’est la mère sur-protectrice qui a joué le rôle du père. Et les femmes qui m’ont le plus excitées étaient des femmes à poigne, fortes, des femmes qui me disent non qui me résistent, qui sont masculines dans leur façon de penser, des femmes qui renvoient de la perversité – oui c’est le mot ! – ou des femmes qui me renvoient l’image de père. » (cf. le mail d’un ami homo, Pierre-Adrien, 30 ans, reçu en juin 2014) Tout concorde pour montrer que l’homosexualité prend racine dans la politique parricide d’une mère cinématographique abusive, d’une hyène de films pornos… et parfois d’une mère biologique machiste réelle. « J’appartenais à ma mère, selon la logique matriarcale. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 14) ; « Éric est victime de la ‘revendication virile’ de sa mère, celle de posséder le pénis. Chez une femme, cette revendication est d’abord d’ordre narcissique : quand elle découvre qu’elle ne possède pas le pénis, les petites filles se sentent humiliées. La mère a tendance à ‘déviriliser’ son fils, comme si elle s’emparait de sa virilité pour son propre usage, pour devenir l’homme qu’elle n’est pas. » (Virginie Mouseler, Les Femmes et les homosexuels (1996), p. 38) ; « Je sais bien que je suis la mère d’un enfant anormal. » (Estelle, la mère de Stéphane, homosexuel, dans l’autobiographie Et dans l’éternité, je ne m’ennuierai pas (2014) de Paul Veyne, p. 239) ; « J’accuse aujourd’hui ma mère d’avoir fait de moi le monstre que je suis et de n’avoir pas su me retenir au bord de mon premier péché. Tout enfant, elle me considère comme une petite fille et me préfère à ma sœur, morte aujourd’hui. De mon père, j’ai le souvenir lointain d’un officier pâle, doux, presque timide, perpétuellement en butte aux sarcasmes de son épouse. » (Jean-Luc, homosexuel, 27 ans, cité dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, p. 75) ; « Au départ de presque toutes ces lamentables existences, il y a les mères. Les petites vies étriquées de ces êtres qui vivent à deux ou se contentent des sordides aventures d’urinoirs sont les résultats de la bonne éducation, les fruits de leçons trop bien suivies sur la crainte du péché, les dangers de la femme, tout ce qui fait la honte d’une religion mal comprise. Cette haine de la femme et cet excessif attachement à la mère, je les ai connus et je sais qu’ils peuvent, par instants, atteindre à la véritable névrose. Encore aujourd’hui, je ne suis pas tout à fait habitué à l’absence de ma mère et, lorsque je suis loin d’elle, je cherche à la joindre par téléphone et lui écris tous les jours. C’est elle, cependant, qui est en grande partie responsable de mon état misérable, par la façon dont elle m’a obligé à vivre constamment sous son sillage. L’opinion que je me suis formée sur les femmes, je la dois selon moi, à ma mère : elle avait un caractère si malheureux que j’en suis arrivé maintes fois à me dire que mon angoisse vient de la crainte de tomber sur une femme semblable à elle. » (idem, p. 104) ; « Le taux considérablement supérieur d’homosexualité masculine s’explique par le fait que ce sont essentiellement les femmes qui ont la garde des enfants, d’où la difficulté pour le garçon d’acquérir une identité masculine faute d’un modèle à admirer et imiter. » (Thomas Montfort, Sida, le vaccin de la vérité (1995), p. 21) ; etc.
Par exemple, dans l’émission 100% Politique de Patrick Buisson traitant du « communautarisme gay » sur la chaîne LCI en 2003, le romancier homosexuel Guillaume Dustan explique que l’homosexualité masculine vient du fait que les individus gays ont eu « peur de leur mère » : « Je pense que ma mère était beaucoup plus meurtrière à mon égard que mon père. Ma mère, elle voulait vraiment vraiment vraiment ma mort. »
L’action homosexualisante que peuvent avoir certaines mères vis à vis de leur fils ou de leur fille n’est pas tant une homosexualisation qu’une asexuation ou une inversion de sexes (ce n’est qu’après avoir été modifié dans son identité que la personne homosexuelle se posera la question de son désir sexuel) : « Je suis la dernière d’une fratrie de 3 enfants et seule fille. Ma mère m’a toujours considérée comme son ‘troisième fils’. Il en a résulté une garçonnisation volontaire de sa fille : elle m’habillait comme mes 2 frères, me faisait raser les cheveux à la tondeuse chez le coiffeur du village, disait à tout le monde que j’étais un ‘véritable garçon manqué’. Et ce travestissement de mon enveloppe corporelle était si réussi, que les gens qui ne me connaissaient pas me disaient ‘Bonjour mon garçon’. À chaque ‘bonjour garçon’, je sentais le couperet de la guillotine me tomber sur la nuque. J’avais honte de ce à quoi je ressemblais, mais je ne pouvais lutter car ma mère était violente avec moi si je tentais de me rebiffer. Alors, j’ai fini par adopter les codes des garçons : marcher comme un mec, parler comme mon père et mes frères, regarder les filles comme mon père et mes frères les regardaient, me battre avec les copains comme un vrai mâle. Il arrivait même que des filles de mon âge qui me voyaient pour la 1ère fois soient troublées par moi et tombent sous mon charme. Alors, je les séduisais. Ce travestissement a duré jusqu’à l’âge de 12 ans, âge où ma mère m’a mise à l’internat pour filles. Le jour de la rentrée, j’entends encore raisonner en moi la parole méchante et ironique dite avec un rictus moqueur ainsi qu’un léger pouffement de rire de la part du père d’une fille ‘tiens, y’a des garçons dans cet internat ?’. Là, je me suis dit ‘c’en est trop, je veux être une fille’. Quelque mois après, je suis tombée follement amoureuse de ma prof de français à l’internat. Belle femme douce, féminine et ferme. Tout l’opposé de ma mère. Et ça a été le point de départ d’une lutte tenace pour m’affranchir de la méchanceté de ma mère. Mais j’ai réussi à devenir une belle femme. Dans mon entourage, personne ne connaît mon combat et cet attrait si puissant pour les femmes. » (une amie lesbienne, Valérie, 31 ans, qui m’a écrit ce mail en 2012)
Par exemple, dans l’émission Infra-Rouge intitulée « Souffre-douleurs : ils se manifestent » diffusée sur la chaîne France 2 le 10 février 2015, le jeune Lucas Letellier, lycéen se disant « homosexuel », témoigne du harcèlement scolaire qu’il a subi, aux côtés de sa mère, une femme agressivement gay friendly, qui, derrière un soutien expansif, marque bien son territoire (et le fils ne s’en révolte même pas !) : « T’es toujours mon grand bébé quand même ! »
Autre exemple : la mère de Charles Trénet a empêché le mariage de son fils homosexuel avec la femme qu’il aimait, Monique Pointier. Dans le docu-fiction « Le Dos rouge » (2015) d’Antoine Barraud, Bertrand Bonello est obsédé par le monde de la peinture : « Pourquoi cette attirance pour les musées ? Il ne l’a jamais su. » (la voix-off de la mère de Bertrand, parlant de son fils) Il rêve de fuir sa réalité pour pénétrer dans les toiles, et sa mère l’a initié à cette drogue : « C’était comme une maison de poupées. Un théâtre de marionnettes. On passait des heures devant les agneaux à deux têtes. Il était bouleversé. Nous étions en plein syndrome de Stendhal. Ivres de beauté. Il voulait vivre là. À côté. Et moi j’étais là, sans savoir quoi faire. C’est dans un musée que j’ai senti que mon fils était un homme. » (la voix-off de la mère de Bertrand)
L’idéal féminin de nombreuses personnes homosexuelles est une mère symbolique castratrice : « À Vienne, Gustave Klimt, à Paris, Regnault, le jeune prix de Rome ami de Mallarmé, Gustave Moreau dont c’est le cœur de la mythologie intime, à Londres Oscar Wilde et Aubrey Bearsley, en Allemagne von Stuck, en Belgique Delville, Toorop, Mellery ou Ferdinand Knopff : tous ont été obsédés par le thème de la femme destructrice. Ce ne sont qu’Hérodiades, Salomés et Judiths, que femmes thraces déchirant le corps d’Orphée ou contemplant rêveusement sa tête coupée. On retrouve, en costumes 1900, les mêmes redoutables et sataniques amazones dans les romans de l’époque : chez D’Annunzio (Il Triomfo Della Morte), chez Pierre Louÿs (La Femme et le pantin) ou Octave Mirbeau (Le Jardin des supplices). L’homme – ou ce qu’il en reste : la tête, belle, douloureuse et asexuée – est donc chaque fois la victime d’une femme et comme prédestiné à l’être par ses aspirations célestes et sa nature ambiguë. » (Françoise Cachin, « Monsieur Vénus et l’ange de Sodome : L’androgyne au temps de Gustave Moreau », Bisexualité et Différence des sexes (1973), pp. 84-85) ; « Ma mère était assez violente, peut-être plus que mon père, en réalité, et dans la seule confrontation qui, à ma connaissance, les opposa physiquement, ce fut elle qui le blessa, en lançant sur lui le bras du mixeur électrique qu’elle était en train d’utiliser pour préparer une soupe : le choc fut tel qu’il en eut deux côtes fêlées. Elle est assez fière de ce fait d’armes, d’ailleurs, puisqu’elle me l’a raconté comme on raconte un exploit sportif. » (Didier Éribon, Retour à Reims (2010), p. 81)
Il n’est pas exagéré de parler de meurtre symbolique du père ou de l’homme dans notre société. Cela n’a pas exactement à voir avec la question de la « masculinité » (ou même du « genre », cette nouvelle entourloupe idéologique trouvée par les Queer & Gender Studies pour maquiller ce meurtre castrateur de la « domination masculine » orchestrée par une société du « tout génital sans le sexuel » ; c’est pourquoi je ne suis pas complètement d’accord avec Élisabeth Badinter quand elle écrit dans son essai X Y de l’identité masculine (1992) que « les crises de la masculinité naissent dans les pays à la civilisation raffinée, où les femmes jouissent d’une plus grande liberté qu’ailleurs. », p. 25). Il s’agit plus d’une crise de la sexuation que de la masculinité. Cela dit, l’étude que mène Badinter est très pertinente par rapport au thème du parricide et de la misandrie : elle a relevé que dans les romans du XXème siècle, la figure de « l’homme qui pleure » était particulièrement récurrente. Cette tendance au massacre du cœur des hommes via l’humiliation des hommes-objets (= c’est le système des poupées vaudous) s’observe aussi dans les films et les publicités, où les hommes et les pères s’en prennent plein la figure, et sont montrés comme des gros bébés immatures. L’homosexualité sera la proposition sociale fleurie, la méthode douce, pour tuer le père à petit feu, l’air de rien. « Pour nous, les enfants, il y avait entre nos parents comme une cloison étanche. Pour moi, de onze à quinze ans, il y eut deux mondes sans communication possible. Le monde de la mère et le monde du père. Incompatibilité renforcée par la division politique : le monde de la mère gaulliste et le monde du père collabo. Mais la division politique restait secondaire par rapport à la coupure morale décidée par notre mère, veto originel et d’autant plus fort, d’autant plus paralysant qu’il n’était pas exprimé. Affreuse oppression du non-dit.[…] Je m’obligeais en moi-même à rester étranger à celui que ma mère me désapprouvait de continuer à reconnaître pour mon père. » (Dominique Fernandez, Ramon (2008), pp. 36-37) ; « J’avais intériorisé l’interdit maternel. […] Amoureux de mon père, je l’ai toujours été, je le reste. Ma mère, je l’ai admirée, je l’ai crainte, je ne l’ai pas aimée. Lui, c’était l’absent et c’était le failli, l’homme perdu, sans honneur. C’était le paria. » (idem, p. 45)
Par exemple, en me rendant à la projection d’un navet tel que « La Croisière » (2011) de Pascale Pouzadoux, je n’ai pas eu de mal à voir quelle mauvaise pente veulent nous faire prendre beaucoup de productions cinématographiques actuelles. Dans ce film, on ne nous montre que des hommes émasculés : entre les curés frustrés sur le point de se défroquer, les hommes qui reçoivent des bouchons de champagnes dans les couilles, les maris qui délaissent leur femme et oublient leur anniversaire, les types qui s’égarent à tout jamais dans les toilettes, les chefs qui démissionnent de leur poste (Alix dira au capitaine du bateau, Jean Benguigui, qui veut fuir son navire, qu’il « ne sert à rien »), les queutards menottés et réduits au silence, les mecs défigurés sur des civières… le tableau de la gent masculine n’est pas brillant ! Symboliquement, c’est le désir masculin tout entier qui est mis à mort. Et bien sûr, les femmes toutes-puissantes, avec plusieurs maris ou/et célibattantes, ont le dernier mot ! Le seul homme (Raphaël) qui va trouver grâce aux yeux de ces despotes femelles, et qui réussit à tirer son épingle du jeu dans le film, il sera dans l’obligation de se travestir. Mieux : de s’homosexualiser ! Hortense, au moment de tomber amoureuse de lui, conclura : « J’ai envie d’être homosexuelle… avec un homme. » On a là la démonstration par a + b d’une parfaite homosexualisation par le matriarcat !
Dans la pièce Desperate Housemen (2010) de Stéphane Murat, les comédiens évoquent la féminisation de la société et des « auteurs » littéraires actuels, tels que Marc Lévy ou Guillaume Musso, qui, pour leurs titres de romans, ne choisissent que des questionnements très féminins : Seras-tu là ?, Où es-tu ?, Que serais-je sans toi ?, Je reviens te chercher, etc.
On constate, chez les sujets homos, que l’influence maternelle dans l’affirmation future de leur homosexualité, est en général capitale. Par exemple, certains hommes gays ont été habillés dans leur enfance en fille par leur mère : c’est le cas de Gabriele D’Annunzio, Félix Youssoupov, Oscar Wilde, Federico García Lorca, André Gide, etc. « Lors de la naissance d’Oscar, lady Wilde n’a pas voulu accepter l’idée que le destin pût lui donner un autre garçon. Pour elle, ce second enfant est une fille et c’est en fille qu’elle l’élève : elle fait de lui sa compagne ; surtout, elle l’exhibe, le caresse, le guide comme une petite fille. Il n’a pas de jeux de garçon : ondulé, paré, parfumé et pur, il fait de la tapisserie. Pour lui, son père est laid, sale, débraillé, puant l’alcool. Quant à son frère Willie, il n’est qu’un vice incarné. » (Jean-Louis Chardans, Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p. 75) ; « C’est ainsi qu’au plus secret de moi-même, dès mes premières années d’enfance, j’ai voulu imiter ma mère ; par instinct, mais aussi par orgueil, je me suis comporté en femme. » (idem, p. 80)
Le dressage castrateur ne se limite pas aux vêtements. Ce sont l’attitude, la gestuelle, la sociabilité, qui se coulent dans le moule maternaliste. « C’est elle qui souvent rappelait à l’ordre son fils lorsqu’il se servait de sa voix basse. » (Sandor Ferenczi concernant le cas d’une mère de fils homosexuel, « Le Rôle de l’homosexualité dans la pathologie de la paranoïa » (1911), cité dans l’ouvrage collectif L’Homosexualité de Platon à Foucault (2005) de Daniel Borillo et Dominique Colas, p. 413)
Les mères des personnes homosexuelles sont autant celles qui habillent leur fils en fille que celles qui les force à incarner, par purisme sexiste, l’« éternel masculin », qui ne supportent pas le moindre écart de conduite appartenant soi-disant uniquement aux membres de l’autre sexe (ex : « Les garçons, ça ne pleure pas » ; « Les filles, c’est sensible et ça ne cherche pas la bagarre »), qui sacralisent la différence des sexes de manière rigide et bourgeoise : « Elle détestait particulièrement les chochottes. » (Frédéric Mitterrand en parlant de sa mère, dans son autobiographie La Mauvaise Vie (2005), p. 89) ; « La plupart du temps ils me disaient ‘gonzesse’, et ‘gonzesse’ était de loin l’insulte la plus violente pour eux. […] Même ma mère disait d’elle ‘J’ai des couilles moi, je me laisse pas faire’. » (Eddy Bellegueule dans son autobiographie En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, p. 30) ; etc. Et à ce titre, le jugement de Badinter « Les hommes sont plus homophobes que les femmes. » (Élisabeth Badinter, X Y de l’identité masculine (1992), p. 177) mériterait, à mon sens, d’être revu…
Pour continuer dans cette lancée, on observe que l’homosexualité est souvent le fruit d’une castration, d’une humiliation imposée par la maman. Par exemple, dans l’autobiographie d’Abdellah Taïa Une Mélancolie arabe (2008), Slimane, homosexuel, a été battu par sa mère, « une vieille femme autoritaire » (p. 106), durant son enfance. Dans le film « Moonlight » (2017) de Barry Jenkins, la mère de Chiron, le jeune héros homosexuel, se moque de lui et de sa « démarche » efféminée.
Cette mère incestueuse qui homosexualise, choie, et soumet, peut tout à fait être un homme, un père, ou tout simplement jouer à l’homme en s’homosexualisant. Par exemple, toujours dans Une Mélancolie arabe, Taïa se dit « protégé par un père tendre et une mère un peu sorcière. » (p. 31) Le matriarcat n’a pas de sexe ; c’est avant tout un désir machiste, incestueux, qui écoute tout mais qui n’entend rien. Qu’il soit appliqué par un homme ou femme, peu importe, finalement.
Il n’y a pas que les hommes réels qui pâtissent de la propagande des amazones phalliques. Le pire, c’est que ce sont aussi les femmes réelles qui sont victimes des revendications de ceux (les « féministes », les filles à pédés, les femmes lesbiennes, les mères vengeresses, les hommes et des femmes surprotecteurs) qui prétendent les défendre. Le sexisme pro-femmes ou pro-mères fait des dégâts collatéraux, et instille la misogynie dans les veines de nombreux êtres humains (futurs homosexuels ?) : « Durant ce temps, ma mère ne cesse de tisser autour de ma vie d’enfant un véritable cocon de tendresse mais se garde bien de m’élever en garçon. […] Je n’avais aucune pensée sexuelle à l’égard de l’autre sexe car, pour moi, un être féminin était neutre et je n’aurais su que faire avec lui ; toute femme, pour moi, à cette époque, était une mère. Je surpris néanmoins, un soir, à la campagne, une jeune fille qui se baignait dans un ruisseau, n’ayant pour tout vêtement que sa chemise. Je n’eus pas le courage de regarder bien longtemps et je m’enfuis chez moi pour conter, en toute sincérité mon aventure… à ma mère. C’était la première fois, au cours de mes douze années d’existence, qu’il m’avait été donné d’approcher une femme inconnue… surtout dans une tenue aussi sommaire. Ma mère me fit la morale et brossa pour moi un tel tableau physique et moral des femmes que je n’en dormis pas de la nuit : la femme, la jeune fille… êtres abjects, lâches, sans hygiène ; la nudité… quelle horreur !… surtout chez la femme, cet être perpétuellement maudit… C’est ainsi que, par suite des extraordinaires révélations de ma mère, le sexe féminin me fut à jamais interdit alors que cette même occasion aurait pu doucement me le révéler… […] Tout en me chérissant, ma mère me présentait les relations avec l’autre sexe comme un mal immoral. […] Hormis ma mère, la bonne et la cuisinière, je ne voyais jamais de femmes… et encore moins de petites filles. […] Si, dans une famille, la mère est la plus forte, les enfants se disent alors : ‘Je voudrais être une femme, pour dominer et conquérir avec ces mêmes armes.’ » (Jean-Luc, homosexuel, 27 ans, parlant de ses premières années, à 9-12 ans, cité dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, pp. 76-78) ; « Mon père a eu une très mauvaise influence sur mon adolescence. Et ma sœur et moi, nous avons été élevées dans la haine du père. Par ma mère, d’ailleurs, qui nous a montées contre notre père. » (Germaine, femme lesbienne suisse, dans le documentaire « Les Homophiles » (1971) de Rudolph Menthonnex et Jean-Pierre Goretta)
Le problème de cette agression féministe/maternante, c’est qu’elle s’annonce sous les hospices de la douceur, de la mode, de la sensibilité, de l’écoute « participative », de l’amour, de la sécurité. « Toute ma vie des femmes auront monté la garde autour de moi. » (Pascal Sevran, Le Privilège des Jonquilles, Journal IV (2006), p. 41) ; « Les garçons manqués […] sont d’authentiques casse-cou. Moi, bien au contraire, je dois rester tranquille dans mon coin et surtout ne pas remuer trop d’air parce qu’on craint toujours qu’il m’arrive un accident. […] Ma mère est inquiète […] Mon père n’est pas en reste. Quand on se promène, je ne peux pas accélérer un tant soit peu l’allure sans que je l’entende prophétiser derrière moi : ‘Tu vas tomber’, et je tombe, en effet, comme si j’avais à cœur de lui donner raison. […] On m’élève dans du coton comme si je risquais de me briser. On veille constamment à ce qu’il ne m’arrive rien de fâcheux. Et on ne cesse de me répéter que c’est parce qu’on aime beaucoup l’enfant gâtée que je suis qu’on agit ainsi. » (Paula Dumont, Mauvais Genre (2009), p. 51-52) La mère d’enfant homosexuel n’est pas tant violente d’avoir été sciemment méchante que d’être sincère et trop aimante. C’est la violence troublante de l’inceste, celle qu’on n’attend pas étant donné sa proximité, sa familiarité, sa beauté. « La bonne mère est naturellement incestueuse et pédophile. » (Élisabeth Badinter, X Y de l’identité masculine (1992), p. 76) ; « Jocaste a-t-elle su et voulu vivre l’inceste avec son fils ? Les femmes d’aujourd’hui veulent-elles et savent-elles ce qu’elles font en prenant la première place auprès de leur enfant ? Ont-elles connaissance de ce qu’elles déclenchent ainsi chez leurs fils, chez leurs filles ? Ces femmes qui disent le plus naturellement du monde, en parlant de leur fils ‘il fait son Œdipe’, pensent-elles une minute ‘et moi je fais ma Jocaste’ ? Si Œdipe est considéré comme le modèle universel de l’homme, Jocaste ne peut-elle pas être tenue pour le mythe éternel de la femme-mère ? » (Christiane Olivier, Les Enfants de Jocaste (1980), p. 12) Une trop grande sollicitude maternelle peut engendrer plus tard une misanthropie, un rempli narcissique d’ordre sexuel (= l’homosexualité), chez le fils surprotégé : « Lorsque j’étais enfant, nous habitions un quartier appelé Marrac ; ce quartier était plein de maisons en construction dans les chantiers desquelles les enfants jouaient ; de grands trous étaient creusés dans la terre glaise pour servir de fondations aux maisons, et un jour que nous avions joué dans l’un de ces trous, tous les gosses remontèrent, sauf moi, qui ne le pus ; du sol, d’en haut, ils me narguaient : perdu ! seul ! regardé ! exclu ! (être exclu, ce n’est pas être dehors, c’est être seul dans le trou, enfermé à ciel ouvert : forclos) ; j’ai vu alors accourir ma mère ; elle me tira de là et m’emporta loin des enfants, contre eux. » (Roland Barthes, « Un Souvenir d’Enfance », Roland Barthes par Roland Barthes (1975), p. 111)
Michel Schneider, dans son excellent essai La Confusion des sexes (2007), nous parle de la « politique maternaliste du non-sexe » (p. 23) que nos sociétés actuelles mettent insidieusement en place, du « maternalisme désexualisant » (idem, p. 27), celui qui nous prive de désir (du Désir) : « Les familles se structurent de plus en plus autour des femmes (en cas de séparation, l’enfant et la résidence sont presque toujours confiés à la mère). » (idem, p. 82) ; « Les mères feraient-elles des maîtres moins tyranniques que les pères ? Le pouvoir moderne serait-il moins absolu d’être exercé par des femmes ou par des hommes s’inspirant de ce qu’ils pensent être des vertus maternelles ? Mais d’où tire-t-on de l’Histoire l’idée que la politique serait une histoire d’amour, une affaire de cœur ? N’y a-t-il pas là dénégation du lien fondamental entre le pouvoir et la violence, entre la politique et la mort ? » (idem, p. 36) Éric Zemmour va le sens de Schneider quand il écrit que l’uniformisation des rapports femme-homme participe d’un même asexuation sociale à visage maternel : « Il n’y a plus d’hommes, il n’y a plus de femmes, rien que des êtres humains égaux, forcément égaux, mieux qu’égaux, identiques, indifférenciés, interchangeables. […] on suggère la supériorité évidente des ‘valeurs’ féminines, la douceur sur la force, le dialogue sur l’autorité, la paix sur la guerre, l’écoute sur l’ordre, la tolérance sur la violence, la précaution sur le risque. […] La société unanime somme les hommes de révéler la ‘féminité’ qui est en eux. » (Éric Zemmour, Le Premier Sexe (2006), p. 10) ; « Le patriarcat, c’est l’accumulation des petits et grands secrets, pour se forger en dehors de la mère ; le matriarcat, c’est la transparence, la mise à mort de tous les secrets, la fusion placentaire. Comme dans tout régime totalitaire, le secret, voilà l’ennemi. L’homme finit par s’y résoudre. C’est lui qui doit guérir. Qui doit se transformer. Qui doit lier désir et sentiment, sexe et famille, pulsion et fidélité. C’est l’homme qui doit devenir une femme. » (idem, p. 47)
Alain Finkielkraut et Pascal Bruckner, dans Le Nouveau désordre amoureux (1977), évoquent à juste titre le culte moderne non de la « Surfemme » mais plutôt du « Surhomme féminin » (p. 83). Ce n’est pas un hasard si, dans l’esprit et le discours d’un certain nombre de personnes homosexuelles, la mère est confondue avec la femme-objet macho (partiellement incarnée en la personne transsexuelle, la prostituée, ou la femme lesbienne) : « À la fête de l’Huma, j’étais à côté d’une transsexuelle, à la peau bleutée. Rapprochement inconscient avec ma mère. » (Annie Ernaux, Je ne suis pas sortie de ma nuit (1997), p. 42) ; « Lorsque j’ai eu 40 ans, elle m’a dit : ‘Maintenant, tu fais ce que tu veux, mais, surtout, ne dis rien à ton père, ne lui montre jamais que tu es comme ça, il va dire que c’est de ma faute, que je suis une prostituée.’ » (Brahim Naït-Balk citant sa mère, dans son autobiographie Un Homo dans la cité (2009), p. 89) ; « Je t’avais demandé ce que voulait dire le mot ‘pute’. Tu m’avais expliqué que c’était une femme qui se donnait aux hommes contre de l’argent. Et sans que j’insiste, tu as voulu préciser ce que signifiait puto, pute au masculin. Tu m’as dit que c’était de cette façon qu’un homme allait par plaisir avec un homme, mais qu’il devait payer. Je t’ai demandé pourquoi. Tu m’as dit que ces hommes-là étaient généreux. Je ne comprenais toujours pas. » (Alfredo Arias à sa grand-mère, dans son autobiographie Folies-Fantômes (1997), p. 161) ; « Tu me rappelais souvent que le premier mot que j’aie prononcé était ‘pute’. » (idem, p. 164) ; « Lito [une femme transsexuelle transformée en homme] avait fait converger toutes ses forces dans le but unique d’imiter sa mère. Dans l’intimité, il s’habillait comme elle. Il interprétait le répertoire lyrique qui avait fait la gloire de Katia. Elle acceptait volontiers cet hommage filial et le miroir qu’il lui tendait : elle se voyait plus jeune et, grâce à ce subterfuge, elle parvenait à se croire éternelle. » (Alfredo Arias, idem, p. 291) ; « J’avais seize ans quand ma grand-mère est venue voir ma première pièce représentée, avec les meilleures comédiens argentins. Une des vieilles comédiennes avait été sa maîtresse. » (Copi évoquant sa grand-mère lesbienne, dans l’article « Entretien avec Michel Cressole : Un mauvais comédien, mais fidèle à l’auteur » de Michel Cressole, le journal Libération du 15 décembre 1987) ; « Mamie Jeannine a divorcé lorsque mon père avait 3 ans. Elle a quitté son mari pour Jacques Larue, cet homme dont elle est tombée passionnément amoureuse. Mamie était d’une incroyable modernité ! À l’époque, ça ne se faisait pas de divorcer, ni de porter de pantalon, ou d’avoir les cheveux coupés court à la garçonne ! Mais mamie s’est toujours moquée du qu’en-dira-t-on. Elle était libre ! […] Avec mamie, on discute des heures, ‘on blague’, comme elle dit, et on rit. Des bavards invétérés ! Je l’ai convertie à la sitcom britannique hilarante ‘Absolutely Fabulous’. Une mamie branchée, croyez-moi ! D’une incroyable modernité. Parfois, on va au cinéma tous les deux. Je me souviens comme si c’était hier du jour où nous sommes allés ensemble au multiplex voir le film ‘Pourquoi pas moi’. Une comédie kitsch sur le coming out. […] Un nanar totalement oublié mais qui tient une place à part dans mon coeur tant il est lié à un moment crucial de ma vie. Mamie a adoré ! Évidemment, elle a tout compris, pas besoin de mettre des mots. Juste son regard, doux, malicieux et bienveillant, suffit à exprimer tout l’amour qu’elle me porte. Je sais qu’elle m’aime comme je suis. » (c.f. l’autobiographie Fils à papa(s) (2021) de Christophe Beaugrand, Éd. Broché, Paris, pp.36-39) ; etc.
L’homosexualité est bien un désir machiste peinturluré de rose, un rose souvent porté et défendu par les femmes, les mères, et les hommes faibles. « Ma mère m’a soupçonnée d’être lesbienne avant que je ne le sache moi-même. » (Lidwine, femme lesbienne de 50 ans, dans l’essai Se dire lesbienne (2010) de Natacha Chetcuti, p. 67) ; « Elle passait la soirée chez la voisine. Elle rentrait ivre avec la voisine, elles se faisaient des blagues lesbiennes ‘Je vais te bouffer la chatte ma salope’. » (Eddy Bellegueule à propos de sa mère, dans son autobiographie En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, p.66). Et ce désir machiste n’est pas réellement sexué, puisqu’il concerne aussi les femmes lesbiennes, niées dans leur féminité et masculinisées, quelque part : « Nous autres voulons dans notre folie faire de la femme un instrument de pensée logique, nous lui apprenons tout ce qui est possible. Je trouve cela catastrophique. Nous masculinisons les femmes de telle sorte qu’à la longue la différence sexuelle et la polarité disparaissent, que nous voulions tant les masculiniser qu’avec le temps la différence entre les sexes, la polarité disparaîtra. Dès lors, le chemin qui mène à l’homosexualité n’est pas loin. Nous masculinisons également trop notre jeunesse. Il est catastrophique qu’un jeune soit raillé au-delà de la normale parce qu’il est amoureux d’une fille, que pour cette raison on ne le prenne pas au sérieux, qu’on le prenne pour un faible. ‘Il n’y a que des amitiés de garçon. Ce sont les hommes qui décident sur terre’, lui dit-on. L’étape suivante, c’est l’homosexualité. J’estime qu’il y a une trop forte masculinisation dans l’ensemble du mouvement[nazi], et que cette masculinisation contient le germe de l’homosexualité. » (Himmler, cité dans l’essai Le Rose et le Brun (2015) de Philippe Simonnot, pp. 260-263) ; « Je suis arrivée au pensionnat à l’âge de 14 ans. J’étais très naïve. Et je me suis retrouvée très tôt face à ces problèmes. Et j’ai été choquée. Il ne se passait que ça autour de moi, et je ne voulais pas le voir. Et j’en étais choquée. Depuis la surveillante qui couchait avec la surintendante, jusqu’aux élèves qui partageaient ma chambre, il n’y avait que ça autour de moi. » (Germaine, femme lesbienne suisse, dans le documentaire « Les Homophiles » (1971) de Rudolph Menthonnex et Jean-Pierre Goretta) ; etc.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.