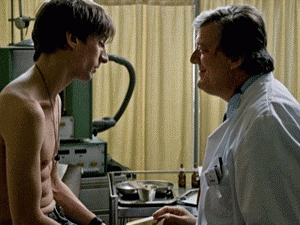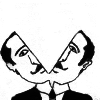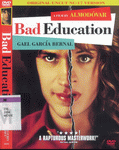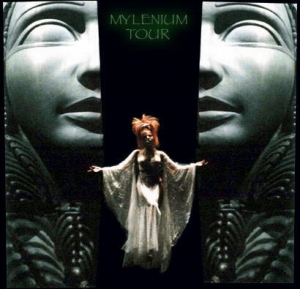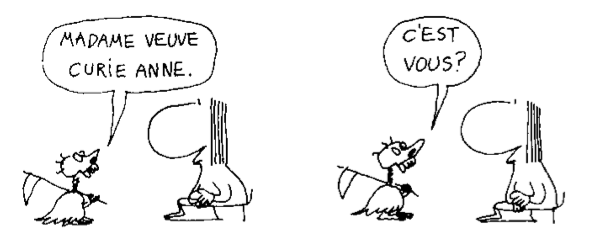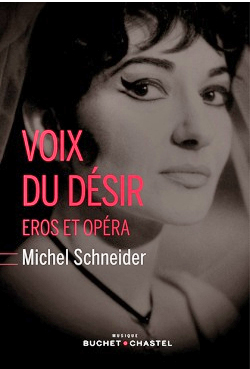Mort
NOTICE EXPLICATIVE :
Ça vous étonne que les mêmes qui réclamaient le « mariage pour tous » demandent maintenant l’« euthanasie pour tous » ?
La relation des personnes homosexuelles à la mort est très ambiguë : on pourrait la définir comme un envoûtement. Beaucoup d’entre elles font de la mort le sujet principal de leurs œuvres, et se définissent parfois comme des « morts-vivants fascinés par la mort » (cf. l’article « Andy Warhol » d’Élisabeth Lebovici, dans le Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes (2002) de Didier Éribon, p. 495). Le cimetière et le monde gothique sont des codes extrêmement présents dans la fantasmagorie homosexuelle, y compris chez des personnalités peu morbides qui ne passeront jamais à l’acte du suicide et qui ne vivront pas d’expériences sadomasochistes. Le rapport des personnes homosexuelles à la mort est souvent celui de la fascination identificatoire. Elles se persuadent qu’elles sont ses jumelles, parce qu’en règle générale, elles amalgament la mort réelle et la mort cinématographique larmoyante ou froide. « Il me semble que les cheveux qui collent aux tempes sont les miens, que les yeux clos comme ceux qu’on voit dans les photographies des cadavres sont les miens. » (Lucas, le narrateur homosexuel du roman Son Frère (2001) de Philippe Besson, p. 63) Par leur traitement de l’androgynie, elles célèbrent la mort dans sa forme la plus parfaite. La Faucheuse serait l’épouse idéale et « pure » (idem, pp. 46-47), le reflet narcissique qu’elles pourraient rejoindre pour gagner l’éternité et s’auto-contempler. Leur identification à la veuve drapée de sa mantille noire, portant des lunettes de soleil pour cacher sa fausse/digne peine, est relativement fréquente. Dans leurs créations, les personnages se voient très souvent morts et imaginent leur propre enterrement.
En réalité, l’adhésion des personnes homosexuelles à la mort est bien plus esthétique que réelle. Comme le commun des mortels, elles n’aiment ni la mort ni la souffrance réelles, mais leur idée romancée, leurs mises en scène. On peut penser notamment au narcissisme dans la souffrance qu’elles trouvent en la figure de saint Sébastien, le « saint patron de la communauté homosexuelle ». Leur désir de mort réside davantage dans la jouissance de l’anticipation/réécriture de la mort réelle que dans la mort en elle-même. De même, le plaisir du sadomasochisme se situe plus dans la transgression d’un interdit et dans la scénarisation de la douleur que dans la souffrance en soi. Une fois la douleur actualisée, il perd toute sa magie et sa force.
Le problème est que beaucoup de personnes homosexuelles confondent la mort avec ses représentations… et (se) laissent croire qu’elles désirent profondément mourir quand elles vivent des dépressions. « Les auteurs que j’aime sont tous suicidaires » confie Werner Schrœter à Michel Foucault (cf. « Conversation avec Werner Schœter », dans l’essai Dits et Écrits II (2001) de Michel Foucault, p. 1073). Klaus Mann, quant à lui, nous rappelle dans son Journal (1937-1949) la nature du désir homosexuel, nature liée bien sûr à la vie mais prioritairement à la mort : « Tous les gens vers lesquels je me sens attiré, et qui se sentent attirés vers moi, voudraient mourir. » (p. 49) Certaines réclament même le « droit au suicide » en partant du principe que, puisqu’on ne leur a pas demandé leur avis pour naître, elles n’ont pas à le demander aux autres pour mourir. « Je suis partisan d’un véritable combat culturel pour réapprendre aux gens qu’il n’y a pas une conduite qui ne soit plus belle que le suicide. » (Werner Schœter, « Conversation avec Werner Schœter », dans l’essai Dits et Écrits II (2001) de Michel Foucault, p. 1076) Malheureusement, ce ne sont pas toujours seulement des mots. Bon nombre de personnes homosexuelles pensent au suicide ou bien passent à l’acte. La liste des célébrités homosexuelles ayant mis fin à leurs jours est interminable : prenez n’importe quel nom des dictionnaires les répertoriant, et vous le constaterez très rapidement. Des études nord-américaines indiquent que le taux de suicide chez les jeunes adultes homosexuels actuels serait de 6 à 14 fois plus important que chez « les hétéros » du même âge (Michel Dorais, Mort ou fif (2001), p. 18). Je me demande dans quelle mesure leur désir de laisser la mort sur le terrain du figé n’encourage pas finalement le passage du mythe à l’actualisation violente. Loin d’être une exorcisation, la mythification de la mort peut parfois servir de prétexte à la création inconsciente de réalités fantasmées. Certaines personnes homosexuelles se sont parfois attachées viscéralement à une mort imagée pour ne pas affronter (ce qu’elles imaginent être) la mort réelle. Du coup, elles cherchent parfois à se frotter aux deux. C’est le cas de l’écrivain Yukio Mishima, qui à force de vouloir fuir la mort, l’a rejointe dans le mythe actualisé en se suicidant selon la tradition samouraï : « Je me complaisais à imaginer des situations dans lesquelles j’étais moi-même tué sur le champ de bataille ou assassiné. Pourtant, j’avais de la mort une peur anormale. » (Yukio Mishima, Confession d’un masque (1971), p. 30)
N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Mort = Épouse », « Fantasmagorie de l’épouvante », « Emma Bovary « J’ai un amant ! » », « Clown blanc et Masques », « Frankenstein », « Morts-vivants », « Passion pour les catastrophes », « Sommeil », « Animaux empaillés », « Cercueil en cristal », « Matricide », « Parricide la bonne soupe », « Viol », « Milieu homosexuel infernal », et à la partie « Momie » du code « Homme invisible », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.
FICTION
a) L’attraction pour la mort :
La mort occupe une grande place dans la vie des personnages homosexuels de fiction, comme on peut le voir dans le roman Accointances, connaissances, et mouvances (2010) de Denis-Martin Chabot, la chanson « Pont de Verdun » de Jann Halexander, la performance Golgotha (2009) de Steven Cohen (avec l’obsession pour les crânes de squelettes humains), le film « Unfinished : Exploring The Transgender Self » (2013) de Siufung (avec les tatouages de deux têtes de mort à la place des seins), le film « I Dreamt Under The Water » (« J’ai rêvé sous l’eau », 2008) d’Hormoz (centré sur un homme mort), les romans Son Frère (2001), Un Garçon d’Italie (2003), Un Instant d’abandon (2005) (reprenant l’affaire insoluble de la mort du petit Grégory) de Philippe Besson, le film « Society » (2007) de Vincent Moloi (dans lequel quatre anciennes amies d’école sont réunies autour d’une cinquième qui est décédée), la pièce Frères du bled (2010) de Christophe Botti (qui se déroule le jour de la Toussaint), la pièce La Mort vous remercie d’avoir choisi sa compagnie (2010) de Philippe Cassand, le film « A Festa Da Menina Morta » (2008) de Matheus Nachtergaele, la pièce Journal d’une autre (2008) de Lydia Tchoukovskaïa (où Ana écrit le poème « Requiem »), le film « Les Autres » (2001) d’Alejandro Amenábar, le roman Orlando (1928) de Virginia Woolf, le roman N’oubliez pas de vivre (2004) de Thibaut de Saint Pol, le film « Funeral Parade Of Roses » (1969) de Toshio Matsumoto, le film « Le Mystère Silkwood » (1983) de Mike Nichols, le film « The Lawless Heart » (2002) de Neil Hunter et Tom Hunsinger, le film « La Petite Mort » (1995) de François Ozon, le film « New Wave » (2008) de Gaël Morel (avec Romain, l’amant mort), le film « Après lui » (2006) de Gaël Morel, le film « Funérailles » (2008) de Subarna Thapa, le film « La Déchirure » (2007) de Mikaël Buch (avec la veillée mortuaire), la chanson « Plutôt mourir » de David Courtin, etc.
Le thème de la mort est omniprésent dans les films de Pedro Almodóvar (cf. l’univers de l’hôpital dans « Todo Sobre Mi Madre », « Tout sur ma mère » (1998), le coma dans « Hable Con Ella », « Parle avec elle » (2001), la criminologie dans « Matador » (1986), etc.), dans les romans d’Anne Garréta (Ciel liquides (1990), La Décomposition (1999), etc.), dans les pièces de Jean Genet (Les Nègres en 1958, Pompes funèbres en 1947, etc.).
Par exemple, dans le film « Respire » (2014) de Mélanie Laurent, Sarah, l’une des héroïnes lesbiennes, fait le constat cynique que l’existence humaine est « glauque » : « C’est le monde. » dit-elle laconiquement à Victoire. Dans le film « Test : San Francisco 1985 » (2013) de Chris Mason Johnson, Todd, l’un des héros homosexuels, n’a qu’une ambition dans la vie : « Mourir jeune et joli. » Dans la pièce Les Faux British (2015) d’Henry Lewis, Jonathan Sayer et Henry Shields, Thomas, le héros homosexuel, est fasciné par la mort. Le crime lui permet d’être esthétique et théâtral : « Grand Dieu !! » ; « Doux Jésus !! » ; « Quelle situation abominable !! » ; « Quelqu’un a fermé la porte. Mon Dieu ! Nous sommes piégés !!! » ; etc. Et son compagnon secret, Charles, est décrit comme un suicidaire. Dans la pièce Le Cheval bleu se promène sur l’horizon, deux fois (2015) de Philippe Cassand, Herbert, l’un des héros homosexuels, a une tête de mort tatouée dans le cou.
Dans le film « Que Viva Eisenstein ! » (2015) de Peter Greenaway, Sergueï Eisenstein, homosexuel, veut aller voir le Musée des morts de Guanajuato (Mexique). Palomino, son amant et guide mexicain, joue à fond la carte du mysticisme mortuaire pseudo national : « Demander une rançon même pour un mort est une pratique courue au Mexique. ». Ils visitent ensemble des cimetières mexicains. Eisenstein finit par se prendre pour les morts : « C’est le Jour des Morts… et je suis un homme mort. »
Très souvent, le héros homosexuel est placé sous le signe de la mort : « Qu’elle était étrange, chez Fernand, cette curiosité soudaine pour les choses finies ! » (François Mauriac, Génitrix (1928), p. 93) ; « Curieusement, je n’ai jamais vu de magazine intitulé Death. Il pourrait y avoir au moins une rubrique sur le sujet. Un article du style : ‘Les cercueils faits maison : une alternative bon marché’, dans une de ces revues pour ménagères. » (Ronit, l’héroïne lesbienne du roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, pp. 43-44) ; « C’est vrai que tu es née le jour de la fête des morts ? » (Chloé à son amante Cécile, dans le roman À ta place (2006) de Karine Reysset, p. 28) ; « Jason venait de faire son apparition. Il se tenait debout sur le rocher au-dessus d’eux, les mains sur les hanches, la jambe gauche s’avançant légèrement dans le vide. Il était doré comme un croissant. Ses boucles blondes flottaient dans la brise légère. Corinne, assise à ses pieds, l’observait, incrédule. Avec son maillot de bain qui représentait des têtes de mort sur fond noir, il ressemblait vraiment à un messager des dieux de l’enfer. ‘Encore une beauté d’archange, songeait-elle.’ » (Corinne décrivant Jason, le personnage homosexuel du roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 83) ; « Oh ! Lumineuse après-midi, 1er novembre. » (cf. la chanson « 1er novembre (Le Fruit) » du Beau Claude) ; « Tu ne peux pas t’empêcher d’être attiré par les histoires morbides. » (Vincent s’adressant à son ex-amant Stéphane, dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson) ; « Quand on meurt, j’aimerais savoir ce qu’on ressent. On croit qu’on s’endort ? » (Jacques s’adressant à Enoch, dans le film « Friendly Persuasion », « La Loi du Seigneur » (1956) de William Wyler) ; « Je ne lis pas tellement les [auteurs] vivants. » (Arthur s’adressant à son amant Jacques, dans le film « Plaire, aimer et courir vite » (2018) de Christophe Honoré) ; etc.

Film « Avant que j’oublie » (2007) de Jacques Nolot
Il arrive que le personnage homosexuel remplace un grand frère ou une grande soeur, bref, un enfant mort… et pour le coup, se croit être un faux vivant. Par exemple, dans le one-man-show Jefferey Jordan s’affole (2015) de Jefferey Jordan, le héros homosexuel est confondu par sa grand-mère Mamie Suzanne avec son grand-père, et d’abord pour un de ses frères morts : « Sur les trois frères, c’est pas toi qui es mort en 95 ? »
Le héros homosexuel exerce parfois le métier de croque-mort (ou fait comme si) : cf. les séries télévisées Six Feet Under et La Famille Addams, le film « Les Croque-morts en folie ! » (1982) de Ron Howard, le film « Cher disparu » (1965) de Tony Richardson (dans l’univers des pompes funèbres), etc. « Je sens la mort : je suis croque-mort. » (Elliot dans la comédie musicale La Nuit d’Elliot Fall (2010) de Vincent Daenen) ; « Fossoyeur, c’est un métier où on ne chôme pas ! » (Knocherl dans le film « Scènes de chasse en Bavière » (1969) de Peter Fleischmann) ; etc. Par exemple, dans le film « Les Yeux ouverts » (2000) d’Olivier Py, quand Olivier demande à Vincent pourquoi il prétend être « l’homme le plus triste du monde », ce dernier lui répond pour lui clouer le bec : « Je travaille aux pompes funèbres, j’aime baiser avec les monstres, et je suis impuissant. Ça te va ? » Dans la pièce La Belle et la Bière (2010) d’Emmanuel Pallas, Léo, le héros homosexuel est croque-mort, et travaille aux pompes funèbres « Aux Joyeux Défunts ». Il dit lui-même qu’il est obnubilé par la mort, et sa mère se désole qu’il soit « toujours abonné à ses morbideries ». Il possède chez lui toute la panoplie des objets dédiés à la mort : des squelettes, des mugs en forme de crâne, un ordi Apple avec une tête de mort à la place de la pomme, « plein de photos de crânes et de cercueils ».
La mort est bien un objet de désir chez le héros puisqu’il l’associe très souvent à son homosexualité : « Luca est condamné à mort à cause de son homosexualité. » (cf. la bande-annonce du spectacle musical Luca, l’évangile d’un homo (2013) d’Alexandre Vallès). Il la vénère comme un dieu : « Where are you, God of the Death ? » (Didier Bénureau dans son spectacle musical Bénureau en best-of avec des cochons, 2012) ; « Les seuls trucs qui t’excitent, ce sont tes crânes et tes cercueils. » (Garance s’adressant à Léo le héros homo, dans la pièce La Belle et la Bière (2010) d’Emmanuel Pallas) ; etc. Dans le film « Certains l’aiment chaud » (1959) de Billy Wilder, Jerry et Joe, travestis en femmes, racontent qu’ils ont joué dans des orchestres pour les funérailles (« Nous jouions dans les enterrements. ») ce qui laisse leur chef Sweet Sue perplexe : « Ça ne vous ferait rien de rejoindre les vivants ? »
b) Le goût homosexuel pour les cimetières :

Film « Volver » de Pedro Almodovar
En outre, le personnage homosexuel affectionne les cimetières, comme c’est le cas dans le roman Le Garçon sur la colline (1980) de Claude Brami, le film « Ma vraie vie à Rouen » (2002) d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau, le film « Volver » (2006) de Pedro Almodóvar, le vidéo-clip de la chanson « Thriller » de Michael Jackson, le film « My Own Private Idaho » (1991) de Gus Van Sant, le film « Torch Song Trilogy » (1989) de Paul Bogart, le roman Ciel liquides (1990) d’Anne F. Garréta, le film « Contact » (2002) de Kieran Galvin, le vidéo-clip de la chanson « Parler tout bas » d’Alizée, le conte Lisa-Loup et le Conteur (2003) de Mylène Farmer, le film « Le Quatrième Homme » (1983) de Paul Verhoeven, le film « Cachorro » (2003) de Miguel Albaladejo, le film « La Comtesse aux pieds nus » (1954) de Joseph Mankiewicz, le film « Alexandrie, pourquoi ? » (1978) de Youssef Chahine, le film « Les Chansons d’amour » (2007) de Christophe Honoré, la pièce Cosmétique de l’ennemi (2008) d’Amélie Nothomb, la pièce Les Fugueuses (2007) de Pierre Palmade et Christophe Duthuron, le film « Cloudburst » (2011) de Thom Fitzgerald (avec la scène du fou rire du couple lesbien dans le cimetière), le film « Après lui » (2006) de Gaël Morel, le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta, etc.
Beaucoup d’histoire d’amour homosexuel ont lieu dans un cimetière, comme si ce dernier était l’endroit romantique par excellence : cf. le roman Dream Boy (1995) de Jim Grimsley, le vidéo-clip de la chanson « Regrets » (tourné en février 1991 dans un cimetière juif de Budapest) et de la chanson « Plus grandir » de Mylène Farmer, le film « Odete » (2005) de João Pedro Rodrigues, le film « La Bête immonde » (2010) de Jann Halexander (tourné au Cimetière du Nord à Maggelburg), le film « Hedwig And The Angry Inch » (2001) de John Cameron Mitchell, le film « Borstal Boy » (2000) de Peter Sheridan, le film « The Return Of Post Apocalyptic Cowgirls » (2010) de Maria Beatty (où quatre jeunes femmes lesbiennes s’aiment dans un cimetière d’avions en Arizona, au cœur d’un monde à l’abandon), le film « Le Fil » (2010) de Mehdi Ben Attia (avec les deux amants Malik et Bilal dans un cimetière), le film « Morrer Como Um Homen » (« Mourir comme un homme », 2009) de João Pedro Rodrigues (avec Rosário et le travesti M to F Tonia dans le cimetière décoré de bougies), le roman Le Cimetière de Saint Eugène (2010) de Nadia Galy (avec les amants Slim et Mocka dans le cimetière), le film « Donne-moi la main » (2009) de Pascal-Alex Vincent, le film « La Vie privée de Sherlock Holmes » (1970) de Billy Wilder (avec les quatre nains dans le cimetière, lieu considéré comme un cadre idéal pour un pique-nique), la pièce Golgota Picnic (2011) de Rodrigo García (où des ébats masculins s’opèrent), le film « Le Refuge » (2010) de François Ozon, le film « Les Passagers » (1999) de Jean-Claude Guiguet, la pièce Perthus (2009) de Jean-Marie Besset (Paul et Jean-Louis, les deux amants, se rencontrent dans un cimetière), etc.
D’ailleurs, le héros homosexuel dit parfois son attachement pour les cimetières : « On ne se sent jamais plus vivant que dans un cimetière. » (Elliot, le héros de la comédie musicale La Nuit d’Elliot Fall (2010) de Vincent Daenen) ; « Que c’est joli, un cimetière ! » (le Baron Lovejoy, homosexuel, idem) ; « Dès l’âge de 14 ans, je vivais aux côtés de mes amis du cimetière. » (le héros homosexuel de la pièce Chroniques des temps de Sida (2009) de Bruno Dairou) ; « Dans mon cimetière, je me suis habitué à percevoir les rumeurs du monde, les soubresauts des humains. » (Luca dans le roman Un Garçon d’Italie (2003) de Philippe Besson, p. 166) ; « Il dit que c’est l’histoire d’un pays, d’un siècle qui se raconte dans les cimetières de France. » (Lucas citant son frère Thomas, dans le roman Son Frère (2001) de Philippe Besson, p. 60) ; « Sur vos tombes, j’irai cracher. Chacun, je les souillerai de mes déjections de pédé. » (Luca dans le spectacle musical Luca, l’évangile d’un homo (2013) d’Alexandre Vallès) ; « Ton absence, c’est comme si je me trouvais en silence dans un cimetière un matin d’hiver. » (Stéphane s’adressant à son ex-compagnon Vincent, dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson) ; « Il paraissait étrange à Jane d’avoir un jour pu trouver le cimetière de Saint-Sébastien charmant. » (Jane, l’héroïne lesbienne du roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 198) ; « Anna vient ici de temps en temps. Elle habite dans l’appartement d’en face depuis toujours. Le cimetière était son terrain de jeu. » (le Père Walter parlant d’Anna, idem, p. 204) ; etc.
Dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, Bryan et Kévin se rencontrent pour la première fois au cimetière, face à la tombe de Julien, l’homosexuel du lycée qui s’est suicidé : « Nous étions là, figés devant ce cercueil que nous regardions en silence. » (Bryan, p. 50) ; « Au cimetière, nous étions épaule contre épaule. Aujourd’hui, bras dessus, bras dessous. J’étais aux anges ! » (idem, p. 16) ; « En réalité, je déprimais complètement. On mit cela sur le compte de la mort de Julien. C’était en partie vrai, mais la vraie raison de ma déprime venait du fait que je pensais à celui qui n’était pas là, comme d’hab, et qui pleurait avec moi tout à l’heure, quand nos épaules s’étaient touchées. Les filles et ma mère avaient raison, je n’étais pas là, j’étais encore au cimetière. Pas avec Julien, j’y étais avec mon amoureux. » (idem, p. 52) ; « Kévin se faisait draguer aux mariages, moi je repérais les beaux mecs dans les cimetières. On faisait une sacrée paire ! » (idem, p. 409) ; etc.
Dans le film « Contracorriente » (2011) de Javier Fuentes-León, le cimetière occupe une place importante dans la formation du couple Miguel-Santiago : par exemple, les amants se donnent rendez-vous là-bas pour vivre leur amour secret (« Bonne nouvelle. Viens au cimetière à 16h. » écrit Miguel dans un de ses mots doux) ; et Santiago prend des photos de Miguel pendant que ce dernier célèbre les funérailles de son cousin Carlos (et il avoue l’avoir trouvé « très sexy » à ce moment-là : « Tu ressemblais à un vrai leader ! »)
Le cimetière apparaît comme une sorte de Jardin d’Éden inversé, de terre d’élection d’amants maudits : « Mon parc est semé de gens morts ! » (Copi, La Journée d’une rêveuse, 1968) Il se veut un retour à l’innocence de l’enfance. Par exemple, dans le film « Boys Like Us » (2014) de Patric Chiha, toute la bande de potes homos va se balader au Père Lachaise ; et Jean-Luc, le cousin homo, retourne avec les enfants au cimetière pour les y statufier par mimes « esthétisants ». Dans le film « Plaire, aimer et courir vite » (2018) de Christophe Honoré, Arthur va se recueillir devant la tombe du romancier Bernard-Marie Koltès au cimetière du Père Lachaise. Dans le film « Miss » (2020) de Ruben Alves, Alex (le héros transgenre M to F qui candidate pour être Miss France) est orphelin et a perdu ses deux parents biologiques dans un accident de voiture. On le voit à la fin déposer des fleurs dans le cimetière.
c) Certains personnages homosexuels s’imaginent leur propre enterrement :

Vidéo-clip de la chanson « Fuck Them All » de Mylène Farmer
Le héros homosexuel a tendance à se mettre dans la peau des absents ou des morts, bref, à prêter à la réalité la forme de ses fantasmes de mort et de ses sentiments égocentrés : cf. le roman Les Absents (1995) d’Hugo Marsan ; etc. « J’ai un curieux défaut. Celui de souvent penser à ceux qui ne sont pas là, à l’instant. » (Bryan dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 44) ; « Encore une fois, penser à ceux qui ne sont pas là ! Toujours ce décalage, pourquoi ? Je me suis souvent posé cette question. Une seule réponse plausible : je me suis inquiéter pour ceux qui sont présents. Ça ne les rend pas invulnérables pour autant, mais c’est comme ça. Je n’ai peur que pour les absents ! Comment les protéger, les secourir ? » (idem, p. 242) ; « Toute cette mise en scène hospitalière a quelque chose de carcéral, de concentrationnaire, et lorsque j’ai le malheur de m’entrevoir dans une glace, je frémis d’horreur en reconnaissant mes frères et sœurs juifs partis en fumée. Six millions de fantômes veillent à mon chevet, attendant que je les rejoigne. » (Émilie à son amante Gabrielle, dans le roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami, pp. 183-184) ; « C’est troublant de penser qu’à un endroit – un même endroit – ont déambulé des gens qui ne sont plus. […] Désormais, des personnes que je ne connais pas vont habiter ce lieu, s’asseoir sur un nouveau siège de piano, s’allonger sur la même pelouse gelée en automne, dormir dans les mêmes chambres. C’est tout un sanctuaire qui s’échappe. Il ne me reste que quelques objets – et puis des souvenirs. » (Chris, le héros homosexuel du roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 55) ; etc.

Film « Odete » de João Pedro Rodrigues
L’esprit homo-bobo se plaît à se projeter précipitamment dans la mort, et à jouer la Vieille Maréchale de Strauss qui écrit ses mémoires (alors qu’il est pourtant en pleine force de l’âge !), juste pour le plaisir de s’imaginer mourant et de se faire plaindre, juste pour s’inventer un héroïsme esthétique qui le consolera de son inavouable ennui existentiel : « Tu dis : je suis l’homme sans ascendance, ni fraternité, ni descendance. Je suis cette chose posée au milieu du monde mais non reliée au monde. Je suis celui qui ne sait pas d’où il vient, qui n’a personne avec qui partager son histoire et qui ne laissera pas de traces. Ainsi, quand je serai mort, c’est davantage que le nom que je porte qui disparaîtra, c’est mon existence même qui sera niée, jetée aux oubliettes. » (la figure de Marcel Proust à son jeune amant Vincent, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 101) ; « Je veux mourir mince, ne pas me nourrir avant de mourir. Je veux rester jeune. […] J’veux mourir blond, avec une tête de p’tit garçon. […] Des lunettes noires pour faire la star. […] À moins que je finisse dans un musée et que je me fasse empailler. » (Didier Bénureau dans son spectacle musical Bénureau en best-of avec des cochons, 2012) ; etc.
Le rapport à la mort du personnage homosexuel est souvent de fascination identificatoire. « Ce visage avait été si beau. […] je pouvais lire la mort dans son regard passé du brun noisette au noir profond. » (Jean-Marc en évoquant Luc, son « ex » malade du Sida, dans le roman Le Cœur éclaté (1989) de Michel Tremblay, p. 37) ; « Rencontre/Maladie/Mort/Deuil. Les larmes m’envahissent, les couleurs se brouillent devant mes yeux, je gémis et me tords de douleur, je pleure comme un enfant de cinq ans. Je ne peux plus m’arrêter, je pleure toutes les larmes que j’ai gardées en moi depuis plusieurs semaines ou mois ou années, et entre deux respirations, je geins lamentablement. » (Mike, le narrateur homosexuel face aux photos de Nan Goldin, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 90) ; « Quand quelqu’un se noyait à Fortaleza, je pensais que ça aurait pu être moi… » (Donato, le héros homosexuel, secouriste en mer, dans le film « Praia Do Futuro » (2014) de Karim Aïnouz) ; etc. Par exemple, dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta, Daniel dit qu’il cherche derrière chaque visage le reflet de la mort.
Dans le roman Son Frère (2001) de Philippe Besson, Lucas, le personnage homosexuel, reconnaît la mort comme son propre reflet spéculaire. « Il me semble que ce corps qu’on repose à intervalles réguliers à des étudiants en médecine indifférents est le mien. » (p. 63) ; « J’ai cette image saugrenue dont je ne parviens pas à me débarrasser, celle du président Kennedy, à Dallas, le 22 novembre 1963, à l’arrière de sa Lincoln décapotable. […] Je vois l’affolement et je songe que c’est cela qu’il pourrait nous être donné de connaître. J’ai beau me dire que c’est absurde, malsain sans doute, je n’arrive pas à m’éloigner de cette vision. » (idem, p. 56) Son désespoir résigné face à la mort serait « vrai » parce qu’intégral. Il n’a pas digéré le part d’inéluctabilité de la mort, alors qu’il pense pourtant en avoir pris conscience de manière absolue, visionnaire, minoritaire, … homosexuelle ! « Il n’y aura pas d’autre issue que la mort. […] Ils auront beau affirmer que les chances de survivre l’emportent sur celles de succomber, ils auront beau avoir, au moins au début, la raison et les probabilités de leur côté, ils n’empêcheront pas la mort de se produire. Nous savons qu’ils ne savent pas, nous avons cette intuition fabuleuse, un désespoir intégral, très pur. C’est impossible, sans doute, à expliquer. Nous ne parviendrons pas à leur faire admettre notre certitude. Ils s’essaieront, mais sans y parvenir, à nous raisonner. » (Lucas en parlant des médecins, idem, pp. 46-47)
Cette fixation identitaire homosexuelle sur la mort a tout l’air d’être le fruit d’une relation incestueuse maternelle. Par exemple, dans le film « Le Naufragé » (2012) de Pierre Folliot, la mère d’Adrien, le héros homosexuel qui s’est suicidé, voit par une hallucination son fils mort dans sa baignoire. Dans le film « Après lui » (2006) de Gaël Morel, Camille, une mère un peu folle qui a du mal à accepter la mort de son fils Matthieu, transpose complètement la vie de son fils (certainement homo) sur celle de son meilleur ami et meurtrier Franck.
C’est le fait de ne pas avoir été suffisamment désiré et aimé qui fait que le personnage homosexuel ou transsexuel s’identifie à la mort. « Je regrette de l’avoir fait. » (le père d’Adineh l’héroïne transsexuelle F to M, femme qui a perdu sa mère à 5 ans, dans le film « Facing Mirrors : Aynehaye Rooberoo », « Une Femme iranienne » (2014) de Negar Azarbayjani)
Quelquefois, dans les fictions abordant la thématique de l’homosexualité, la mort est présentée comme une jumelle/un jumeau : « Alexis Guérande est mort. Alexis Guérande est mort, ce matin, à côté de moi. Il est mort, frappé à la tête par une balle de hasard, dans un moment de répit, dans un moment où les combats avaient cessé et où notre attention s’était relâchée. Juste une balle qui s’est logée dans sa tempe gauche, rien d’autre, quelque chose de très net, comme un éclat de diamant pur qui forme tout à coup un trou rouge au bout de ses sourcils. La mort a été instantanée. » (Arthur parlant d’un compagnon de tranchée, un poète breton de 20 ans, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 175) ; « Avant la fin de la semaine, je me serai débarrassé de mon frère… Je pense que je vais sans doute le tuer à Paris. » (Jack en parlant de son double mythique Constant, lors du dénouement de la pièce The Importance To Being Earnest, L’importance d’être Constant (1895) d’Oscar Wilde) ; etc. Par exemple, dans le film « Le Refuge » (2010) de François Ozon, Paul, le héros homosexuel, est le double de Louis, son frère mort.
Comble du narcissisme : il arrive souvent que le héros homosexuel s’imagine son propre enterrement, pour pleurer et s’émouvoir sur lui-même : cf. le one-man-show Raphaël Beaumont vous invite à ses funérailles (2011) de Raphaël Beaumont, la pièce Jeffrey (1993) de Paul Rudnick, le film « Puta De Oros » (1999) de Miguel Crespi Traveria (dans lequel un homme allongé dans un tombeau, veillé par des pleureuses, ouvre soudain les yeux), le film « My Own Private Idaho » (1991) de Gus Van Sant (avec la scène du double enterrement), le vidéo-clip de la chanson « Dégénération » de Mylène Farmer, la chanson « Camomille » de Stefan Corbin (dans laquelle le narrateur se raconte comme un homme pleurant sous son parapluie un jour d’enterrement), la pièce Quartett (1980) d’Heiner Müller (mise en scène en 2015 par Mathieu Garling), etc. Par exemple, Dans le film « Seul le feu » (2013) de Christophe Pellet, Thomas, le héros homosexuel, en visitant le Père Lachaise, exprime le souhait de se faire incinéré. Dans le film « Mezzanotte » (2014) de Sebastiano Riso, on assiste, lors de l’enterrement de Rettore, l’un des héros homos, à deux enterrements dessinés par deux groupes opposés, celui des potes homos junkies comme lui, celui de la famille bourgeoise endeuillée.
« Il dit qu’il veut des fleurs, des couronnes, ce décorum un peu vulgaire, un deuil éclatant, celui qu’on montre, qu’on expose. […] Il dit qu’il faudra des larmes, des évanouissements peut-être, des manifestations spectaculaires, que la souffrance s’exprime plutôt que d’être comprimée, contenue. » (Lucas parlant de son frère Thomas, dans le roman Son Frère (2001) de Philippe Besson, p. 61) ; « Il y aura un monde fou à mon enterrement ! Je vais téléphoner aux agences de presse. » (« L. » dans la pièce Le Frigo (1983) de Copi) ; « Beaucoup de monde était présent le jour de mon enterrement. » (Bryan, en cadavre parlant, dans le roman Si tu avais été…(2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 452) ; « Je fais le mort si je veux. Je ressuscite si je veux ! » (la productrice dans la pièce Psy Cause(s) (2011) de Josiane Pinson) ; « C’est à croire que je suis au tombeau. » (Rosa dans le spectacle musical Rosa La Rouge (2010) de Marcial Di Fonzo Bo et Claire Diterzi) ; « Même ma mort, même la mise en scène de ma mort, j’ai dû la faire toute seule. » (Evita dans la pièce Eva Perón (1969) de Copi) ; « Je creusais une tombe, dans les rêves cela arrive. Mais c’était la réalité. » (Bjorn dans le roman Riches, cruels et fardés (2002) d’Hervé Claude, p. 155) ; « Dans mon lit, là, de granit, je décompose ma vie. » (cf. la chanson « Paradis inanimé » de Mylène Farmer) ; « Les enterrements, c’est pas mal. » (Justin dans le film « Joyeuses Funérailles » (2007) de Franz Oz) ; « C’est beau de sublimer, mais je commence à être pas mal vieux pour rêver que Jean Besré se meurt d’amour pour moi ou que Guy Provost m’enterre sous des tonnes de fleurs coupées parmi les plus rares et les plus odorantes. Ce petit théâtre ne suffit pas à remplir ma vie ni à combler mon besoin d’amour. » (le narrateur parlant de l’opéra La Bohème de Puccini dans le roman La Nuit des princes charmants (1995) de Michel Tremblay, p. 19) ; « C’est ça que je veux pour ma mort : qu’on promène mon corps sur un brancard, à la lueur des bougies. » (Jérémie, homo et malade du Sida, exprimant ces dernières volontés, dans le film « 120 battements par minute » (2017) de Robin Campillo) ; etc.
Dans la comédie musicale La Nuit d’Elliot Fall (2010) de Vincent Daenen, Elliot voit son nom inscrit sur sa propre tombe, au moment où il se ballade dans un cimetière. Dans le film « La Robe du soir » (2010) de Myriam Aziza, Juliette, l’héroïne lesbienne, se voit morte dans sa tombe. Dans le roman Pavillon noir (2007) de Thibaut de Saint Pol, Cyril veut « passer sa vie à inventer sa mort » (p. 106). Dans la chanson « La Chanson de Jérémy » de Bruno Bisaro, Jérémy voit son propre enterrement. Dans le clip de la chanson « Plus grandir » de Mylène Farmer, Mylène pousse un landau dans un cimetière et s’arrête devant une stèle gravée à son nom. Dans le film « Juste une question d’amour » (2000) de Christian Faure, Laurent s’identifie à son cousin Marc qui était gay, comme lui, et qui est mort. Dans la pièce Dépression très nerveuse (2008) d’Augustin d’Ollone, Louis s’imagine et prépare son enterrement : « Depuis que je suis né, [j’ai] plutôt l’impression de préparer ma mort. »
d) « Je suis mort » :

Film « Nés en 68 » d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau
Dans le même ordre d’idée, certains personnages homosexuels disent de leur vivant qu’ils sont morts : « On s’accroche et on fait c’qu’on peut pour pas être mort un jour sur deux. » (le héros du film « À mon frère » (2010) d’Olivier Ciappa) ; « J’ai rêvé que j’étais mort ! » (l’amant du narrateur de la nouvelle « Un Jeune homme timide » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 45) ; « Laissez-moi m’allonger et fermer les yeux pour toujours. » (Rinn, l’héroïne lesbienne de la pièce Gothic Lolitas (2014) de Delphine Thelliez) ; « Je suis morte. Je suis bien. » (Anne Cadilhac se décrivant dans son cercueil, bouffée par les vers, lors de son concert Tirez sur la pianiste, 2011) ; « Ça fait longtemps que je suis mort ? Peut-être trop longtemps. » (Jack, en cadavre parlant, dans la pièce La Dernière Danse (2011) d’Olivier Schmidt) ; « Je suis déjà mort, il ne reste plus qu’à me décider, qu’à officialiser. » (Bryan à son amant Kévin, dans le roman Si tu avais été…(2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 313) ; « Je voudrais être morte, comme ma mère ! » (Ronit, l’héroïne lesbienne du roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, p. 266) ; « Il est mort. Il est mort et moi, je ne suis déjà plus vivant. » (Vincent en parlant de son amant Arthur, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 185) ; « Je suis mort. » (le professeur Foufoune dans la pièce Bill (2011) de Balthazar Barbaut) ; « Mais je suis si peu mort ! Je suis à peine mort ! » (le Vrai Facteur dans la pièce La Journée d’une Rêveuse (1968) de Copi) ; « Je suis morte. » (la figure d’Evita dans la pièceEva Perón (1969) de Copi) ; « Je suis en train de crever ! Je meurs ! Je meurs ! » (Rogelio dans la pièce L’Ombre de Venceslao (1978) de Copi) ; « Mon Dieu, je suis morte ! » (China, idem) ; « Je suis frappé par plusieurs coïncidences : je m’imagine être mort hier à midi. Au moment où j’ai téléphoné à Marielle de la cabine publique j’étais déjà mort, en attendant le jugement dernier j’ai tué trois fois. » (le narrateur homosexuel du roman Le Bal des Folles (1977) de Copi, p. 126) ; « Dites-lui que je suis déjà mort ! » (Cyrille, le héros homosexuel parlant d’Hubert à l’Infirmière, dans la pièce Une Visite inopportune (1988) de Copi) ; « Je devais être mort ? » (idem) ; « Je suis mort. » (Arnaud dans la pièce Quand mon cœur bat, je veux que tu l’entendes… (2009) d’Alberto Lombardo) ; « Peut-être je suis mort moi aussi, je dis. » (le narrateur du roman Le Crabaudeur (2000) de Quentin Lamotta, p. 16) ; « Putain, je suis mort. » (un personnage du film « Toto qui vécut deux fois » (1998) de Daniele Cipri et Francesco Maresto) ; « Serais-je en enfer, se demanda-t-il. À bien y penser il était bien possible qu’il fût mort depuis plusieurs jours. » (le narrateur du roman La Vie est un tango (1979) de Copi, p. 174) ; « Ça fait vingt ans que je suis mort. » (Hervé dans le film « Nés en 68 » (2008) d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau) ; « Nous sommes morts. » (les héros homosexuels du film « Adam et Steve » (1995) de Craig Chester) ; « Moi j’suis déjà mort. » (Willie, le héros homosexuel malade du Sida, dans le roman La Meilleure part des hommes (2008) de Tristan Garcia, p. 186) ; « Le défunt, c’est moi. » (Louis dans la pièce Dépression très nerveuse (2008) d’Augustin d’Ollone) ; « Moi, je suis mort. » (Enrique dans le film « La Mala Educación », « La mauvaise éducation » (2003), de Pedro Almodóvar) ; « Fais comme si j’étais mort. » (cf. la chanson « Un Merveilleux Été » d’Étienne Daho) ; « J’suis déjà mort, moi, en fait. » (le héros de la pièce Happy Birthday Daddy (2007) de Christophe Averlan) ; « Thomas, tu n’es pas mort. Tu es juste une absence, comme un voyage. » (la mère de Thomas, le héros homosexuel, dans le film « Œdipe (N + 1) » (2001) d’Éric Rognard) ; « Quand on a cru mourir et qu’on vit, on est obéissant, docteur. » (Catherine dans le film « Suddenly Last Summer », « Soudain l’été dernier » (1960), de Joseph Mankiewicz) ; « Elle était comme morte, et moi comme si j’allais mourir. […] Nous nous étions endormies. » (la Religieuse dans le roman La Religieuse (1760) de Denis Diderot) ; « ‘Mort, pensa Fabien. Je suis mort. C’est moins difficile qu’on ne croit. Et il ne se passe rien…’ » (Fabien dans le roman Si j’étais vous (1947) de Julien Green, p. 314) ; « Décédée depuis longtemps de l’intérieur, desséchée de l’extérieur. » (la narratrice lesbienne du roman La Voyeuse interdite (1991) de Nina Bouraoui, p. 132) ; « Mes camarades morts sont moins morts que moi. » (Garnet Montrose dans le roman Je suis vivant dans ma tombe (1975) de James Purdy, p. 29) ; « Dis-leur que je suis mort. » (Roy Cohn dans la pièce Angels In America(1991) de Tony Kushner) ; « Il faut un mot nouveau pour décrire à quel point je suis mort. » (Danny, l’un des héros homos du film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza) ; « Je suis mort de chez mort. » (Chris après le baiser donné à son amant Danny, idem) ; « Je vous demande la mort comme un dû. » (Lacenaire dans la pièce éponyme (2014) de Franck Desmedt et Yvon Martin) ; « Je me tue à faire le mort. » (cf. la chanson « Fragile » de Christophe Willem) ; « Il faut être naturellement somnolent. On se met au lit. Et on fait le mort. » (Palomino, parlant du comportement homosexuel qu’il va imposer à son amant Sergueï Eisenstein, dans le film « Que Viva Eisenstein ! » (2015) de Peter Greenaway) ; etc.
Dans le film « Les Enfants terribles » (1949) de Jean-Pierre Melville, la mort est présentée comme irréelle, comme un rêve éveillé : on comprend qu’il s’agit davantage de la mort psychique du zombie sans désir que de la mort véritable ; Paul, souvent allongé, est un homme qui « fait le mort ». Dans la pièce Elvis n’est pas mort (2008) de Benoît Masocco, les personnages disent tous qu’ils sont morts : ils parlent comme les cadavres vivants d’un panthéon en déclin. Dans le film « Cléopâtre » (1963) de Joseph Mankiewicz, Marc-Antoine affirme qu’il est mort. Dans la pièce Nietzsche, Wagner, et autres cruautés (2008) de Gilles Tourman, Nietzsche parle de lui-même à la troisième personne du singulier en annonçant qu’il est mort. Dans la pièce Une Nuit au poste (2007) d’Éric Rouquette, Isabelle dit qu’elle meurt debout. Dans la performance Nous souviendrons-nous (2015) de Cédric Leproust, le narrateur adulte, qui vit pourtant hors de sa sphère de conscience, joue à être un fœtus qui n’est pas encore sorti du ventre de sa mère, et parle de lui à la troisième personne : « Je vais raconter la fin de sa vie et sa mort. »
Souvent dans les fictions homosexuelles, la mort est simulée : on peut penser par exemple à la pièce Les Oiseaux (2010) d’Alfredo Arias (avec la fausse mort du Coryphée, qui fait semblant de s’écrouler sur scène).
En plus d’être une réplique de cour de récré (prononcée pourtant par un adulte), ce « Je suis mort » est l’expression d’un désir de mourir tout en niant la mort, bref, l’expression d’une schizophrénie : littéralement, le héros homosexuel s’absente sur place : « Je suis mort. […] Je m’absente… un peu comme si je n’étais plus là. » (Éric dans le film « New Wave » (2008) de Gaël Morel)
Le coming out de sa propre mort est aussi plus concrètement l’énonciation de sa soumission amoureuse, du renoncement à sa liberté : « Je ne sais plus ce que je dis. Je suis malade, fatigué… Tu as gagné. Tu m’as conquis. » (le secrétaire de presse à Bulldog, son amant, dans le film « Bulldog In The Whitehouse », « Bulldog à la Maison Blanche » (2008), de Todd Verow) Dans la pièce Hétéropause (2007) d’Hervé Caffin et de Maria Ducceschi, par exemple, la voyante prédit à Hervé qu’au moment de se mettre en couple homosexuel, il vivra une « mort immatérielle » : une baisse du désir, en d’autres termes. Dans la pièce L’un dans l’autre (2015) de François Bondu et Thomas Angelvy, François, cherchant à découvrir quel est le personnage qui est marqué sur son post-it, demande à son amant Thomas : « Est-ce que je suis mort ? »
e) La mort prise pas assez au sérieux ET trop au sérieux :
Comme il se prend pour sa propre mort pour s’en protéger, le héros homosexuel a tendance à nier la réalité de la mort. « J’aime pas penser à la mort. » (Martin, le héros sur qui pèse une forte présomption d’homosexualité, dans la pièce Scènes d’été pour jeunes gens en maillot de bain (2011) de Christophe et Stéphane Botti) ; « La mort ne me semble rien et ne me concerne pas. » (Lacenaire dans la pièce éponyme (2014) de Franck Desmedt et Yvon Martin) ; etc. En général, il la fige en icône magnifique ou au contraire en estampe camp néo-gothique (qu’on appelle facilement « humour noir »). Par exemple, L’Ombre de Venceslao (1978) est la seule de toutes ses pièces de Copi où un personnage meurt pour de bon.
C’est la raison pour laquelle la mort réelle est presque systématiquement amalgamée au monde de l’image : « Il faut que je t’explique pourquoi j’ai peur de la photographie. Pour moi, c’est la mort. » (Chris, le héros homosexuel du roman La Synthèse du Camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 44) Par exemple, dans le film « Harvey Milk » (2009) de Gus Van Sant, Harvey Milk regarde la mort dans un opéra. Dans le film « Tesis » (1996) d’Alejandro Amenábar, Angela se passionne pour la mort mi-cinématographique, mi-réelle, à travers l’étude des snuff movies.
La cristallisation artistique de la mort par l’esthétique a pour nom « Kitsch », et c’est une technique largement portée par les artistes homosexuels. L’excellente définition du kitsch selon Milan Kundera dans le roman L’Insoutenable légèreté de l’être (1984) (« Le kitsch est un paravent qui dissimule la mort. », pp. 357-367) trouve dans certaines scènes cinématographiques ou théâtrales des fictions homosexuelles une parfaite illustration. Par exemple, dans le film « Les Enfants terribles » (1949) de Jean-Pierre Melville, le kitsch est représenté à la lettre par la scène finale : Élisabeth qui s’est tirée dessus après avoir empoisonné mortellement son frère, s’écroule, faisant tomber le paravent qui dissimule la mort de Paul. Par ailleurs, il est question du « paravent de la mort » dans la pièce La Sonate des Spectres (1907) d’August Strindberg. Et on retrouve cette idée du kitsch comme paravent de mort dans différents ouvrages homosexuels : « Ce sont des gens à l’esprit pratique qui n’ont simplement pas envie de voir la mort en face ou plutôt à côté car une cloison nous en séparait. » (François dans le roman Riches, cruels et fardés (2002) d’Hervé Claude, p. 125) ; « […] la lampe brillant derrière un paravent qui dissimulait à moitié le lit du jeune homme » (Fabien presque mort, dans le roman Si j’étais vous (1947) de Julien Green, p. 303) ; « La galerie comportait les paravents d’un jardin d’hiver qui n’avait jamais vu le jour. Paul les traîna, les déplia et s’en fit des remparts, une sorte de ville chinoise. » (la voix de Jean Cocteau dans le film « Les Enfants terribles » (1949) de Jean-Pierre Melville)
La tragicomédie kitsch et camp, au-delà de son aspect risible, est un instrument très employé par le dramaturge argentin Copi pour faire de la mort une mise en scène de cour de récré, une irréalité : « Zut ! J’avais oublié que vous étiez mort ! » (l’Infirmière à Cyrille et à Regina Morti, dans la pièce Une Visite inopportune, 1988) ; « Tu vois, Lou, il y a pas de mort ! » (Ahmed en voyant Pédé ressusciter, dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur, 1986) ; « Oh, j’avais oublié qu’elle était morte ! » (Daphnée en parlant de son bébé qu’elle a assassinée, dans la pièce La Tour de la Défense, 1974) Dans les pièces de Copi, revient souvent le motif de la mort à répétition. « Je suis la septième à se suicider ce soir ? […] Quelle concurrence dans le métier ! Goliatha, venez dire adieu à la petite patronne ! Je rentre dans le frigo ! » (« L. » dans la pièce Le Frigo, 1983) Par exemple, dans La Nuit de Madame Lucienne (1985), tous les personnages s’entretuent et mettent en scène des meurtres (la femme de ménage est assassinée en mille et un chapitres) ; dans L’Ombre de Venceslao (1978), Venceslao le gaucho se suicide, Rogelio est empoisonné, sa jeune femme meurt sous les balles des militaires ; dans Une Visite inopportune, Cyrille ne meurt pas vraiment, ni même Regina Morti ; dans Les Quatre Jumelles (1973), les protagonistes passent leur temps à « mourir pour de faux » et de manière ultra ludique et violente à la fois : « Tais-toi ! Tu es morte ! » (Joséphine à sa sœur Fougère qui l’appelle, dans la pièce Les Quatre Jumelles) ; « Je vais te tuer, Leïla. Comment veux-tu mourir ? » (Maria, idem) Mais concrètement, la mort ou le départ sont des réalités très peu affrontées par l’auteur. La preuve en est que pour lui, même les objets peuvent mourir : « Il est mort l’ascenseur. » (cf. une réplique de la femme de chambre dans la pièce Le Frigo) La mort ou le viol sont éminemment liées chez Copi à la mort iconographique, au viol cinématographique : ce ne sont pas des hommes qui meurent, ce sont des poupées ou des acteurs : « C’est Rooney […] Le requin lui arrache un bras, son petit corps saute en l’air comme un pantin, retombe dans la mer. » (le narrateur homosexuel dans le roman Le Bal des Folles (1977), p. 104) ; « Ensuite il est entré une petite fille de six ans environ avec mon chien empaillé dans les bras et elle me l’a donné. […] Je suis sorti dans la rue comme tous les jours. Ça n’a pas tellement changé par rapport à avant la catastrophe, exceptant le fait que tous les gens sont morts et empaillés. » (le narrateur homosexuel dans le roman L’Uruguayen (1972), pp. 31-32) ; « Est-ce que la vraie mort qui vous guette a quelque chose à envier à la mort drapée en noir d’une scène de théâtre ? » (le Professeur Vertudeau dans la pièce Une Visite inopportune) ; « Mon grand-père le clown s’est suicidé en cours de spectacle. Il s’est pendu au trapèze, tout le monde croyait à un numéro comique ! Il a eu quinze minutes d’applaudissements avant qu’on s’aperçoive qu’il était mort ! » (le Machiniste dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne) La mort est à ce point niée par Copi que ses héroïnes féminines ne savent en général pas s’en aller, quitter la scène, affronter leur finitude : « Elle [Daphnée] est toujours en train de partir et elle ne part jamais. » (Jean dans la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi) Et les personnages des ouvrages de Copi transcendent la mort sans l’expérimenter : « On se fout de la mort ! Ha ha ! Car nous aurons vécu la mort ! » (Cachafaz à son amant Raulito dans la pièce Cachafaz, 1993) ; « La mort, nous, nous la conjurons ! » (Raulito, idem) Dans l’article « Jorge Lavelli : Copi n’est pas une dérision » d’Hugues Le Tanneur, publié dans le journal Aden le 1er octobre 2001, Lavelli explique à juste titre que, par exemple, L’Ombre de Venceslao (1978) « est la seule pièce de Copi où un personnage meurt pour de bon. Venceslao se pend après s’être confessé au perroquet de sa maîtresse. Mais il revient sous la forme d’une ombre. » Dans l’article « Copi, le non-conforme » de Gilles Costaz, sur le journal Le Matin de Paris du 11 octobre 1983, Copi lui-même confirme cette idée de déni de la mort par la surexploitation de la mort fictionnelle : « Dans Le Frigo, c’est une des très rares fois où je ne tue pas mon personnage. Généralement, quand j’en crée un, je m’attends à lui asséner une mort violente. Là, ma transsexuelle ne meurt pas. C’est sans doute que je l’aime. » Alors qu’en soi la mort marque un achèvement non-définitif mais brutal et sans retour, Copi la conçoit comme un processus inachevé, une transition, un sommeil, un jeu, une schizophrénie : « Il se passe des choses très bizarres avec mes morts. Je n’arrive pas à les enterrer. C’est-à-dire, ils n’arrivent pas à mourir complètement. » (Jeanne au Marchand de melons, dans la pièce La Journée d’une Rêveuse (1968) de Copi) ; « Dors, dors, mon mort… dors, dors, oh, mi amor… » (cf. le chant de Louise au Vrai Facteur, idem) ; « Je ne suis pas sûr qu’elle [Louise] ne soit pas morte ! Elle est très roublarde. Parlons bas ! Elle a quatre oreilles ! » (Jeanne au Marchand qui lui propose d’enterrer son amie Louise, idem) ; « Ne m’appelez pas madame. Appelez-moi mademoiselle, ou bien veuve. […] Je préfère que vous m’appeliez veuve. Bien que je ne le sois pas vraiment, mon mari n’étant pas mon mari et n’étant d’ailleurs pas vraiment mort, à vrai dire. » (Jeanne au Marchand de melons, idem) ; « J’ai encore tué. » (le narrateur homosexuel à son éditeur, dans le roman Le Bal des Folles, p. 121) ; « Je n’aime pas ce mélange de rêve et de réalité, j’ai peur d’être encore amené à tuer comme dans mes précédents rêves. […] Je sais que même si je ne suis pas un criminel, mon emploi du temps de ces quatre derniers jours m’est complètement sorti de la tête, n’aurais-je pas pendant cette période tué pour de bon ? Est-ce que Marielle ne courra pas un danger restant seule avec moi ? Non, voyons, je suis la personne la plus pacifique du monde. Les gens violents dans leurs rêves sont dans la réalité incapables de tuer une mouche. » (idem, p. 134)
En règle générale, les œuvres de fiction traitant d’homosexualité retranscrivent clairement le rapport idolâtre d’attraction-répulsion que le héros homosexuel entretient avec la mort : ce dernier est d’autant plus attiré par elle qu’il la craint : « Félicité imaginait son fils grelottant au petit jour devant un cadavre de la veille. Lui qui avait si peur de la mort, il devait faire une étrange tête. » (François Mauriac, Génitrix (1928), p. 45) ; « Un enchantement amer l’enchaînait à ce cadavre. » (idem, p. 48) ; « Je dois quitter Paris au plus vite ! À n’importe quel prix. […] Pour la première fois de ma vie, je sens la mort qui plane sur moi. Il faut fuir, et vite. » (Madeleine dans le roman À mon cœur défendant (2010) de Thibaut de Saint-Pol, pp. 20-21) ; « Max perdait les pédales, ce qui ne m’a pas étonné, il a toujours été hyperprotégé par ses parents. Ils n’avaient pas dû lui apprendre que la mort existait. » (François à propos de son « chéri », dans le roman Riches, cruels et fardés (2002) d’Hervé Claude, p. 118) ; etc. Par exemple, dans la pièce Quand je serai grand, je serai intermittent (2010) de Dzav et Bonnard, Dzav est nécrophobe.
La mort est d’habitude tellement crainte du héros homosexuel qu’elle est même vue par lui comme l’origine de la vie et de l’amour : « Soudain, nous nous souvenons que ce qui nous rapproche, ce qui nous attache l’un à l’autre, c’est ce mort entre nous. Nous sentons la présence de ce disparu entre nous. Nous sommes à nouveau ensemble, elle et moi. » (Vincent parlant de la mère d’Arthur, son amant, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 206) ; « Si dans les mains du Seigneur qui t’éduqua de la sorte bonheur rime avec malheur et les mots ‘vivante’ et ‘morte’ frappent toujours à la même porte, c’est au-delà de notre faute. » (Ahmed à Lou, sa femme morte, dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « L’amour, la mort peut-être. » (cf. la chanson « L’Innamoramento » de Mylène Farmer) ; « ‘l’amour’ et ‘la mort !’ ça se prononce presque pareil ! » (Kévin à Bryan dans le roman Si tu avais été…(2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 114) Dans beaucoup d’ouvrages homo-érotiques, l’amour homosexuel débute précisément par une mort qui ne lui semble pourtant pas directement liée : cf. la mort du Rav dans le roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, la mort du bébé à la frontière israëlo-palestinienne dans le film « The Bubble » (2003) d’Eytan Fox, la mort de Carlos le cousin de Miguel dans le film « Contracorriente » (2011) de Javier Fuentes-León, etc.
f) Le personnage homosexuel se suicide ou est dégoûté de la vie :

Téléfilm « Prayers For Bobby » de Russell Mulcahy
Étant donné que la mort est à la fois sublimée et niée par les intentions esthétiques et sentimentalistes du personnage homosexuel, ce dernier en arrive très souvent à se la donner concrètement. On retrouve le thème du suicide en lien avec l’homosexualité extrêmement souvent dans les œuvres de fiction : cf. le roman Pavillon noir (2007) de Thibaut de Saint Pol, le film « Ode To Billy Joe » (1976) de Max Baer, le film « Charlotte dite Charlie » (1995) de Caroline Huppert, le roman Mi Novia Y Mi Novio (1923) d’Álvaro Retana (avec le personnage de Roberto), la pièce Sortilegio (1942) de Gregorio Martínez Sierra (avec le personnage d’Augusto), la pièce D’habitude j’me marie pas ! (2008) de Stéphane Hénon et Philippe Hodora , la pièce Le Jardin des Dindes (2008) de Jean-Philippe Set, la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi (avec le personnage de Daphnée qui tente de se suicider, et qui se rate), le film « La Fille aux jacinthes » (1955) d’Hasse Ekman, le film « Bas fond » (1957) de Palle Kjoerulff-Schmidt, le film « Quartet » (1948) d’Harold French, la pièce Cannibales (2008) de Ronan Chéneau, le film « La Victime » (1961) de Basil Dearden, le film « Amour à trois » (1969) de Sergio Capogna, le film « Les Amitiés particulières » (1964) de Jean Delannoy (Alexandre se jette du haut d’un train qui passe sur un aqueduc), le film « La Cage aux Folles » (1978) d’Édouard Molinaro, (avec Zaza et ses multiples chantages au suicide), le film « Alors, heureux ? » (1979) de Claude Barrois, Pierre Jolivet, et Marc Jolivet, le film « Colloque de chiens » (1977) de Raoul Ruiz, le film « W imie… » (« Aime… et fais ce que tu veux », 2014) de Malgorzata Szumowska (avec le suicide de Gayo), le film « Tempête à Washington » (1962) d’Otto Preminger, le film « Sergent » (1967) de John Flynn, le film « Play It As It Lays » (1972) de Frank Perry, le film « Mamá Es Boba » (1997) de Santiago Lorenzo (avec le suicide du journaliste homo), le film « Luc ou la part des choses » (1982) de Michel Audy, le film « La Rage au cœur » (2000) de Léa Pool, le film « Amor Maldito » (1986) d’Adelia Sampaio, le film « F. est un salaud » (1998) de Marcel Gisler, le film « Bueberry Hill » (1989) de Robbe De Hert, le film « Total Loss » (2000) de Dana Nechushtan, le film « Quartiere » (1987) de Silvano Agosti, le film « Les Uns et les Autres » (1980) de Claude Lelouch, le film « Tir à vue » (1984) de Marc Angelo, le film « La Truite » (1982) de Joseph Losey, le film « Cahier volé » (1991) de Christine Lipinska, le film « Le Cahier volé » de Régine Desforges, le film « Le Goût de la cerise » (1997) d’Abbas Kiarostami, la pièce Fixing Frank (2011) de Kenneth Hanes (avec Frank, l’homosexuel suicidaire), le film « Bumblefuck, USA » (2011) d’Aaron Douglas Johnston, le film « Un Fils » (2011) d’André Gaumond, le film « Sala Samobójców » (« Suicide Room », 2011) de Jan Komasa, le film « Afternoon » (2008) de Ruaairo McKenna, le film « Duel » (2010) d’Edgar D’Alberto Rezende, le film « Scènes de chasse en Bavière » (1969) de Peter Fleischmann (avec le suicide d’un des deux personnages homos, Rovo), le film « La Ballade de l’impossible » (2011) de Tran Anh Hung (avec le suicide de Kisuki après qu’il ait découvert son impuissance sexuelle), le film « 3000 euro » (2009) de François Zabaleta (sur la tentation suicidaire et le suicide assisté), le téléfilm « Prayers For Bobby » (2009) de Russell Mulcahy (Bobby tente de se suicider en ingérant des médicaments, puis ensuite en se jetant du haut d’un pont), le roman Vincent Garbo (2010) de Quentin Lamotta (avec le suicide de François), le roman La Cité des Rats (1979) de Copi (avec le suicide au cyanure), le roman La Vie est un tango (1979) de Copi (avec le suicide d’Horacio Silberman, le directeur du Musée des Beaux-Arts de Buenos Aires), le film « Nuits d’ivresse printanière » (2009) de Lou Ye (avec le suicide de Wang Ping dans la forêt), le film « The Children’s Hour » (« La Rumeur », 1961) de William Wyler (avec le suicide de Martha, la lesbienne), le one-woman-show Mado fait son show (2010) de Noëlle Perna/Mado la Niçoise (avec la 28e tentative de suicide raté du gay dépressif), la pièce Et Dieu créa les folles (2009) de Corinne Natali (avec le suicide de Frédérique, l’héroïne lesbienne), la pièce Frères du bled (2010) de Christophe Botti (avec le suicide par pendaison de Maurice), la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi (avec le personnage de Lou, suicidaire), le film « Absences répétées » (1972) de Guy Gilles, le film « Alger la Blanche » (1985) de Cyril Collard, le film « The Saddest Boy In The World » (2006) de Jamie Travis, le film « Charlotte dite Charlie » (2003) de Caroline Huppert, le film « Harvey Milk » (2009) de Gus Van Sant (avec le suicide de Jack), la pièce Ma double vie (2009) de Stéphane Mitchell (avec le personnage lesbien d’Élodie), le film « Parfum d’absinthe » (2005) d’Achim von Borries (basé sur des faits réels, et racontant la vague de suicides commanditée par un cercle de jeunes étudiants homosexuels britanniques), le film « Attitudes » (2005) de Xavier Dolan (Jules, le héros homo, veut « en finir »), le spectacle musical Bénureau en best-of avec des cochons (2012) de Didier Bénureau (avec le suicide du guerrier anglais), le film « Joe + Belle » (2011) de Veronica Kedar (Belle est suicidaire et sort d’un établissement psychiatrique), le film « Mia » (2011) de Javier Van de Couter (avec Mia, une jeune femme qui vient de se suicider), le film « Le Roi de l’évasion » (2009) d’Alain Guiraudie (avec Armand, le héros homosexuel, qui essaie de se tailler les veines avec une scie), le film « Huit femmes » (2002) de François Ozon (qui tourne au drame quand le père finit par se suicider pour de vrai à la fin), le film « Starcrossed » (2005) de James Burkhammer (avec Darren et son frère Connor, amants secrets, qui finissent par se suicider dans une piscine, avec des menottes), le film « Darkroom – Tödliche Tropfen » (« Backroom – Drogue mortelle », 2019) de Rosa von Praunheim (avec Lars, le héros homosexuel suicidaire), la chanson « Veux-tu danser ? » de Michel Rivard, etc.
Par exemple, dans la comédie musicale Se Dice De Mí En Buenos Aires (2010) de Stéphan Druet, Claudia, la servante, fait croire qu’elle va se suicider à l’arme à feu. Dans le film « Mezzanotte » (2014) de Sebastiano Riso, Davide, le héros homosexuel, veut se jeter par la fenêtre. Dans la pièce Le Clan des Joyeux Désespérés (2011) de Karine de Mo, au moment où Lili rentre dans l’appartement de Mona où celle-ci tente de se suicider au gaz et qu’elle repose inanimée, elle lit le pendentif de Mona à l’envers (« Anom » = à n’homme)… et est tentée de lui faire un bouche-à-bouche lesbien, avant de se rétracter par acquis de conscience. Dans la pièce Ça s’en va et ça revient (2011) de Pierre Cabanis, Hugo, le personnage bisexuel, avoue avoir songé au suicide dans ses années lycée. Dans le film « Guillaume et les garçons, à table ! » (2013) de Guillaume Gallienne, Guillaume, le héros bisexuel, dit au médecin militaire qu’il a fait une tentative de suicide « parce que l’Autre a essayé de me noyer » : il parle en réalité de son frère, et essaie d’être réformé de l’armée. Dans la biopic « Yves Saint-Laurent » (2014) de Jalil Lespert, Yves Saint-Laurent dit qu’il veut mourir. Dans le film « Sils Maria » (2014) d’Olivier Assayas, Helena est attirée par la « jeunesse » de Sigrid, et cette dernière, en bonne profiteuse, la pousse au suicide. Dans le film « Boys Like Us » (2014) de Patric Chiha, Gabriel, l’un des héros homos, décrit la vie comme « un gouffre ». Dans la pièce Un Cœur en herbe (2010) de Christophe et Stéphane Botti, Mathan, le jeune héros homosexuel de 19 ans, a fait une T.S. (tentative de suicide) à 18 ans. Dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson, le beau Vincent raconte que la première fois qu’il a couché homosexuellement, c’était dans un coin reculé d’une plage, à l’âge de 15 ans, avec un homme de 20 ans, Sébastien, qui s’est fait sauter la cervelle à l’arme à feu un an après. Dans le film « Una Giornata Particolare » (« Une Journée particulière », 1977) d’Ettore Scola, Gabriele, le chroniqueur radio homosexuel licencié, est tenté d’en finir avec la vie en se tirant une balle au revolver, quand il est interrompu par l’arrivée impromptue de sa voisine de pallier, Antonietta. Dans le téléfilm « Baisers cachés » (2017) de Didier Bivel, le jeune Louis, homosexuel, fait une tentative de suicide en se jetant du haut d’un immeuble désaffecté. Dans le téléfilm Fiertés (épisode 1) de Philippe Faucon, diffusé sur Arte en mai 2018, Victor, 17 ans, homo, est sur le point de se trancher la gorge avec une lame de rasoir. Dans le film « Mon Père » (« Retablo », 2018) d’Álvaro Delgado Aparicio, Noé, le héros homosexuel, se suicide en se jetant dans un puits. Dans le film « Plaire, aimer et courir vite » (2018) de Christophe Honoré, Jacques, le héros homo atteint du Sida, planifie à la fin du film son suicide : « Je me sens plein d’une tristesse suicidaire. » Dans le film « Ma Vie avec John F. Donovan » (2019) de Xavier Dolan, John le héros homosexuel se suicide par overdose. Dans le film « Close » (2022) de Lukas Dhont, Rémi se suicide parce que son amant Léo a repoussé ses avances et n’a pas assumé leur « amour » d’adolescence.
Dans les créations de Tennessee Williams, Copi, Shakespeare, Thomas Mann, Julien Green, Bernard-Marie Koltès, etc., les personnages finissent souvent par se donner la mort. On retrouve la figure de l’homosexuel suicidaire dans le film « Mandragora » (1997) de Wiktor Grodecki, le roman Le Malfaiteur (1955) de Julien Green, les romans Confidence africaine (1931) et Un Taciturne (1932) de Roger Martin du Gard, le roman Macaron Citron (2001) de Claire Mazard, le film « Presque rien » (2000) de Sébastien Lifshitz, le film « L’Ennemi naturel » (2003) de Pierre-Erwan Guillaume, le film « La Captive » (2000) de Chantal Akerman, le film « La Conséquence » (1977) de Wolfgang Petersen, la chanson « Je t’aime Mélancolie » de Mylène Farmer (« Un long suicide acide, je t’aime Mélancolie. »), etc.

B.D. « Femme assise » de Copi
La question du suicide revient comme une marotte dans la bouche des personnages homosexuels : « On a pensé se suicider… mais comme on n’avait qu’une corde pour deux… » (Stef et Nono, dans la pièce Copains navrants (2011) de Patrick Hernandez) ; « Nono a le suicide maladroit. » (Stef en parlant de Nono, idem) ; « J’pense qu’au suicide. » (un des personnages homosexuels de la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel) ; « Je songe au suicide. » (un escargot de la B.D. La Femme assise (2002) de Copi, p. 67) ; « J’ai suicidé la réalité, j’ai fait une apnée de moi même. » (l’Actrice de la pièce Parano : N’ayez pas peur, ce n’est que du théâtre (2011) de Jérémy Patinier) ; « Dès que le rideau tombe, dès que la vie reprend, j’ai peur. » (idem, p. 32) ; « C’est agressif la vie. C’est agressif la vérité. » (idem, p. 33) ; « Je suis certain d’être bon pour la guillotine, rien qu’à y penser mes cheveux se dressent sur ma tête. Quand je songe au procès qui m’attend je suis encore plus effrayé. Tant pis, je me suiciderai quand cette vie me deviendra trop dure. » (le narrateur homosexuel du roman Le Bal des Folles (1977) de Copi, p. 125) ; « J’ai tellement envie de mourir… » (Petra dans le film « Die Bitteren Tränen Der Petra Von Kant », « Les Larmes amères de Petra von Kant » (1972) de Rainer Werner Fassbinder) ; « La vie m’est fade. » (la narratrice lesbienne dans le roman Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train (2005) de Cy Jung, p. 69) ; « Je suis un grand suicidaire. » (Eugène, le héros homo du one-man-show Un Barbu sur le net (2007) de Louis Julien) ; « Je le saurais si j’étais suicidaire… » (Louis dans la pièce Dépression très nerveuse (2008) d’Augustin d’Ollone) ; « Après deux matins, à l’aube, Claude [l’héroïne lesbienne] se suicide. » (Mike Nietomertz, Des chiens (2011), p. 122) ; « Je voudrai ramper sous une pierre et dormir pour toujours. » (Bobby, le héros homo du téléfilm « Prayers For Bobby » (2009) de Russell Mulcahy) ; « J’ai failli me foutre en l’air. » (Morgane, héros transsexuel M to F, dans l’épisode 405 de la série Demain Nous Appartient, diffusé sur TF1 le 21 février 2019) ; « Décroche pas non plus, c’est pas la peine. J’suis complètement suicidaire. J’suis au-dessous de tout avec toi. Je me sens prisonnier, en apnée, au bord d’un gouffre. » (Adrien parlant au répondeur d’Eva, sa meilleure amie qu’il a éloignée volontairement d’Alexandre, dans le film « Pédale douce » (1996) de Gabriel Aghion) ; « Rien d’extraordinaire : Fripounet voulait encore s’ouvrir les veines. » (Eva parlant d’un de ses amis gays après une discussion téléphonique, didem) ; etc.
Le suicide du héros homosexuel ou transgenre peut être symbolique, à travers la négation de soi-même : « Miri n’existe plus !!! » (Miriam/Lukas, l’héroïne transsexuelle F to M, dans le film « Romeos » (2011) de Sabine Bernardi) ; « Je me sens si mal. J’en ai assez de vivre et j’ai peur de mourir. » (Michael, le héros homosexuel s’adressant à son ami Donald, dans le film « The Boys In The Band », « Les Garçons de la bande » (1970) de William Friedkin) ; « Je pourrais me tuer. » (Alan, homosexuel, déprimé au téléphone, idem) ; « Harold fait une collection de barbituriques qu’il prépare pour anticiper le long hiver qu’est la mort. […] La mort, ce n’est pas comme au théâtre. Tu n’auras pas le courage de le faire. Tous les homos ne se flinguent pas à la fin de l’histoire. » (Michael, le héros homosexuel s’adressant plus ou moins directement à Harold son colocataire gay, idem) ; etc.
En général, c’est la star qui, par sa beauté fatale, sert de prétexte esthétique et d’alibi au suicide : cf. le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot (avec Nadège, la femme magnifique qui se suicide), la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1986) de Copi (avec le suicide de l’actrice Vicky), la comédie musicale Non, je ne danse pas ! (2010) de Lydie Agaesse (avec la mariée qui se défenestre du haut d’un immeuble, et qui atterrit sur une Volvo verte), etc. « Je suis mort. Yolanda m’a suicidé. » (cf. le message que Yolanda écrit sur un journal de bord, dans le film « Entre Tinieblas » (« Dans les ténèbres », 1983) de Pedro Almodóvar) ; « Ça a de la gueule, quand même. Mourir sur scène, sous les projecteurs. » (Raphaël Beaumont dans son one-man-show Raphaël Beaumont vous invite à ses funérailles, 2011) La femme suicidée auquel le héros homosexuel s’identifie ressemble à « la fille d’à côté », à une moitié de cerveau d’une conscience en proie à une schizophrénie auto-destructrice, à la jumelle narcissique androgynique : « Elle s’est pendue vers six heures du matin, j’étais tout seul, j’écrivais et pourtant je n’ai pas entendu le moindre bruit. […] Pourtant la fenêtre de sa salle de bains donne sur la mienne. Et les deux étaient ouvertes. » (le narrateur homosexuel du roman Le Bal des Folles (1977) de Copi, p. 50) ; « Yo quiero morir. » (Max, le héros homosexuel travesti en Shakira, dans la pièce 1h00 que de nous (2014) de Max et Mumu) ; « Je suis sur le point d’entrer dans mon frigo ! Je suis déçu de la vie et de ses apparences ! » (« L. », le héros transgenre M to F de la pièce Le Frigo (1983) de Copi) ; « Mon voisin sur un coup de tête s’est jeté aux oubliettes. » (cf. la chanson « Mon Voisin » du Beau Claude) ; etc.
Le suicide est appréhendé comme un chemin de sanctification, une voie d’accès à l’éternité cinématographique : cf. le roman Une Chute infinie (2009) de Mohamed Leftah, la chanson « C’est une belle journée » de Mylène Farmer, etc. Par exemple, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, Kévin se suicide pour être immortel : « J’aurais dix-huit ans à jamais. » (p. 461)
En réalité, le suicide du héros homosexuel, même si ce n’est pas dit explicitement, vient principalement d’un orgueil personnel démesuré (cf. le roman Le Portrait de Dorian Gray (1890) d’Oscar Wilde, le film « Traitement de choc » (1972) d’Alain Jessua – racontant l’histoire d’un quinquagénaire homo qui met fin à ses jours parce qu’il refuse de vieillir, etc.), ou de drames surgissant dans sa vie amoureuse intime, plutôt que de la soi-disant non-acceptation sociale de son homosexualité. Par exemple, dans la pièce La Dernière Danse (2011) d’Olivier Schmidt, Paul prend en cachette des photos de son amant Jack pour faire des articles à sensation sur son compte ; quand ce dernier le découvre, il se suicide devant lui pour assouvir sa vengeance et prouver sa blessure d’amour. Dans la pièce Gouttes dans l’océan (1997) de Rainer Werner Fassbinder, Léopold pousse son jeune amant Franz au suicide (il avale du cyanure). Dans le film « La Robe du soir » (2010) de Myriam Aziza, la jeune collégienne Juliette tente de se suicider parce qu’elle est tombée excessivement amoureuse de sa prof de français. Dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, Kévin essaie de se pendre à cause de l’infidélité de son amant Bryan. Toujours dans ce roman, on découvre que Bryan, le héros gay, est aussi (voire plus !) responsable de l’abandon puis du suicide subséquent de son camarade de classe efféminé Julien, que ses camarades « hétéros » : « C’était mon frère de cœur. Nous avions la même faiblesse – si c’en est une – mais je ne me reconnaissais pas en lui. Je l’avais toujours ignoré. Finalement, j’étais peut-être pire que ceux qui se moquaient de lui. » (p. 49) ; « Personne n’était là quand Julien en avait besoin, quand il était bien vivant, quand il désespérait. Personne pour l’écouter, pour le comprendre et lui tendre la main… alors, il est parti. » (idem, p. 51) Dans le film « Les Incroyables Aventures de Fusion Man » (2009) de David Halphen, un steward suicidaire veut se jeter du haut d’un immeuble parce qu’il y ait poussé par une « Méchante Pédale ». Dans le film « Save Me » (2010) de Robert Cary, Mark se sent coupable du suicide de son ami Lester (qui s’est taillé les veines dans sa baignoire). Dans le film « A Single Man » (2009) de Tom Ford, George cherche constamment à se suicider parce qu’il ne se remet pas de la mort accidentelle de son compagnon. Dans La Mort à Venise (1912) de Thomas Mann, Aschenbach finit par mourir en contemplant l’objet de ses désirs : « Il semblait à Aschenbach que le psychagogue pâle et charmant lui souriait là-bas, lui faisait signe ; que, détachant la main de sa hanche, il la tendait vers le lointain, et prenant les devants s’élançait comme une ombre dans l’immensité pleine de promesses. Comme tant de fois déjà il voulut se lever pour le suivre. Quelques minutes s’écoulèrent avant que l’on accourût au secours du poète dont le corps s’était affaissé sur le bord de la chaise. On le monta dans sa chambre. Et le jour même la nouvelle de sa mort se répandit par le monde où elle fut accueillie avec une déférente émotion. » (p. 107) Tous ces exemples illustrent que la réalité et les causes réelles du suicide du héros homosexuel sont bien plus internes qu’externes au désir homosexuel.
FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION
PARFOIS RÉALITÉ
La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :
a) La mort occupe une grande place dans la vie des personnes homosexuelles :

le réalisateur Eisenstein
La mort occupe une grande place dans la vie des personnes homosexuelles. Déjà toutes petites, certaines parmi elles avouent avoir été obnubilées par elle. Leurs maîtres d’école déploraient leurs « goûts morbides » (Patrick White cité sur le site www.islaternura.com, consulté en janvier 2003). Elles ont parfois eu conscience de la mort et de la futilité de la vie très jeunes (cf. le documentaire « Francis Bacon » (1985) de David Hinton). Par exemple, Federico García Lorca se rappelle de l’enterrement du compadre Pastor dans les moindres détails, alors qu’il n’avait pourtant que 3 ans (Francisco García Lorca, Federico Y Su Mundo (1980), p. 58). De son côté, Jean Cocteau a connu la mort de très près : dans sa jeunesse, il doit porter le suicide de son père. Malcolm Lowry consacre l’un de ses romans au Jour des Morts au Mexique (cf. le documentaire « Le Volcan » (1976) de Donald Brittain). À 14 ans, Paul Verlaine adresse à Victor Hugo un de ses premiers poèmes, intitulé « La Mort » ; d’ailleurs, ses élégies (« Melancholia », « Resignation », etc.) occupent une place non-négligeable dans son œuvre.
Il est fréquent que les personnes homosexuelles remplacent (dans la tête de ses parents ou en vrai) un enfant mort, après un accident, une fausse couche ou un avortement : « Ma sœur était morte [à l’âge de cinq ans] et ma mère m’appelait ‘sa petite fille’ et m’apprenait le canevas. » (Jean-Luc, 27 ans, homosexuel, dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, p. 77) ; « Une histoire qu’elle racontait souvent à qui voulait bien l’entendre : avant de me mettre au monde elle avait perdu un enfant. » (Eddy Bellegueule dans le roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, p. 73) ; « Maman, j’ai envie de mourir. » (cf. propos de Kimy, un garçon transgenre M to F de 8 ans, rapportés lors du débat « Transgenres, la fin d’un tabou ? » diffusé sur la chaîne France 2 le 22 novembre 2017) ; « Au début de ma puberté, quand j’avais 11-12 ans, j’ai pensé au suicide. » (Lucas Carreno, femme F to M, idem) ; etc. Par exemple, dans le documentaire « Cocteau/Marais : un couple mythique » (2013) Yves Riou et Philippe Pouchain, on apprend que l’acteur homosexuel Jean Marais est arrivé jute après le décès de sa sœur Madeleine. Il a donc remplacé une morte, et a dû subir le refus du deuil de sa mère (sa mère qui, à sa naissance, s’est exclamée : « Enlevez-le, je ne veux pas le voir ! »). Jean Marais avouera lui-même qu’elle s’est bien rattrapée… sans lui en vouloir d’avoir vêtu dans son cœur et dans son identité l’âme d’une sœur morte : « Après, ma mère m’a adoré et j’ai adoré ma mère. Comme ma mère aurait voulu une fille, elle me traite en fille. » Il existe des liens étroits entre avortement (= infanticide) et homosexualité, que je développe par exemple dans le code « Petits Morveux » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels.
À l’âge adulte, cette passion pour la mort ne s’atténue pas : « Jean Genet a toujours entretenu un rapport privilégié avec la mort, avec les morts. Et on peut même dire qu’à partir d’un certain moment il n’a écrit que pour les morts. L’occasion pour lui idéale d’un véritable spectacle théâtral ne serait-elle pas un convoi funèbre, le lieu idéal pour ce nouveau théâtre étant le cimetière ? […] Les deux dernières pièces de Jean Genet, les plus belles, Les Nègres et Les Paravents étaient envahies par la mort. » (cf. l’article « Donner aux morts » de Paule Thévenin, dans le Magazine littéraire, n°313, septembre 1993, p. 36) ; « La vie n’est pas digne d’être vécue. » (Stefan Sweig, juste avant son suicide, dans le documentaire « Stefan Sweig, histoire d’un Européen » (2015) de François Busnel) ; « Comme je crois au néant, y’aura plus rien de moi. » (Jean-Louis Bory au micro de Jacques Chancel, dans l’émission Radioscopie sur France Inter, 6 mai 1976) ; etc. Dans son Journal (2008), le dramaturge Jean-Luc Lagarce tient la rubrique nécrologique de toutes les célébrités people : « Je ne note que les morts. » écrit-il. Sur le cliché Andy Warhol, Paris (1974) pris par Helmut Newton, Andy Warhol figure mort (ou endormi ?). Le documentaire « Charles Trénet, l’ombre au tableau » (2013) de Karl Zéro et Daisy d’Errata raconte que, pendant l’Occupation, lorsqu’une rumeur a couru sur la prétendue mort de Charles Trénet, ce dernier envoya des cartes d’invitation d’un goût douteux : « Charles Trénet : ni juif, ni mort ! »
Il arrive que certaines personnes homosexuelles exercent le métier de croque-mort. Ce fut par exemple le cas du chanteur Jann Halexander. Pour ma part, je connais dans mon entourage proche des amis homosexuels qui sont réellement croque-mort.
Alors comment expliquer la corrélation entre homosexualité et mort ? Je crois que la coïncidence vient de la nature idolâtre du désir homosexuel. Cela en choquera peut-être certains, mais je le dis quand même : le désir homosexuel, même s’il est par ailleurs un élan d’amour et de vie, se rapproche davantage d’un désir de mort. « Le goût de vivre commençait à s’émousser. » (Christian, dandy homosexuel de 50 ans, dans le documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz) Comme il est éloigné de la Réalité – puisqu’il rejette en grande partie la différence des sexes –, il s’oriente vers un devenir-objet qui désincarne et déshumanise plus qu’il n’humanise et unifie l’individu qui le ressent. Dans mon essai Homosexualité intime (2009), j’explique ainsi pourquoi beaucoup de coming out font autant violence à des parents : en même temps que leur enfant leur annonce qu’il « aime » homosexuellement et qu’il « est » pleinement homo, il ne se rend pas compte (et les parents d’aujourd’hui de moins en moins également) qu’il dit par la même occasion qu’il souhaite mourir. On retrouve par exemple ce lien entre coming out et mort quand le réalisateur français François Ozon, à l’occasion d’une interview accordée au magazine gay Illico à propos de son film « Le Temps qui reste » (2005), fait un parallèle inconscient entre la révélation de l’homosexualité et la découverte d’une maladie mortelle : « Romain a un coming out à faire, non pas sur sa sexualité qu’il n’a jamais cachée, mais sur le fait qu’il va mourir. »
En voulant fuir les petites morts de l’existence, celles qui font davantage partie des hommes et des pères, les bonnes morts si elles sont au service de la douceur et des plus faibles (la guerre, les limites, la souffrance, l’effort, la loi, le combat, la force, le pouvoir, la politique, etc.), les personnes homosexuelles s’exposent fatalement à vivre les mauvaises morts, celle du confort et de la fuite du Réel (l’ennui, l’angoisse, la frustration, la schizophrénie, le fétichisme, la consommation, le doute, etc.), les mauvais côtés de la féminité (la possessivité, la vengeance, la jalousie, les complications amoureuses, etc.). « Cette génération veut abandonner la pulsion de mort qui est le propre de la virilité depuis des millénaires. Ils veulent être du côté de la vie, du côté des femmes. » (Éric Zemmour, Le Premier Sexe (2006), p. 86) ; « Le pouvoir, c’est le mal, la mort, le phallus, l’homme. Plus personne, dans les jeunes générations de nos pays, ne veut assumer ce fardeau. » (idem, p. 120)
b) Le goût homosexuel pour les cimetières :
En outre, un certain nombre de personnes homosexuelles affectionnent les cimetières : je vous renvoie aux auto-portraits de la photographe lesbienne Claude Cahun dans les cimetières, aux photos de Jann Halexander, de Mylène Farmer, ou à l’univers du chanteur Mika lors de ses concerts.
Par exemple, dans le documentaire « Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé : l’Amour fou » (2010) de Pierre Thoretton, on apprend que la toute première rencontre entre Pierre Bergé et Yves Saint-Laurent a eu lieu lors de l’enterrement de Christian Dior, en 1957 ; pour Bergé, cette inhumation est un jour capital, la pierre blanche sur laquelle s’est fondée leur « couple ».

Vidéo-clip de la chanson « Regrets » de Mylène Farmer
Le cimetière est un lieu qui permet aux personnes homosexuelles de rentrer dans la peau de la veuve ou de la Drama Queen : « Si, comme Georges Perec, je ne me souviens pas du moment de ma naissance, en revanche je sais – depuis mon plus jeune âge – la passion que je porte aux cimetières. » (Michel Chomarat, dans les Archives des mouvements LGBT+ (2018) d’Antoine Idier, Ed. Textuel, Paris, p. 153) ; « Je ne sais pas pourquoi je suis allé sur sa tombe. Mais je sais que dans les allées de cet immense et magnifique cimetière en ruine, je me suis vu dans ma fin, en train de partir définitivement. J’ai vu encore une fois le monde arabe autour de moi qui n’en finissait pas de tomber. Et là, j’ai eu envie de pleurer. De crier de toute mon âme. De me jeter moi aussi d’un balcon. » (Abdellah Taïa parlant de l’actrice Souad Hosni, dans son autobiographie Une Mélancolie arabe (2008), p. 91) ; « Les cimetières ont vraiment une signification pour moi. » (le chanteur Jann Halexander, au micro de l’émission radiophonique Homo Micro sur RFPP, le 24 janvier 2011) ; « Je me souvins de la pinède proche du cimetière de St Tropez, ce lieu de drague […] » (Gaël-Laurent Tilium, Recto/Verso (2007), p. 213) ; « J’adore les cimetières. C’est l’un des endroits dans lesquels je me sens bien. Où que j’aille dans le monde, je vais dans un cimetière, cela apprend beaucoup sur une culture, un peuple. » (la chanteuse Mylène Farmer, citée dans la biographie Mylène Farmer, le Mystère (2003) de Mathias Goudeau, p. 61)
Récemment, un ami homosexuel sexagénaire, marié avec plusieurs enfants, m’a avoué qu’il « recherchait le bonheur dans les cimetières en Allemagne, où il se trouvait dans la paix » ; il m’a aussi dit que depuis son enfance, et après dans ses relations amoureuses homosexuelles, il « avait subi des violences et avait tenté de se suicider ». J’ai également visité le fameux cimetière du Père Lachaise, et mon guide (un vieux papy lui-même homosexuel) m’a raconté combien l’endroit était un haut lieu de drague homosexuelle. Il a d’ailleurs rencontré plusieurs de ses amants là-bas ; certaines chapelles sont devenues de véritables backroom ou baisodromes, et il existe tout un réseau insoupçonné de rencontres amoureuses spécifiquement homosexuelles : hallucinant !
Je pense que le cimetière, plus qu’un lieu étrange ou une simple posture esthétique mélancolique, est le rempart d’un viol fantasmé ou réellement vécu par les personnes homosexuelles : « Cette fois un ancien collègue de son père attira Ednar chez lui dans un guet-apens ; lorsqu’il comprit le but de l’invitation, il voulut s’enfuir. L’homme le retint ; il se débattit, parvint à se libérer et, enjambant la fenêtre, il s’enfuit et escalada le mur du cimetière voisin. Dans le crépuscule, il prit la poudre d’escampette pour échapper au viol. » (Jean-Claude Janvier-Modeste, dans son autobiographie Un Fils différent (2011), pp. 12-14)
c) Certaines personnes homosexuelles s’imaginent leur propre enterrement :
Les personnes homosexuelles ont tendance à se mettre à la place des absents ou des morts, bref, à prêter à la réalité la forme de leurs fantasmes de mort et de leurs sentiments égocentrés (souvent victimisants) : « J’entends les soupirs des mourants. C’était une nuit d’hiver. C’était nous deux et le temps des adieux. » (Stefan Corbin, pendant son concert Les Murmures du temps au Théâtre de L’île Saint-Louis Paul Rey, à Paris, en février 2011) Je vous renvoie par exemple aux fameux dying organisés par Act-Up ou pendant les Gay Pride ; ou encore à la scène du mime d’assassinat par rafale de mitraillette dans le documentaire « Et ta sœur ! » (2011) de Sylvie Leroy et Nicolas Barachin.

Jean Cocteau
Le rapport des personnes homosexuelles à la mort est souvent de fascination identificatoire. Voilà pourquoi elles la présentent souvent comme une jumelle/un jumeau : « J’ai le sentiment que ma mère s’en veut toujours du décès de mon frère, comme si elle n’avait pas bien pris soin de moi, alors qu’elle n’avait que 15 ans ! J’ai aussi le sentiment qu’elle a fait une sorte de transfert sur moi. J’ai remplacé l’enfant mort. » (Brahim Naït-Balk, Un Homo dans la cité (2009), p. 15) ; « Il aura fallu que je m’habitue à ce visage décharné que le miroir chaque fois me fait voir comme ne m’appartenant plus mais déjà à mon cadavre, et il aurait fallu, comble ou interruption du narcissisme, que je réussisse à l’aimer. » (Hervé Guibert évoquant son corps ravagé par le Sida, dans son autobiographie Le Mausolée des amants (2001), p. 500)
Comble du narcissisme : il arrive souvent qu’elles s’imaginent leur propre enterrement, pour pleurer et s’émouvoir sur elles-mêmes. Dans sa biographie Saint Genet (1952), Jean-Paul Sartre évoque le narcissisme de Jean Genet à s’imaginer mort (p. 218) ; dans le documentaire « La Villa Santo Sospir » (1949), Jean Cocteau explique qu’il a décoré la chapelle saint Pierre en 1957 « comme son propre sarcophage ». Dans le documentaire « Homophobie à l’italienne » (2007) de Gustav Hofer et Luca Ragazzi, Luca (la trentaine) décide qu’à sa mort ses cendres seront dispersées dans le beau paysage urbain romain qu’il contemple. Par ailleurs, il n’est pas très étonnant que de nombreuses chanteurs célébrés par la communauté homosexuelle se filment morts à l’intérieur d’un cercueil ouvert dans leurs vidéo-clips (cf. « Everytime » de Britney Spears, « Tristana » et « Fuck Them All » de Mylène Farmer, « ¿ Qué Harás Tú Cuando Mueras ? » de Marta Sánchez, « Ghosts » de Michael Jackson, etc.).

Claude Cahun, « Autoportrait »
« Il avait anticipé les lieux et l’espace de sa mort. Il voulait mourir au bord de la mer. » (Peter Kammerer parlant de son ami Pier Paolo Pasolini, dans le documentaire « L’Affaire Pasolini » (2012) d’Andreas Pichler) ; « Images que j’aimerais voir défiler avant de mourir. » (Denis intitulant une de ses séquences filmiques testamentaires qu’il offre à son amant Luther, dans le docu-fiction « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta) ; etc.
d) « Je suis mort » :

Dans une boîte gay, pour Halloween…
Dans le même ordre d’idée, certaines personnes homosexuelles disent de leur vivant qu’elles sont mortes (autrement dit, elles énoncent l’impossible…) : « D’avance, j’étais mort, autant tout oser dès maintenant. » (Abdellah Taïa, Une Mélancolie arabe (2008), p. 28) ; « Un jour, je te raconterai la première fois que je suis mort. » (idem, p. 51) ; « À vrai dire, je suis déjà mort. » (cf. un extrait de la lettre d’Alfredo Ormando, qui s’est immolé lui-même au Vatican en 1998, dans le documentaire « Les Règles du Vatican » (2007) d’Alessandro Avellis) ; « Je suis mort. » (Jean-Luc Lagarce dans son Journal, 2008) ; « Chaque minute est une éternité quand on croit que l’on va mourir à la seconde suivante. » (Cathy Bernheim, L’Amour presque parfait (2003), p. 72) ; « Au fond qu’est-ce que je risque, je suis déjà à moitié mort. » (Frédéric Mitterrand, La Mauvaise Vie (2005), p. 155) ; « Et moi aussi, je suis mort. Bien sûr que je suis mort. Il ne reste rien de l’enfant qui n’avait pas dix ans. » (Christophe Honoré, Le Livre pour enfants (2005), p. 43) ; « En ce qui me concerne, je n’ai pas peur de la mort. Parce que j’ai été beaucoup plus de temps mort que vivant. » (Jean Cocteau dans le documentaire « Jean Cocteau, autoportrait d’un inconnu » (1983) d’Edgardo Cozarinsky) ; « J’étais dans ma deuxième vie. Je venais de rencontrer la mort. J’étais parti. Puis je suis revenu. » (cf. les toutes premières lignes de l’autobiographie d’Abdellah Taïa, Une Mélancolie arabe (2008), p. 9) ; « D’avance, j’étais mort, autant tout oser dès maintenant. » (idem, p. 28) ; « La mort m’avait choisi. » (idem, p. 14) ; « C’était cela, la vérité. Mon corps réel. Il fallait changer. Le changer. Revenir au jour du départ et de l’arrivée. Maigrir. Absolument maigrir. Arrêter de manger. Jouer de nouveau, sans le savoir, avec la mort. » (p. 63) ; « C’est ça, la mort. La vraie mort. La mort directe, consciemment. […] Se détacher de son corps, du monde, en vitesse, dans l’effarement. » (idem, p. 94) ; « C’est quelque part comme si j’étais mort. » (Bruno Wiel, jeune homme trentenaire homosexuel, jadis agressé par quatre hommes et laissé pour mort, et parlant de sa situation présente, dans le documentaire « Homos, la haine » (2014) d’Éric Guéret et Philippe Besson, diffusé sur la chaîne France 2 le 9 décembre 2014) ; « Faire le mort était mon rôle préféré : mon ou ma partenaire jouait à ma place et je n’étais pas engueulé. » (Dominique Fernandez parlant des parties familiales de bridge, dans la biographie Ramon (2008), p. 38) ; « J’ai l’impression que je serai mort bien avant la diffusion de ce film. Je ne sais pas pourquoi je vous parle. J’ai l’impression d’un retour de ce vieux poison. Je le ressens comme une punition. Parce que je donne une mauvaise image de ces pauvres chrétiens. » (Thomas, homosexuel, dans le documentaire « Du Sollst Nicht Schwul Sein », « Tu ne seras pas gay » (2015) de Marco Giacopuzzi) ; etc. Par exemple, dans le docu-fiction « Le Dos rouge » (2015) d’Antoine Barraud, au moment où Bertrand Bonello demande à sa femme si elle doit retourner sur scène pendant son spectacle, celle-ci lui répond : « Ben non, chui morte », en se référant bien sûr à son personnage.
À la manière des zombies, elles prétendent vivre ou vivent leur vie comme si elles ne l’éprouvaient pas comme leur, sont des « joyeux suicidés moraux » (pour reprendre la formule de Jean-Paul Sartre dans sa biographie Saint Genet (1952), p. 86), passant par une crise de dépersonnalisation, expérience qui rejoint la notion freudienne de narcissisme intégral. Comme l’écrivait Luis Cernuda, elles affirment « vivre sans exister ». Elles se comportent parfois en morts-vivants qui ne trouvent pas incongru d’affirmer « Je suis mort » alors qu’elles sont pourtant bien en vie.
Concernant mon expérience personnelle, à l’été 2002, je suis allé rendre visite près de Montpellier à un ami homosexuel, presque trentenaire, que j’avais rencontré sur Internet, et qui m’a hébergé quelques jours chez lui. Jamais je n’aurais imaginé que ces six journées seraient si interminables. Il s’est montré particulièrement désagréable à mon égard parce qu’il a vite compris qu’il n’arriverait pas à coucher avec moi. J’avais fait le déplacement spécialement pour lui, mais je voyais bien que ma présence l’agaçait prodigieusement, si bien qu’à la fin, alors que j’étais obligé de rester chez lui vu que je n’avais aucun pied à terre dans la région, il ne m’adressait quasiment pas la parole. Un jour qu’il avait été particulièrement peu loquace, et que je lui demandais pourquoi il ne me répondait pas, il m’avait sorti inconsciemment cette phrase surprenante qui avait résonné en moi comme un écho à toutes les fois où je l’avais déjà à l’époque entendue de la bouche d’autres personnages ou auteurs homosexuels : « Je ne suis pas agacé. Moi, je suis mort. » Quelques semaines plus tard, j’ai su le fin mot de son mutisme, de son attitude odieuse, et de cette phrase, puisque l’ami en question m’a avoué que juste avant mon arrivée, il comptait se suicider.
e) La mort prise pas assez au sérieux ET trop au sérieux :
Beaucoup de personnes homosexuelles ont tendance à se prendre pour leur propre mort afin de s’en protéger, car elles en ont une frousse maladive. « Victor Garcia, Copi, Jérôme Savary font partie des gens qui courent devant la mort. » (Colette Godard, dans sa biographie L’Enfant de la fête (1996) consacré à Jérôme Savary) ; « Plus que quiconque, sans doute, je répugne à la vue d’un corbillard et je m’en trouve profondément affecté ; une draperie mortuaire, accrochée à une porte, me rend malade pour une semaine entière. » (Jean-Luc, homosexuel, 27 ans, dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, p. 88) ; « Le monde s’est mis alors à trembler autour de moi. La terre s’ouvrait sous mes pieds. L’abîme. J’y suis tombé. Le cycle de la mort aveugle, que j’avais déjà croisé enfant, jeune homme, recommençait. C’était le désert. Le désert et la panique. […] J’avais peur, peur, peur… Peur de partir. » (Abdellah Taïa, Une Mélancolie arabe (2008), p. 93) Par exemple, lors de sa conférence « Différences et Médisances » autour de la sortie de son roman L’Hystéricon, à la Mairie du IIIe arrondissement, le 18 novembre 2010, le romancier français Christophe Bigot parle ouvertement de son rapport idolâtre (d’attraction-répulsion) à la mort, de son « fantasme de guillotine » : « Je suis vraiment phobique à ce qui touche à la torture, à la guillotine, la lapidation, la peine de mort. C’est un truc que je ne guérirai jamais. » Dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, la « peur des malades et des morts » est considérée comme un symptôme d’homosexualité (p. 378). Dans son autobiographique Le Flamant noir (2004), Berthrand Nguyen Matoko parle de son angoisse morbide (« La mort me faisait peur. », p. 98) et tente de « découvrir l’origine de la phobie de la mort comme dans un premier souvenir traumatisant de son enfance, celui de la mort de son grand-père lorsque j’avais 7 ans ». Le cinéaste russe Sergueï Eisenstein, homosexuel, s’est photographié à côté d’un crâne humain.
L’identification à la mort médiatique ou cinématographique sera bien souvent chez elles un réflexe de survie face à une peur excessive de la mort réelle : « Je me complaisais à imaginer des situations dans lesquelles j’étais moi-même tué sur le champ de bataille ou assassiné. Pourtant, j’avais de la mort une peur anormale. » (Yukio Mishima, Confession d’un masque (1971), p. 30) ; « Depuis que j’ai 12 ans, et depuis qu’elle est une terreur, la mort est une marotte. […] La découverte de la mort par le truchement de cette vision horrifique d’un homme qui hurle d’impuissance à l’intérieur de son cercueil devint une source capiteuse de cauchemars. Par la suite, je ne cessai de rechercher les attributs les plus spectaculaires de la mort, suppliant mon père de me céder le crâne qui avait accompagné mes études de médecine, m’hypnotisant de films d’épouvante et commençant à écrire, sous le pseudonyme d’Hector Lenoir, un conte qui racontait les affres d’un fantôme enchaîné dans les oubliettes du château des Hohenzollern, me grisant de lectures macabres jusqu’aux stories sélectionnées par Hitchcock, errant dans les cimetières et étrennant mon premier appareil avec des photographies de tombes d’enfants, me déplaçant jusqu’à Palerme uniquement pour contempler les momies des Capucins, collectionnant les rapaces empaillés comme Anthony Perkins dans ‘Psychose’, la mort me semblait horriblement belle, féeriquement atroce… » (Hervé Guibert, À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie (1990, pp. 158-159) ; « Frisson de tristesse et de tendresse. Je comprends de nouveau mon destin – je ne pourrai jamais être aimé, alors qu’il me faut aimer, et c’est pourquoi j’attends la mort comme une rédemption. J’ai fixé au-dessus de mon bureau cette image de l’innocence rieuse, de la sottise, de la force et de la beauté. » (Klaus Mann en parlant d’une photo du skieur Arosa, dans son Journal (1937-1949), pp. 37-38) ; « New York me désespérait avec une grâce certaine où, la sereine langueur de la pollution piquée par le bruit et la chaleur, apportait un bonheur furtif et réparateur mais où, planaient irrémédiables, mon angoisse de vivre et l’attente de la mort. Damné jusqu’à la fin des temps, encombré de mes grandes jambes inutiles, j’étais seul, la nuit, plein de désirs inexaucés, sans savoir que mes seuls amis étaient les étoiles, émues, anonymes, de ma présence. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 118)
Comme la mort réelle est sublimée voire niée par le cinéma et les médias, elle est souvent perçue par les personnes homosexuelles comme l’origine de la vie et de l’amour : « Mon premier contact avec la maternité, c’est ma mère qui tombe inanimée et qui baigne dans son sang. C’est mon premier souvenir, le plus blessant et le plus percutant. Pour moi qui ne sait rien de la vie, d’un seul coup, la maternité c’est la mort […] c’est pour toutes ces raisons que je suis persuadée aujourd’hui que, bien que me sachant et me revendiquant de sexe féminin, j’ai refusé cette intrusion de l’enfant dans mon ventre. » (Paula Dumont parlant de la fausse couche de sa mère, dans son autobiographie Mauvais Genre (2009), pp. 54-55) ; « Je me suis sentie confusément coupable de la mort du fiancé de Janette Levreau et encore bien davantage du chagrin de cette dernière. Et depuis ces temps troublés, je me suis demandé souvent si je n’avais pas des pouvoirs paranormaux. En tout cas, je veille très attentivement à ne jamais avoir de souhaits homicides. […] Après avoir assassiné mon frère et un jeune militaire, j’ai assez de crimes sur la conscience ! » (Paula Dumont par rapport à sa maîtresse de CM2, Janette, dans son autobiographie Mauvais Genre (2009), p. 47)
f) Quand la comédie devient sérieuse et orgueilleuse : le suicide
Étant donné que la mort peut être à la fois transcendée et niée par les intentions esthétiques et sentimentalistes, beaucoup de personnes homosexuelles en arrivent très souvent à la désirer, ou à se la donner concrètement. « Le taux de suicides chez les jeunes homosexuels est cinq fois plus élevé que la moyenne. » (Peter Gehardt dans son documentaire « Homo et alors ?!? », 2015) ; « Aujourd’hui encore en Suisse, un jeune homosexuel sur 4 fait une tentative de suicide. C’est 3 à 4 fois plus que chez les hétérosexuels. » (la voix-off dans l’émission Temps présent spéciale « Mon enfant est homo » de Raphaël Engel et d’Alexandre Lachavanne, diffusée sur la chaîne RTS le 24 juin 2010 ; dans cette même émission, Alexandre, jeune témoin homo suisse de 24 ans, raconte qu’il a tenté de se suicider).
Par exemple, les écrivains japonais Yasunari Kawabata et Yukio Mishima s’avouent partager « la même attirance de la mort, du suicide et de l’autodestruction » (Yukio Mishima, Correspondance 1945-1970 (1997), p. 8). D’ailleurs, Mishima se suicidera vraiment pour rejoindre son amant Morita, en se faisant hara-kiri. Magnus Hirschfeld prétendra en 1914 que 300 de ses patients, soit 3% des 10 000 individus homosexuels qu’il a reçus, se sont donné la mort. Pour les seules années 1906-1907, on comptait six suicides parmi les sujets homosexuels officiers de l’armée allemande, dont l’existence avait été dévastée par les réclamations de maîtres-chanteurs. Pour sa part, le philosophe français Michel Foucault réclame le « droit au suicide » : « Des gens que nous ne connaissons pas […] ont préparé, avec beaucoup de soin, notre entrée dans le ‘monde’. Il n’est pas admissible qu’on ne nous permette pas de préparer nous-mêmes avec tout le soin que nous souhaitons, ce quelque chose auquel nous pensons depuis longtemps. » (Michel Foucault, « Un Plaisir si simple », Dits et Écrits II, 1976-1988 (2001), pp. 778-779)
Certains individus homosexuels expriment ouvertement leur souhait d’en finir avec leur vie : « Je n’étais pas loin de me fiche en l’air. » (Brahim Naït-Balk, Un Homo dans la cité (2009), p. 130) ; « Le suicide avait longtemps flirté avec mes pensées, mais la peur de mourir avait occulté définitivement cette obsession. » (Ednar dans le roman autobiographique Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 34) ; « Mon désir de mourir est immense. Besoin profond de paix. » (Klaus Mann, Journal (1937-1949), p. 76) ; « Tous les gens vers lesquels je me sens attiré, et qui se sentent attirés vers moi, voudraient mourir. » (idem, p. 49) ; « La vie est un enfer. » (Yves Saint-Laurent s’adressant à son amie Loulou de la Falaise, dans le documentaire « Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé : l’Amour fou » (2010) de Pierre Thoretton) ; « Au milieu de l’été de mes 15 ans, j’ai fait une tentative de suicide. » (Perry Brass, vétéran gay, dans le documentaire « Stonewall : Aux origines de la Gay Pride » de Mathilde Fassin, diffusé dans l’émission La Case du Siècle sur la chaîne France 5 le 28 juin 2020) ; etc.
Il y en a malheureusement qui sont passés concrètement à l’acte : Alfredo Ormando (qui s’est immolé en 1998 devant les bâtiments du Vatican), Bobby le jeune fils gay de Mary Griffith (qui a sauté du haut d’un pont d’autoroute aux États-Unis), Leslie Cheung (l’acteur homosexuel chinois qui s’est jeté le 1er avril 2003 du 24e étage du Mandarin Hôtel de Hong Kong), Carl-Joseph Walker-Hoover (un jeune garçon noir de 11 ans aux États-Unis, le 6 avril 2009), etc. On ne compte plus les personnalités homosexuelles qui se sont suicidées en vrai : Hart Crane, René Crevel, Philippe Jullian, Heinrich von Kleist, Jan Lechon, Yves Navarre, Louis Goulven Salou, Virginia Woolf, James Whale, Friedrich Krupp, Alan Turing, Roger Stéphane, Raymond Roussel, Pierre Molinier, Adrienne Monnier, Mario Mieli, Klaus Mann, Jean-Louis Bory, Fersen, Claude Cahun, Jean Boullet, Alain Pacadis, Louis II de Bavière, Annemarie Schwarzenbach, Bernard Buffet, Otto Weininger, Benedict Friedlander, Benedict Friedländer, Aaron Hernández, Stefan Sweig, etc. « Il y a aussi des allusions à une tentative de suicide qu’elle avait faite quand elle était adolescente… Hélène était malade. La plupart du temps, elle était brillante, elle passait aussi par des épisodes de dépression où, de son propre aveu, elle n’était plus elle-même. » (Paula Dumont, La Vie dure : Éducation sentimentale d’une lesbienne (2010), p. 57) ; « Sans hygiène morale ni physique, leur tendance au déséquilibre, la drogue les conduisent souvent au suicide. » (Jean-Louis Chardans parlant des travestis, dans son essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p. 291) ; « Il y a toujours du chantage entre nous. C’est très très répandu. Ça se passe par des lettres ou des téléphones. Y’a mon premier ami que j’ai perdu de cette manière, d’ailleurs. Il s’est suicidé. À cause d’un chantage, oui. » (Frank, témoin homosexuel suisse, dans le documentaire « Les Homophiles » (1971) de Rudolph Menthonnex et Jean-Pierre Goretta) ; etc.
Dans les émissions de « télé-réalité » françaises, les stars d’un quart d’heure homosexuelles qui se sont données la mort ne manquent pas : on peut penser au suicide par pendaison de « Jpé », l’un des participants de Trompe-moi si tu peux (juin 2010) sur la chaîne M6 ; ou encore au suicide d’« FX » (François-Xavier Leuridan) de Secret Story 3 (2009) sur la chaîne TF1 (lui s’est jeté sous une voiture qui circulait sur autoroute).
Parmi les personnes transgenres ou transsexuelles, le taux de suicide bat tous les records, notamment parce qu’elles nient leur sexuation, ont souvent été violées étant petites, ou bien parce que leur « transition » est douloureuse et laisse de lourdes séquelles. Par exemple, dans le documentaire « Mr Angel » (2013) de Dan Hun, Buck Angel, transsexuel F to M, est passé par plusieurs tentatives de suicides et addictions à la drogue.
Le désir de mort n’est évidemment pas propre aux personnes homosexuelles. Sigmund Freud constate l’existence d’une destructivité foncière chez l’Homme, qu’il appelle « pulsion de mort ». Cependant, il semblerait que le désir homosexuel, plus que d’autres désirs humains, est davantage un élan qui oriente vers la mort qu’un élan de vie. Dans son essai Homoparenté (2010), le psychanalyste Jean-Pierre Winter explique d’ailleurs comment le rejet de la différence des sexes dans le couple homosexuel induit un « déni de la différence entre la vie et la mort » (p. 135), donc un glissement vers la destruction, la désincarnation et la division de l’être humain, du couple, et de la famille.
Avec Facebook apparaissent aussi les cas médiatisés d’adolescents dont le suicide est présenté caricaturalement comme une conséquence directe de l’homophobie soi-disant « non-homosexuelle » (Tyler Clementi, ce violoniste introverti qui se suicida en 2010 parce que ses ébats homosexuels avaient été filmés par son colocataire ; Lance Lundsten, un lycéen de 18 ans, dans le Minnessotta, en 2011 ; Kameron Jacobsen, un jeune New-yorkais de 14 ans, en 2011 ; Jack Reese, mort à 17 ans, en 2012 ; Jeffrey Fehr, 18 ans, harcelé à l’école au nom de son homosexualité, et qui s’est suicidé en janvier 2012 en Californie ; etc.). Je vous renvoie à la campagne « It Gets Better » (« Ça ira mieux ») de Dan Savage, menée en 2010 sur YouTube contre la vague de suicides des jeunes gay, et qui fut relayée par des personnalités des États-Unis telles que Barak Obama, David Paterson, Hillary Clinton, Gloria Estefan, etc.
On remarquera que le dossier des « suicides d’homosexuels » ou des « suicides pour cause d’homophobie » sert à alimenter une véritable censure sur les réelles causes des suicides des personnes homosexuelles, qui ne sont pas tant exogènes qu’endogènes (cf. je vous renvoie à mon papier sur les clés pour sortir des tentations de déprime ou d’envies de suicide liées à l’homosexualité). En effet, si on regarde bien les cas où les individus homosexuels ont mis fin à leurs jours, on constate que leurs suicides s’expliquent certes par des facteurs extérieurs à reconnaître, mais principalement par des histoires internes au « milieu LGBT », par les attitudes inadmissibles des personnes homosexuelles entre elles dans le cadre amoureux : « Je souffris de nouveau énormément de cet amour malheureux : je fus même au bord du suicide. » (Jean-Luc, homosexuel, 27 ans, dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, p. 81) ; « J’en arrive même à me persuader que je n’aurai pas à me suicider parce que cet amour va s’en charger à ma place. » (Alexandre Delmar, Prélude à une vie heureuse (2004), p. 59) Par exemple, Malcolm Lowry a refusé les avances d’un camarade de lycée, qui s’est ensuite suicidé.
Le plus paradoxal, c’est que beaucoup de personnes homosexuelles, en se focalisant sur des termes tels que « homophobie » ou « suicide » qu’elles ne veulent surtout pas comprendre, en faisant l’autruche pour que les causes des suicides de personnes homosexuelles ne soient pas identifiées – et ce, toujours dans un principe bien-intentionné de sur-protection des victimes –, poussent finalement les individus homosexuels qu’ils veulent préserver du suicide au suicide, en inversant les problèmes et leurs solutions. Par exemple, dans l’émission Homo Micro du 13 février 2007, Jean Le Bitoux conseille aux personnes homos de ne pas aller voir les psys car « il y a des suicides après ». Or c’est précisément parce qu’elles ne vont pas voir de bons psys et des amis qui pourraient les aider à mettre des mots sur leur mal-être qu’elles en viennent justement à commettre parfois l’irréparable.
La problématique des suicides des gens homosexuels est bien sûr sociale, mais aussi et surtout individuelle et désirante. Nous aurions tout intérêt – parce qu’on ne le fait pas assez – de nous pencher sur la question de la haine de soi (que traduit le désir homosexuel), de l’orgueil blessé, de l’éloignement du Réel par l’esthétique de la mort, de l’impact parfois dramatique de certains médias dans le processus de construction de l’identité sexuée et sexuelle de nos contemporains, pour traiter de l’étiologie des suicides des sujets homosexuels.
Car en général, c’est l’excessive identification sentimentaliste à la star suicidaire (il suffit de prendre un peu au sérieux l’esthétisme mélancolique d’une Dalida, d’une Marilyn Monroe, d’une Judy Garland, ou d’une Mylène Farmer, pour s’abandonner à la mort) qui sert à un certain nombre de personnes homosexuelles d’alibi au suicide : « Je n’ai jamais oublié Souad Hosni. Je n’avais pas oublié son feuilleton Houa et Hiya qui me faisait courir dans mon adolescence, à la sortie du collège. J’avais depuis rattrapé mon retard en regardant presque tous les films qu’elle avait tournés. Je l’avais suivie de près, de très près, avec attention et une certaine admiration. Et puis, au début des années 90, après l’échec retentissant de son film ‘Troisième Classe’, elle avait disparu. Pendant deux ou trois ans, on ne savait pas où elle était. Elle se cachait en fait à Londres où elle soignait un mal de dos et une dépression chroniques. On la disait sans le sou, ruinée. L’État égyptien, qui payait pour son hospitalisation, avait fini par la lâcher, l’abandonner. En juin 2001, elle s’était suicidée en se jetant du balcon de l’appartement où elle résidait à Londres. » (Abdellah Taïa, Une Mélancolie arabe (2008), p. 91) ; « Là, dans cette obscurité, dans cette exécution, cette mort volontaire, je me suis souvenu de ma sœur hantée. » (Abdellah Taïa à son amant Slimane, op. cit., p. 123)
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.