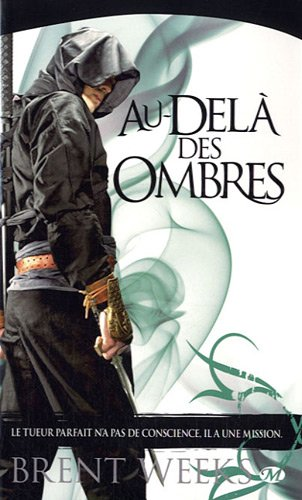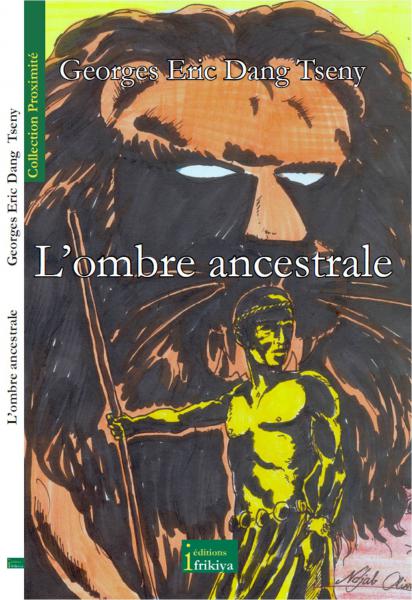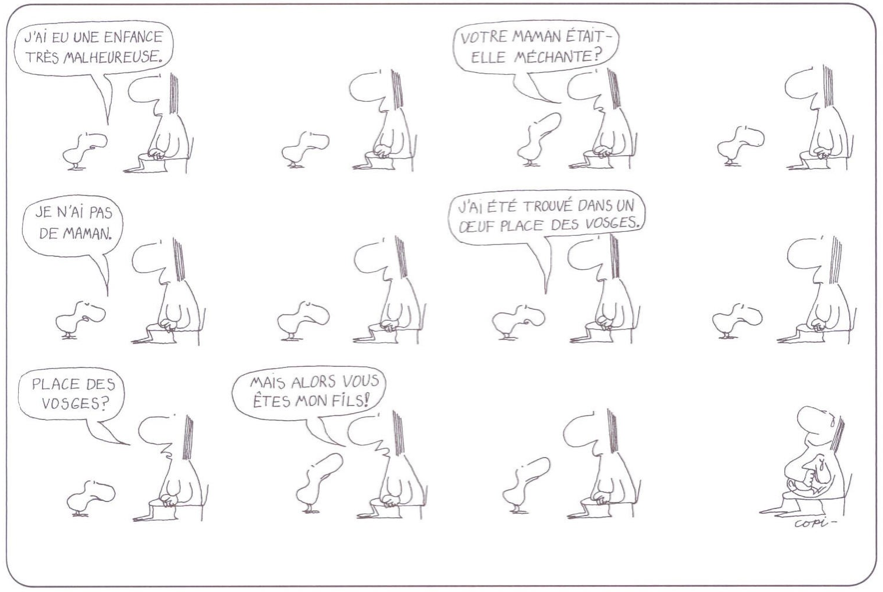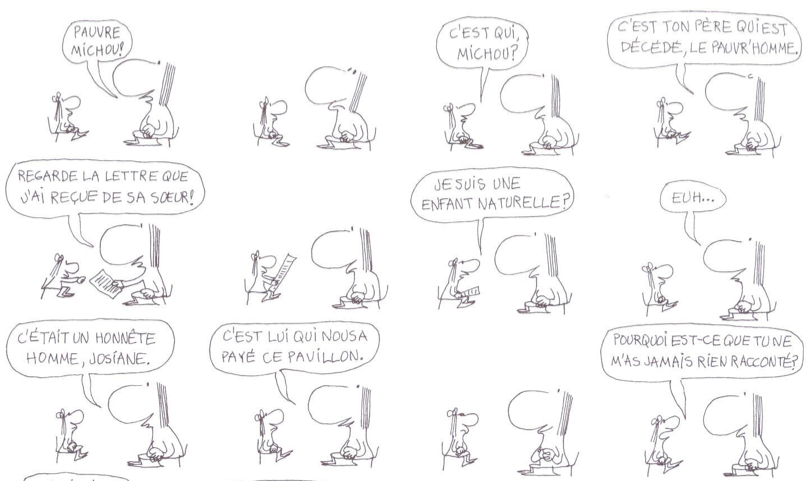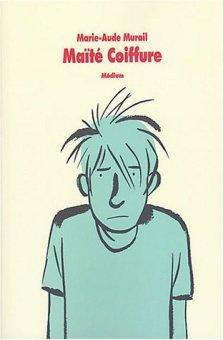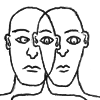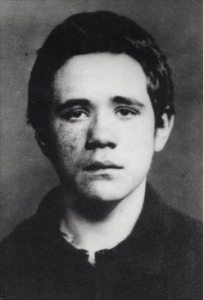Ombre
NOTICE EXPLICATIVE :
Dans l’iconographie homosexuelle, la conscience expulsée du personnage homosexuel apparaît souvent sous la forme de l’ombre. Symboliquement, cela a du sens. Un bon nombre de personnes homosexuelles considèrent, parce qu’elles le fantasment, mais aussi parce que cela peut être vrai, que quelqu’un leur a fait de l’ombre dans leur vie : leur père, leur mère, leur frère, un camarade de classe, une célébrité, leur amant homosexuel, elles-mêmes à l’état de reflet dans le miroir ou de photo jaunie sur un pêle-mêle. Elles s’imaginent qu’aux yeux des autres elles n’existent pas pour elles-mêmes mais pour une lignée abstraite, un passé « glorieux » pesant (cf. je vous renvoie à la partie sur la « Peur d’être unique » du code « Moitié » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels). Ce n’est pas par hasard si la métaphore de l’enfant déambulant dans la galerie où sont exposés tous les tableaux des victoires supposées de ses aïeux vient fréquemment habiter la fantasmagorie homosexuelle. Le drame homosexuel, selon moi, n’est ni plus ni moins que de se prendre pour une photocopie, de douter de son originalité et de son unicité. Nombreux sont les enfants de personnes célèbres qui se disent homosexuels parce qu’ils ont longtemps souffert de leur statut de « fils de… (l’Homme invisible ombreux) » : Judith Gauthier, Anna Freud, Lucien Daudet, Maurice Rostand, Jaime Salinas, Klaus Mann, Siegfried Wagner, Saadi Khadafi, etc. Par exemple, Robin Maugham, neveu de Somerset Maugham – lui-même homosexuel –, a écrit une autobiographie dont le titre est éloquent : Escape From The Shadows (traduction française : « Fuir les ombres »).
Quand l’ombre apparaît dans les œuvres artistiques homosexuelles, en général, ce n’est pas dans un sens positif. Idéalement, elle aurait pu être envisagée comme la marque salutaire de notre incarnation humaine, l’heureux signe de notre « être-au-monde », la preuve que nous sommes certes limités mais aimés/réchauffés par un Dieu solaire… Mais non. Pour la conscience homosexuelle, l’ombre est plutôt synonyme d’ambiguïté oxymorique diabolique (l’amant homosexuel se révèle sous un jour décevant, triste ou violent), envisagée comme le « côté obscur de la force » de l’amour homosexuel, comme le poids pesant d’une hérédité niant l’unicité de l’être humain. La peur d’être unique, voilà bien l’un des terreaux majeurs du désir homosexuel.
N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Doubles schizophréniques », « Mère possessive », « Parricide la bonne soupe », « Actrice-Traîtresse », « Inceste », « « Je suis un Blanc-Noir » », « Moitié », « Inceste entre frères », « Innocence », « Amant diabolique », « Couple homo enfermé dans un cinéma », « Morts-vivants », « Haine de la famille », « Fantasmagorie de l’épouvante », « Clown blanc et Masques », « Fresques historiques », « Homme invisible », « Poids des mots et des regards », « Se prendre pour le diable », « Mère gay friendly », « S’homosexualiser par le matriarcat », « Noir », « Fusion », « Jumeaux », à la partie « Ombres chinoises » du code « Femme et homme en statues de cire », à la partie « Crâne en cristal » du code « Chevauchement de la fiction sur la Réalité », à la partie « Peter Pan » du code « Parodies de Mômes », à la partie « Père et fils gays » du code « Inceste », et à la partie « Veuve » du code « Mort = Épouse », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.
FICTION
a) L’ombre au tableau :
Il est beaucoup question d’ombre dans les œuvres fictionnelles traitant d’homosexualité. Souvent, le personnage homosexuel est suivi par une obscurité énigmatique : cf. le poème « Les Étrennes des orphelins » d’Arthur Rimbaud, le film « Les Ombres gigantesques » (1922) de Loïe Fuller, les chansons « Avant que l’ombre » et « À l’ombre » de Mylène Farmer, le conte L’Ombre d’Hans Christian Andersen, le roman L’Ombre (1941) de Francis Carco, la pièce Nietzsche, Wagner, et autres cruautés (2008) de Gilles Tourman, le film « Les Ombres de la nuit » (2004) de J. T. Seaton, le film « Prora » (2012) de Stéphane Riethauser, le film « De l’ombre il y a » (2015) de Nathan Nicholovitchetc, la chanson « Shadowland » de K.D. Lang, la chanson « Le Long des berges grises » de Reda Caire, la chanson « I’m The Boy » de Serge Gainsbourg, etc.
En général, l’ombre est de mauvais augure : « Nous nous sommes allongés dans l’herbe à l’ombre d’un arbre en lisière de la route, lorsqu’un bruit de moteur nous tire de notre ennui. Une forme apparaît au loin dans le ciel. Un aéroplane. Nous le regardons s’approcher, incrédules et curieux. Il vient vers nous. Tout à coup, un cri retentit : ‘C’est un avion allemand. Il va nous tirer dessus !’ » (Madeleine dans le roman À mon cœur défendant (2010) de Thibaut de Saint-Pol, p. 34) ; « Les bâtiments abandonnés sont comme les gens abandonnés. Ils deviennent aigris et peu fréquentables. Vous n’avez pas vu des ombres traverser la cour la nuit ? » » (Karl Becker s’adressant à Jane, l’héroïne lesbienne, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 67) ; « Jane regarda une nouvelle fois le bâtiment en ruine qui s’élevait de l’autre côté de la rue, comprenant que, même en été, son ombre s’étirerait dans la chambre, étouffant toute chance de chaleur. Elle avait pris l’immeuble de derrière pour une réplique, plus jolie que le leur, plus élégant et rénové, mais peut-être était-ce l’inverse et leur bâtiment était-il le reflet de l’immeuble délabré. Cette idée lui donna l’impression d’être petite, et l’enfant qu’elle portait plus petit encore, un poisson solitaire piégé dans des eaux fluviales. » (idem, pp. 70-71) ; « L’obscurité commençait à filtrer à l’intérieur de l’église, les ombres des arbres du cimetière entraient par les fenêtres en vitrail et s’allongeaient sur les dalles de pierre. » (idem, p. 204) ; « Love Song quand je vois l’ombre nous séparer. » (cf. la chanson « Love Song » de Mylène Farmer) ; « Vous êtes très obscure. » (Geoffrey s’adressant à l’écrivaine lesbienne Virginia Woolf, dans le film « Vita et Virginia » (2019) de Chanya Button) ; etc. Par exemple, dans la pièce L’Ombre de Venceslao (1977) de Copi, la mort-ombre est omniprésence et porte malheur à tous les personnages : Venceslao le gaucho se suicide, Rogelio est empoisonné, sa jeune femme meurt sous les balles des militaires, etc.
b) Je ne suis que l’ombre de moi-même :
Souvent, c’est le héros homosexuel qui se prend pour l’ombre : cf. le roman Les Vivants et leur Ombre (1977) de Jacques Lacretelle, le film d’animation « L’Ombre d’Andersen » (2000) de Jannik Hastrup, le roman El Beso De La Mujer-Araña (Le Baiser de la Femme-Araignée, 1976) de Manuel Puig (avec Léni, la « collabo »), le roman Si j’étais vous (1947) de Julien Green (avec le personnage diabolique de Brittomart, qui agit comme un double malfaisant du héros), la pièce L’Héritage de la Femme-Araignée (2007) de Christophe et Stéphane Botti (avec Audric parlant à son ombre), etc.
« J’ai toujours préféré l’ombre et la liberté qu’elle autorise. » (Cyril, l’internaute psychopathe surdoué du roman Pavillon noir (2007) de Thibaut de Saint Pol, p. 12) ; « Moi, c’est Claire et je me mets souvent dans des situations sombres. » (Claire à sa compagne de cellule, dans la pièce Une Heure à tuer ! (2011) d’Adeline Blais et Anne-Lise Prat) ; « Vous n’êtes plus qu’une ombre. » (la Reine s’adressant au Rat dans la pièce La Pyramide ! (1975) de Copi) ; « Je singe les ombres. » (cf. la chanson « Monkey Me » de Mylène Farmer) ; « Les ténèbres, je connais bien. » (le Baron Lovejoy, homosexuel, dans la comédie musicale La Nuit d’Elliot Fall (2010) de Vincent Daenen) ; « Ma vie me faisait peur, je ne faisais que jouer un rôle… et je ne redevenais que moi-même quand j’étais dans le noir. La solution c’était le noir éternel ou porter une perruque sur une scène. » (Actrice, dans la pièce Parano : N’ayez pas peur, ce n’est que du théâtre (2011) de Jérémy Patinier) ; « Sûrement que le soleil s’éteint et que Lucifer me guide, et je serai une ombre comme la Tour de Babel… et ton amour, Père rappelle-toi !! L’Église promulgue que je suis une pédale de merde, si c’est ça mon péché, je suis coupable, comme une infâme Inquisition. Mais je n’ai tué personne. » (cf. la chanson « Madre Amadísima » de Haze et Gala Evora) ; etc.
Comme pour Peter Pan, l’ombre représente souvent ce double schizophrénique et narcissique du héros, l’immaturité de ce dernier, sa mauvaise conscience, sa peur d’exister, sa méchanceté (espiègle ?) : cf. le roman La Sombra Del Humo En El Espejo (1924) d’Augusto d’Halmar, le film « Le Testament d’Orphée » (1959) de Jean Cocteau (avec la figure du poète emporté par deux ombres de cheval), etc. « C’est pas moi ; c’est mon ombre. » (Andersen dans le film « L’Ombre d’Andersen » (2000) de Jannik Hastrup) ; « Stephen [l’héroïne lesbienne] décida sombrement qu’elle avait dû rester enfant. » (Marguerite Radclyffe Hall, The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928), pp. 111-112) ; « Ton ombre suit ton corps de trop très. » (Paul s’adressant à son amant Jean-Louis dans la pièce Perthus (2009) de Jean-Marie Besset) ; « Faisons à nous deux un héros de roman. […] J’irai dans l’ombre à ton côté. Je serai l’esprit. Tu seras la beauté. » (Cyrano à Christian dans la pièce Cyrano intime (2009) d’Yves Morvan) ; « Tu n’es plus que l’ombre de toi-même. » (cf. la chanson « Bambino » de Dalida) ; « Je ne supporterai pas plus longtemps de vivre dans l’ombre. » (Gabriel s’adressant à son amant Philippe qui ne l’assume pas, dans la pièce Mon frère en héritage (2013) de Didier Dahan et Alice Luce) ; etc.
C’est souvent un personnage diabolique qui revêt le costume de l’ombre : « Un homme s’avance dans les salles à peine éclairées du musée. Son ombre glisse sur chaque tableau, le visiteur nocturne sait qu’il ne sera pas inquiété. […] Il a les cheveux longs, légèrement ondulés. Il est habillé tout de noir et a gradé son imperméable. […] Il a l’air de parler tout seul, mais cette impression est la conséquence des nouvelles technologies, qui rendent les téléphones portables presque invisibles. […] La Mission commence. […] La femme qui vient à la rencontre de l’homme énigmatique, dans la salle numéro cinq, sait très bien, elle aussi, ce que la ‘Mission’ recouvre comme réalité. […] Le Maître est le numéro un d’une organisation plus ou moins secrète, dont le nom complet est : La Guilde de Saint Dibutades. […] La Guilde a rompu ses liens avec l’Église à la fin du seizième siècle, lorsque ses membres ont canonisé Dibutades, contre l’avis de la papauté. Aujourd’hui encore, la puissance de l’organisation s’étend à la planète entière, mais seuls le Maître et ses proches associés en connaissent la véritable ampleur. » (Jean-Philippe Vest, Le Musée des amours lointaines (2008), pp. 15-16) Par exemple, dans le film d’animation « La Princesse et la Grenouille » (2009) de Ron Clements et John Musker, le marabout Dr Facilier, autoproclamé le « Maître des Ombres », est particulièrement efféminé.
Il n’est pas rare que l’ombre soit la figure esthétisée de la mort/de la femme violée jugée « belle » par le personnage homosexuel (cf. je vous renvoie à la partie « Veuve » du code « Mort = Épouse » dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels) : « Je suis fatiguée des ombres. » (Sibylle s’adressant à Dorian qui la poussera au suicide, dans le roman Le Portrait de Dorian Gray (1890) d’Oscar Wilde) ; « La mère est là. Elle est là, droite, debout devant moi, raide dans la douleur. Sa raideur ressemble à la rigidité d’un cadavre. Ce n’est pas l’expression d’une forme de dignité même si je ne doute pas un seul instant que cette femme soit d’une exemplaire dignité. C’est l’immobilité de la souffrance absolue, la position de qui lutte pour ne pas mourir. […] La mère est là. Elle est grise, comme si le visage était de cire, comme si toute lumière avait disparu, comme si l’ombre avait affaissé tous ses traits, comme si l’obscurité s’était emparée d’elle. […] On est submergé par sa douleur à elle. » (Vincent décrivant la mère de son petit ami Arthur qui a perdu son fils à la guerre, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, pp. 189-192) ; « La duchesse d’Albe se tenait presque cachée dans l’ombre d’un jasmin, le visage dissimulé sous une mantille noire. » (Copi dans sa nouvelle « L’Autoportrait de Goya » (1978), p. 13) ; « Est-ce moi qui tangue comme une ombre sur les talons d’une reine en cavale ? » (cf. la chanson « Les Enfants de l’aube » de Bruno Bisaro) ; « Quand j’arrivai dans le dernier couloir menant à la tour Nord, j’eus la certitude d’apercevoir de nouveau un morceau de robe blanche et les rubans d’une robe de mariée flotter un instant à l’autre bout du lugubre corridor, avant de disparaître dans l’ombre. » (Bathilde parlant du fantôme Lady Philippa qu’elle considère comme une jumelle tragique, dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 304) ; etc. Par exemple, dans le roman La Cité des rats (1979) de Copi, Bijou, la Reine des rats, se fait aussi appeler « La Reine des Ombres » (p. 27).
L’identification du héros homosexuel à la pénombre annonce sa mort prochaine ou effective. Par exemple, dans la pièce La Dernière Danse (2011) d’Olivier Schmidt, Jack, l’un des deux amants de l’intrigue, se définit comme une ombre (« Ça fait longtemps que je suis mort ? Peut-être trop longtemps. »), un « mec vampirisé » par son amant Paul : il finit d’ailleurs par se suicider. Dans la pièce L’Ombre de Venceslao (1977) de Copi, le héros, Venceslao, se pend après s’être confessé au perroquet de sa maîtresse, et revient sous la forme d’une ombre.
c) Être « le fils de », le fils de l’ombre :
Dans les fictions homo-érotiques, l’ombre renvoie généralement à quelqu’un qui a fait de l’ombre dans la vie du héros homosexuel : son père, sa mère, son frère, une actrice, lui-même (en chair et en os).
Cela peut être l’ombre du père qui lui fait ombrage par sa célébrité et ses hautes fonctions : cf. le roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman (avec Ronit, l’héroïne lesbienne, fille d’une sommité du monde juif : le Rav), le film « Le Neveu de Beethoven » (1985) de Paul Morrissey, le film d’animation « Shark Tale » (« Le Gang des Requins », 2004) d’Éric Bergeron (avec Lenny, le requin douillet et mauviette, dont le père, Don Dino, n’est rien moins que le parrain du gang des requins), le film « Celui par qui le scandale arrive » (1960) de Vincente Minnelli, le roman Portrait de Julien devant la fenêtre (1979) d’Yves Navarre, le film « All Over Brazil » (2003) de David Andrew Ward, le roman La Confusion des sentiments (1928) de Stefan Zweig, le film « Laberinto De Pasiones » (« Le Labyrinthe des passions », 1982) de Pedro Almodóvar, le roman Le Fils du Président (2001) de Krandall Kraus, le film « My Own Private Idaho » (1991) de Gus Van Sant (avec Scott, le héros homosexuel dont le père est le maire de la ville), etc.
« À seize ans, moi, j’étais encore seulement un fils. Le fils d’un très grand médecin, le saviez-vous ? L’agrégation, la faculté, l’Académie, la faculté, l’Académie, toutes ces choses en imposent à un fils. Je me souviens d’une ombre portée sur nos vies, d’un homme plus grand que nous tous, sans que nous sachions véritablement si cette grandeur était une aubaine ou un malheur pour notre futur d’homme. Aujourd’hui, avec le recul, sans doute, je dirais que notre indifférence réciproque était plus feinte que réelle, et qu’au final j’aurai appris de mon père. » (Vincent, le jeune héros homosexuel de 16 ans, parlant de son père à Marcel Proust, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 54) ; « Je sais l’importance qu’il accorde à la lignée, comme si nous étions des pur-sang chargés de reproduire l’espèce. » (idem, p. 96) ; « Le maire du village, c’est mon père. C’est pas drôle. Depuis qu’il sait que je suis homo, il ne veut plus me voir. Ça fait 6 ans qu’on ne se parle plus. » (Antoine, héros homosexuel, dans le téléfilm « Le Mari de mon mari » (2016) de Charles Nemes) ; « Cecilia a toujours travaillé dans l’ombre de sa mère. » (Dallas, l’assistant-couturier homosexuel œuvrant au service de la grande styliste, dans l’épisode 98 « Haute Couture » de la série Joséphine ange gardien) ; etc.
Par exemple, dans la pièce La Mort vous remercie d’avoir choisi sa compagnie (2010) de Philippe Cassand, Éric, le héros homosexuel, est le fils du présentateur télé Georges de la Ferrinière (lui-même homosexuel !). Dans le film « K@biria » (2010) de Sigfrido Giammona, Giovanni, le père de Francesco, est politicien et se montre incapable d’accepter l’homosexualité de son fils. Dans le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza, Zach, le héros homosexuel, est le fils du directeur de l’université. Dans le téléfilm « Le Clan des Lanzacs » (2012) de Josée Dayan, Barthélémy, le jeune héros homosexuel, est l’un des héritiers de l’Empire Lanzac et vit dans l’ombre de son père, chef d’entreprise. Dans la pièce En ballotage (2012) de Benoît Masocco, Édouard, le héros homosexuel, a pour père le président de la République, Gérard Couret, homophobe au possible, et qui lui met une pression incroyable pour la passation de pouvoir ; Sofia, la secrétaire de Gérard, exerce aussi sur lui la pression de l’héritage politique : « T’as ça dans le sang ! Tu as le sang de ton père ! » Dans la nouvelle « L’Apocalypse des gérontes » (2010) d’Essobal Lenoir, le fils du Roi Rigane est homosexuel… ce qui ne semble pas faire l’orgueil de son père : « J’aurai même un fils homosexuel pour justifier qu’on dépense de l’argent pour cette maladie de tantouses […]. » (p. 134) Dans le film « Dallas Buyers Club » (2014) de Jean-Marc Vallée, Rayon, le héros transsexuel M to F, se rend chez son père, homme politique riche, pour lui demander de l’argent ; il vit encore avec le poids du regard sombre de ce dernier sur lui : « As-tu honte de moi ? » Dans le film « Rafiki » (2018) de Wanuri Kahiu, les deux héroïnes lesbiennes, Kena et Ziki, ont chacune respectivement leurs pères qui se présentent (en rivaux, donc) aux élections d’une municipalité de Nairobi (Kenya), Slopes : John Mwauras et Peter Okemi. Dans la série Sex Education (2019) de Laurie Nunn, Adam, le héros homo, est le fils du proviseur (Monsieur Groff) et en souffre : « J’aimerais être un mec normal avec une queue normale et un père normal ! » (c.f. épisode 1 de la saison 1).
La mère peut également exercer une influence sombre sur son fils ou sa fille homosexuel(-le) : cf. le film « Homme aux fleurs » (1984) de Paul Cox, le film « Mon fils à moi » (2006) de Martial Fougeron, le film « Sonate d’automne » (1978) d’Ingmar Bergman, le film « Psycho » (« Psychose », 1960) d’Alfred Hitchcock, le film « Tacones Lejanos » (« Talons aiguilles », 1991) de Pedro Almodóvar (avec l’ombre des chaussures de la mère sur l’affiche), le film « Mi Hijo No Es Lo Que Parece » (1973) d’Angelino Fons, etc. Je vous renvoie évidemment aux codes « Mère gay friendly », « Mère possessive » et « S’homosexualiser par le matriarcat », dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels.
« Je me laisse mourir au fond de mon lit avec pour seule compagne l’ombre de ma mère emprisonnée entre mes bras qui brassent le vide. […] Vivre cachée comme une chose dans l’ombre de ma mère. » (la narratrice lesbienne du roman La Voyeuse interdite (1991) de Nina Bouraoui, p. 64)
L’homosexualité du héros apparaît alors non pas comme une identité naturelle et libre, mais comme une stratégie de résistance et d’opposition, comme la cristallisation d’une peur (réelle ou projetée) de décevoir les attentes du père/de la mère, comme le produit de l’homophobie parentale et de sa propre homophobie intériorisée : « J’pourrais me raser le crâne pour ne pas lui ressembler. » (Chloé parlant de sa mère, dans la pièce Scènes d’été pour jeunes gens en maillot de bain (2011) de Christophe et Stéphane Botti) ; « Stephen [l’héroïne lesbienne] profitait, semblait forte, et quand ses cheveux poussèrent, on découvrit qu’ils étaient auburn comme ceux de Sir Philip [le père de Stephen]. Il y avait aussi une petite fente à son menton, si petite qu’elle sembla d’abord une ombre ; et quelques temps après […], Anna [la mère de Stephen et l’épouse de Philip] vit que ses yeux devenaient pers et pensa que leur expression était celle du père. […] Anna croyait devenir folle car cette ressemblance avec son mari la frappait comme un outrage. Elle haïssait la façon dont Stephen se mouvait. » (Marguerite Radclyffe Hall, The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928), pp. 20-23)
d) Être « le frère de », le frère de l’ombre :
Cf. je vous renvoie au code « Jumeaux » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels.
Parfois, c’est le frère du héros homosexuel qui est l’ombre portée. « Mon frère a surgi de nulle part. » (Donato, le héros homosexuel, parlant de son frère Ayrton, dans le film « Praia Do Futuro » (2014) de Karim Aïnouz) Certains personnages homosexuels ont l’impression de remplacer le frère mort ou idéalisé par la famille : cf. le film « Le Clan » (2003) de Gaël Morel, le téléfilm « Juste une question d’amour » (2000) de Christian Faure (avec l’ombre du cousin homosexuel décédé sur Laurent, le héros homosexuel), le film « Celui par qui le scandale arrive » (1960) de Vincente Minnelli, etc.
Dans le film « Joyeuses Funérailles » (2007) de Franz Oz, Daniel déclare vivre constamment « dans l’ombre de son frère Robert ».
e) La pression d’une lignée sombre ou trop glorieuse :
Sur les épaules du héros homosexuel pèse souvent le lourd fardeau d’un héritage familial et national présenté comme glorieux, le poids de la responsabilité d’assurer la descendance (c’est parfois lui-même qui se met la pression tout seul) : cf. la nouvelle « À l’ombre des bébés » (2010) d’Essobal Lenoir, etc.
« Il va hériter du blason, du château, des estancias et de mes îles d’Outremer ! Et nous allons tout tenter pour en faire un Vice-Roi ! » (Pédé parlant de son petit-fils Gilles Blaise de la Soledad, dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « Tanguy s’arrêta devant un petit hôtel dont la façade régulière accusait le style français. Il sourit. Il trouvait amusant de penser qu’il était le petit-fils de celui qui avait habité cet hôtel, et possédé des terres innombrables et des maisons à travers toute l’Espagne. » (Michel del Castillo, Tanguy (1957), pp. 180-181) ; « Dans son orgueil de mâle, Clément de Bassignac avait vécu les cinq premières maternités de son épouse comme une réelle frustration. Dylan [le héros homo, le sixième enfant après cinq filles], dès sa naissance, cet enfant ‘mâle’, fut la gloire et la fierté de sa famille. Le ciel leur envoyait Dylan pour aider Clément à hisser la bannière de sa virilité comme lui-même avait tenu naturellement ce rôle auprès de son père Étienne de Bassignac. » (Jean-Claude Janvier-Modeste, dans son roman semi-autobiographique Un Fils différent (2011), p. 32) ; « De toute façon, vous ne pouvez rien pour moi. Au-dessus de moi, il y a tout le poids de mon éducation. » (une patiente à sa psy dans la pièce Psy Cause(s) (2011) de Josiane Pinson) ; « Quoi qu’elle [Gabrielle, l’héroïne lesbienne] ait réalisé, jamais elle n’en a reçu la moindre reconnaissance sociale ; toute l’admiration, la célébrité sont revenues aux hommes de la famille : à son grand-père, le pionnier, à son père, le fondateur de l’usine, puis à son mari, ‘ingénieur aux cent brevets’. Elle n’a été qu’une femme de l’ombre, à la suite de tant d’autres… » (Élisabeth Brami, Je vous écris comme je vous aime (2006), p. 50)
Par exemple, dans la pièce À toi pour toujours, ta Marie Lou (2011) de Michel Tremblay, Manon ne supporte pas d’être le portrait craché de son père ; et sa grande sœur Carmen n’accepte pas davantage de vivre dans l’ombre de sa sœur Manon. Dans le one-man-show Un Barbu sur le net (2007) de Louis Julien, le protagoniste affirme être « le raté de la famille ». Dans son one-man-show Les Bijoux de famille (2015), Laurent Spielvogel décrit le poids de la tradition juive et de la pression nataliste pesant sur ses épaules. Dans la pièce Hétéro (2014) de Denis Lachaud, les deux pères de Gatal, le héros homosexuel, lui mettent une pression de malade pour qu’il se marie, perpétue leur nom de famille et leur race : « Ta semence est épaisse et riche. » ; « Tu es le prétendant, cow-boy ! » ; « Il faudra bien t’assurer que ta descendance est bien le fruit de ta descendance. » Le promis de Gatal ressent cette même chape de plomb : « Pourquoi cet héritage empoisonné ? » clame-t-il à ses parents qu’il nomme « les fantômes du passé ».
Dans le film « Mine Vaganti » (« Le Premier qui l’a dit », 2010) de Ferzan Ozpetek, Tommaso, le héros homosexuel, porte un double poids sur les épaules : il doit reprendre l’entreprise de pâtes de son père qui lui fout une pression de malade (alors qu’il aspire à une carrière littéraire) ; et il doit aussi supporter le coming out inattendu de son frère Antonio, révélation qui l’empêche de faire la sienne.
Parfois, le héros homosexuel se dévalorise en se comparant à une famille fictionnelle et cinématographique (ses stars, ses héros de dessins animés et de films, une figure politique lointaine et charismatique…) plutôt qu’à sa famille réelle : cf. le film « Merci… Dr Rey ! » (2003) d’Andrew Litvack, le roman À l’ombre des jeunes filles en fleurs (1919) de Marcel Proust, la chanson « Du côté de chez Swann » de Dave, le roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa (avec l’ombre du roi Hassan II), etc. Par exemple, dans son one-man-show Gérard comme le prénom (2011), l’humoriste Laurent Gérard a peur/en a marre d’être confondu avec l’imitateur Laurent Gerra : « Qu’on ne me prenne plus pour un homonyme ! » Dans le film « Sacré Graal » (1974) de Terry Gilliam et Terry Jones, le prince Herbert souffre d’être le fils deux parents célébrités.
f) L’enfant homosexuel visitant le Panthéon de ses ancêtres :
Scénario curieux. Très souvent dans les œuvres homo-érotiques, on peut observer la même mise en scène : le personnage homosexuel se retrouve seul dans une galerie d’art dans laquelle sont exposés les exploits de ses aïeux, ou à l’intérieur d’une chambre remplie de photos de stars (cf. je vous renvoie au code « Fresques historiques » et à la partie « Crâne en cristal » du code « Chevauchement de la fiction sur la Réalité » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels). Il oscille entre admiration et vertige : cf. la pièce La Reine morte (2007) d’Henry de Montherlant (avec le prince), le film « Sancharram » (2004) de Licy J. Pullappally (avec Kiran pénétrant dans la maison familiale), le roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman (avec Ronit, l’une des héroïnes lesbiennes visitant la maison de son enfance, p. 165), le film « Dead Poets Society » (« Le Cercle des Poètes disparus », 1989) de Peter Weir (avec la scène des photos de classe que Monsieur Keating fait parler), le film d’animation « Anastasia » (1997) de Don Bluth et Gary Oldman, le film « L’Attaque de la Moussaka géante » (1999) de P. H. Koutras, la pièce L’Anniversaire (2007) de Jules Vallauri, le film « For The Boys » (1991) de Mark Rydell, la pièce La Femme assise qui regarde autour (2007) d’Hedi Tillette Clermont Tonnerre, le vidéo-clip de la chanson « Redonne-moi » de Mylène Farmer, le film « Freak Orlando » (1981) d’Ulrike Ottinger, le film « The Servant » (1963) de Joseph Losey (avec Hugo dans la chambre ornée de posters de bodybuilders), le film « Portrait de femme » (1996) de Jane Campion (Isabelle perdue dans la galerie de statues italiennes), etc.
« À peine engagé entre les décors vagues du studio désert, Paul devint un chat prudent auquel rien n’échappe. » (la voix-off de Jean Cocteau dans le film « Les Enfants terribles » (1949) de Jean-Pierre Melville) ; « Il traverse la chambre abricot, son regard saute d’une image d’Épinal à l’autre, sous verre, encadrées de noir, en frise autour de la pièce, Vengeance d’une portière, Le Prince Mirliton, Till L’Espiègle, Histoire de Mimi Bon-Cœur. » (Jean-Louis Bory, La Peau des zèbres (1969), p. 48) ; « Dans mon enfance, j’étais venue ici une fois. À l’époque, il y avait partout de grands fauteuils et des tables ; je ne me rappelle pas les icônes, mais seulement les petits dieux pleins d’allégresse et les pampres qui ornaient le plafond vert céladon. » (Laura, l’une des deux héroïnes lesbiennes du roman Deux femmes (1975) d’Harry Muslisch, p. 109) ; « Ma mère m’a ruinée, elle a tout gaspillé dans sa galerie d’art ! Ma mère est une femme excentrique et insupportable ! » (« L. » à Hugh dans la pièce Le Frigo (1983) de Copi) ; « Ah, combien de souvenirs se sont abrités sous ces frondaisons ! Décors de maisons de maîtres, conversations dans un jardin d’hiver, scène de bals masqués, voyages de noces à Baden-Baden ! Sous cette coupole d’images, elle s’était assoupie pour toujours. » (Laura, l’un des deux héroïnes lesbiennes du roman Deux femmes (1975) d’Harry Muslisch, p. 11) ; « Derrière elle, tous les meubles de la famille l’avaient vue grandir : le vaisselier breton, les chaises de velours grenat, la lourde table Henri II, le fauteuil dans lequel son tuteur était mort, mais qui venait d’une autre maison, la desserte en poirier luisant, tout cet ensemble d’une majesté un peu funèbre formait un décor loin duquel Élise se sentait inquiète et mal à l’aise. […] ‘Cette salle à manger est ma forêt natale. Je suis là comme une bête sauvage dans sa jungle.’ Aujourd’hui, pourtant, le regard qu’elle jetait sur ces meubles en détournant la vue des arbres n’était pas sans l’anxiété de quelqu’un qui, à la fois, souhaite et redoute qu’un événement se produise. » (Fabien dans le roman Si j’étais vous (1947) de Julien Green, pp. 202-203) ; « C’est là que tout a commencé, la fondation du cabinet, les premiers locaux, les premiers succès. Ne l’oubliez pas, monsieur de Linotte, nous sommes à la fois des héritiers et des conquérants… » (Monsieur de Binette faisant visiter les prestigieux et glaciaux locaux du Cabinet Fersen au jeune Antoine, dans le roman Les Nettoyeurs (2006) de Vincent Petitet, p. 49) ; « L’ouverture des Maîtres chanteurs de Wagner retentit dans sa salle. Sur l’écran, Antoine reconnut le visage d’Andrew Fersen et les bureaux bostoniens. » (p. 63) ; « Maria-José [un homme transsexuel M to F] était la seule héritière de Louis du Corbeau, propriétaire de la plus complète collection au monde d’art précolombien, sans compter les Rubens et les Géricaults qui tapissaient son château du Berry. Elle se demanda ce qu’elle allait faire de sa fortune. » (Copi, « Le Travesti et le Corbeau » (1983), p. 33) ; « Elle [Stephen, l’héroïne lesbienne] avait, pour la première fois, passé la lourde porte d’entrée toute blanche, sous le brillant vantail demi circulaire. Elle avait marché dans le vieux hall carré où il y avait des peaux d’ours et les portraits des Gordon si bizarrement costumés, le hall avec son porte-cravaches où Stephen rangeait ses cravaches, le hall avec sa belle fenêtre irisée qui donnait sur les pelouses bordées de plantes herbacées. Et peut-être que, la main dans la main, ils avaient passé le hall, son père, un homme, sa mère, une femme, déjà marqués de leur destinée… et cette destinée avait été Stephen. » (Marguerite Radclyffe Hall, The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928), p. 113) ; « En vérité, elle courait en passant sous la lourde porte blanche sous le vantail demi circulaire et dans l’escalier qui conduisait au hall où étaient accrochés les anciens portraits bizarres des Gordon… des hommes morts depuis longtemps, mais encore merveilleusement vivants, puisque leurs pensées avaient façonné la beauté de Morton, puisque leur amour avait créé des enfants de père en fils… de père en fils jusqu’à la venue de Stephen. » (idem, p. 139) ; « Alors, le silence revient dans la chambre de mon enfance. Je regarde les volets fermés sur la fenêtre ouverte. Je regarde le liseré rouge de la tapisserie, les photographies sur le mur, la reproduction d’une toile du Greco, les meubles du siècle dernier, qui proviennent de l’ancienne demeure des aïeux disparus, l’imposant miroir au-dessus de la cheminée de marbre, un fauteuil dont l’étoffe est usée, et le lit où nous nous trouvons étendus, dans le désordre des draps de famille, ceux où figurent les initiales des noms du père et de la mère, comme des armoiries ridicules. Je regarde ce tout petit monde qui n’est pas à notre mesure, ce lieu étrange où je n’imaginais pas perdre ma virginité, cet espace incertain où nous tanguons délicieusement. » (Vincent en parlant de lui et de son amant Arthur, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 68) ; « Il était avant tout un nain, creusant des galeries obscures dans les mines de la littérature, à la recherche d’un filon scintillant. Il était un conservateur de rêves. Oui, le dernier archiviste d’histoires futiles. » (Pawel Tarnowski, homosexuel continent, dans le roman Sophia House, La Librairie Sophia (2005), p. 171) ; etc.
En général, le regard du héros homosexuel sur le patrimoine dont il hérite par le sang et le Réel n’est pas très valorisant. Par exemple, dans le film « Lust » (2000) de Dag Johan Haugerud, les membres de la famille, allongés et endormis, sont passés au crible de la lampe-torche tenue par les deux amants homosexuels. Dans la chanson « À table » de Jann Halexander, le narrateur homosexuel contemple, navré, aux côtés de sa grand-mère (une sorte de jumelle narcissique, de matriarche dont on se moque comme un animal de foire qu’on expose « pour la galerie ») le triste spectacle d’un repas de famille : « Grand-mère, Grand-mère, ne désespère pas ! On est deux à haïr ces repas. On n’en peut plus de la famille. » Dans le roman La Cité des rats (1979) de Copi, Gouri et Rakä visitent les galeries des grottes de la Cité des Rats : « La Reine inspectait les étages supérieurs où elle trouva, dit-elle, d’excellentes fresques sur le mur dans le goût de celles des grottes d’Altamira qui représentaient des rats aux cheveux longs, probablement nos ancêtres que no légendes font venir de l’Atlantide. » (p. 142) Dans le film « Mezzanotte » (2014) de Sebastiano Riso, Davide, le héros homosexuel, a fait du grenier familial sa caverne aux merveilles, où il se travestit, accroche les photos de ses actrices, se maquille. C’est pourtant le drame quand son père, qui a découvert le pot aux roses, l’y entraîne de force pour tout y casser au marteau, surtout les miroirs. Davide résiste en vain : « Papa ! Rentrons à la maison ! » Dans le docu-fiction « Christine de Suède : une reine libre » (2013) de Wilfried Hauke, la voix-off s’adresse à la reine pseudo « lesbienne » Christine, jouée par une actrice qui regarde ses parents et ancêtres accrochés en toiles aux murs de son château, pour mettre en relief le poids de la lignée royale pesant sur ses épaules : « Ton père compte sur toi pour suivre son œuvre. » Dans le film « Vita et Virginia » (2019) de Chanya Button, Vita Sackville-West se ballade dans son manoir d’enfance de Knole, avec son amante Virginia Woolf, et semble écrasée par son lignage. Elle dit être « passée d’une lignée d’hommes à une autre », sans s’y reconnaître.
La galerie tristement « familière » du personnage homosexuel est en réalité la vitrine du narcissisme mortel de ce dernier : « Plusieurs fois dans les mois qui suivent je retourne seul au Louvre (sans jamais réussir à m’y faire enfermer ; j’aimerais beaucoup vivre ici et le dis chaque fois aux gardiens) […] À force d’observations, je finis par découvrir que je figure sur trois peintures au moins et que sur celle signée Raphaël j’apparais carrément tout entier à poil […] : c’est là devant ce tableau que pour la première fois de son existence Vincent Garbo aura éprouvé sur tout son corps l’émotion de l’amour. » (Vincent Garbo dans le roman éponyme (2010) de Quentin Lamotta, p. 45). Dans le téléfilm « Un Noël d’Enfer » – « The Christmas Setup » – (2020) de Pat Mills, Hugo, le héros gay, a toujours été fasciné par le bureau d’un certain Monsieur Carroll, constructeur d’une gare éponyme, qu’il regardait de l’extérieur sans pouvoir y rentrer (Il se trouve que ce Monsieur Carroll, ayant vécu au XIXe siècle, était un homosexuel planqué). Hugo fait visiter à son futur amant Patrick l’officine de Carroll qu’il parvient enfin, en tant qu’adulte, à pénétrer : « C’est le bureau de Monsieur Carroll. Quand j’étais petit, j’adorais coller mon front et voir toutes les affaires telles qu’il les a laissées. C’est comme un musée. L’histoire de toute une vie. » (Hugo). Patrick est sous le charme aussi : « C’est dingue. On dirait qu’on est remontés dans le passé. »
g) J’ai épousé une ombre : L’ombre comme métaphore du viol et de l’amour possessif
À l’ombre des jeunes amants en fleurs… Souvent, l’ombre est tellement imposante et crainte qu’elle finit par devenir amoureuse (cf. je vous renvoie également au code « Amant diabolique » dans le Dictionnaire des Codes homosexuels). Il n’est pas rare, dans les fictions traitant d’homosexualité, que l’amant homosexuel prenne la forme de l’ombre sous laquelle il fait bon se protéger, mais qui soudain se montre inexplicablement froide et menaçante : cf. le roman Una Sombra Entre Los Dos (1934) d’Elisabeth Mulder, l’affiche du film « Swimming Pool » (2003) de François Ozon, la chanson « Sleeping With Ghosts » du groupe Placebo, la chanson « Cap Falcon » d’Étienne Daho, le film « Strangers On A Train » (« L’Inconnu du Nord-Express », 1951) d’Alfred Hitchcock, le film « Reflection In A Goldeneye » (« Reflets dans un œil d’or », 1967) de John Huston, le roman La Confusion des sentiments (1928) de Stefan Zweig, les chansons « Shadow Of love » et « Je cherche l’ombre » de Céline Dion, la pièce Tante Olga (2008) de Michel Heim, etc.
« Laissez venir les ombres. » (les personnages de la comédie musicale La Nuit d’Elliot Fall (2010) de Vincent Daenen) ; « J’aime être dans le noir. » (Cherry, l’héroïne lesbienne de la pièce La Star des oublis (2009) d’Ivane Daoudi) ; « Nous nous sommes retrouvés dans la pénombre climatisée, son ombre sur le mur, son corps sur le mien. » (Ashe à propos de Paul, dans le roman Riches, cruels et fardés (2002) d’Hervé Claude, p. 45) ; « D’un coup du cœur enlace l’ombre qui passe. » (cf. la chanson « Tristana » de Mylène Farmer) ; « J’ai eu envie de me branler. Je me suis mis sur le dos, j’ai gardé les yeux entrouverts […]. Quand j’ai ouvert les yeux, […] j’ai eu l’impression que l’obscurité de la forêt derrière moi s’était étendue. Mais ce n’était pas ça, c’était une ombre, une vraie, et j’ai pensé que quelqu’un d’autre avait partagé mon plaisir. » (Claudio, l’un des personnages homosexuels du roman Riches, cruels et fardés (2002) d’Hervé Claude, p. 103) ; « Tu es une ombre – non pas l’ombre d’une morte, mais celle d’une femme encore à naître. » (Sylvia à son amante Laura, dans le roman Deux femmes (1975) d’Harry Muslisch, p. 97) ; « Je suis son ombre. Il me raconte tout. » (Yoann, le héros homosexuel, par rapport à Julien son amant, dans la pièce Ma belle-mère, mon ex et moi (2015) de Bruno Druart et Erwin Zirmi) ; etc.
Quelquefois, l’amant homosexuel fictionnel apparaît comme une ombre, une séduisante et troublante menace diabolique, qui empêche d’exister : « Je demande à mon ombre, sans trêve… si ce baiser sacré… peut me trahir. » (cf. les paroles d’un boléro dans le roman El Beso De La Mujer-Araña, Le Baiser de la Femme-Araignée (1979) de Manuel Puig, p. 215) ; « Je me demande si tu ne manœuvres pas dans l’ombre pour manipuler Lola. » (Nina s’adressant à Vera, dans la pièce Géométrie du triangle isocèle (2016) de Franck d’Ascanio) ; « J’appréhende l’ombre qu’il fait sur moi quand ça va pas. » (cf. la chanson « Amélie m’a dit » d’Alizée) ; « Il n’est de Jean Valjean sans l’ombre de Javert. » (Valjean s’adressant à Javert, pendant qu’ils se déclarent leur flamme l’un à l’autre, dans la comédie musicale Les Miséreuses (2011) de Christian Dupouy) ; « Je t’ai vu passer en moto, toi tu ne m’as pas vu ! Si je n’avais pas reconnu la moto… tu n’aurais été qu’une ombre qui passe ! » (Kévin s’adressant à son amant Bryan, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 305) ; « J’aime une ombre, un fantôme… » (Bryan s’adressant à son amant Kévin, op. cit., pp. 309-310) ; « Je t’ai vu descendre du ciel, un matin d’hiver. Je t’ai vu seul, sombre et silencieux. » (idem, p. 453) ; « Elle [Esti, l’amante lesbienne] a reculé d’un pas. La moitié de son visage a disparu dans l’ombre. Autour de nous, les arbres bruissaient et bourdonnaient. » (Ronit, l’héroïne lesbienne du roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, p. 143) ; « Je pensais à Linde, et à la peau sombre et au sindhoor rouge sans de l’autre femme [Rani, la servante-amante rencontrée dans un bidonville]. » (Anamika, l’héroïne lesbienne du roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, p. 18) ; « Nos trois sexes formaient un seul canon, qui traversait nos corps encastrés, dirigés par un cerveau unique. Nous éjaculâmes en rafale, le garçon de derrière, puis moi, puis l’ange. À l’instant où ce dernier déchargeait cette accumulation de nos énergies vitales, une forme hideuse jaillit de l’ombre. […] Un rai de lumière dévoila cette créature. […] Aussitôt nous fûmes embrochés comme des infidèles, et son sperme ardent traversa nos trois corps comme un fluide électrique. » (le narrateur homosexuel de la nouvelle « La Queue du diable » (2010) d’Essobal Lenoir, pp. 116-118) ; « Mais dans quelle ombre vous nous foutez ? J’suis déjà l’ombre de mon homme. » (Raulito, l’homme travesti M to F, s’adressant à l’agent, dans la pièce Cachafaz (1993) de Copi) ; « Je ne veux plus […] vivre à côté d’un homme comme son ombre ! » (l’un des personnages de la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « Je ne voulais pas vivre dans ton ombre, sous ta tutelle. » (Luc s’adressant à son amant Jean-Marc qu’il a quitté, dans la pièce Parfums d’intimité (2008) de Michel Tremblay) ; etc.
L’ombre représente en réalité l’invisibilité et l’absence d’amour. Par exemple, dans la pièce Non, je ne danse pas ! (2010) de Lydie Agaesse, les hommes absents sont comparés à des ombres.
L’ombre qui plane sur le héros homosexuel, c’est aussi plus dramatiquement celle du viol et de l’inceste… ou de la honte que ces derniers inspirent : « Je m’apprête à passer des formidables vacances à Rome, j’accepte même de jouer le romantisme indispensable dans cette vieille ville entre deux coïts rapides dans un coin sombre avant d’aller boire une bière avec son partenaire Piazza Navona et lui prêter dix mille lires que vous ne reverrez plus. » (le narrateur homosexuel du roman Le Bal des folles (1977) de Copi, p. 22) ; « Maintenant je suis un mec, je viens de te voir passer devant moi dans la rue, je te chope dans un coin sombre et je te baise comme la belle salope que tu es… » (Claude, l’héroïne lesbienne, s’adressant à sa copine Polly, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 74) ; etc.
L’ombre est d’ailleurs tout simplement la métaphore du violeur, du ravisseur : « J’avais rêvé que j’observais le viol de lady Philippa par les vitraux brisés de la chapelle. En même temps, j’étais lady Philippa moi-même, contemplant terrorisée mon propre visage dans l’ouverture en forme d’ogive, depuis la pierre tombale où je subissais ce terrible attentat. En revanche, mon agresseur lui-même n’était dans mon rêve qu’une masse sombre et sans visage. » (Bathilde dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 303) ; « Il fixa des yeux une tache sur son bouvard. […] C’était une tache d’une forme bizarre qui fait songer à l’ombre d’une main sans pouce. […] Cela ressemblait à une main de voleur, mais de voleur qui eût volé autre chose que de l’or. ‘Un voleur de vent’, murmura Fabien. Et plus haut il répéta : ‘Voleur de vent, voleur de vent.’ » (Julien Green, Si j’étais vous (1947), p. 29) ; etc.
h) Obscure clarté diabolique :
En définitive, l’ombre figure la dualité diabolique de la lumière froide, obscure et intensive de Lucifer (cf. je vous renvoie aux codes « Homme invisible » et « Lunettes d’or » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels) : cf. le roman L’Ombre ardente (1897) de Jean Lorrain, le film « Shatten Der Engel » (« L’Ombre des anges », 1976) de Rainer Werner Fassbinder, le film « L’Âge atomique » (2012) d’Héléna Klotz, le recueil de poèmes Ombre du paradis (1944) de Vicente Aleixandre, le roman Le Reflet d’une ombre (2004) de Jonathan Denis, le film « L’Ombre blanche » (1924) d’Alfred Hitchcock, le roman Les Neiges interdites (2002) de Thierry Brunello, la pièce La Corte Del Cuervo Blanco (1914) de Ramón Gy de Silva, le film « In The Shadow Of The Sun » (1972-1980) de Derek Jarman, la chanson « Les Fleurs de l’interdit » d’Étienne Daho, le film « Black Shampoo » (1976) de Greydon Clark, le film « Ghostlight » (2003) de Christopher Hermann, le film « L’Ange noir » (1993) de Jean-Claude Brisseau, le roman La Trace de l’ange noir (1949) d’Hans Henny Jahnn, l’opéra-rock Starmania de Michel Berger (avec la bande des Étoiles noires, semant la terreur dans Monopolis), le film « Les Astres noirs » (2009) de Yann Gonzalez, le film « Day’s Night » (2005) de Catherine Corringer, le film « Una Noche » (2012) de Lucy Molloy, etc.
« Le soleil était devenu, année après année, une grande obsession morbide pour Khalid. Il en parlait tout le temps. Il en avait une connaissance scientifique, intime, amoureuse. Il voyait le soleil comme une menace sérieuse, certaine. […] Le soleil et la mort se regardent fixement. Le soleil gagne. Il va bientôt triompher. Exploser. Tout deviendra ombre. […] J’imagine le soleil qui vient vers moi. […] Il me noircit. Il me transforme. En cendres ? En quoi exactement ? Je me demande si, juste à la toute fin, je serai complètement noir. Noir de brûlures. […] Quelle est la lumière des ténèbres ? » (Khalid, l’un des héros homosexuels du roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, pp. 69-71) ; « Sur la blancheur de l’oreiller, la tête de Fabien faisait une grande tache sombre. » (Julien Green, Si j’étais vous (1947), p. 303) ; « À mesure que l’obscurité se faisait plus épaisse, la blancheur du lit se détachait plus vivement dans cette sorte de nuit en plein jour et l’on finissait par ne plus voir que ce grand rectangle couleur de neige où gisait Fabien. » (idem, p. 305) ; « Toi aussi je t’aime, même si tu es moins claire que les autres. » (Aldebert à Hud, une femme noire, dans la comédie musicale HAIR (2011) de Gérôme Ragni et James Rado ; Hud dira qu’elle « est l’éclipse qui couvre la lumière blanche ») ; « Vois la pénombre qui éclaire mon visage. » (cf. la chanson « J’ai essayé de vivre » de Mylène Farmer, en référence à « l’Autre » diabolique) ; « Il fait toujours nuit pour moi. » (Léo, le héros homosexuel aveugle, dans le film « Hoje Eu Quero Voltar Sozinho », « Au premier regard » (2014) de Daniel Ribeiro) ; etc.
L’ombre des fictions homosexuelles est diabolique, non d’être 100% mauvaise et obscure, mais d’être précisément un peu lumineuse et attractive. Par exemple, dans le film « Suddenly Last Summer » (« Soudain l’été dernier », 1960) de John Mankiewicz, Sébastien meurt au moment du jour où le soleil est au zénith et qu’il perd son ombre. Ceci est confirmé par cette phrase de Garnet Montrose dans le roman Je suis vivant dans ma tombe (1975) de James Purdy : « À midi tu n’as pas d’ombre, et sur toi le Démon exerce son emprise. » (p. 78) Dans un roman La Confusion des sentiments (1928), Stefan Zweig évoque les « voies infernales entre l’ombre et la lumière » (p. 117).
L’obscure clarté est au bout du compte ce mal qui prend l’apparence du bien, de l’« amour » possessif qui n’aime pas et qui étouffe : cf. le film « Ombres de soie » (1977) de Marie Stephen. « Tu ne me verras pas. Je ne t’importunerai pas. Je vivrai dans ton ombre. Je t’entourerai d’une protection dont tu n’auras même pas conscience. » (Félicité s’adressant à son fils Fernand, dans le roman Génitrix (1928) de François Mauriac, p. 80)
Enfin, l’ombre, c’est aussi la honte et la visibilité agressive de l’homosexualité, l’homophobie intériorisée du héros homosexuel, l’obscurité qui s’habille de lumière parce qu’il s’efforce de l’appeler « identité » ou « amour » : « Contrairement à ce qui se passait aux Antilles, ici en métropole, nous poursuivions le combat avec acharnement. L’imminence d’une manifestation sur la voie publique se précisait à mesure que nous imposions nos idées. […] Plus que jamais le moment était venu de sortir de l’ombre, et les grands chambardements de la société de mai 68 furent une aubaine. » (Ednar, le héros homosexuel racontant ses premières années de militantisme homosexuel, dans le roman autobiographique Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 172)
FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION
PARFOIS RÉALITÉ
La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :
a) L’ombre au tableau :
Regardez et écoutez ce que nous, personnes homosexuelles, avons à vous dire. Dans nos propos, aussi inconscients soient-ils, se trouve parfois l’ombre (… d’un doute… ou plutôt d’une identité et d’un amour douteux) : cf. les photos Ombre (1979) et L’Ombre (1981) d’Andy Warhol, le roman L’Ombre ancestrale (2013) de Georges Eric Dang Tseny, etc. « Mais derrière cette façade glamour se cache sans doute une part d’ombre. » (Peter Gehardt, ironique, dans son documentaire « Homo et alors ?!? », 2015)
Dans le documentaire « Charles Trénet, l’ombre au tableau » (2013) de Karl Zéro et Daisy d’Errata, Charles Trénet avoue qu’il souffre, en amour, d’un « mal mauve », celui « de l’ombre et du remord ».
b) Je ne suis que l’ombre de moi-même :
D’ailleurs, certains individus homosexuels se prennent vraiment pour une ombre : « Je suis un spectre, une ombre. » (le chanteur Stéphane Corbin lors de son concert Les Murmures du temps au Théâtre de L’île Saint-Louis Paul Rey, à Paris, en février 2011) ; « Par peur d’être catalogués, les homosexuels sortaient uniquement à la tombée de la nuit (pareil à des chauves-souris) pendant que les voyous et les drogués squattaient en permanence les lieux. » (Jean-Claude Janvier-Modeste, dans son roman autobiographique Un Fils différent (2011), p. 188) ; « J’ai commencé à m’aimer en regardant mon ombre marcher à côté de moi. » (Déborah, personne intersexe élevée comme une fille, dans le documentaire « Ni d’Ève ni d’Adam : une histoire intersexe » de Floriane Devigne diffusé dans l’émission Infrarouge sur la chaîne France 2 le 16 octobre 2018) ; etc.
Comme pour Peter Pan, l’ombre peut symboliser concrètement chez eux un double schizophrénique, une immaturité, une mauvaise conscience, une méchanceté, un désir noir, voire la folie : « En 1964, j’ai vu arriver dans mon bureau, un tout petit homme, tout mince, assez sombre, l’air d’un oiseau. » (l’éditeur Christian Bourgeois décrivant le dramaturge argentin Copi, et cité dans l’essai Le Rose et le Noir (1996) de Frédéric Martel, p. 157) ; « Les ombres de la folie se firent bientôt plus menaçantes, et à l’automne de 1918, Nijinski montra des signes inquiétants de déséquilibre qui culminèrent à la fin de l’année. » (Christian Dumais-Lvowski dans l’avant-propos des Cahiers (1919) de Vaslav Nijinski, p. 10)
c) Être « le fils de », le fils de l’ombre :
Dans le discours de l’individu homosexuel, l’ombre renvoie généralement à quelqu’un qui lui a fait de l’ombre : son père, sa mère, son frère, une actrice, lui-même (en chair et en os). Je vous renvoie évidemment aux codes « Mère gay friendly », « Mère possessive » et « S’homosexualiser par le matriarcat », dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels ; ainsi qu’à l’essai Luis Cernuda En Su Sombra (2003) d’Armando López Castro, à l’autobiographie Lions And Shadows (1938) de Christopher Isherwood, et à l’autobiographie Escape From The Shadows (1975) de Robin Maugham, etc.
La mère ou le père a pu avoir sur son fils ou sa fille homosexuel(-le) une influence sombre : cf. la photo Andy Warhol And Julia Warhola (1958) de Duane Michals, le film « Les Garçons et Guillaume, à table ! » (2013) de Guillaume Gallienne (avec la vraie mère du réalisateur, regardant son fils dans l’obscurité de la salle de théâtre où il raconte son histoire, à la fin), etc. « J’ai longtemps eu le sentiment de n’être qu’un ersatz de mon père. » (Paula Dumont, Mauvais Genre (2009), p. 15) ; « L’ombre menaçante de la peau de vache envahissait toute la chambre. » (Frédéric Mitterrand en parlant de sa mère, La Mauvaise Vie (2005), p. 116) ; « C’était une ombre, mon père. Donc c’est difficile d’avoir une colère contre lui. » (Andrew Comiskey, en conférence à la Trinité à Paris, le 3 octobre 2014) ; « Il faut que je m’avoue la prédominance de la jalousie et d’une absurde vexation. Il remporte la victoire partout où il se montre. Sortirai-je jamais de son ombre ? Mes forces y suffisent-elles ? … Bref, ‘les Grands Hommes’ ne devraient pas avoir de fils… » (Klaus Mann en parlant de son père Thomas Mann, dans son Journal (1989-1991), p. 115) ; « Mes rapports avec lui étaient difficiles et point exempts d’un sentiment de culpabilité, puisque mon existence jetait par avance une ombre sur la sienne. » (Thomas Mann parlant de son fils Klaus, cité dans l’article « Famille Mann » de Jean-Philippe Renouard, dans le Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, p. 309) ; « Je suis né de ce traître, se dit-il, je porte son nom, son œuvre, sa honte, je suis son héritier. » (Dominique Fernandez parlant de son père collabo sous l’Allemagne nazie, dans la biographie Ramon (2008), p. 18) ; «
Dans l’essai Le Rose et le Brun (2015) de Philippe Simonnot, Nicolaus Sombart avoue qu’il s’est senti condamné à être le fils de son père, à être toute sa vie « le fils de Werner Sombart » (p. 273). La fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, Lily Rose, se dit lesbienne/bisexuelle.
L’homosexualité des personnes homos apparaît alors non pas comme une identité naturelle et libre, mais comme une stratégie de résistance et d’opposition, comme la cristallisation d’une peur (réelle ou projetée) de décevoir les attentes du père/de la mère, comme le produit de l’homophobie parentale ou de leur propre homophobie intériorisée : « Ses illusions de m’aider à faire une carrière politique en Argentine à son image (ce pour quoi je fus conçu) avait échoué avant la première tentative. » (le dramaturge homosexuel Copi parlant de son père diplomate et ambassadeur à l’étranger, à Paris en août 1984 dans la biographie Copi (1990) du frère de Copi, Jorge Damonte, p. 85)
d) Être « le frère de », le frère de l’ombre :
Cf. je vous renvoie au code « Jumeaux » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels.
Parfois, c’est le frère du sujet homosexuel qui est l’ombre portée : cf. le film « Enfances » (2007) de Yann Le Gal (avec Fritz Lang et son frère), etc. À ce titre, je vous renvoie à la partie « Jalousie » du code « Inceste entre frères » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels.
Par exemple, toujours dans le film biographique « Enfances » (2007) de Yann Le Gal, on nous apprend qu’Ingmar Bergman, petit, a essayé d’étouffer sa petite sœur bébé avec un coussin parce qu’elle lui avait « piqué » sa place de benjamin. Quant à Romaine Brooks, elle a connu une enfance perturbée à cause de l’attention excessive que sa mère accordait à son jeune frère.
Il n’est pas rare que certains individus homosexuels aient l’impression de remplacer (dans le cœur de leurs parents) le frère mort ou idéalisé : « J’ai le sentiment que ma mère s’en veut toujours du décès de mon frère, comme si elle n’avait pas bien pris soin de moi, alors qu’elle n’avait que 15 ans ! J’ai aussi le sentiment qu’elle a fait une sorte de transfert sur moi. J’ai remplacé l’enfant mort. » (Brahim Naït-Balk, Un Homo dans la cité (2009), p. 15) ; « Ma sœur était morte (à l’âge de cinq ans) et ma mère m’appelait ‘sa petite fille’ et m’apprenait le canevas. » (Jean-Luc, 27 ans, homosexuel, dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, p. 77) ; « Je suis née parce que ma sœur est morte, je l’ai remplacée. Je n’ai donc pas de moi. » (Annie Ernaux, Je ne suis pas sortie de ma nuit (1997), p. 44) ; « Là, dans cette obscurité, dans cette exécution, cette mort volontaire, je me suis souvenu de ma sœur hantée. » (Abdellah Taïa, Une Mélancolie arabe (2008), p. 123) ; etc.
C’est parfois la ressemblance troublante avec ses frères de sang qui a jeté une ombre dans l’esprit de l’individu homo. Par exemple, dans son autobiographie Le Flamant noir (2004), Berthrand Nguyen Matoko raconte que lorsqu’il était adolescent, les amis de son père le « confondaient toujours avec ses sœurs » (p. 17). Parmi mes amis homosexuels, certains ont d’ailleurs souffert d’avoir été pris dans la rue pour telle ou telle grande sœur ou tel ou tel petit frère.
e) La pression d’une lignée sombre ou trop glorieuse :
Sur les épaules de l’individu homosexuel pèse souvent le lourd fardeau d’un héritage familial et national présenté comme glorieux, le poids de la responsabilité d’assurer la descendance (c’est parfois lui-même qui se met la pression tout seul) : « Tu m’apparaissais comme une ombre suspendue dans l’air. » (Alfredo Arias à sa grand-mère, dans son autobiographie Folies-fantômes (1997), p. 156) ; « Je suis le zéro de la famille, celui qui ne compte pas. » (Lucien Daudet, homosexuel, complexant du succès littéraire de son père Alphonse et de son frère Léon, cité dans le Dictionnaire des homosexuels et bisexuels célèbres (1997) de Michel Larivière, p. 116) ; « Pendant cette période de maladie et de jeux solitaires, la sollicitude exacerbée de ma mère développa en moi des manières de poule mouillée, au grand mécontentement de mon père. Je devenais un être incontestablement hybride, bien différent de la lignée familiale des héros conquérants du Tennessee oriental. La lignée paternelle avait été illustre. » (Tennessee Williams parlant de son adolescence, Mémoires d’un vieux crocodile (1972), p. 30) ; « Je rentre en Cours Préparatoire. Mon père et mon grand-père sont passés par ces mêmes bancs des années plus tôt. Et maintenant c’est à moi de prendre la relève… » (Alexandre Delmar, Prélude à une vie heureuse (2004), p. 9) ; « Je suis l’aîné de sept frères et sœurs : ni mon environnement social et provincial ni ma place d’aîné dans ma fratrie n’étaient propices à un épanouissement sexuel. […] La position d’aîné dans une famille maghrébine implique de se comporter en modèle, dans le strict respect des traditions : virilité, mariage, paternité et autorité sur les cadets, autant de ‘qualités’ qui me manquaient cruellement. » (Brahim Naït-Balk, Un Homo dans la cité (2009), pp. 7-8) ; etc.
Par exemple, dans sa biographie Rosa Bonheur, sa vie, son œuvre (1909), Anna Klumpke raconte comment on a caché à Rosa Bonheur sa bâtardise en lui faisant miroiter un passé familial magique : « Tu descends par ta mère d’une race royale. » (p. 172) Michel Foucault, le philosophe français, est attendu au tournant dès son adolescence : son père, son grand-père et son arrière-grand-père furent médecins ; il s’opposera toute sa vie avec véhémence à son « destin familial ». De son côté, Federico García Lorca, le fils aîné de sa famille, subit la pression de son père qui veut faire de lui un « homme important » ; le dramaturge espagnol fera l’inverse de ce (qu’il croit) qu’on attend de lui puisqu’il choisit d’exercer le « métier le plus inutile du monde », à savoir poète. Quant à Louis II de Bavière, il hérite très jeune de l’empire de son père disparu prématurément, et vivra toute sa vie la tête polluée des conquêtes passées opérées par ses ancêtres. Dans la biopic « Vice » (2018) d’Adam McKay, Mary, la fille du vice-président nord-américain Dick Cheney, est lesbienne.
Selon le sociologue Didier Éribon (dans son autobiographie Retour à Reims, 2010), tout Homme serait forcément esclave de son destin familial, serait l’objet d’un conditionnement par l’« ordre social » : « Car ils sont tôt tracés, les destins sociaux ! Tout est joué d’avance ! Les verdicts sont rendus avant même que l’on puisse en prendre conscience. Les sentences sont gravées sur nos épaules, au fer rouge, au moment de notre naissance, et les places que nous allons occuper définies et délimitées par ce qui nous aura précédé : le passé de la famille et du milieu dans lesquels on vient au monde. » (pp. 52-53)
En réalité, beaucoup de personnes homosexuelles se dévalorisent en se comparant à une famille fictionnelle et cinématographique (leurs stars, leurs héros de dessins animés et de films, une figure politique lointaine et charismatique…) plutôt qu’à leur famille réelle. Comme je l’expliquais en notice, beaucoup d’enfants de célébrités se déclarent plus tard homosexuels : Judith Gauthier, Anna Freud, Lucien Daudet, Maurice Rostand, Jaime Salinas, Klaus Mann, Siegfried Wagner, Saadi Khadafi, Robin Maugham, etc. Par exemple, la photographe lesbienne Claude Cahun est la nièce de Marcel Schwob. Christopher Ciccone, le frère de la chanteuse Madonna, est ouvertement gay. Roxane Depardieu, la fille de Gérard Depardieu, se dit lesbienne.
f) L’enfant homosexuel visitant le Panthéon de ses ancêtres :
Scénario curieux. Quelquefois, dans le discours de l’individu homosexuel, on peut observer la même mise en scène : il se décrit en train de se balader seul dans une galerie d’art dans laquelle sont exposés les exploits de leurs aïeux, ou à l’intérieur d’une chambre remplie de photos de stars (cf. je vous renvoie au code « Fresques historiques » et à la partie « Crâne en cristal » du code « Chevauchement de la fiction sur la Réalité » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels). Il oscille entre admiration et vertige : « Ma tante, moderne et indépendante, habitat un studio au-dessus de son salon : un grand lit par terre, des photos d’artistes collées au mur, Henri Garat et Mireille Balin, Jean Gabin, Michèle Morgan, Arletty, tout y était un peu bohème. » (Jean-Claude Brialy, Le Ruisseau des singes (2000), p. 19) ; « Au mur, une ancêtre nous regardait malicieusement dans son tableau. » (Denis Daniel, Mon théâtre à corps perdu (2006), p. 35) ; « Je pénétrai sans bruit dans la chambre décorée de meubles chinois en laque de Coromandel, partout des petits personnages, des fleurs, des oiseaux qui me faisaient rêver de l’Orient. » (idem, p. 41) ; « En sortant de la brasserie, j’ai observé longuement la façade de la gare du Nord, et j’ai pensé que mon père était une des statues, boulonnées sur la corniche, et qu’il me regardait, et j’ai pensé : est-ce qu’il me regarde ou est-ce qu’il me surveille ? » (Christophe Honoré, Le Livre pour enfants (2005), p. 91) ; « Notre maison regorgeait de livres, des jeux de société, ainsi que des décorations militaires qui peuplaient le salon. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 18)
Par exemple, dans son autobiographie Confession d’un masque (1971), Yukio Mishima raconte comme il s’est introduit dans la chambre de sa grand-mère, qu’il présente comme un sanctuaire « plein de kimonos colorés et d’obis garnis de roses afin de se travestir en une magicienne qu’il avait admirée sur une scène de théâtre ». François Reichenbach, quant à lui, est élevé dans une riche famille de collectionneurs de tableaux. Dans le documentaire « Louis II de Bavière, la mort du Roi » (2004) de Ray Müller et Matthias Unterburg, la figure de Louis II est filmée en train de se promener dans la galerie de ses ancêtres où sont exposés des toiles relatant les exploits qu’il devra imiter… mais qu’il n’imitera pas car il fuira ses responsabilités de roi.
g) J’ai épousé une ombre : L’ombre comme métaphore du viol et de l’amour possessif
À l’ombre des jeunes amants en fleurs… Souvent, l’ombre est tellement imposante et crainte qu’elle finit par devenir amoureuse (cf. je vous renvoie également au code « Amant diabolique » dans le Dictionnaire des Codes homosexuels). Il n’est pas rare, dans l’esprit du sujet homosexuel, que son amant prenne la forme de l’ombre sous laquelle il fait bon se protéger, mais qui soudain se montre inexplicablement froide et menaçante car elle empêche d’exister : « Mais j’avais l’impression d’avoir perdu mon ombre. Je courus vers toi. » (la narratrice lesbienne s’adressant à son amante, dans le roman La Vallée heureuse (1939) d’Anne-Marie Schwarzenbach) ; « Martine éprouvait pour moi une admiration sans bornes. D’après ses critères, j’étais celle qui avait réussi, alors qu’elle avait tout raté. Dans cette logique, il était souhaitable pour elle de rester dans mon ombre et de continuer à vivre ainsi, par procuration. » (Paula Dumont parlant de sa relation amoureuse « malsaine » avec sa copine Martine, dans son autobiographie La Vie dure : Éducation sentimentale d’une lesbienne (2010), p. 72)
L’ombre qui plane, c’est aussi celle du viol et de l’inceste… et surtout celle de la honte que ces derniers inspirent : « Je voudrais te demander pardon. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Tu me l’as dit à l’époque, très fermement. Mais je ne pouvais pas m’en empêcher. Mon désir de perfection me hante. C’est désagréable, j’en conviens. En plus, je t’ai fait peur dans la pénombre de la chambre que nous partagions. Tu as ouvert les yeux. On pouvait lire ton étonnement. Mais ça me prenait comme ça, de me réveiller vers deux ou trois heures du matin, comme un somnambule. J’allais jusqu’à l’armoire où se trouvaient tes vêtements que je revêtais, à moitié endormi. » (Alfredo Arias à sa grand-mère, dans son autobiographie Folies-fantômes (1997), p. 160) ; « Après avoir poussé mon désir d’entrer dans l’âge adulte, mon père m’intimait donc l’ordre de me rétracter intelligemment, espérant que j’étais assez grand pour découvrir, seul, les secrets de la vie d’un père de famille. C’était compter sans l’ombre persistante qui pesait sur mon chemin, dans le décor éclaboussé de chaleur et d’amour, de mon amour maternel. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 48)
Parfois, l’ombre est tout simplement la métaphore du violeur, du ravisseur : « ‘Je ne vais pas te violer tout seul… Nous allons tous te violer. Faire de toi une vraie petite fille…’ Il a ouvert la porte. La peur m’a repris. Elle montait. Elle m’inondait. M’aveuglait. Les autres sont entrés. Ils étaient quatre et non deux comme au début. Comme il faisait encore un peu sombre dans la pièce, je n’arrivais pas à voir à quoi ressemblaient les deux nouveaux. Ils se sont tous déshabillés aussitôt. La sex party allait commencer. » (Abdellah Taïa, Une Mélancolie arabe (2008), p. 24) ; « Plus tard, à l’approche de la première lumière qui annonce le grand jour, je me retrouvais dans sa chambre sans trop savoir pourquoi. Sa forte ombre qui tournait autour de moi bourdonnait des mots incompréhensibles, tel un chanteur aux mâchoires serrées. […] La sensation de beauté qui m’avait ébloui la veille, laissa la place à un visage banalement masculin, pas nécessairement très beau mais sexy, avec un air d’ivresse dans les yeux. » (Berthrand Nguyen Matoko décrivant son amant d’un soir qui va le sodomiser sauvagement, dans son autobiographie Le Flamant noir (2004), pp. 66-67) ; etc.
h) Obscure clarté diabolique :
En définitive, l’ombre décrite par certaines personnes homosexuelles figure la dualité diabolique de la lumière froide, obscure et intensive de Lucifer (cf. je vous renvoie aux codes « Homme invisible » et « Lunettes d’or » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels). Elle est diabolique, non d’être 100% mauvaise et obscure, mais d’être précisément un peu lumineuse et attractive : cf. le documentaire « Les Mille et un soleils de Pigalle » (2006) de Marcel Mazé (racontant le quotidien de deux jeunes Maghrébins dans les sex-shops parisiens). Par exemple, dans le one-woman-show Mâle Matériau (2014) d’Isabelle Côte Willems, la comédienne transgenre F to M, pendant qu’elle chante « Are You Boy Or Girl ? », reçoit des spots de couleurs qui projettent sur un mur blanc trois ombres colorées d’elle : une bleue, une rose, une jaune. Signes de sa schizophrénie mégalomaniaque.
L’obscure clarté est au bout du compte ce mal qui prend l’apparence du bien, de l’« amour » possessif qui n’aime pas et qui étouffe : « Dans mon enfance, ma mère était pour moi une ombre blanche. » (Annie Ernaux, Je ne suis pas sortie de ma nuit (1997), p. 93) ; « Avec la neige, j’ai toujours les idées noires. » (André Schneider, le réalisateur homosexuel du docu-fiction « Le Deuxième Commencement », 2012) ; etc.
Enfin, l’ombre, c’est aussi la honte et la visibilité agressive de l’homosexualité, l’homophobie intériorisée du sujet homosexuel pratiquant, l’obscurité qui s’habille de lumière parce qu’il s’efforce de l’appeler « identité » ou « amour » : « De Brazzaville à Goussainville, l’homosexualité était devenue l’ombre de moi-même : un véritable cheval de bataille, impliqué autoritairement dans ma vie de tous les jours. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 103)
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.