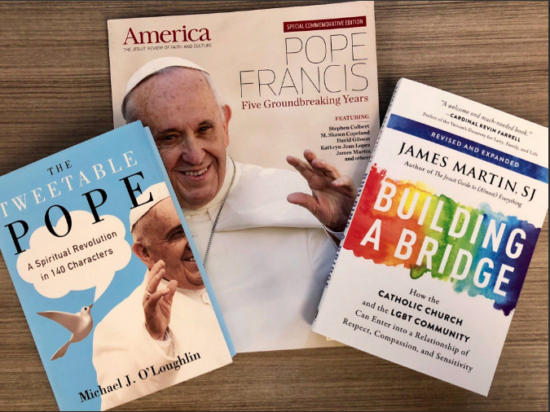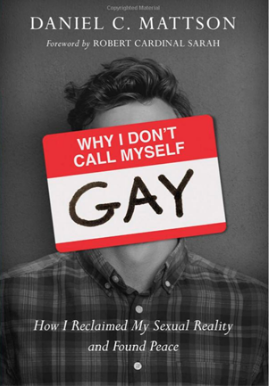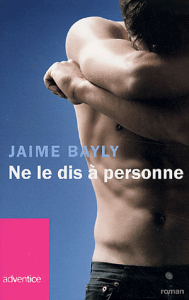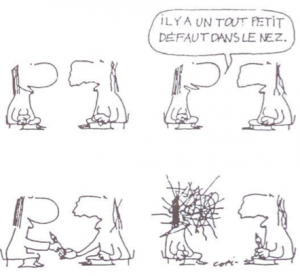Déni
NOTICE EXPLICATIVE
Sois un amoureux (gay ou pas) et tais-toi ! Voici le code exposant la mauvaise foi – manifeste et quasi généralisée – des personnes homosexuelles à propos de leur désir homosexuel. Il illustre de manière claire la censure imposée par les militants homosexuels et leurs suiveurs gays friendly jouant le jeu de l’homophobie sociale, broyant les cerveaux et les libertés, encourageant même parfois les suicides qu’ils prétendent pourtant neutraliser. Car je ne sais pas si on vous a mis au courant, mais l’individu homosexuel pratiquant se comporte comme un censeur, un délateur, un menteur, un dissimulateur, un hypocrite, et un trouillard invétéré.

Il suffit de montrer aux membres de la communauté homosexuelle que leur désir homosexuel survient dans des contextes souffrants – et donc potentiellement violents quand cette souffrance est niée –, car tel est objectivement le cas, pour qu’ils montent au créneau, en hurlant agressivement qu’ils « ne souffrent jamais », que le malheur n’est pas qu’homosexuel ! La souffrance, c’est le grand interdit des discours sur l’homosexualité. En général, les personnes homosexuelles ne voudraient entendre que des paroles positives sur leur désir et leurs amours, être dorlotées dans leurs petites certitudes mièvres. Pour imposer leur censure concernant le viol ou le fantasme de viol, elles emploient toujours les mêmes stratégies de diversion : le déni pur et dur (j’entends par ce mot le refus de reconnaître une réalité), l’indignation, la menace, l’humour potache auto-parodique, le silence… Mais ces techniques du déni, au lieu d’atteindre leur but et de faire oublier le problème qu’elles sont censées occulter, en sont les meilleurs indicateurs. À force de trop cacher, on montre, et même on invite à regarder !
Je n’ai pas peur de dire haut et fort que la communauté homosexuelle telle qu’elle existe actuellement, et telle qu’elle a toujours existé (on ne refait pas le désir homosexuel…), est un système totalitaire, une dictature peu puissante mais non moins intolérante et intolérable. Même si les personnes homosexuelles s’annoncent comme une minorité progressiste, moderne, ouverte, aimante, diverse, transparente, et libérante, elles construisent, en défendant l’identité homosexuelle éternelle et l’« amour » homosexuel aveuglément, une terrible censure sur les drames vécus par notre Humanité, et a fortiori par elles-mêmes.
Et tant que cela ne changera pas, je dénoncerai – toute ma vie s’il le faut – cette propagande mortifère du silence, qu’on appelle à tort « amour », « respect », ou « révolution ». On pourra bien me mettre le scotch marqué « homophobe » sur la bouche, je continuerai de dire que les véritables personnes homophobes sont ces militants pseudo pro-gays, de lutter contre les injustices et les souffrances cachées, de défendre ma liberté et celle de mes amis homosexuels, d’appeler au refus du lavage de cerveau idéologique et du terrorisme « intellectuel » homosexuellement correct, de plaider la reconnaissance des faits et de la nature violente du désir homosexuel pour que la supériorité du Désir avec un « D » majuscule soit enfin découverte.
N.B. : Je vois également aux codes « Viol », « Violeur homosexuel », « Oubli et amnésie », « Homosexuel homophobe », « Appel déguisé », « Milieu homosexuel infernal », « Amoureux », « Clown blanc et Masques », « Humour-poignard », « Innocence », « Médecin tué », « Douceur-poignard », « Emma Bovary « J’ai un amant ! » », « Témoin silencieux d’un crime », « « Première fois » », « Faux intellectuels », « Maquillage », et à la partie « Divin Artiste » du code « Pygmalion » dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.
1 – PETIT « CONDENSÉ »
Le déni du fantasme de viol
(et parfois du viol réel)
« À les écouter, il n’est pas abusif de parler de TABOU. Il ne s’agit pas seulement de honte. […] Comment expliquer que des hommes – qui pour certains ont lutté des années ensemble, revendiquant le droit de disposer de leur corps, de leurs désirs, des hommes qui, contrairement à d’autres mâles, ont pris l’habitude de se rencontrer pour parler d’eux, de leur vie la plus intime…– n’aient jamais parlé de ces scènes de viol entre eux ? Énoncent même qu’ils n’en ont jamais discuté avec leurs compagnons après plusieurs années de vie commune… Quel est le sens de ce tabou ? » (Daniel Welzer-Lang, Le Viol au masculin, 1988)

Film « Et l’homme créa la femme » de Frank Oz
Je n’avais pas trop d’a priori quand j’ai fait mes premières rencontres avec des personnes qui se définissaient clairement en tant qu’« homosexuelles ». J’étais convaincu que la souffrance n’avait rien de spécifiquement homosexuel. À ceux qui écrivaient qu’ils n’avaient « jamais vu d’homosexuel bien portant et heureux » (Wilhelm Stekel, Onanisme et Homosexualité, 1951), j’avais envie de répondre que je n’avais jamais vu de personnes hétéros bien portantes et pleinement heureuses non plus. L’homosexualisation du malheur comme le refus systématique d’homosexualisation de la souffrance, obéissant toutes deux à la comparaison/appropriation stérile des souffrances, étaient pour moi une seule et même expression du déni de la mort et de l’amour.
Mais j’ai découvert que beaucoup d’individus homosexuels, à force de croire que la souffrance était leur propriété privée ou au contraire une réalité qui ne les touchait jamais, désiraient et parfois se créaient leur propre blessure, bien souvent dans une lutte fiévreuse contre la victimisation et un sourire forcé.
La souffrance rejoint la vie de chacun, que nous soyons homosexuels, hétérosexuels, et plus largement humains. Aucun Homme n’est en mesure de faire de ses souffrances le ferment de son identité profonde, pas plus qu’il n’est habilité à dire qu’elles n’influent absolument pas sur sa personne et ses actions. Nous vivons tous avec des blessures, plus ou moins profondes selon les épreuves de notre existence et notre capacité à y faire face. Toute personne qui nie cette réalité-là pour lui-même ou pour les autres, s’expose à maquiller ses douleurs humaines et à les rendre beaucoup plus grandes, invisibles et mythiques, que s’il les avait soignées à temps.
Dans son essai Big Mother (2002), Michel Schneider décrit bien les ravages que peuvent opérer les réalités fantasmées dans nos existences lorsqu’elles ont l’aval de nos désirs de mort et de vie, et qu’elles obéissent plus à l’orgueil de nos bonnes intentions qu’à la reconnaissance humble de nos limites humaines : « En psychanalyse, est traumatique une effraction du réel dans l’imaginaire qui plonge le sujet dans l’incapacité de la symboliser. Ainsi, le viol ou l’acte pédophile sont des traumatismes, parce qu’ils font écho dans la réalité aux fantasmes inconscients de la victime, et parce qu’ils enfreignent la loi symbolique qui donne sens à la différence des sexes. » (p. 309) Beaucoup de personnes homosexuelles souffrent au fond de ne pas se sentir souffrantes dans une situation pénible, et faute d’avoir pu mettre des mots simples sur celle-ci.
A – LE REFUS DE LA RÉFLEXION SUR L’HOMOSEXUALITÉ :
A – a) Je ne souffre pas !
Pour la majorité des personnes homosexuelles, il est hors de question d’avouer qu’elles sont, au même titre que tous les Hommes, touchées par la douleur. Elles seraient à l’image de leurs super-héros : inébranlables, « inoxydables » (cf. le film « L’Homme de sa vie » (2006) de Zabou Breitmann). Certaines personnes hétérosexuelles se choquent avec elles de simplement entendre qu’une personne homosexuelle puisse souffrir. À force de lui assigner un destin malheureux, tout un pan de la société voudrait transformer la communauté homosexuelle en race préservée du malheur.
Une des techniques les plus fréquemment employées socialement pour nier le fantasme de viol ou le viol réel est la sexualisation générique de celui-ci. Bien que les statistiques nous apprennent qu’au moins un garçon sur six – 16% de la population masculine générale, quand même – est victime de violences sexuelles avant l’âge de 18 ans (Denis René, « Les Abus sexuels et les hommes d’orientation homosexuelle », sur le site www.criphase.org/hommeetabus.pdf, consulté en août 2007), le viol commis à l’encontre des hommes reste un sujet totalement occulté par nos sociétés du Superman et par nos media (le terme « viol » sera au mieux remplacé par celui d’« attentat à la pudeur » dans le cas des abus au masculin…). Cet aveuglement fait aujourd’hui la grisaille des personnes gay qui se savent d’une certaine manière violées – par leurs propres fantasmes de viol au moins, et parfois dans les faits – mais qui s’interdisent de le penser parce qu’elles feraient soi-disant partie du « sexe fort ». Nous pouvons nous demander dans quelle mesure l’assignation sociale du viol à la femme exclusivement (étant entendu la femme cinématographique en priorité) ne joue pas justement le jeu du viol opéré sur les hommes, et a fortiori sur les femmes réelles.
Ceci étant, la communauté homosexuelle rentre complètement dans la mouvance du déni social du viol puisqu’elle fait très souvent barrage à toute réflexion sur le désir homosexuel. « C’est vrai que je me suis posé la question, de temps en temps, de me dire : ‘Si je n’avais pas été violée, est-ce que je serais homosexuelle ?’ Maintenant, je m’en fous. » (Catherine citée dans l’essai L’Homosexualité dans tous ses états (2007) de Pierre Verdrager, p. 59) Comme on a maintes fois l’occasion de s’en rendre compte, la blessure homosexuelle, due surtout à un fantasme de viol, et parfois – plus rarement – à un viol réel, manque de simplicité pour se dire. Elle s’exprime indirectement à travers la schizophrénie – celle-ci est signe d’une extériorisation excessive de soi – et des codes symboliques qui dénoncent le viol tout en niant son existence. Le paradoxe réside dans le fait que beaucoup de personnes homosexuelles voient dans la mise en scène de la censure et de leur auto-censure un moyen de dire/occulter leur souffrance ou leur fantasme de souffrance, sans comprendre qu’ainsi, elles la cautionnent : soit elles l’exagéreront, soit elles la nieront en bloc, un peu à raison parce que le fantasme de viol n’est pas le viol réel, et un peu à tort (les fantasmes de viol peuvent parfois s’actualiser en actes réels et violents : cela dépend de notre liberté humaine). Comme l’Eva Perón (1969) de Copi, qui raconte comment elle s’est fait violer par l’épicier borgne de son quartier tout en revenant sur ses déclarations, il leur arrive de déclarer qu’elles n’ont jamais été abusées en se posant en victimes pour prendre la défense de leur (supposé) agresseur, ou même pour se substituer à lui : « Je ne sais pas pourquoi je te disais qu’il me touchait. Il me racontait sa vie. Et peu à peu je suis devenue comme lui, tu comprends, je n’y peux rien. »
Contre toute attente, beaucoup de personnes homosexuelles se mettent alors à cautionner le viol et l’inceste dont elles ont parfois fait l’objet, ou bien le désir de viol qu’elles ont ressenti, en affirmant qu’ils sont des affabulations. « Il est clair que la grande interdiction de l’inceste est une invention des intellectuels. » (Michel Foucault, « Choix sexuel, Acte sexuel », entretien avec J. O’Higgins en 1982, dans Dits et Écrits II (2001), p. 1154) Pour épargner à leur violeur l’inculpation, il arrive qu’elles essaient de se convaincre que lors du coït incestueux ou violent elles réagissaient trop, que finalement rien de terrible ne s’est réellement passé. Au moment de la violence sexuelle physique, elles ont pu éprouver un certain plaisir génital qu’elles ont interprété par la suite comme de l’amour, et ensuite comme de « l’amour pour les hommes ». Dans le film « Back Room » (1999) de Guillem Morales, par exemple, le jeune Ivan, puceau, se fait prendre par deux hommes dans les backroom d’une discothèque. Nous entendons en voix-off son monologue intérieur montrant qu’il essaie de se convaincre lui-même que ce qu’il est en train de vivre est banal et merveilleux : « Il faut que ça me plaise. Je l’ai voulu. » Une fois dépucelé, il minimise le traumatisme de l’expérience par la comparaison avec le catastrophique : « Je pensais que ce serait pire. » Cette réalité du viol ou du désir de viol est d’autant plus occultée que la victime se dit qu’elle « ne demandait que cela », en intériorisant ce que son agresseur a voulu faire du viol : un acte d’amour nécessaire et obligatoirement réciproque.
L’autocensure démarre par une mise aux oubliettes de la souffrance. Du passé souffrant, beaucoup de sujets homosexuels font table rase. Ils assurent qu’ils vont très bien et refusent qu’on pleure sur leur sort. « Nous ne voulons pas qu’on nous soigne, ni qu’on nous analyse, ni qu’on nous explique, ni qu’on nous tolère, ni qu’on nous comprenne. » (Néstor Perlongher, « El Sexo De Las Locas » (1983), p. 34) L’homosexualité ne constituerait pas une difficulté en soi. « On ne souffre pas ! » s’insurgent les militants homosexuels du FHAR sur RTL, le 10 mars 1971, à l’émission radiophonique de Ménie Grégoire qui tenta de mettre des mots sur « le douloureux problème de l’homosexualité ». Ce serait uniquement le fait que « les autres » en fassent un problème qui poserait finalement problème. Certaines personnes homosexuelles se plaisent à penser que l’idée du « bonheur homosexuel » insupporte leurs ennemis, et que leur haine est tout simplement surnaturelle et irrationnelle.
Elles sont capables de mobiliser une énergie assez phénoménale pour soutenir leur déni de souffrance. En moralisant leur propre blessure, il est fréquent qu’elles pathologisent ou contextualisent à l’excès le discours de leur interlocuteur, car pour elles, décrire objectivement un mal revient à le faire et à souhaiter qu’il se (re)produise. Nous avons du mal, quand nous souffrons, à laisser à l’autre la primeur de la découverte de notre blessure, parce qu’en nous prenant pour notre balafre – alors qu’elle nous est essentiellement extérieure, quand bien même elle nous colle dans certains cas durablement à la peau –, nous nous la cachons à nous-mêmes. La question « Souffres-tu ? » arrive alors bizarrement à nos oreilles comme l’interrogation lapidaire qu’elle n’a pas à être : « Tu as souffert ? Pourquoi ? Justifie ta souffrance anormale, Toi, le Malade ! »
C’est d’abord sur elles-mêmes que beaucoup de personnes homosexuelles opèrent une censure. Elles se persuadent que leur malaise par rapport à l’homosexualité est infondé, qu’elles se « prennent la tête » pour rien, qu’elles se posent trop de questions au sujet de leur sexualité, et donc qu’il leur faut chasser tout sentiment de culpabilité grâce à unepositive attitude faussement dynamique : « Si nous ressentons des sentiments négatifs à propos de notre sexualité, nous devons accroître notre confiance en nous. Cultivons-nous sur notre sexualité en lisant beaucoup. […] Des livres rassurants. » (Terry Sanderson, Gay Kâma Sûtra (2003), pp. 30-31) Dans certains films, les réalisateurs dressent le portrait de l’homosexualité coupable afin que l’ensemble des communautaires la conspuent et enregistrent docilement toutes les phrases injustifiées de l’auto-flagellation homosexuelle à ne surtout jamais répéter. La liste de propos répertoriés dans la catégorie « homosexualité non-assumée » (genre « Qu’est-ce qui ne va pas chez moi ? » ; « Je suis anormal… », « Se faire pénétrer, c’est mal : cela revient à devenir femme et à nier ma masculinité », etc.), d’une part est censée rassurer l’ensemble des personnes homosexuelles (« Tu vois, tu n’es pas le seul, nous sommes tous passés par cette phase d’auto-détestation. »), et d’autre part lui faire la leçon (« Parce que nous sommes passés par-là, tu dois nous écouter. Tu n’as pas à culpabiliser, est-ce clair ?! »). Beaucoup de personnes homosexuelles cherchent à chasser la voix de leur conscience que la communauté homosexuelle et la société baptisent hâtivement « haine de soi injustifiée » ou « culpabilité malsaine ». L’expression d’une résistance ou d’un doute par rapport à l’homosexualité est presque toujours identifiée comme un sentiment de culpabilité insensé, une difficulté à « s’assumer », une homophobie intériorisée, une perversion « satanique » (Simon dans la revue Têtu, n°68, juin 2002) venue exclusivement et originellement de l’extérieur, une puante marque d’orgueil trouvée dans un self control ascétique, une soumission de « honteuse » à un modèle politique oppressif ; alors que parfois il s’agit tout simplement d’une gêne saine et salutaire, d’un réveil de conscience, d’un juste amour de soi, ou d’une peur stimulée par une résistance vitale contre les tentatives d’abus et d’entrave à la liberté individuelle.
Je dirais même quand dans bien des cas, surtout quand il s’agit d’homosexualité, c’est le bannissement systématique de cette bonne gêne qui est vraiment perturbant, et non la gêne en elle-même. Beaucoup de personnes homosexuelles se matraquent à elles-mêmes « C’est pas de ta faute ! C’est pas de ta faute ! » (Sean Maguire dans le film « Will Hunting » (1997) de Gus Van Sant), parce que précisément elles s’infligent souvent la culpabilité de ne plus se reconnaître coupables pour des actes qui parfois la mériteraient. L’encouragement à renier ses erreurs n’a jamais été une preuve d’amour de soi. La phobie de la culpabilité demeure le plus sûr moyen d’expérimenter de vieux réveils de conscience inexpliqués et coûteux. Ce n’est pas pour rien si, par exemple, la scène d’aveux déchirés de Marthe dans le film « The Children’s Hour » (« La Rumeur », 1961) de William Wyler émeut autant certaines personnes homosexuelles encore aujourd’hui : « La répugnance et le dégoût d’elle-même qu’elle éprouve me bouleverse quand je revois le film. Et je pleure en me demandant pourquoi. Pourquoi est-ce que cela me bouleverse ?!? Ce n’est qu’un vieux film idiot… Les gens ne réagissent pas comme ça aujourd’hui… Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Les gens éprouvent toujours un sentiment de culpabilité que je partage, même si on prétend assumer sa condition en s’écriant : ‘Je suis heureuse, bien dans ma peau, bisexuelle, homo’, on a beau dire ‘Je suis homo et fière de l’être’, on se pose toujours la question de savoir ‘Comment est-ce que je suis devenu comme je suis ?’. » (Susie Bright citée dans le documentaire « The Celluloïd Closet » (1981) de Rob Epstein et Jeffrey Friedman) L’embarras des sujets homosexuels face à leur désir ou à leur couple dit une part de la culpabilité justifiée qu’engendrent certains actes homosexuels. Loin d’être inquiétante, cette juste culpabilité est salutaire : elle dit que la conscience personnelle s’anime et se révolte à bon droit. Les personnes homosexuelles devraient s’accrocher à leurs gênes intérieures : elles sont de l’or en barre, des signes que leur conscience est encore en vie et qu’elle les appelle à se réveiller !
A – b) L’effacement du passé :
Le déni homosexuel concernant la souffrance est particulièrement observable à travers le traitement de la mémoire opéré par la communauté homosexuelle. Beaucoup de ses membres refusent catégoriquement de poser un regard sur leur passé. Ils réécrivent souvent leur histoire personnelle sous forme de légende noire, comme si leur jeunesse « hétérosexuelle » n’avait été que mensonge. Le passé qu’ils ressuscitent est prioritairement mythique, sentimental, impersonnel et folklorique. J’en tiens pour preuve la passion qu’énormément d’artistes homos développent pour les grandes fresques historiques kitsch (la Rome et la Grèce antiques, la Guerre de Sécession nord-américaine, la Révolution française, le règne de Sissi Impératrice, etc.). La reconstitution des temps dits « anciens » sert en général à la contemplation narcissique et à la fuite de la Réalité. La majorité des personnes homosexuelles partent, comme Marcel Proust, « à la recherche du temps perdu », pour ne pas affronter ce qu’elles ont à vivre dans le présent. Le travail de réactivation de la mémoire tel qu’elles le conçoivent n’est pas un acte volontaire et libre : le passage de la dégustation de la madeleine de Proust le montre parfaitement (Marcel Proust, Du côté de chez Swann (1913), p. 51). Il est principalement impulsé par le culte de l’instant, la tristesse nostalgico-anachronique, et le désir d’isolement. Il a donc peu à voir avec la vraie mémoire, celle qui fait aimer l’Humanité, qui est partiellement intelligible et contrôlée par le Désir. Pour beaucoup d’entre elles, « l’histoire officielle est une hallucination » (Néstor Perlongher, cité par Miguel Ángel Zapata, « Néstor Perlongher : La Parodia Diluyente ») et la tradition se confond avec le « détritus » (Néstor Perlongher, cité dans l’article de William Rowe, « Notas Sobre La Poesía Latinoamericana Actual »).
L’expression « biographie homosexuelle » tiendrait-elle donc de l’antinomie ? Il faut croire que oui quand nous voyons combien de personnes homosexuelles tirent une croix sur leur passé et font barrage à tout travail de recherche sur leur existence. « Les albums de famille sont faits pour qu’on les ferme et les oublie au fond d’une armoire. » (p. 22) écrit Cathy Bernheim dans son autobiographie L’Amour presque parfait (2003). Nous trouvons des exemples parlants de cette autocensure parmi les célébrités homosexuelles, qui n’accueillent les biographes à bras ouverts qu’après avoir pris soin de brûler leurs journaux intimes et s’être assurées du silence inconditionnel de leurs proches. Adeptes du pseudonyme et de la dissimulation, un certain nombre d’artistes homosexuels défendent « l’œuvre sans auteur » – souvent sous l’excuse du refus des honneurs ou du vedettariat –, et l’interdiction – déclinée bien souvent en obligation – de l’emploi du « je ». Il s’agit pour eux de « désindividualiser » (Michel Foucault, « Préface » de l’essai L’Anti-Œdipe (1973) de Gilles Deleuze et Félix Guattari) au maximum les discours pour s’appuyer essentiellement sur le texte lui-même, en laissant de côté son contexte d’énonciation et l’orientation sexuelle de son auteur. « Nul sujet de s’exprime jamais dans nulle narration. » (Anne Garréta, Pas un jour (2002), p. 9) Ils revendiquent que leur identité est une non-identité, car ils confondent à tort l’identité avec l’image d’identité développée par un certain type de sociétés totalitaires (la froideur de la carte d’identité, des empreintes digitales, de la case à cocher dans un formulaire administratif, de la signature sur le registre d’état civil, etc.).
Paradoxalement, ils empêchent l’établissement du lien autobiographique homosexuel au nom précisément de leur supposée identité homosexuelle, c’est-à-dire d’un tyrannique étiquetage contemporain des sexualités qu’ils critiquent férocement par ailleurs. Dans un sens, ils n’ont pas tort. Il est évidemment absurde et dangereux d’arracher aux œuvres ce qu’elles ne disent pas, de violer une intimité et une vie privée, d’individualiser des discours à outrance, d’oublier que l’auteur qui se dit et qu’on dit « homo » n’est pas d’abord « un homosexuel » mais un Homme comme les autres, de tisser dogmatiquement des liens de causalité entre cryptographie et sexualité. L’histoire et la sexualité de l’auteur ne devraient pas interférer excessivement dans l’interprétation du sens plénier de l’œuvre en elle-même, ni être l’unique grille de lecture. Il est vrai qu’un écrit, à lui tout seul, se suffit presque à lui-même et délivre déjà du sens sans que nous ayons besoin de connaître par cœur tous les accidents de poussette de son papa.
Mais à rendre cette règle trop générale et à force d’interdire l’homotextualité, beaucoup d’auteurs homosexuels finissent à leur insu par « homosexualiser » vraiment leur création… car cet acharnement à ne pas être et à produire une écriture non-identitaire est finalement bien une signature homosexuelle ! En effet, le désir homosexuel désincarne plus qu’il n’humanise un discours. En faisant comme si l’auteur homosexuel et ses désirs n’existaient pas, ils divinisent une œuvre artistique qui reste avant tout un artefact humain, et négligent ainsi la richesse de la fantasmagorie commune développée par toutes les créations homosexuelles. Par exemple, comment considérer dans À la recherche du temps perdu (1913-1927) de Marcel Proust le couple Swann/Odette comme une simple relation entre une femme et un homme, et faire abstraction du désir homosexuel de la conscience qui l’a accouché ? Ou bien, si nous voulons ignorer que, chez Jean Cocteau, le mot « jeu » remplace presque toujours celui de « sexe » ou de « viol », comment comprendre les allusions discrètes à la masturbation et à l’inceste lorsque Paul déclare dans le roman Les Enfants terribles (1929) qu’« il s’est trop habitué à jouer seul » au moment où sa sœur lui propose de « jouer au jeu » avec elle ? Et comment reconnaître la voix de James Dean dans le film « Rebel Without Cause » (« La Fureur de vivre », 1955) de Nicholas Ray, plaquée sur une chanson oubliée des années 1980 telle que « Les Yeux de Laura » du groupe Goût de Luxe, en ignorant le lien d’homosexualité qui unit ces deux productions ? Sans l’étude des coïncidences et des codes homo-érotiques, nous passons à côté du sens des créations (je n’ai pas dit « sens plénier », car les réalités fantasmées ne sont pas notre Réalité profonde), et nous vidons une œuvre de son désir homosexuel, autrement dit de son humanité.
A – c) Tentative de destruction des images homo-érotiques :
Actuellement, la communauté homosexuelle – médiatique ou pas – fomente de discrets autodafés, en détruisant les œuvres homo-érotiques qu’elle avait jadis créées, pour ne nous montrer que des versions édulcorées et peu réalistes des couples homosexuels – que quelques années après elle reniera très certainement en ordonnant leur disparition –, au nom paradoxalement de la sauvegarde et de la construction du Patrimoine Culturel Homosexuel. Beaucoup de personnes homosexuelles s’en prennent aux images médiatiques de l’homosexualité car celles-ci les renvoient à leur désir homosexuel, et parfois aux réalités fantasmées désagréables qu’il a engendrées. Certains films et des pans entiers de la réflexion sur l’homosexualité menée à des époques dites « obscurantistes » sont en ce moment même mis à l’index parce qu’ils feraient partie de la production artistique de la honte homosexuelle (cela est tout à fait paradoxal, surtout à l’heure où des chercheurs inaugurent des centres d’archives homosexuel et des « Observatoires » partout en France, comme cela s’est déjà fait aux États-Unis). Mais leur guerre iconoclaste se destine également aux images de l’homosexualité d’aujourd’hui. Les célébrités homosexuelles, lorsqu’elles osent se rendre visibles, sont presque toutes systématiquement accusées de prosélytisme ou d’exhibitionnisme par les membres de leur propre communauté. Beaucoup de personnes homosexuelles dénoncent souvent les infrastructures et les moyens médiatiques mis en place pour exploiter leurs amours. Leur révolte contre tout ce qui entoure le désir homosexuel et à l’encontre du « ghetto marchand » en particulier peut s’entendre, mais ne résout absolument pas la question du désir homosexuel en lui-même. Elle les empêche même d’y répondre et montre qu’elles n’ont pas encore renoncé à certaines utopies d’amour, qu’elles restent trop dépendantes de leurs images, malgré le fait qu’elles soient persuadées du contraire puisqu’en intentions, elles croient les fuir. Si vous voulez en mettre certaines vraiment en colère, vous n’avez qu’à vous appuyer sur tout ce qui fait la culture homosexuelle dite « classique » en vue de décrire le désir homosexuel (Gay Pride, « Cage aux Folles », fleuristes, coiffeurs, antiquaires, Opéra, mère possessive, Mylène Farmer, musique techno, infidélité, Sida, backroom, etc.) : elles le transformeront presque systématiquement en « clichés réducteurs » pour ne pas l’analyser, ou pire, pour se donner un prétexte pour le copier en douce. Par exemple, ceux d’entre elles qui critiquent le plus violemment l’image « grande folle » sont bien souvent les personnalités narcissiques qui s’en approchent le plus. Le rapport idolâtre s’exprime à la fois par le mépris et par l’admiration dédramatisée – … et parfois imitatrice – de ce qui était a priori rejeté.
Refuser totalement le cliché, ou noyer son pouvoir d’actualisation dans l’artifice, c’est se condamner à y retomber sous d’autres formes. On ne bat pas l’image violente avec ses armes à elle. Ou alors on s’y enchaîne. Par exemple, à force de dire que la sportive lesbienne, le steward gay, la personne homosexuelle malade du Sida, etc., sont des « clichés », on finit par encourager justement ce passage du mythe à la réalité fantasmée, puisqu’on ne reconnaît pas des faits parfois larvés à l’état de désirs. Et c’est ainsi que nous pouvons observer que l’homosexualité chez les athlètes féminines est extrêmement courante (par exemple, l’équipe nationale féminine de handball française, jusqu’à une époque très récente, était presque uniquement composée de femmes lesbiennes) ; par ailleurs, faites le test d’interroger les hôtesses de l’air d’Air France : elles vous assureront qu’à peu près 70 % de leurs collègues masculins sont homosexuels ; enfin, au tout début de l’épidémie du Sida, en 1983, il est prouvé que 80% des individus infectés par le VIH étaient homosexuels (Frédéric Martel, Le Rose et le Noir (1996), p. 346). Concernant le dernier exemple, reconnaître le substrat de réalité fantasmée résidant dans l’image de « l’homosexuel malade du Sida » ne fait pas pour autant du Sida un « cancer gay », ni des personnes homosexuelles des sujets sidéens, ou en passe de le devenir : jusqu’à preuve du contraire, un virus ne choisit pas ses victimes selon leur orientation sexuelle. Et pourtant, cette image renvoie à une réalité qu’il faut prendre en compte pour respecter l’histoire de beaucoup de personnes homosexuelles. Tout comme un diplôme ne fait pas la valeur d’une personne – même s’il peut la dire –, l’image peut être signe d’un désir et parfois d’une réalité provoquée par ce désir. Il n’y a pas de cliché sans feu. Un lieu commun n’est pas insensé de ne pas renvoyer systématiquement à une réalité positive et justifiable : j’ai beau par exemple faire mémoire que certains Juifs ont été envoyés aux camps en tant que « sales Juifs », ou prendre conscience qu’objectivement une personne noire aura probablement plus de mal que moi à trouver du travail à cause de sa couleur de peau, cela ne remet en cause et ne justifie ni l’étiquette néfaste qui accompagne les Juifs et les Noirs, ni l’existence des réalités que cette dernière a parfois provoquée (l’antisémitisme, les camps de concentration, le racisme, etc.). Reconnaître l’existence d’un étiquetage négatif et en faire mémoire, ce n’est pas le justifier et stigmatiser davantage une personne. C’est au contraire reconnaître celle-ci telle qu’elle est, dans toute sa dimension, avec ce que l’étiquetage a parfois fait d’elle, et ce qu’il ne modifiera jamais de sa grandeur humaine. Détester son image, y compris une image insultante ou peu conforme à ce que nous sommes, c’est détester toute une part de nous-mêmes. Le désir homosexuel met en place des images particulières qu’il convient de respecter et de comprendre sans les moraliser pour les détruire, même si elles renvoient souvent à des événements peu glorieux – le viol notamment – ou carrément faux. Autrement, nous encourageons leurs actualisations violentes dans l’acte iconoclaste ou iconodule.
Entre l’image et la réalité fantasmée, c’est l’histoire volontairement/involontairement confuse de la poule et de l’œuf : nous ne saurons jamais vraiment dire qui a engendré l’autre… et pourtant, un désir humain a pu quand même agir. À force de fuir leurs clichés, certaines personnes homosexuelles les matérialisent en partie. Il n’est pas rare de croiser un certain nombre parmi elles qui s’alignent concrètement et toujours imparfaitement aux images sociales assignées à leur orientation sexuelle, en devenant par exemple des fans de Mylène Farmer, des artistes, des personnalités du monde de l’image, des fleuristes, des coiffeurs, des couturiers, des antiquaires, etc. Pourquoi le nier, si en effet c’est vrai ? Cela ne retire rien aux innombrables exceptions à ces images, autrement dit à toutes les personnes qui se disent « homosexuelles ». Nous n’avons aucune raison valable pour déchirer le cliché et refuser son influence, si le lien de coïncidence entre certains goûts et l’homosexualité existe réellement. Les sujets homosexuels resteront à jamais ce qu’ils sont : des Hommes libres et uniques. Mais ils sont aussi ce que leurs images ont fait d’eux.
On est même en droit de se demander dans quelle mesure l’effet actualisateur de la simulation de destruction des images de l’homosexualité n’est pas plus ou moins deviné puis recherché par bon nombre de personnes homosexuelles. C’est exactement le syndrome de la star qui, en feignant de refuser les paparazzis, leur fait comprendre qu’ils doivent se ruer sur elle. Attaquer l’image néfaste et les injustices qu’elle a instaurées dans la réalité concrète, sous le prétexte que celles-ci ne devraient pas exister, incite à nier que l’image puisse influer sur les existences, et donc à encourager son influence. Beaucoup d’individus homosexuels se réjouissent/s’offusquent intérieurement de voir l’étrange correspondance travaillée de leurs goûts et de leurs fantasmes avec leurs frères communautaires, même si ce plaisir/dégoût dans la ressemblance a majoritairement la force du non-dit. Une fois dévoilé et retiré de la causalité, il montre toute sa médiocrité… donc il est dit « homophobe », « trop généralisateur » et « stéréotypé ». Elles ne méconnaissent pas les points communs qu’elles partagent ensemble : ils leur indiquent où se trouvent leurs viviers, et leurs probables jumeaux de désirs et d’actes. Et le cliché homo, en même temps qu’elles le conspuent quand il viendrait des « hétéros », ne leur est absolument pas inconnu ni désagréable lorsqu’il dessert leurs propres intérêts. Par exemple, pas une personne homosexuelle n’ignore qu’en allant à une représentation de théâtre lyrique, à une association féministe, à un concert de Mylène Farmer, à une expo d’art moderne, sur certains chat Internet, dans un bar réputé gay friendly, ou à l’Opéra, elle a plus de chances de rencontrer d’autres personnes homosexuelles comme elle que dans un stade de foot, un garage automobile ou dans les « téci » de la banlieue parisienne, même s’il existe des exceptions partout. Certains milieux sociaux et corps de métiers sont plus connotés homosocialement que d’autres : au moins dans les mentalités, et ensuite dans la réalité. L’attaque des images de l’homosexualité par la majorité des personnes homosexuelles est donc à la fois subie et stratégique.
A – d) La phobie de la Vérité :
L’autocensure de beaucoup de personnes homosexuelles passe essentiellement par un refus de la réflexion intellectuelle et scientifique sur le désir homosexuel. Car si l’opinion publique apprend qu’il est possible de détecter les coïncidences du désir homosexuel de manière partiellement logique et rationnelle, cela confirmerait l’idée selon laquelle l’homosexualité peut être réveillée par un contexte plus ou moins identifiable, donc désacralisée et mise à distance. En général, elles préfèrent remplacer l’explication rationnelle de leur désir sexuel par une lecture poétisante de celui-ci, imposant le relativisme intellectuel comme unique religion : selon elles, la Vérité unique n’existerait pas car il n’y aurait que « des » vérités parcellaires et non-fondamentales. Ceux qu’elles choisissent pour ennemis ont d’ailleurs tous un lien avec la recherche de la Vérité (les intellectuels humanistes, les religieux, les journalistes, les politiciens, les savants, etc.). Elles soutiennent souvent que la raison ne doit surtout pas guider leurs choix d’amour, que « l’intelligence est leur pire ennemi » (Jean Cocteau dans le documentaire « Jean Cocteau, autoportrait d’un inconnu » (1983) d’Edgardo Cozarinsky). Dès que quelqu’un commence à les faire réfléchir et à les bousculer dans leurs préjugés, il « polémique », « rentre trop dans le débat », ou est suspecté de « juger ». Elles préfèrent les témoignages « je » non étayés et émotionnels que la confrontation des points de vue pour une recherche collective et raisonnée de la Vérité.

« L’amour est universel. Qui sommes-nous pour le juger? »
Ce sont précisément les notions de jugement et de Vérité qui sont l’objet de tous leurs fantasmes et de leur hantise. « Le goût camp refuse l’axe bipolaire du jugement esthétique habituel : bon-mauvais. » (cf. l’article « Le Style Camp » de Susan Sontag, L’Œuvre parle (1968), p. 440) Complètement galvaudé par la société actuelle et les media qui ont détourné des phrases bibliques sans les comprendre (« Ne juge pas ton prochain et tu ne seras pas jugé », « Que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre », etc.), le verbe « juger » est presque uniquement compris dans son sens péjoratif, c’est-à-dire de « condamner », de « traîner en procès », alors qu’il peut également signifier beaucoup plus positivement « discerner », « évaluer », « penser », « dénoncer les actes puis relever les personnes après ». Si le jugement des personnes est à bannir, il est en revanche très bon et nécessaire de juger des actes et des idées, surtout quand ces derniers créent des injustices. Le jugement de valeur, les préférences hiérarchisantes, la morale (non-moralisante !), les priorités éthiques, etc., n’ont jamais, jusqu’à preuve du contraire, constitué un danger pour la santé humaine. Bien au contraire ! Comme le révèle à juste titre Anthony de Mello dans Une Minute d’humour (1999), « il y a un défaut que le bon juge a en commun avec le mauvais juge : il juge. » (p. 149) Et ce point commun partagé avec le mauvais juge, il faut que les Hommes l’assument, le portent sans honte, sans s’excuser de penser et de contredire ce qui heurte leur conscience. Sinon, la raison humaine est mise en péril. La « jugement-phobie » (excusez le néologisme, mais je n’ai pas trouvé de mot plus approprié…), qui se veut ouverture et respect de la pensée, agit en réalité comme une atteinte à la création et à l’intelligence humaine. Un certain nombre de personnes homosexuelles se laissent gagner par cette « jugement-phobie » puisqu’elles ont tendance à transformer le doute en un dieu absolu qui désavoue ce qu’il était censé leur apporter, à savoir la Vérité. Et quand quelqu’un s’engage dans la recherche de la Vérité, elles s’arrangent pour lui faire comprendre qu’il s’enlise sur le terrain des certitudes afin de le faire passer pour un grossier et orgueilleux personnage, et pour masquer ce qu’il essaie de leur dire et qui les dérange. À les entendre, il vaudrait mieux ne prétendre à rien du tout, dans la simulation d’innocence absolue et la fausse humilité, que d’imaginer que les Hommes peuvent s’apporter les uns aux autres et trouver ensemble des horizons de sens communs pour essayer de vivre humblement le bonheur.
Par leur croyance haineuse en la vérité des modèles qu’elles rejettent, elles arrivent à dire que c’est la Vérité qui est mensonge, et le mensonge qui est plus vrai que ce qui leur serait imposé comme vrai. « Pour qu’une chose semble vraie, disait Jean Cocteau, il ne faut pas qu’elle soit vraie. » Étant donné que toute vérité n’est jamais totalement à l’abri de la récupération, elles finissent souvent par trouver la Vérité dangereuse et gênante. Par exemple, si un intellectuel leur fait une critique fondée à propos des caprices du désir homosexuel et de leurs conséquences fâcheuses sur la réalité concrète, certaines reconnaîtront mollement qu’il a « peut-être raison », mais lui conseilleront de se taire parce que ses prises de positions « rejoignent de manière inopportune certains arguments de la rhétorique homophobe » (cf. l’article « Ghetto » de Michael Sibalis, dans le Dictionnaire de l’homophobie (2003) de Louis-Georges Tin, p. 196). Mais empêcher la recherche de la Vérité au nom de la récupération/déformation homophobe, n’est-ce pas donner finalement le dernier mot aux ennemis de la Vérité et aux « homophobes » ? Elles reprochent au fond à la parcelle de Vérité d’être trop vraie et trop faible, de se laisser caresser par les Hommes. Elles décident donc de placer la Vérité ailleurs, sur un terrain où la liberté humaine ne pourra pas la dénaturer, c’est-à-dire du côté de la mort, du « Cosmos », ou du despotisme. Elles parlent alors, comme Michel Foucault, de « régime de vérité ». « Par vérité je ne veux pas dire l’ensemble des choses vraies qu’il y a à découvrir ou à faire accepter, mais l’ensemble des règles selon lesquelles on démêle le vrai du faux et on attache au vrai des effets spécifiques de pouvoir. » (Michel Foucault, Dits et écrits I (2001), pp. 545-546) Elles ont finalement amalgamé la Vérité avec les instances humaines qui se sont emparées dogmatiquement de la définition du vrai, le contenu avec l’enveloppe, pour donner inconsciemment raison à l’enveloppe : « Toutes ces revendications de la personne humaine, de l’existence sont abstraites : c’est-à-dire coupées du monde scientifique et technique qui, lui, est notre monde réel. » (idem) Elles arrivent au paradoxe de croire que la Vérité ne se trouve que dans ce qui leur est montré comme « anti-Vérité » et ce qui brise, selon elle, « le mythe de la Vérité vraie ». La croyance selon laquelle la Vérité est uniquement contextuelle, sensitive, fragmentaire, et individuelle, nie qu’elle affirme par-là que la Vérité n’existe pas. En effet, elle fait de ces poncifs une Vérité unique et possédable, donc une anti-Vérité, puisque la Vérité, par définition ne se possède pas. C’est tout à fait sage, en effet, de postuler que la recherche de la Vérité est la remise en question permanente de la perception de cette Vérité. Mais le doute doit aussi nous faire dire que la Vérité existe et qu’il est juste de la rechercher. Sinon, à quoi bon douter ? À mon avis, le comble de l’orgueil, ce n’est pas seulement de croire que la Vérité se possède et que nous pourrions l’incarner ; c’est aussi de penser que nous ne sommes pas faits pour la Vérité et que la Vérité ne s’incarne jamais, c’est la suffisance que procure la démission à la Vérité, car il faut finalement beaucoup d’humilité, et donc de justesse, pour s’estimer digne de partir à la recherche de la Vérité en sachant que nous serons quoi qu’il arrive toujours à côté et en dessous d’Elle, et que c’est Elle qui vient à nous, par bribes.
Aussi bizarre que cela puisse paraître, ce rejet brutal de l’existence du vrai et du faux, et donc le refus du choix entre l’un et l’autre, s’accompagne souvent de l’élection du mal, car seul le mal promeut l’indécision. Mal agir, ce n’est pas uniquement décider de suivre délibérément le mal, contrairement à l’idée communément admise ; c’est aussi « faire en laissant faire », promouvoir le non-choix entre le mal et le Bien parce que nous voulons suivre les deux, c’est l’immobilisme mortifère suscité par la saisissante découverte de notre libre arbitre. Le mal nous suggère de faire comme l’âne adolescent qui, en voyant qu’il a la possibilité de boire à la fontaine située à sa droite ou bien de manger les fruits du pommier à sa gauche, décide de crever de faim et de soif sur place parce que la perspective du choix le paralyse.
Notre société matérialiste actuelle, qui veut nous éviter de faire des choix en nous assénant qu’ils sont tous possibles, s’affaire précisément à gommer toute frontière entre le Bien et le mal. Et l’Homme moderne obéit souvent à la lettre au commandement du rejet du jugement de valeur et de la morale en croyant penser par lui-même en ne prononçant pas les mots interdits « Vrai », « faux », « Bien », « mal », « Dieu », « diable », « pardon », « culpabilité », « vie », « mort », « péché », etc. En général, il n’aime pas apprendre que le Bien et le mal existent, car cette démarche lui montre qu’il peut être libre s’il pose un choix entre les deux et qu’il privilégie la vie. Or, comme il a de plus en plus à tendance à s’éviter des choix entiers qui le rendraient responsable de ses actes, il réduit le Bien comme le mal à des abstractions effrayantes pouvant toutes deux s’incarner en personnes humaines clairement identifiables. En refusant de reconnaître l’existence du Bien et du mal, il se condamne sans s’en rendre compte à une lecture manichéenne du monde exprimée sous la forme du déni : il croit vivre « par-delà le Bien et le mal ».
Quand je parle de manichéisme ici, je ne me réfère pas uniquement au sens social actuel du terme, qui me paraît spectaculairement réduit : le manichéisme n’est pas que la création paranoïaque d’un axe séparant clairement un Bien et un mal jugés humainement personnifiés ; il se situe aussi dans la négation de cet axe ou de l’existence du Bien comme du mal. Le manichéisme historique est un mouvement religieux syncrétique dans lequel le Bien et le mal sont posés comme des forces égales (= des moitiés androgyniques identiques) et radicalement opposées que l’on pourrait posséder comme des objets ou incarner soi-même en les niant. L’individu manichéen croit au Bien mais aussi au mal personnifiés à vie en l’Homme. Or le mal n’a jamais pu s’incarner éternellement en l’Homme comme l’a fait le Bien. En ce sens, cela relève de l’anachronisme et du non-sens d’affirmer par exemple que l’Église catholique est fille ou mère du manichéisme. D’une part, d’un point de vue historique, le manichéisme est apparu postérieurement et en opposition au christianisme, au IIIème siècle après J.-C. : l’Église catholique a de tout temps dénoncé le manichéisme comme une secte. Et d’autre part, même si dans son discours le christianisme parle de « Bien », de « mal », de « péché » et de « tentation », et qu’elle considère que Dieu et le diable existent, elle n’envisage absolument pas le Bien comme une possession, ne croit pas en l’incarnation durable du mal, et avance que la force du Bien est supérieure à celle du mal. Tout le contraire, donc, de la pensée manichéenne !
Certains penseurs de renom se confondent encore dans les termes quand ils projettent sur les religions leurs propres fantasmes manichéens. Ils prennent tout discours sur le Bien et le mal pour un discours manichéen qui s’accaparerait ces deux forces, alors que la reconnaissance de l’existence du Bien et du mal – qui sont des réalités visibles et concrètement à l’œuvre dans notre monde – pour tendre vers le Bien, n’a jamais impliqué la promulgation doctrinale d’une « frontière nettement discernable » (Milan Kundera, L’Art du roman (1986), p. 17) entre Bien et mal, ni la prétention à la possession de la Vérité unique universelle. Comme l’énonce à juste titre Michel Foucault, ce n’est pas parler du mal qui fait le mal : c’est précisément de ne pas en parler bien qui implique que nous soyons tentés de séparer hâtivement l’Humanité en moutons blancs d’un côté et en moutons noirs de l’autre. « Tous les gens qui disent qu’il ne faut pas penser en termes de bien et de mal pensent eux-mêmes profondément en termes de bien et de mal. […] Il n’est pas possible de ne pas penser en termes de bien et de mal. Mais il faut à chaque instant dire : mais si c’était le contraire ou si ce n’était pas ça, ou si la ligne passait ailleurs… » (Michel Foucault, « Radioscopie de Michel Foucault », entretien avec Jacques Chancel en 1975) Les membres d’une société sont bien obligés, pour co-habiter ensemble, de se faire une idée de ce qui est bon ou mauvais pour l’Homme et son épanouissement, et de reconnaître que le Bien et le mal existent, pour risquer une parole de vie et tracer (au crayon à papier !) des lignes de conduite donnant des repères aux individus plus fragiles, en tenant toujours compte des réalités parfois complexes et toujours singulières de chacun.
Le manichéisme historique a encore laissé des traces dans nos civilisations actuelles (la traditionnelle confusion entre péché et défaillance, la croyance en l’existence réelle des gentils et des méchants cinématographiques, l’idée répandue selon laquelle Hitler était le diable en personne, ou que tout chercheur et défenseur de la Vérité unique et universelle est un monstre d’orgueil, le démontrent bien !), traces d’autant plus tenaces qu’il est appliqué sans être nommé explicitement en tant que tel puisqu’il se déclare intentionnellement contre lui-même. Les nouveaux manichéens passent en effet leurs temps à se présenter comme des défenseurs de l’anti-manichéisme ! Ils se pensent à l’abri du manichéisme, mais poussent des hauts cris (manichéistes !) à chaque fois qu’ils entendent parler explicitement de « Bien » ou de « mal », ou prêtent attention à ceux qu’ils ont définis comme les représentants humains de ceux-ci. Ils considèrent sans se l’avouer que le Bien et le mal sont des choses qu’ils peuvent devenir par contagion. Le signe montrant qu’ils se situent dans la moralisation manichéenne et non la morale, c’est la dénégation de leurs propres actes qu’ils ne souhaitent pas juger en leur âme et conscience, qu’ils voudraient banals, ni bons ni mauvais. Le « Il ne faut pas faire parce que c’est mal » devient fréquemment dans leurs discours « Je ne fais pas ». Ils ont tendance à confondre les faits avec les opinions, le constat avec le moralisme. Ils se persuadent que tout est permis, et que rien ne les guide … surtout pas le mal, évidemment. « Si j’ai pu faire du mal (dans ma vie), c’est tout à fait inconsciemment. » (Denis Daniel, Mon théâtre à corps perdu (2007), p. 9) La vision du monde connue actuellement comme manichéenne et qui stipule que « le Bien se trouve ici et le mal là » est souvent remplacée chez eux par une fable équivalente : « Rien n’est tout blanc, rien n’est tout noir parce que tout est un peu des deux à la fois et que rien n’a à être prioritairement ni bon ni mauvais : c’est à moi de décider où se trouve le bien et le mal pour mon existence. » (Adam et Ève devant l’Arbre de la connaissance du Bien et du mal tiennent exactement le même discours : c’est cela, le péché « originel », à proprement parler) Mais en contre-partie, les manichéens des temps modernes, qui en général ne vivent que pour le plaisir et l’argent (ou le refus affiché de l’argent), se construisent leur propre morale maison sous la forme du binarisme moralisant, laissant de côté la morale humaniste, celle qui ne résout pas les problèmes de la vie par des « oui » ou des « non » catégoriques, des « pour » ou des « contre » schématiques, mais par des « comment », une observation au cas par cas, la nuance, le compromis, le doute, et une espérance tournée vers le meilleur possible. L’antagonisme « équilibrant » – en réalité une philosophie de vie pseudo humaniste s’appuyant sur une pensée bouddhiste mal comprise (par exemple l’équilibre dit « nécessaire » et « indispensable » entre le « yin » et le « yang » ; ou bien encore la croyance non moins absurde que le mal est comme la face pile du Bien, et même la raison d’être du Bien) est le propre de la pensée manichéenne contemporaine.
Les nouveaux manichéens ne saisissent pas qu’en se plaçant constamment en « justes » milieux dans une confortable neutralité jugée seule vraie, ils font déjà preuve d’un dogmatisme qui ne s’assume pas lui-même : ils se créent mentalement un bon et un mauvais à fuir à tout prix comme des pestes parce qu’ils désirent inconsciemment les déifier derrière un neutralisme bien-pensant. Ils conçoivent non plus le Bien et le mal en termes de forces extérieures à eux et incarnées par les autres – cette image du manichéen classique, au contraire, les répugne plus qu’autre chose –, mais cette fois sous forme de forces intérieures ayant le pouvoir de s’incarner dans l’individu même, et donc en eux (et c’est cela, vivre le véritable enfer : croire qu’on est le diable en personne). Leur manichéisme place l’Homme en unique énonciateur silencieux du Bien et du mal pour lui et pour les autres, et traduit chez l’être humain qui en adopte la doctrine muette un désir et un sentiment d’incarner cette créature qui condense Dieu et le diable et qui passe de l’un à l’autre sans se définir : l’androgyne.
A – e) L’interdiction du discours sur la sexualité :
Dans la communauté homosexuelle, le rejet du discours sur le vrai se manifeste surtout par l’interdiction du discours éthique sur la sexualité. La majorité des personnes homosexuelles et de leurs sympathisants pense que la sexualité adulte relève uniquement de la sphère de l’intime et du « Couple », et qu’elle n’a pas à être guidée par une autre instance que la conscience individuelle. « Seules les relations à deux peuvent être dans le vrai. Tout ce qu’il y a d’important dans une vie se passe toujours entre deux personnes. » (Marie-Laure Delorme, « Philippe Besson : autour d’un secret » dans le Magazine littéraire, n°423, septembre 2003, p. 69). Leur demande du « droit à l’indifférence » concernant leurs pratiques et leurs préférences sexuelles énonce qu’aucun discours sur la sexualité ne doit pas être posé – celui qui enfreint cette règle d’or sera jugé « réactionnaire » et « coincé » –, même si paradoxalement, à d’autres moments, elle s’exprimera par une obligation du déballage de la vie génitale, et un regret que le thème de la sexualité soit encore trop « tabou » dans la société (mais où sont les préservatifs pour que nous commencions à réfléchir et à « parler vrai » ?…).
Pour invalider tout discours sur le sexe, certaines personnes homosexuelles s’appuient sur l’argument de l’expérience – principalement génitale. Il est intarissable, et se résume ainsi : seul celui qui aurait quantitativement pratiqué la totalité des pratiques sexuelles édictées par la doxahomosexuelle et hétérosexuelle aurait le droit de parler de la sexualité en connaissance de cause : autant dire personne, vu la longueur de la liste… Cela part souvent d’un bon sentiment. Leur devise est de dire qu’il faut essayer pour voir et se découvrir en vérité, que toute expérience sexuelle – comprendre « génitale » ou « amoureusement corporelle » –, à partir du moment où elle est faite en accord avec soi-même et avec l’être aimé, est forcément épanouissante et irréprochable. Selon elles, l’important dans les actes sexuels, ce serait l’amour que nous y mettons, et non les faits en eux-mêmes. Autrement dit, dans l’exposé des prophètes hédonistes de « l’expérience », c’est la réelle expérience, celle qui s’appuie sur les faits et leurs horizons de sens (c’est-à-dire sur la Réalité), qui est dénigrée. Les libertins homosexuels ont quitté l’empirisme pour rejoindre l’expérimentalisme déshumanisé, suivant à la lettre l’algèbre du besoin qui exige que la baisse de qualité dans les rapports génitaux soit compensée par le nombre de rapports génitaux. Ils chantent la sacro-sainte « Expérience » quand ils n’en tiennent déjà plus compte, puisque la véritable expérience n’est pas d’abord quantitative mais qualitative : nous pouvons multiplier toutes les expériences que nous voudrons tout au long de notre vie, si nous n’en tirons pas les enseignements qui s’imposent, nous serons moins mûrs que celui qui aura consenti à privilégier certaines expériences par rapport à d’autres, quitte à en vivre moins, pour être heureux. C’est le rapport aux expériences de vie, et non leur nombre, qui fait la véritable expérience qui force le respect.
L’interdiction posée sur la réflexion de la sexualité s’étend bien évidemment à l’homosexualité. Beaucoup de personnes homosexuelles s’enjoignent entre elles à ne pas se poser de questions par rapport à leur propre orientation sexuelle. Ces encouragements/avertissements, souvent très bien intentionnés, visent à éviter l’auto-flagellation et la tourmente de la masturbation intellectuelle. En matière de sexualité, il s’agirait de ne plus faire intervenir sa cervelle, de « se lâcher ». « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas » est la seule maxime intellectualisante que certains sujets homosexuels semblent avoir retenue de leurs cours de philo du lycée. Comme, pour eux, la raison s’oppose d’office au corps – car ils confondent la raison avec son idéologie desséchante, le rationalisme –, ils refusent toute logique qui ne s’appuie pas uniquement sur l’expérience sensuelle et génitale.
B – L’ÉVENTAIL DES TECHNIQUES DU DÉNI HOMOSEXUEL :
B – a) L’opposition plus ou moins frontale :
Afin de faire barrage à la réflexion sur le désir homosexuel, une autre technique de censure est parfois mise en place : celle de l’opposition de principe, déguisée en recherche scrupuleuse de la nuance. Certains penseurs homosexuels marquent une nette préférence pour le flou, le non-dit, la réponse anti-conventionnelle et non-relationnelle. Aux questions qu’ils pensent fermées, ils répondent par la fougue langagière. Aux questions soi-disant ouvertes, ils répliquent avec concision ou à côté. La seule règle est l’inversion. Il s’agit de ne jamais paraître sûr ou dogmatique – même s’ils le seront dans l’application radicalisée de cette règle –, de ne jamais correspondre au supposé désir de l’autre. Pas d’enthousiasme suspect, pas de violence, pas de « faire plaisir », pas de consensus : de la mesure dans l’anti-conformisme. Beaucoup d’intellectuels homosexuels vivent dans l’illusion d’une « objectivité dans la neutralité ». Et quelques temps après, ils se retournent de leur siège où ils avaient feint de s’assoupir, et découvrent avec surprise l’hypocrisie de l’apolitisme, de la pensée laïciste et de l’anti-fascisme moralisant, car la neutralité est déjà un présupposé idéologique qui n’est pas neutre.
Certains personnes homosexuelles jouent sur les mots afin de laisser agir la mauvaise foi : en intentions, par purisme et goût du vrai ; en désir, par une volonté de ne jamais trouver un terrain d’entente avec leur interlocuteur. L’énervement de ce dernier, s’il arrive enfin, leur apporte l’assurance que leur malhonnêteté intellectuelle est une vérité ultra-gênante à entendre, et dont elles peuvent être fières en toute sérénité. Le postulat de base est de ne pas se choquer, même et surtout quand elles en ont le plus envie. Elles préfèrent observer un faux calme exaspéré et vainqueur plutôt que de prendre le risque de passer pour des hystériques qui nient tout en bloc ou qui victimisent à l’excès. Le but de l’exercice n’est pas vraiment d’écouter ce que dit l’autre mais de détecter dans son discours les indices qui montrent à la face du monde qu’elles ne seront jamais aussi bêtes et agressives que lui. En outre, leur paix travaillée ne manque pas d’exciter certains de leurs farouches opposants : à ce moment-là, dans une indignation silencieuse et contenue, elles les surveillent du haut de leur observatoire (pensez à la création, le 9 octobre 1998 en France, de « l’Observatoire du PaCS » pendant la promulgation de la loi), en marquant scrupuleusement et d’une main tremblante sur leurs carnets les paroles abjectes dites sous le coup de la colère qu’elles ont en partie attisée, pour ensuite ressortir calmement leurs notes aux moments opportuns. Elles préfèrent jouer les victimes sans voix, sous le choc, abasourdies par la violence inhumaine dont elles feraient l’objet, pour préparer discrètement leur vengeance, plutôt que d’observer les faits.
De même, quand l’un de leurs camarades se risque à tendre des ponts entre elles, en évoquant au détour d’une conversation des coïncidences observables concrètement dans les vécus d’une majorité de personnes homosexuelles (comme par exemple le fait qu’en général les sujets homosexuels ne gardent pas un souvenir impérissable de leur passage au collège, ou bien qu’ils n’ont pas des situations familiales et amoureuses des plus simples), elles accueillent souvent ces constats connus de tous par des réactions de surprise molle (« Oooh… tu crois ? … Comme tu y vas… »), des assentiments timides et moralisants (« Mouaih… peut-être. C’est un point de vue… Mais tout ça, c’est à cause de la société »), ou par un optimisme dénégateur (« Non. Je ne vois pas trop où tu veux en venir. Ne crois-tu pas que tu noircis un peu le tableau, que tu généralises trop ? ») ne permettant pas de déboucher vers un possible débat de fond. Paradoxalement, en s’interdisant tout débordement émotionnel, bon nombre de personnes homosexuelles veulent se persuader que les autres sont absolument choqués par ce qu’elles vivent, afin de dévaluer ce qu’ils pensent et l’importance de leurs propres actions. Décrire un tort reviendrait, selon elles, à extrapoler, à cacher une honte personnelle, et même à créer ou grossir soi-même l’offense que l’on commente. Mais la plupart du temps, elles se croient plus choquantes qu’elles ne le sont véritablement. Ceux qu’elles rêvent « bien-pensants scandalisés pour leurs fausses insolences » en ont vu d’autres. S’ils réagissent à ce qui n’est choquant que pour elles, c’est uniquement parce qu’ils ne veulent pas accorder à la bassesse du déni ou de l’exagération des souffrances l’importance qu’elles lui prêtent : ils se rient de leur prétention. La dédramatisation intérieurement euphorique joue finalement le jeu de la dramatisation excessive : l’Homme passionné, parce qu’il connaît ses excès, se protège dans la neutralité relativiste. Puisque tout devrait logiquement le choquer face à une violence objective, il décide que rien ne le choquera, pour sauver la face. Il fait semblant de ne jamais s’emporter, de ne pas jouer le jeu de ce qu’il croit être de l’intégrisme, et s’expose alors à reporter sa retenue sous forme d’excès d’humeur souvent assez brutaux et inattendus à des moments où il s’y attend le moins.
L’autre procédé que beaucoup de personnes homosexuelles emploient pour invalider le débat sur le sens du désir homosexuel est la mise en scène de la tristesse. Elles font mine de ne pas s’intéresser à ce qu’elles racontent, de regarder le monde avec des lunettes noires, d’endurer une déprime inexplicable et insurmontable. Elles érigent la mélancolie en caractère, en nature profonde et innée. « Dans un paysage détruit, je vois toute la beauté du monde. Alors que quelqu’un d’autre dira qu’il la voit dans un arbre qui fleurit, moi, définitivement, je préfère l’arbre calciné. Pourquoi ? Je ne sais pas. » (Mylène Farmer citée dans la revue Studio, décembre 1993) La post-modernité en a convaincu plus d’unes que la culture humaine n’avait rien à leur apprendre et qu’il fallait annoncer cette Bonne Nouvelle de la négativité à tout le monde sur un ton égaré et grandiloquent. Elles se dévalorisent pour décourager les autres de venir les bousculer, pour prouver la toute-puissance de la mort sur la vie. Elles se présentent comme des cas désespérés, incurables, et s’acharnent à réduire à néant tous les efforts que les autres mettront en place pour les aider. « Tout ce que vous direz sera peut-être très juste, mais je le sais déjà : pour les autres, ça marche sûrement très bien, mais pour moi, ça ne marchera pas. » Leur ténacité dans le découragement ne fait que confirmer à leurs yeux la force de l’abattement qu’elles désirent voir gagner en elles. Le négativisme apporte l’orgueil éphémère du narcissisme, l’illusion de l’existence d’une réalité révélée à elles seules : une sorte de vérité mortelle annonçant que la Vérité n’existe pas, que la vie n’est qu’apparence, que l’amour unique ne vaut rien et ne dure pas, etc., etc. Le regard nihiliste ne se sait pas toujours ennemi de la Vérité puisque au contraire il prétend agir en son nom et débusquer les faux-semblants dans un purisme déshumanisé. Il croit être réaliste en défendant sa désespérance par les images violentes médiatiques, en s’orientant prioritairement vers le négatif et la mise en évidence des réalités fantasmées que les « idéalistes » n’auraient pas vues. Pour beaucoup de personnes homosexuelles, il s’agit de guérir les autres de ce terrible mal que sont les idéaux d’amour et de perfection. La Vie, ce n’est pas tout rose… donc ce sera surtout noir. Point final.
Dans un registre similaire, beaucoup de personnes homosexuelles noient tout essai d’explication du désir homosexuel dans l’argument esthétique vaporeux. Elles reprennent la bonne vieille rengaine de « l’ineffabilité de l’art » pour ne pas avoir à rendre compte de leurs agissements. Ce qui est artistique ne se dirait pas avec des mots, n’aurait pas besoin de se justifier. Grâce à l’art, elles mettent à l’abri leurs œuvres de l’interprétation en dressant des barbelés dorés tout autour. « L’art est une propriété privée, la plus privée que l’homme ne se soit jamais accordée. » (Witold Gombrowicz, Journal 1957-1960 (1976), pp. 218-219) Elles posent la suppression de la parole éthique en matière d’art comme obligatoire. Dégager une interprétation ou un horizon de sens, souligner l’absence de contenu universel ou de beauté d’un ouvrage, c’est sombrer dans un obscurantisme « fasciste ». « En art, il ne devrait y avoir aucune référence au bien et au mal » affirme Walt Whitman (cité par Jean-Philippe Renouard dans le Dictionnaire des Cultures gays et lesbiennes (2002) de Didier Éribon, p. 501). Et Marcel Proust de rajouter : « Je suis totalement incapable de comprendre qu’une quelconque œuvre d’art puisse être critiquée d’un point de vue moral. Le domaine de l’art et celui de l’éthique sont entièrement distincts. » (idem) À leur avis, à partir du moment où est appliqué à n’importe quelle action ou création le statut d’objet culturel, celle-ci devient inattaquable, sacrée. Pas touche à mon œuvre d’art ! Certains artistes homosexuels présentent l’art comme un processus sans but, mais qui s’accomplit magiquement comme tel, sans qu’ils soient responsables de leurs idées. En réalité, ils programment et innocentent un accidentel qu’ils ont bien souvent prémédité. Si nous prenons le cas précis de la poésie de Paul Verlaine, nous nous rendons vite compte que celle-ci n’est pas si irrationnelle et si anti-conventionnelle que son auteur la rêvait : Paul Valéry voyait, non sans raison, en Verlaine un faux naïf, un « zutiste » travaillé, un « primitif organisé » (Jean-Michel Maulpoix, « Poétique de la chanson grise », dans le Magazine littéraire, n°321, mai 1994, p. 43). L’écriture automatique de beaucoup d’écrivains homosexuels se veut gage d’authenticité non-programmée. En fin de compte, ils dosent la réapparition agile du hasard à travers les calculs précis de la pensée. Ils orchestrent ce qui ne s’orchestre pas – l’improvisation – pour ne pas s’expliquer à eux-mêmes le pourquoi de leur mise en scène. Ils simulent le non-contrôle pour cacher qu’ils ont tout prémédité dans le ratage… sauf le fait qu’ils ne s’en rendent pas compte !
Beaucoup de personnes homosexuelles font passer leur homosexualité pour une question impossible, donc puissante. Elles convertissent le paradoxe en essence profonde. Cela n’a pas beaucoup de sens puisque se définir par le paradoxe revient précisément à ne pas se définir du tout : une contradiction n’est ni une essence ni une vérité objective. Mais dans le monde schizoïde, le non-sens poétique semble produire du surnaturel vraisemblable. Certains individus homosexuels célèbrent la pureté des paradoxes par l’usage de l’oxymore, figure de style très appréciée des précieux et des romantiques, et confrontent leur interlocuteur à une logique qui nie, affirme et demande, tout cela dans un même mouvement rhétorique. Tout est tout, rien n’est rien, rien n’est tout, tout est rien, je m’en fous, pourquoi tu dis ça ? Moins direct et adulte que la négation, qui est l’acte clairement posé de l’énonciation d’un « non » impliquant une prise en compte de l’existence de ce qui est refusé, le paradoxe, par le flou qu’il impose, déroute davantage, et peut donner à celui qui en use une impression d’éphémère victoire. Bon nombre d’intellectuels homosexuels croient en l’abdication majestueuse de la pensée. C’est vrai qu’après un exposé où ils défendent, attaquent, nient qu’ils défendent et qu’ils attaquent, l’abandon dramaturgique semble boucler la boucle avec la propreté rassurante de la neutralité esthétisante. Afin d’éviter de s’expliquer, il leur arrive de simuler le besoin de recueillement, la coûteuse introspection impossible. Ils singent alors la fausse timidité de la folle perdue, la « difficulté de l’homosexuel à s’exprimer » décrite parodiquement par Copi. Le retrait se veut acte de modestie. En réalité, le prix qu’il en coûte est tellement exhibé que, dans ces cas-là, il eût été plus humble de ne pas être humble…
À d’autres moments, ils simulent le délire, par dérision mais aussi par peur ou désir de devenir vraiment fous. À l’image, ils cultivent l’ambiguïté du psychopathe et la présomption de démence, en chantant des comptines par exemple, ou en s’identifiant à l’ermite mis à l’écart de la société, mais qui malgré les apparences, dirait au monde les plus profondes vérités : en général, le mythe du vieux marin, du « libre penseur » bohème, du sage étranger et pauvre, etc., les séduit intellectuellement beaucoup. Ils aiment ce qu’ils appellent « la littérature de la folie », l’écriture indécidable où on ne distingue plus bien si leurs auteurs ont réellement toute leur tête ou s’ils simulent la folie sous l’effet de drogues ou d’une vérité transcendante offerte uniquement aux simples d’esprit.
Dans l’ensemble, la critique médiatique actuelle se laisse lamentablement convaincre par « l’énigme homosexuelle ». Nous entendons certains journalistes jouer les miraculés récemment convertis par les génies homosexuels. Ils applaudissent à ce qu’ils ne comprennent pas, et se satisfont de conclusions insipides sur les œuvres artistiques des auteurs gay : « Son casse-tête esthétique est un problème à résoudre, mais en réalité il n’a pas de véritable solution. » (Raúl E. Romero, « António Botto, Un Poeta Órfico… », sur le site Isla de la Ternura, consulté en janvier 2003) Même les parodistes qui se moquent du « non-sens » de leurs créations – je pense en particulier au trio comique français les Inconnus, qui a tourné en ridicule le répertoire musical de Mylène Farmer et du groupe Indochine en soulignant sa pauvreté sémantique – ne le remettent pas pour autant en cause. On finit par s’habituer à ne pas les comprendre. Peu à peu, l’opinion publique transforme l’étrangeté homosexuelle en caractère divin recevable. Et pourtant, si elle s’arrêtait un tant soit peu sur les codes homosexuels, elle verrait que, même si le plat de la production artistique homosexuelle reste toujours difficilement comestible et intelligible, il n’en est pas pour autant si mystérieux et puissant qu’il n’y paraît. Rien n’y est vraiment caché, malgré ce que leurs auteurs veulent (se) faire croire par l’impression de chaos qu’ils composent. Leur bazar artistique est inconsciemment organisé et décodable. Ils s’évertuent parfois eux-mêmes à nous le dire. Il nous suffit juste de les prendre un peu au sérieux, tout en laissant les symboles dans le monde des fantasmes. La notion de « mystère artistique homosexuel » est certes une mascarade, mais une mascarade signifiante quand même, donc à problématiser.
B – b) Le déni par la tragi-comédie :
Une fois que les personnes homosexuelles ont vu que leur monde avait compris leur petite comédie de l’indignation silencieuse ou du faux mystère, il leur arrive parfois de laisser tomber pour un temps le jeu du déni frontal, et de s’esclaffer de rire pour montrer à leur interlocuteur qu’elles ne sont pas aussi folles – ou qu’elles sont bien plus folles ! – qu’il ne le croit.
On remarque que beaucoup d’entre elles cherchent à ne pas prendre leur fantasme de viol au sérieux. Mais en faisant diversion pour évacuer sa violence, elles l’actualisent par un rire dénégateur, inapproprié aux drames qu’il soulève. Derrière la répétitive blague potache, le calembour scatologique ou cassant, est souvent exprimée une envie d’auto-destruction, une frustration d’amour inavouée, un enchaînement aux media, une fausse exorcisation de la peur de la sexualité, une bêtise qui se présente comme de l’esprit, un manque d’amour de soi transformant l’audace en vulgarité, la parodie en égoïsme, le besoin des autres en cynisme agressif. Humour et désir de mort ne s’opposent pas toujours, et bon nombre de sujets homosexuels en fournissent la preuve à travers leurs recours à l’humour camp. Ils ont tendance à ne savoir rire d’eux qu’entre eux et aux dépens des autres, dans l’auto-parodie excessive. À cause du regard malveillant et complexé qu’ils se portent, ils peuvent devenir extrêmement susceptibles. Dès que l’humour vient de l’extérieur, ils demandent souvent à ce qu’il cesse. « Du côté des médias, on souhaiterait une diminution des blagues sur les ‘folles’ […] On peut imaginer les ravages qui s’ensuivent sur un jeune en questionnement. » (Michel Dorais, Mort ou Fif (2001), p. 113) Les « blagues à pédés », les petites attaques ou railleries, les boutades sur les hommes efféminés, plus bêtes que méchantes, résonnent souvent comme de véritables insultes quand ils leur donnent le poids qu’elles n’auraient jamais eu s’ils ne les avaient pas eux-mêmes cautionnées. Alors que l’humour aimant nous aide à rigoler sainement de nous-mêmes, et qu’il ne fait pas rire aux dépens de l’autre mais avec l’autre (… même s’il prend parfois le risque de le bousculer dans une simulation de destruction : l’humour qui ne dérange pas les meubles n’a pas grand intérêt…), c’est comme si, pour un certain nombre de personnes homosexuelles, la simulation de destruction par le rire passait par l’actualisation incontrôlée de cette destruction puisque l’amour de soi n’est pas assez présent et qu’en désir, la Réalité n’est pas toujours respectée. Or, si l’humour aimant permet d’approcher une réalité désagréable pour la rendre moins abrupte et plus humaine, jamais il ne la nie, ni ne l’édulcore. Il ne cherche pas à gommer constamment la frontière entre sérieux et non-sérieux. C’est bien souvent le contraire que fait l’humour employé par la majorité des sujets homosexuels : même si la dédramatisation qu’il propose est bien intentionnée et semble a priori lutter contre la morosité ambiante, il apporte une avalanche de frivolité inappropriée à des situations qui, sans être dramatiques, ne sont pas légères. Il n’est jamais interdit de démystifier la souffrance par l’humour. Mais il y a un temps pour tout : un pour rigoler, un pour être sérieux, un pour être sérieux tout en rigolant, un autre pour rire quand il ne faut pas… et le délire s’éternise souvent beaucoup trop chez certains sujets homosexuels pour qu’ils se respectent réellement eux-mêmes. Quand la légèreté humoristique n’a pas sa place dans un contexte où la souffrance humaine n’est pas reconnue et dénoncée, il agit involontairement comme un glaçon.
En découvrant l’échec de leur entreprise de dérision, la plupart des personnes homosexuelles vont inconsciemment retourner la carte psychique du comique et sombrer dans le tragique singé de la Drama Queen, toujours pour nier leur véritable souffrance. C’est rassurant d’un certain côté (nous les voyons parfois aux bords du suicide en début de soirée… puis danser sur les tables à la fin : leur tristesse a duré le temps d’une averse), et inquiétant d’un autre (qui nous assure, par exemple, qu’un sujet homosexuel suicidaire ne va jamais, les jours de profond spleen, mordre précipitamment à l’hameçon de sa théâtralité et passer à l’acte irréparable ?). C’est parce que la détresse homosexuelle ne se dit pas souvent simplement et sans se styliser à l’excès, que nous devrions lui prêter encore plus d’attention, la trouver touchante. La mise en scène mélodramatique que beaucoup de personnes homosexuelles composent est signifiante, même si elle paraît à première vue théâtrale, fausse, et forcément un peu risible puisqu’elle mime exactement les simulations de crises d’abandon de la femme fatale télévisuelle. « Ènième coup de téléphone de François P., qui m’énerve considérablement : il dit qu’il m’aime, et qu’il ne m’appellera plus jamais, car il va se tuer demain, je n’ai même pas envie de le croire ou de ne pas le croire, je reste indifférent, tout juste agacé : qu’il fasse ce qu’il veut, je ne le connais pas. » (Hervé Guibert, Le Mausolée des amants (2001), p. 23) La « c-homo-édie », pourrions-nous l’appeler, par la lassitude/indifférence qu’elle engendre chez la majorité des personnes homosexuelles qui la jouent pourtant chroniquement, et qui la trouve navrante à force de croire qu’elles la connaissent par cœur, n’est pas assez analysée en termes de nature du désir homosexuel qui, je le crois, est par essence tragi-comique, et cause beaucoup plus de maux invisibles qu’il n’y paraît. Du coup, ceux qui la rejettent la déifient fréquemment, et sont tentés de l’actualiser parfois. Beaucoup de personnes homosexuelles figent leur appel de détresse, souvent justifié, en mouvement esthétique surchargé de pathos cinématographique, pour occulter leur souffrance réelle, qui, une fois ignorée à force d’être esthétisée, peut s’aggraver. Dans le malheur, elles ont tendance à se prendre narcissiquement trop au sérieux ou pas assez au sérieux, si bien que leurs proches hésitent à les écouter, et perdent patience à essayer de démêler chez elles d’un côté ce qui fait partie du fantasme de souffrance, et, de l’autre, ce qui est de l’ordre de la souffrance véritable.
C – CIRCULEZ ! (…Y’A QUELQUE CHOSE À VOIR) :
C – a) L’agression consciente et inconsciente :
À force de ne pas être prises assez au sérieux, de ne pas pouvoir se formuler leur propre mal-être, mais aussi pour empêcher toute analyse du désir homosexuel, beaucoup de personnes homosexuelles deviennent inquiétantes, et s’affairent à intimider leur interlocuteur. L’une de leurs techniques du déni du viol est la réaction indignée censée « masquer l’objet d’indignation par l’indignation elle-même » (Élisabeth Lévy, Les Maîtres Censeurs (2002), p. 17), et effrayer celui qui est tenté, à cause de leurs réactions outrées, de penser qu’il a dit une énormité et qu’il vaut mieux qu’il se taise. Il leur arrive souvent de mimer l’attitude scandalisée qu’elles attendent/redoutent chez les autres pour la devancer et l’avorter. Se choquer en singeant la répression de ses propres sentiments ou en donnant à sa voix un ton hurlant, c’est non seulement montrer le visage innocent du clown blanc offusqué, mais c’est aussi faire un acte communautaire fédérateur : elles ont l’impression de lutter contre le diable homophobe en disant « c’est ignoble… » ensemble, en s’entrechoquant les unes aux autres sur les horreurs dont on les affublerait, pour imposer collectivement une censure.
La demande de silence peut aussi prendre un caractère excessivement impérieux : elles ordonnent à leur entourage de se taire comme elles se l’imposent à elles-mêmes. L’approche de l’homosexualité est d’office présentée comme minée. Pour la petite anecdote personnelle, en ouvrant au hasard ma toute première revue Têtu que j’avais eu le « courage », à l’époque, d’acheter dans un bureau de tabac, j’étais tombé nez à nez sur une publicité de parfum avec la photo d’un méchant piranha ouvrant son effrayante gueule dentée, accompagnée d’une phrase qui conseillait ceci : « N’essayez pas de comprendre. » (cf. la revue Têtu, n°63, janvier 2002, p. 7) J’avais adoré ! C’est exactement le même avertissement que l’on retrouve à l’entrée des livres de Manuel Puig (Malédiction éternelle à qui lira ces pages !, 1980), des films de Jim Sharman (« Vous entrez à vos risques et périls !! » lit-on dans le film « The Rocky Horror Picture Show », 1975), des chansons homo-érotiques de Mylène Farmer (« N’ouvre pas la porte, tu sais le piège… », cf. la chanson « Regrets »), des romans de Renaud Camus (Ne lisez pas ce livre !, 1997), dans le film « W imie… » (« Aime… et fais ce que tu veux », 2014) de Malgorzata Szumowska (« Le Seigneur est tout près. Garde le silence. » indique l’écriteau que lit Michal après avoir surpris Adam et Lukacz ensemble), etc. Via l’ironique menace camp et des images parfois difficilement supportables à regarder, certains réalisateurs homosexuels cherchent à ce que leur spectateur reste prisonnier de ses émotions, ne puisse pas accéder au double-sens de leurs œuvres, et littéralement qu’il se pétrifie comme le marbre. Ce goût pour la terreur folklorique n’est pas à mettre uniquement du côté de l’intention malfaisante, de l’envie de choquer, ou de la morbidité. Il a trait d’une part au plaisir enfantin d’avoir peur et de faire peur (comme chez les enfants maquillés en tigres pendant les kermesses scolaires), et d’autre part à la projection inconsciente d’un désir schizophrénique (homosexuel ou hétérosexuel) vécu comme monstrueux, sûrement parce qu’il l’est en partie du fait de son hybridité. Beaucoup de personnes homosexuelles vont alors projeter sur les autres leur propre souffrance dans sa version grimaçante cinématographique, en cherchant fiévreusement sur le visage de ces derniers des confirmations que leur monstrueux désir de viol qu’elles croient incarner est bien réel et personnifié en elles, ou alors beaucoup trop monstrueux pour qu’elles rentrent dans son jeu. Ceci est particulièrement observable dans les œuvres de fiction homo-érotiques – et parfois dans les discours : il n’est pas inhabituel d’entendre les personnes homosexuelles prendre plaisir à jouer les femmes outrées en prononçant au quotidien des expressions telles que « c’est horrible », « c’est affreux », « c’est atrrroce », etc. L’expressionnisme tragique qu’elles mettent en scène se veut très théâtral et distancé, mais je crois qu’il est aussi dénué de toute dramaturgie, pour la bonne et simple raison qu’il est en partie inconsciemment produit : leurs personnages jouent les Emma Bovary devant leur miroir, répétant inlassablement qu’ils ont un amant, précisément parce que la conscience qui les a créés met en image une peur qu’elle n’a pas conscientisée. L’affolement iconographique est un prétexte à l’auto-contemplation, à la jouissance de s’imaginer grimaçant devant son miroir, qui confirme à certaines personnes homosexuelles l’efficacité de leur désir de viol et de leurs sentiments d’horreur sur elles-mêmes. En règle générale, il ne permet pas une libération de la parole, ni même une réflexion constructive sur les aspects violents du désir homosexuel.
C – b) Un appel maquillé :
Chez certaines personnes homosexuelles, le déni du fantasme de viol – et parfois du viol réel – passe également par la provocation tapageuse, une totale indiscrétion, une demande pugnace qui laisse entendre l’inverse de la forme violente qu’elle prend : « Tu me veux ? Je te défie. Essaie seulement de m’abattre. Vous voulez m’abattre ? Venez donc ! » (Hedwig dans le film « Hedwig And The Angry Inch » (2001) de John Cameron Mitchell) L’appel-déni s’exprime alors par un questionnement moralisant agressif et désespéré, celui qui n’attend apparemment pas de réponse, un peu sur le modèle de la conclusion finale du plaidoyer pro-gay de Steven Carter devant l’assemblée de son lycée dans le film « Get Real » (« Comme un garçon », 1998) de Simon Shore : « Il s’agit d’amour. Alors de quoi est-ce que tout le monde a si peur ?!? » L’agacement sert bien souvent de prétexte à la contemplation narcissique de soi dans le malheur ou la révolte singée : par exemple, bon nombre de personnes homosexuelles aiment à dire que « tout les énerve ou les agace », qu’elles « en ont assez ».
Leur provocation, exprimée par des mots durs et disproportionnés par rapport aux faits critiqués, résonne comme une invitation maladroite à leur arracher le secret de leur propre mutisme : leur désir de viol – et parfois leur viol réel. N’oublions pas que le mot « monstre » vient du verbe latin monstrare qui signifie « montrer ». Leur présentation agressive d’elles-mêmes est tellement chargée de bonnes intentions que bien souvent, elles en oublient sa violence. « Je n’outrage pas les gens, déclare par exemple le provocant Steven Cohen, je viens révéler le caractère outrageux des mécanismes qui les oppriment. » (cf. l’article « Steven Cohen, corps à corps », sur le site http://www.humanite.presse.fr, consulté en juin 2005) Certaines personnes homosexuelles pensent réellement que le mensonge ou les masques disent la Vérité, que le mal est bon. « La méchanceté m’intéressait dans la mesure où elle était vraie. » (Marcel Jouhandeau, Éloge de l’imprudence, 1931) Elles réclament la reconnaissance de la vertu pédagogique du mal. Par exemple, Érik Rémès affirme que « les extrêmes peuvent servir de révélateur pour les autres » (cf. l’article « Érik Rémès, Écrivain » de Julien Grunberg, sur le site www.e-llico.com, consulté en juin 2005). L’idée de la pédagogie inversée semble capitale pour comprendre leur appel par l’agression. Elles disent aux autres qu’elles vont faire l’inverse de ce qu’elles attendent vraiment d’eux, pour que ces derniers les imitent dans l’inversion, et donc fassent mieux qu’elles, soient les vrais révolutionnaires qu’elles n’ont pas eu la force d’être. Elles font passer cette manœuvre pour de la charité, car elles-mêmes croient sincèrement faire acte de bienveillance par l’erreur.
Leur discours hermétique et peu avenant, susurré en messes basses ou perdu dans la fureur d’un carnaval textuel, ne prend pas le lecteur en compte et le rebute dans un premier temps. Mais attention : tout cela est aussi une mise en scène de provocation, une copie du discours totalitaire, une mascarade pédagogique. Leur menace a valeur de double test : si nous réagissons au quart de tour en les prenant au sérieux, nous avouerons, selon certains artistes, notre culpabilité et notre fermeture d’esprit ; si au contraire ils voient que nous prenons un peu de distance par rapport aux images violentes qu’ils nous proposent, que nous avons atteint un certain degré d’insensibilité, et que nous comprenons leur pédagogie du contre-exemple – celle qui dit : « Je fais l’erreur pour que vous ne la fassiez pas » –, ils nous flattent, nous offrent la carte de leur club, nous proposent de passer, comme Osvaldo Lamborghini dans El Fiord (1969), au viol collectif iconographique, en laissant parfois une porte discrètement entrouverte aux exercices pratiques…
Contrairement aux apparences, l’initiation proposée dans leurs écrits ne rime pas qu’avec perversion. Parfois, elle est une volonté d’accompagnement, de complicité, de sacrifice, et un appel. L’allusion, lieu de la confidence et de la proposition indécente, devient une invitation à la création artistique et aux plaisirs homosexuels, provocation d’ailleurs qui ne restera en général que dans le cadre du jeu et qui finira par un « … De toute façon, tout ça, c’était pour de rire… » si le lecteur n’y répond pas, même si elle avait dessiné la probabilité d’un « peut-être » plus sérieux. L’agressivité, reposant davantage sur des univers de représentation que sur la Réalité, s’épuise parfois en abandon laconique à la mélancolie, et s’exprime alors avec l’humour cynique de celui qui devine la vanité de sa position grotesque de figurant « monstrueux » de parc d’attractions duquel ne dépendra ni le bonheur, ni le malheur des personnes qui monteront à bord de son train-fantôme. Beaucoup d’écrivains homosexuels poussent le lecteur à bout pour tester jusqu’où il est capable d’aller pour les aimer. Celui-ci peut entendre, en lisant leur prose, un appel agressif dissonant qui n’emploie pas les moyens que son but requiert, qui cherche l’autre en feignant de ne pas le chercher.
On a reproché à des Hervé Guibert ou des Guillaume Dustan l’exhibitionnisme violent, au lieu de voir dans leur impudeur un mime des mécanismes d’exclusion dont les personnes homosexuelles sont parfois victimes. À mon avis, tout a un sens, et à plus forte raison l’agressivité. Dans ce que profère l’autre, il y a toujours une part de Vérité, même s’il me l’exprime méchamment et que sa volonté est justement d’évacuer la Vérité. Y compris en me jetant une pierre ou en m’agressant verbalement, il me dit quelque chose de la beauté de l’Homme sans même le savoir, car la grâce de son humanité de lui appartient pas, et dépasse sa cruauté. C’est pourquoi la Gay Pride et la visibilité tapageuse des personnes homosexuelles n’ont absolument pas à nous choquer : elles sont juste temporairement dignes d’intérêt, et fondamentalement secondaires et inutiles. Nous devrions nous laisser toucher par les appels au secours de certains individus homosexuels, souvent camouflés dans un discours stéréotypé et lapidaire, qui ne se donnent pas les moyens de leur plainte, qui s’auto-sabordent par le cynisme et l’ironie. Ils attendent une parole, une réaction de notre part. On retrouve cette demande malhabile chez l’Eva Perón (1969) de Copi qui, derrière la farce agressive, s’adresse à notre indifférence laxiste face à l’homosexualité : « Je suis devenue folle, folle, comme la fois où j’ai fait donner une voiture de course à chaque putain que vous m’avez laissé faire. Folle. Et ni toi ni lui ne m’avez dit de m’arrêter. […] Quand j’allais dans les bidonvilles […] et que je rentrais comme une folle toute nue en taxi montrant le cul par la fenêtre, vous m’avez laissé faire. Comme si j’étais déjà morte, comme si je n’étais plus qu’un souvenir d’une morte. » Il y a dans l’attitude de provocation de nombreuses personnes homosexuelles un acte d’illustration visant à exposer aux autres ce qu’ils leur laissent impunément faire, un miroir brisé qui se veut le reflet de la lâcheté sociale. Au fond, elles regrettent amèrement le silence de leurs proches concernant leur situation souvent dramatique. « Mes parents n’entendent pas mon murmure. Mes chuchotements ne parviennent pas jusqu’à leurs oreilles. Ils n’entendaient déjà pas mes cris, il y a des années de cela. » (Luca dans le roman Un Garçon d’Italie (2003) de Philippe Besson, p. 168) Face au mutisme social, elles se demandent quelles personnes seront vraiment capables de se laisser toucher par leurs appels. Elles font tout pour dissimuler leur souffrance, mais paradoxalement, elles regrettent que les autres ne la perçoivent pas, et leur reprocheront parfois d’y être indifférents !
2 – GRAND DÉTAILLÉ
FICTION
Le personnage homosexuel exige le silence et le secret autour de son homosexualité, et parfois du viol qu’il a subi :
a) Le silence sur le viol :

Film « Mommy » (2014) de Xavier Dolan
Dans les fictions homosexuelles, le déni du viol (pas uniquement homosexuel) peut d’abord venir des personnages entourant le héros homosexuel, et le forçant au silence. « Si t’en parles, je te tue. » (Sarah s’adressant à son amante Charlène, par rapport à l’existence de sa mère alcoolique, dans le film « Respire » (2014) de Mélanie Laurent) ; « Il faut nier, nier et encore nier ! » (Hugues s’adressant à son amant Fabien, dans la pièce Le Cheval bleu se promène sur l’horizon, deux fois (2015) de Philippe Cassand) ; « Légendes triviales, ma chère enfant, me répondit lady Swanson. Il ne faut pas croire les domestiques. […] Cette histoire de viol dans une chapelle ne tient pas debout. » (Bathilde cherchant à connaître les détails du viol de lady Philippa, dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 302) ; « Après, ce fut plus facile. On s’améliore avec la pratique. » (Hank, banalisant ses histoires de cul homosexuelles, alors que sa première a été très éprouvante, dans le film « The Boys In The Band », « Les Garçons de la bande » (1970) de William Friedkin) ; « À partir de maintenant, Anna Mann était livrée à elle-même. Plus d’une fille sur deux était victime d’abus sexuels. C’était la façon dont tournait le monde et on n’y pouvait rien. » (Jane, l’héroïne lesbienne du roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 89) ; « En tout cas, y’a pas viol. » (Jarry en voyant la photo de la fille moche de « Inquiète », dans son one-man-show Atypique, 2017) ; « On ne parle pas de ces choses-là. » (Oliver s’adressant à son jeune amant Elio qui ose briser la glace en lui déclarant ses sentiments homos, dans le film « Call me by your name » (2018) de Luca Guadagnino) ; « On n’en parlera plus , ok ? » (André, homo, s’adressant à son pote gay Adrien, par rapport à sa séropositivité, dans le film « Pédale douce » (1996) de Gabriel Aghion) ; etc. Ces censeurs sont d’ailleurs secrètement homosexuels aussi. Par exemple, dans le film « No Se Lo Digas A Nadie » (« Ne le dis à personne », 1998) de Francisco Lombardi, le jeune Joaquín, à 8 ans, tripote un de ses camarades sous une toile de tente scout, et lui demande instamment de taire ce qu’ils viennent de faire : « S’il te plaît, ne le dis à personne. » Dans le film « Jonas » (2018) de Christophe Charrier, Nathan raconte à son futur amant Jonas qu’il a été abusé dès la classe de CM1 dans son école catholique de Saint Cyprien par un prêtre, et lui confie ce secret, en le menaçant de l’égorger si jamais il en parle à d’autres : « Tu sais garder un secret ? De toute façon, si tu parles… » (on découvrira que la balafre que Nathan porte sur sa joue ne vient pas d’un coup de calice donné en représailles par le prêtre, mais d’un lynchage collectif qu’il a subi aux autos tamponneuses à l’âge de 9 ans dans un parc d’attractions appelé Magic World). Dans le one-woman-show Mâle Matériau (2014) d’Isabelle Côte Willems, le médecin qui va opérer la narratrice transgenre F to M pour son changement de sexe se montre particulièrement cruel, despotique et infantilisant : « Il va falloir perdre cette habitude de s’excuser ou de remercier tout le temps. ‘Masque neutre’, vous vous rappelez ? Ça va venir. Une déconstruction, ça prend du temps. » Certains films cachent et abordent la Seconde Guerre mondiale sur fond d’homosexualité et de secret : cf. le film « Sekret » (2012) de Prezemyslaw Wodcieszek, le film « Bent » (1997) de Sean Mathias, le film « L’Arbre et la Forêt » (2008) d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau, la chanson « Ce secret » de Nicolas Maury, etc.
Le problème, c’est qu’ensuite, ce même héros cautionne bien souvent l’appareil social de censure, au point de proclamer fièrement qu’il ne connaît pas la souffrance : « Je n’ai jamais souffert. » (Scott dans le film « Save Me » (2010) de Robert Cary) ; « Après les grands secrets de mes six, dix et treize ans, à ma vie s’ajoutait maintenant le ‘péché’ qui n’aurait jamais dû être. » (Ednar, le héros homosexuel, abordant les trois viols pédophiles puis sa première expérience homosexuelle qu’il a vécus, dans le roman très autobiographique Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 20) ; « Je n’avais pas osé lui raconter les agressions sexuelles dont j’avais été victime afin qu’elle ne se sente pas coupable. » (Ednar à propos de sa mère, idem, p. 59) ; « Nous sommes très fragiles. Nous tombons. Nous échouons. Mais est-ce que c’est plus grave que ça ? » (le narrateur de la performance Nous souviendrons-nous (2015) de Cédric Leproust) ; « La question est toujours la même : qu’y a-t-il derrière ce rideau ? » (Molly en voix-off dans le film « Test : San Francisco 1985 » (2013) de Chris Mason Johnson) ; « Je me suis sans cesse répété que ce n’était pas la bonne voie. Je peux pas. » (Sergueï Eisenstein, homosexuel, feignant la résistance à la sodomie qu’il va « subir » par son amant Palomino, dans le film « Que Viva Eisenstein ! » (2015) de Peter Greenaway) ; etc. Il reprend à son compte et intériorise le diktat social de l’enfouissement de sa blessure homosexuelle. Il est blessé mais affirme ne pas en souffrir. Par exemple, dans le film « Imitation Game » (2014) de Mortem Tyldum, Alan Turing, le mathématicien homosexuel, n’arrête pas de répéter que la violence procure de la satisfaction, mais que l’acte de violence en lui-même est insignifiant.
Comédienne – Fais voir ? Mon Dieu ! Tu t’es presque sectionné le petit doigt ! Ça te fait mal ?
Auteur – Ça ne me fait pas mal mais ça pisse le sang !
(Copi, La Nuit de Madame Lucienne, 1986)
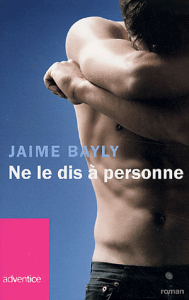
Il se force à banaliser et à taire le viol qu’il a subi, ou le fantasme de viol qu’il ressent en lui-même (cf. le roman Une douleur normale (2013) de Walter Siti). « Non non, rien… Je me suis cassée un talon. » (Octavia, le transsexuel M to F, s’inventant une excuse pour cacher qu’il a été battu, dans la comédie musicale Se Dice De Mí (2010) de Stéphan Druet) ; « Toi qui n’as pas vu l’autre côté, de ma mémoire aux portes condamnées, j’ai tout enfoui les trésors du passé, les années blessées. » (cf. la chanson « L’Innamoramento » de Mylène Farmer) ; « Ne donnez pas trop tôt ni un nom ni un genre à cette violence. » (l’un des deux héros homosexuels de la pièce Dans la solitude des champs de coton (1987) de Bernard-Marie Koltès) ; « Cette perdition n’est pas pénible. Je l’ai cherchée. » (Leo dans le roman Un Garçon d’Italie (2003) de Philippe Besson, p. 78) ; « Ce n’est qu’une blessure superficielle, ce n’est rien. » (Luc à Daphnée dans la pièce La Tour de la Défense (1981) de Copi) ; « Se faire mal en se disant que juste après, juste après, qu’on ne le regrettera sûrement pas. » (cf. la chanson « Marilyn » du groupe Indochine) ; « Entre 20 et 30 ans, je n’avais cessé de me dire que j’étais trop exigeant en amour. » (Michael dans le roman Michael Tolliver est vivant (2007) d’Armistead Maupin, p. 84) ; « J’ai décidé d’effacer tout ça, de faire comme s’il ne s’était rien passé, et si, par hasard, Héloïse me refaisait des avances, de lui dire : ‘Non, c’est hors de question.’ Car il me paraissait qu’elle m’avait violée, finalement. » (Suzanne dans le roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, p. 290) ; « C’est comme quand on était petits et qu’on allait acheter du Cinzano pour maman chez un épicier qui était borgne, je crois, tu t’en souviens ? Il me faisait passer dans l’arrière-boutique et il me touchait, tu t’en souviens, et ensuite on se partageait l’argent du Cinzano ? Il était arrivé au bout de quelque chose d’atroce, ce type, quelque chose d’atroce, atroce. Il ne m’a jamais touchée. Il ne faisait que me parler. Je ne sais pas pourquoi je te disais qu’il me touchait ; il me racontait sa vie. Et peu à peu je suis devenue comme lui, tu comprends, je n’y peux rien. » (Evita niant le viol infligé par l’épicier Cinzano, dans la pièce Eva Perón (1969) de Copi) ; « Elle entendit les pleurs d’un bébé dans l’arrière-boutique, essaya d’alerter la boulangère, mais pas un mot ne sortait de sa bouche, elle était devenue muette. » (Mme Pignou dans la nouvelle « Madame Pignou » (1978) de Copi, p. 49) ; « Que l’un des vôtres se soient fait assassiner, ça ne vous émeut pas plus que ça ??? Vous avez une drôle de façon de vous aimez. » (l’Inspecteur face au mutisme de Franck, le héros homo qui couvre son amant Michel, le tueur du lieu de drague homosexuel, dans le film « L’Inconnu du lac » (2012) d’Alain Guiraudie) ; « Mes coups, parfois, je les retenais pas. Mes mots, oui. » (Vincent s’adressant à son amant Stéphane, dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson) ; « J’crois pas que ça mérite tant d’intérêt que ça, ce qui se passe dans notre dos » (Arnaud, le héros homo se référant à la sodomie, dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit) ; « Tous les pédés me parlent de leur culpabilité héritée de je ne sais quel abus dans leur enfance. Laisse ton enfance tranquille ! » (Arthur, homosexuel) « Qui te parle de son enfance maltraitée ? » (Jacques, son amant, dans le film « Plaire, aimer et courir vite » (2018) de Christophe Honoré) ; etc.
Par exemple, dans le film « Reviens, Jimmy Dean, reviens » (1982) de Robert Altman, quand les amies de Joanne, l’homme transsexuel M to F, l’interrogent sur son opération de changement de sexe, il répond évasivement qu’il « le regrette parfois », lorsqu’il « y pense ». Dans sa chanson « Retour à toi », Étienne Daho se décrit comme un homme « qui réduit au silence le fracas de l’enfance ». Dans le film « Incidences » (2012) d’Andromak, Anne a été victime d’un viol dès son plus jeune âge, mais, par mécanisme d’auto-défense, elle le nie. Dans la pièce Scènes d’été pour jeunes gens en maillot de bain (2011) de Christophe et Stéphane Botti, Léa s’est fait violer, mais se fait passer pour une certaine « Virginie » et parle d’elle à la troisième personne : « Virginie a gardé secret le nom du coupable. »
Dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, la jeune Anna défendra jusqu’à la mort son père qui la viole secrètement. Tous les personnages sauf la narratrice lesbienne, Jane, qui a pris en pitié la fillette de treize ans et qui s’est donnée pour tache de dénoncer le viol que la femme du Docteur Alban Mann et leur fille Anna ont subi, s’attellent à masquer le crime. « Tu prends cette histoire trop au sérieux. […] Chut. […] Je vais te faire couler un bon bain chaud. » (Petra, l’amante de Jane, p. 99) ; « Tu réfléchis constamment. C’est peut-être ça le problème. Tu devrais peut-être débrancher ton cerveau de temps en temps. Regarder la télé, te relaxer. » (idem, p. 120) ; « Tout ce que je vois c’est que vous fourrez votre nez dans quelque chose qui ne vous regarde pas. C’est peut-être de vous qu’Anna devrait se méfier. » (Maria, la prostituée, p. 168) ; etc. Jane s’étonne même qu’Anna ne se révolte pas contre son père : « C’était comme si certaines filles portaient une marque secrète que seuls les pervers pouvaient voir. Une fois qu’elles avaient été abusées, d’autres salauds parvenaient à le sentir d’une façon ou d’un autre, et ils les pistaient pour prendre leur tour. […] ‘Pourquoi est-ce que tu cherches sans cesse des excuses à ces hommes ? Ils ont cherché à gagner ta confiance pour abuser de toi. Même le prêtre ; il a préféré ignorer quel âge tu avais. Tu ne fais pas du tout dix-sept ans. Au fond de son cœur, il savait que tu étais trop jeune. Tu ne le vois pas ?‘ » (p. 242)
Le viol, en éclatant le personnage homosexuel, lui donne paradoxalement une impression d’unité : « Je ferme les yeux sur nos dernières nuits. Qui nous sépare ? Qui nous unit ? » (cf. la chanson « J’attends » de Mylène Farmer) C’est le déni qui donne l’illusion que les morceaux sont recollés.
Dans les fictions homo-érotiques, l’initiation – violente et peu libre – à l’acte homo se fait souvent sous le sceau du secret. Par exemple, dans le roman Papa a tort (1999) de Frédéric Huet, de retour de vacances, Antoine annonce à Julien qu’il a quelque chose à lui montrer : « Je lui ai emboîté le pas. Antoine m’a entraîné jusqu’aux toilettes où il m’a brusquement poussé. J’ai demandé : ‘Pourquoi ?’. ‘Tu verras. C’est un secret’. Alors je me suis avancé sans broncher et Antoine a refermé la porte derrière lui. Et puis là… oh, la, la, la, la, j’en tremble rien qu’à l’écrire mais Antoine qui s’est immobilisé devant moi, m’a plaqué violemment contre le mur, s’est collé à ma poitrine jusqu’à presque m’étouffer, et d’un geste langoureux, il a posé sa bouche contre ma bouche, et tout en se penchant délicatement près de mon oreille, il m’a soufflé : ‘Je t’aime.’ J’ai failli m’évanouir à cet instant. J’étais transporté aux anges, renversé, ébranlé. » (Julien) Cela marche aussi avec le coming out auprès des parents. Par exemple, dans l’épisode 68 « Restons zen ! » (2013-2014) de la série Joséphine Ange gardien, pour mettre son père devant le fait accompli de son homosexualité, Romane, l’héroïne lesbienne, demande à Yindee sa copine de l’embrasser sur la bouche.
b) Le silence « innocent » et béat :
Il est énormément question du secret dans les fictions homo-érotiques : cf. le film « Une Histoire sans importance » (1980) de Jacques Duron, le film « Le Secret d’Antonio » (2008) de Joselito Altarejos, les pièces La Reina Del Silencio (1911) et Sirenas Mudas (1915) de Ramón Gy de Silva, le film « Circumstances » (« En secret », 2011) de Maryam Keshavarz, la chanson « Secret » de Madonna, le film « La Ville des silences » (1979) de Jean Marbœuf, le film « Choses secrètes » (2002) de Jean-Claude Brisseau, le film « Los Abrazos Rotos » (« Étreintes brisées », 2009) de Pedro Almodóvar, la B.D. Humour secret (1965) de Copi, la chanson « Le Grand Secret » du groupe Indochine, le film « Le Secret du Chevalier d’Éon » (1959) de Jacqueline Audry, la chanson « Parler tout bas » d’Alizée, la chanson « Nobody Knows » de Mylène Farmer, le roman Le Secret d’Ugolin (2000) de Béatrice d’Alemagna, le roman Le Secret de l’Hippocampe (2003) de Gaëtan Chagnon, la chanson « Comme c’est curieux » des Valentins, le tableau Secreto Eterno (1987) de Julio Galán, le film « La Flor De Mi Secreto » (« La Fleur de mon secret », 1995) de Pedro Almodóvar, le film « Le Silence » (1962) d’Ingmar Bergman, le film « Les Silencieuses » (1998) de Valeri Todorovski, le film « A Question Of Silence » (1983) de Marleen Gorris, le film « Silence » (1995) de Colette Cullen, « The Everlasting Secret Family » (1988) de Michael Thornhill, le roman Les Yeux silencieux (2003) de Michel Giliberti, le film « Passé sous silence » (2003) de James Mérendino, le film « El Jardín Secreto » (1984) de Carlos Suárez, la chanson « Silence » de Lara Fabian, le film « Un Secret » (2007) de Claude Miller, le film « The Secret Diaries Of Miss Anne Lister » (2010) de James Kent, le roman Les Silences de Colonel Bramble (1964) d’André Maurois, le roman Le Contenu du silence (2012) de Lucía Etxebarría, la chanson « Mes Silences » de Claire Keim, la chanson « Mon Secret » de Suzy Solidor, etc.
Le personnage homosexuel cultive autour de lui le mystère : « J’ai jamais su me présenter moi-même. » (Stella, l’héroïne lesbienne du film « Cloudburst » (2011) de Thom Fitzgerald) ; « Je suis un secret. » (la narratrice du roman Poupée Bella (2004) de Nina Bouraoui, p. 9) ; « Les secrets, c’est ma spécialité. » (Alan Turing, le mathématicien homosexuel, dans le film « Imitation Game » (2014) de Mortem Tyldum) ; « Puisqu’il faut choisir, à mots doux je peux le dire. Sans contrefaçon, je suis un garçon. » (cf. la chanson « Sans contrefaçon » de Mylène Farmer) ; « C’est un détail inextricable impénétrable. C’est un détail… C’est un détail… C’est un détail… » (cf. la chanson « Mon Maquis » d’Alizée) ; « Je ne sais plus parler à personne. Ma langue est incompréhensible. » (la voix narrative de la pièce Arthur Rimbaud ne s’était pas trompée (2008) de Bruno Bisaro) ; « Ma philosophie est de la fermer, de ne jamais avoir d’avis, et d’avoir toujours tort. On me frappe la joue gauche, je tends la droite. Que voulez-vous… rien ne m’affecte. Je suis un philosophe, extrêmement philosophe. » (cf. la chanson « Les Philosophes » d’Arnold Turboust) ; « J’ai moi-même un secret… qui devrait pas être un secret. » (Marina, le père transsexuel M to F de Fred, le héros homo, dans la pièce Des bobards à maman (2011) de Rémi Deval) ; « Comment puis-je leur dire ce secret que j’ai sur le cœur depuis que je suis tout petit ? que je suis différent ? » (Chris, le héros homo de la pièce Happy Birthgay Papa ! (2014) de James Cochise et Gloria Heinz) ; « Silence. Je disparais. Je m’éclipse. Je m’évanouis. » (Catherine, l’héroïne lesbienne de la pièce Un Lit pour trois (2010) d’Ivan Tournel et Mylène Chaouat) ; « C’était un bel homme, James. Pourquoi ça n’aurait pas été une belle femme ? » (la narratrice transgenre F to M se met dans la peau de James, une femme qui s’est fait passée pour un homme toute sa vie, dans le one-woman-show Mâle Matériau (2014) d’Isabelle Côte Willems) ; « Pourquoi je me sens si coupable ? » (Emmanuel, l’un des séminaristes, noir et homosexuel, ayant a vécu à Carthage sa première expérience homosexuelle avec un homme anonyme, dans la série Ainsi soient-ils (2014) de David Elkaïm, épisode 3 de la saison 1) ; « Je me connais, moi. Il n’y a pas de secret. Parce qu’il n’y a rien. Juste moi. » (Narcisse dans le film « Métamorphoses » (2014) de Christophe Honoré) ; « Je n’ai ni tête ni pensée. Et je pense ? » (le narrateur de la performance Nous souviendrons-nous (2015) de Cédric Leproust) ; « Le secret, le secret, toujours le secret ! » (Fabien, homosexuel, s’adressant à son amant Hugues qui n’assume pas leur couple, dans la pièce Le Cheval bleu se promène sur l’horizon, deux fois (2015) de Philippe Cassand) ; « J’ai une vie parfaitement normale. Sauf que j’ai un énorme secret de ouf. » (Simon, le héros homosexuel parlant de son homosexualité, dans le film « Love, Simon » (2017) de Greg Berlanti) ; etc.
Dans les fictions homo-érotiques, le silence est présenté comme quelque chose de positif, de relaxant, voire de courageux : cf. le film « Les Galons du silence » (1994) de Jeffrey A. Bleckner, le film « Everything Goes » (1974) de Tom DeSimone, le film « Relax… It’s Just Sex » (1998) de J. P. Castellaneta, la chanson « Relax » du groupe Franckie Goes To Hollywood (où il est conseillé de se détendre au moment de se faire enculer…), le film « Relax » (1990) de Chris Newby, le film « Mystère Alexina » (1984) de René Féret, etc. Le calme demandé ressemble en réalité à une anesthésie infantilisante, à une fausse paix, à une autocensure, à une méthode Coué (de dépressif ou de pervers). « Il faut que tu te détendes, Clara. » (Sonia annonçant à sa future amante Clara sa bisexualité, dans le téléfilm « Clara cet été-là » (2003) de Patrick Grandperret) ; « Non, je crois pas. À mon avis tu te plantes. » (Simon, le héros gay faisant preuve de mauvaise foi face à Polly qui lui laisse entendre que l’homosexualité est une sexualité régressive, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 19) ; « Je me souviens d’avoir pensé à Horace et son ‘Carpe Diem’. » (Denis s’adressant à son amant Luther, dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta) ; « Ce n’est pas une situation que nous subissons. C’est une situation qui tous les deux nous ressemble. » (idem) ; « On est d’accord, c’est notre secret. » (OSS 117 dans le film « OSS 117 : Rio ne répond plus » (2009) de Michel Hazanavicius) ; « Te poses pas de questions. T’es fait pour les garçons. Je veux du jazz. » (Philippe s’adressant à Bernard dans la comédie musicale La Belle au bois de Chicago (2012) de Géraldine Brandao et Romaric Poirier) ; « Quand j’étais petit, je ne me posais pas autant de questions. » (Pierre Fatus dans son one-man-show L’Arme de fraternité massive !, 2015) ; « Détends-toi. Ce mec a l’air pas mal, il est sexy et sûrement intelligent, alors détends-toi, profite, ne te pose pas trop de questions. Arrête de flipper. » (Polly, l’héroïne lesbienne encourageant son ami gay Mike à sortir avec un certain « Léo » qu’ils ne connaissent ni l’un ni l’autre, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 94) ; « Quel est ton secret ? » (Marc, le héros homo interrogeant son futur amant Sieger, dans le film « Jongens », « Boys » (2013) de Mischa Kamp) ; « Laisse-toi guider par tes envies. Faut pas réfléchir. » (Bernd, le mari de Marie – l’héroïne lesbienne – s’adressant à sa mère, dans le téléfilm « Ich Will Dich », « Deux femmes amoureuses » (2014) de Rainer Kaufmann) ; etc.
Par exemple, tout le message du film « Lilting » (« La Délicatesse », 2014) de Hong Khaou tourne autour de l’idée que « l’amour n’a pas de langage (parce que la langue de l’amour serait universellement muette) » et que « l’amour n’a pas de sexe ». Dans le film « Imitation Game » (2014) de Mortem Tyldum, un des messages forts, c’est que celui qui ne sait rien en sait plus que celui qui sait (on le voit avec le personnage de Joan Clarke, cette femme néophyte et apparemment sans formation scientifique, qui se retrouve propulsée au rang de grande espionne).
Le héros homosexuel confère au déni du viol et de souffrance, ou bien au silence, une valeur quasi sacrée : « Elle, c’est María José et lui, José María.[…] Quelque chose de profondément religieux. Que l’on ne peut confesser. » (Luisa Valenzuela, « Leyenda De La Criatura Autosuficiente », Donde Viven Las Águilas, 1983, p. 68) ; « Il ne s’agit pas de comprendre ; il s’agit de croire. » (Maria Casarès dans le film « Orphée » (1950) de Jean Cocteau) ; « Nous, nous ne disons toujours rien. » (Vincent, le héros homosexuel du roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 22) ; « Depuis notre très beau silence au milieu du salon devant la foule attentive, j’ai l’ardent désir de savoir la direction que va prendre cette histoire qui s’écrit. » (idem, p. 29) ; « Vous reprenez, et j’ai peur, lorsque je vous entends reprendre, ainsi, un discours qui s’est suffi à lui-même, qui est assez. » (idem, p. 77) ; « Tant que je le pourrai, je ne parlerai pas. Je fais ce serment du mutisme, pour que tout demeure d’une pureté absolue, d’une blancheur intacte. » (idem, p. 103) ; « Ce sont des silences religieux, je veux dire : des silences comme ceux des églises. Nous avons la ferveur des communiants, leur gravité. » (idem, p. 119) ; « Les histoires de cœur ont vocation à demeurer secrètes, que c’est dans le secret qu’elles s’épanouissent le mieux à ce qu’on prétend. Le secret, bien sûr, est une forme de pudeur, une manière de timidité. Il est ce silence qui nous protège du regard des autres dont on ignore, par avance, s’il sera bienveillant, neutre ou malveillant. » (idem, p. 144) ; « Tu crois que ce genre de choses s’explique ? Non, ça ne s’explique pas. C’est au-delà des mots, Jean-Pierre. » (Fanny parlant à son mari Jean-Pierre de son nouvel amour lesbien pour Catherine, dans la pièce Un Lit pour trois (2010) d’Ivan Tournel et Mylène Chaouat) ; etc.
La dimension religieuse du silence peut aller de pair avec la sacralisation idolâtre de l’art-amour : le secret est élevé – et donc mis à distance – comme s’il trônait sur un piédestal. « Le but principal de l’homme, en art, n’est pas de communiquer. » (une réplique de la pièce My Scum (2008) de Stanislas Briche) ; « Silence, le silence, c’est le mieux. » (Esti, l’héroïne lesbienne du roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, p. 263) ; etc.
c) Le silence effrayant, amusé, ou basé sur le paradoxe :
Parfois, le personnage homosexuel se divertit de ses messes basses, quitte à singer sa difficulté à parler, ou quitte à menacer son interlocuteur : cf. la chanson « Petits Secrets » (2007) de Christophe Moulin, le roman Maldición Eterna A Quien Lea Estas Páginas (Malédiction éternelle pour qui lira ces pages, 1980) de Manuel Puig, le film « De Eso No Se Habla » (1994) de Maria Luisa Bemerg, la pièce L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer (1971) de Copi, le film « Don’t Ask, I Won’t Tell » (2000) d’April Wilson (clin d’œil à la phrase de Bill Clinton sur l’homosexualité dans l’armée nord-américaine), la chanson « Don’t Tell Me » de Madonna, le roman Zéro Commentaire (2011) de Florence Hinckel, le film « Ne te retourne pas » (2013) de Sophia Liu et Benjamin Blot, le film « Faut pas penser » (2014) de Raphaël Gressier et Sully Ledermann, etc.
Dans un premier temps, le censure se déroule dans l’amusement du tour de passe-passe de magicien. « Un sourire, un geste, il n’est déjà plus là ! » (cf. la dernière phrase de la chanson « Il ne dira pas » d’Étienne Daho) ; « Les secrets, j’en ai des tas. » (Ismaël dans le film « Les Chansons d’amour » (2007) de Christophe Honoré) ; « J’ai rien à dire. (Gros blanc) Il m’arrive jamais rien. (Nouvelle pause). Je sais, c’est chiant… » (le héros homosexuel du one-man-show Raphaël Beaumont vous invite à ses funérailles (2011) de Raphaël Beaumont) ; « Je demande ‘La vérité c’est que tu te sens femme, Cody ? Tu en as toujours rêvé, pas vrai ?’ Il répond de sa voix déformée ‘On va danser, darling ?’ » (Mike le narrateur gay à son pote homo nord-américain Cody, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 103) ; « Aaaah… les tournantes, c’était vraiment génial ! » (Gwendoline, lycéenne transgenre M to F, dans le one-(wo)-man show Désespérément fabuleuses : One Travelo And Schizo Show (2013) du travesti M to F David Forgit) ; etc. Par exemple, dans le film « Love Is Strange » (2014) d’Ira Sachs, quand Ben et George reviennent ensemble sur le pourquoi de leur union amoureuse sans forme, George conclut : « Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. »
Le jeu des devinettes est lancé ! Je vous renvoie à toutes les œuvres artistiques à thématique homosexuelle où les questions sans réponse fleurissent : cf. la chanson « Cherchez le garçon » du groupe Taxi-girl, la chanson « Qui est qui ? » de Barbara dans son spectacle Lily Passion (1984), la chanson « Où sont les femmes ? » de Patrick Juvet, la chanson « Lui ou toi » d’Alizée, la chanson « Chercher la femme » de Coccinelle, la chanson « À pile ou face » de Corinne Charby (reprise par Emmanuelle Béart dans le film « Huit Femmes » (2002) de François Ozon), la chanson « Rebelle » de Cindy dans la comédie musicale Cindy (2002) de Luc Plamondon, la chanson « Le Talisman » d’Étienne Daho, la chanson « Qui est qui ? » de Marie-France, le film « Elle ou lui ? » (1994) d’Alessandro Benvenuti, le film « Who’s The Man ? » (1993) de Ted Demme, etc. On retrouve les créations du « peut-être » et du doute sulfureux dans le film « Le Secret de Brokeback Mountain » (2006) d’Ang Lee, le film « La Mala Educación » (« La Mauvaise Éducation », 2003) de Pedro Almodóvar (le protagoniste chante « Quizás »), le film « La Ley Del Deseo » (« La Loi du désir », 1986) de Pedro Almodóvar (avec le boléro final « Lo Dudo » de los Panchos), la chanson « If » d’Étienne Daho, le film « If… » (1968) de Lindsay Anderson, le film « Quasi Quasi » (2001) de Gianlucca Fumagalli, la chanson « Perhaps » dans le film « Comme les autres » (2008) de Vincent Garenq, la chanson « Perhaps » de Geri Halliwell, la chanson « Are You Boy Or Girl ? » dans le one-woman-show Mâle Matériau (2014) d’Isabelle Côte Willems, etc. « Peut-être… peut-être que tout changera. » (Tassos, la vieille folle qui minaude au micro de son music-hall, dans le film « Xenia » (2014) de Panos H. Koutras)
Puis peu à peu, la drôlerie du déni laisse place à l’agacement et à la menace ludique. « Il ne me reste qu’à […] hurler qu’on m’a violé et que je vais tout répéter à mes très violents frérots. » (Vincent Garbo souhaitant incriminer le prêtre qu’il a perverti, dans le roman Vincent Garbo (2010) de Quentin Lamotta, p. 134) ; « J’en ai marre de ne pas oser. J’en ai assez de garder mon secret. […] Et moi, j’ai la trouille. » (Martin, le héros parlant du Sida – que tous prennent pour son homosexualité au départ – dans la pièce Scènes d’été pour jeunes gens en maillot de bain (2011) de Christophe et Stéphane Botti) ; etc. Beaucoup d’auteurs homosexuels choisissent des univers folkloriquement monstrueux, sombres et camp, pour intimider l’enquêteur indiscret : cf. le roman Les Caves du Vatican (1914) d’André Gide, les films « Laberinto De Pasiones » (« Labyrinthe des passions », 1982) et « Entre Tinieblas » (« Dans les ténèbres », 1983) de Pedro Almodóvar, le film « Ténèbres » (1982) de Dario Argento, le film « Leçons de ténèbres » (1999) de Vincent Dieutre, le poème « El Cadáver » de Néstor Perlongher (où l’auditeur est conduit dans un couloir textuel souterrain le menant à la dépouille d’Eva Perón), etc.
Dans la pièce Ma belle-mère, mon ex et moi (2015) de Bruno Druart et Erwin Zirmi, Julien, le héros homosexuel, se rend compte qu’il a été violé par sa belle-mère Solange : « Pourquoi vous m’avez violé ?? » La belle-mère ricane : « Violé… Tout de suite les grands mots… » Finalement, Solange se rabat sur Yoann, l’amant efféminé de Julien. Elle lui fonce dessus, et ce dernier, au départ, résiste : « Elle voulait me violer ! C’est elle ! C’est moi qui était en-dessous. » Puis finalement, pour une affaire d’héritage, Yoann accepte de faire un gosse à la quinquagénaire.
À l’entrée d’un certain nombres d’œuvres homosexuelles, on a droit à la même injonction : « Circulez ! Y’a rien à voir ! » En général, un écriteau prévient le spectateur qu’il avance en terrain ultra-dangereux. « N’ouvre pas la porte, tu sais le piège… » (cf. la chanson « Regrets » de Mylène Farmer) ; « Prenez bien garde aux Brésiliennes. » (Charlène Duval parlant des travestis dans son one-woman-show Charlène Duval… entre copines, 2011) ; « Ne le dites pas : Tristana, c’est moi ! » (cf. la chanson « Tristana » de Mylène Farmer) ; « Si j’étais vous… Lecteurs, ne dites jamais cela. » (une phrase de la quatrième de couverture du roman Si j’étais vous (1947) de Julien Green) ; « Le frigidaire qui parle, il y a quelqu’un à l’intérieur ? Oh non, c’est dégoûtant, pas ça ! Je ne sais pas mais c’est horrible ! Je le referme ! » (Loretta Strong dans la pièce éponyme (1978) de Copi) ; « Notre demeure est fortement isolée. Oui, cela vous rappelle sans doute quelque chose. Agatha Christie. Chateaubriand. Daphné Du Maurier ou Scooby-Doo. Peu importe qui ou quoi. Si vous frissonnez agréablement et éprouvez le désir de mettre un gros pull ou de faire un feu de cheminée, c’est que vous êtes dans la bonne direction. » (cf. la première page du roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 13) ; « On n’a pas de problèmes ici. » (le Maître de Cérémonie dans la comédie musicale Cabaret (1966) de Sam Mendes et Rob Marshall) ; « LE PRÊTRE EST UNE PÉDALE ! » (cf. l’inscription peinte en rouge et en gros sur la porte de la maison du père Adam, dans le film « W imie… », « Aime… et fais ce que tu veux » (2014) de Malgorzata Szumowska) ; « Attention au pédé agressif. Sobre, il est dangereux… Saoul, il est mortel. » (Harold, le doucereux homosexuel du film « The Boys In The Band », « Les Garçons de la bande », (1970) de William Friedkin) ; « On est au Parc d’attractions et je suis Madame Godzilla. » (l’infirmière d’hôpital s’adressant à Rana, dans le film « Facing Mirrors : Aynehaye Rooberoo », « Une Femme iranienne » (2014) de Negar Azarbayjani) ; etc. Par exemple, dans le film « The Rocky Horror Picture Show » (1975) de Jim Sharman, un écriteau à l’entrée du château hanté nous annonce la couleur : « Vous entrez à vos risques et périls !! » Dans le roman Le Bal des folles (1977) de Copi, le narrateur, après avoir tué son éditeur, place une inscription « Don’t disturb » sur la porte pour maquiller son crime. (p. 90)
La mise en garde mi-grave mi-drôle du personnage homosexuel fait penser à la comédie sérieuse de certains hommes transsexuels stoïques, ou des figurants inquiétants de fêtes foraines invitant de manière très ambiguë les badauds à pénétrer dans leur train-fantôme : cf. la pièce Amour, gore et beauté (2009) de Marc Saez (où dès le départ, le spectateur est accueilli par des comédiens fardés comme des acteurs de film d’épouvante), la chanson « L’Attraction » d’Emmanuel Moire (« Approchez, venez découvrir l’attraction nouvelle, celle qui va bientôt ouvrir si vous voulez d’elle. Approchez, venez visiter l’attraction soudaine. Vous allez sans doute l’aimer, elle vaut toutes les peines. Entrez donc vous asseoir, approchez-vous pour voir. »), le film « Prenez garde à la sainte putain » (1971) de Rainer Werner Fassbinder, la comédie musicale La Nuit d’Elliot Fall (2010) de Vincent Daenen, la photographie Que me veux-tu ? (1928) de Claude Cahun, etc.
Comme il constate que son déni terrorisant attise encore plus la curiosité de la foule, le personnage homosexuel trouve une autre stratégie pour faire oublier son viol : il fait preuve de chantage aux sentiments et surjoue le débordement d’émotions. « Give me time… Do you really want to hurt me ? Do you really want to make me cry ? » (cf. la chanson « Do You Really Want To Hurt Me ? » du groupe Culture Club) ; « Je vous prie de me croire. Je n’ai pas de secret ! » (Irena en larmes face au psychiatre, dans le film « Cat People », « La Féline » (1942), de Jacques Tourneur) ; « Promettez-moi que vous ne serez pas méchant avec moi dans votre gazette. On a propagé de telles insanités à propos de mon soi-disant mauvais caractère ! Il paraît que j’ai l’habitude de gifler mes partenaires. » (Cyrille dans la pièce Une Visite inopportune (1988) de Copi, pp 19-20) ; etc.
L’autre caprice qu’interprète le personnage homosexuel pour ne pas avoir à révéler son viol, c’est celui du paradoxe (cf. le roman Para Doxa (2011) de Laure Migliore) : « Stratégie oblique oblige. » (cf. la chanson « Mes Amis et moi » d’Arnold Turboust ») ; « Soyez vous-même, réveillez vos sens ! Ne dites jamais la première chose qui vous vient par la tête, c’est toujours de la fatalité, un réflexe… Soyez naturel, dites la deuxième ! » (une réplique de la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier) ; « Ma vie est une tragicomédie : elle est remplie de paradoxes. » (Lacenaire dans la pièce éponyme (2014) de Franck Desmedt et Yvon Martin) ; etc.
Il dit tout et son contraire pour ne pas avoir à se positionner et à ouvrir la bouche : « Je n’ai jamais su quelle est la part de réel et d’imaginaire dans ce récit. » (Copi-Traducteur dans le roman La Cité des Rats (1979) de Copi, p. 121) ; « Je milite quotidiennement pour le droit à se contredire soi-même, à changer d’avis, à se mentir, à inventer des mots, à les dire en feu d’artifice… dans le sens que l’on veut… Personne ne me dicte rien à moi… Je pourrais très bien faire de la politique. » (Lise dans la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier) ; « La règle, c’est qu’il n’y a pas de règles. » (Juna, l’une des héroïnes lesbiennes de la pièce Gothic Lolitas (2014) de Delphine Thelliez) ; « De ce paradoxe, je suis complice. » (cf. la chanson « Sans logique » de Mylène Farmer) ; « Ici on acquiesce presque toujours en partant de l’erreur, c’est ironique et amusant. » (Julio Cortázar, « La Barca », Alguien Que Anda Por Ahí (1978), p. 148) ; etc. Il tourne autour du pot, plus ou moins consciemment. « Je veux raconter des histoires. On ne saura pas si elles sont fausses ou si elles sont vraies. » (Loïc, le héros homo, à la fin du film « Garçon stupide » (2003) de Lionel Baier) ; « La vérité est mensonge. Le mensonge est vérité. » (Hyo-Shin dans le film « Memento Mori » (1999) de Kim Tae-yong et Min Kyu-dong) ; « Je suis une femme, je suis un homme, je suis tout, je ne suis rien. » (la voix narrative du roman Poupée Bella (2004) de Nina Bouraoui, p. 9) ; « Tristana prête à tout, pour rien, pour tout. » (cf. la chanson « Tristana » de Mylène Farmer) ; « Ma mère dansait. Triste. Heureuse. Au début de sa vie. Avant mon père. » (Omar, le héros homo du roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, p. 92) ; etc.
d) Le silence impérieux et ennemi de la Vérité :
Bien souvent, le déni se radicalise en ordre : cf. le roman Ne le dis à personne (1994) de Jaime Bayly, le film « Cause toujours » (2008) d’Anne Crémieux, la chanson « Shut Up ! » de Mylène Farmer, le film « Top Secret » (1952) de Mario Zampi, le film « No Se Lo Digas A Nadie » (1998) de Francisco J. Lombardi, le film « Me Da Igual » (1999) de David Gordon, le film « Dormez, je le veux ! » (1997) d’Irène Jouannet, le film « Leave Me Alone » (2004) de Danny Pang, la pièce L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer (1971) de Copi (avec Irina se coupant la langue), le film « Love And Deaf » d’Adam Baran (avec l’appel à fermer sa gueule), la pièce Y a comme un X (2012) de David Sauvage (avec le héros transsexuel M to F Jean-Charles/Jessica, spécialiste des mensonges) ; etc. Par exemple, dans le roman Les Illusions perdues (1837-1843) d’Honoré de Balzac, Lucien reçoit de Vautrin (l’un des premiers héros romanesques homosexuels déclarés) « la loi des lois : le secret ! ». Dans le film « La Vie d’Adèle » (2013) d’Abdellatif Kechiche, pendant le jeu télévisé Questions pour un champion, Julien Lepers pose la question de la définition de l’« omerta », la fameuse « Loi du silence ».
Le personnage homosexuel montre clairement son opposition à la Vérité, réalité qu’il présente comme un « concept » abstrait et inaccessible… parce qu’au fond il vit encore dans l’illusion de La posséder et de La garder pour lui : « J’ai horreur qu’on me pose des questions. » (Ada, l’héroïne lesbienne de la pièce La Star des oublis (2009) d’Ivane Daoudi) ; « C’est arrivé. C’est tout. » (Carole, l’héroïne lesbienne avouant qu’elle est sortie avec Delphine, dans le film « La Belle Saison » (2015) de Catherine Corsini) ; « Tant que je pourrai, je ne parlerai pas. » (la figure de Marcel Proust dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 86) ; « Je ne veux pas de fantasmes, pas de peurs inutiles. Et j’exige le secret. » (Thomas dans le roman Son Frère (2001) de Philippe Besson, p. 45) ; « Je me demande combien de mutilations seront nécessaires pour débusquer la vérité, combien d’examens il lui faudra subir pour espérer savoir enfin ce qui lui arrive. […] Je songe que la vérité pourrait nous faire regretter notre ignorance. » (Lucas, idem, p. 38) ; « N’avons-nous pas souvent été blessés par ceux qui ‘ne font que dire la vérité’ ? Les pensées véritables ne doivent pas toutes être dites. […] Nous ne devrions pas nous précipiter pour ouvrir grand les portes et autoriser la lumière à éclairer des lieux discrets. Car ceux qui ont vu les mystères cachés nous parlent de beauté, mais aussi de douleur. Et il est préférable que certaines choses demeurent invisibles, que certains mots ne soient pas prononcés. » (Naomi Alderman, La Désobéissance (2006), pp. 99-100) ; « J’ai horreur de la Vérité. » (Mathilde dans la pièce Le Retour au désert (1988) de Bernard-Marie Koltès) ; « La Vérité habite le fond d’un puits insondable. » (Sébastien, le héros homo cité dans le film « Suddenly Last Summer », « Soudain l’été dernier » (1960) de Joseph Mankiewicz) ; « Discuter ? À quoi bon ? » (Chris, le héros homosexuel, à propos de son père, dans la pièce Happy Birthgay Papa ! (2014) de James Cochise et Gloria Heinz) ; « J’ai pas de goût. Pas d’avis. » (François dans le film « Un autre homme » (2008) de Lionel Baier) ; « Personne ne peut me comprendre. » (Franz, le héros homosexuel de la pièce Gouttes dans l’océan (1997) de Rainer Werner Fassbinder) ; « T’inquiète pas. Je sais ce que je fais. » (Romane, l’héroïne lesbienne s’adressant à son père qui s’inquiète de son engagement dans l’homosexualité, dans l’épisode 68 « Restons zen ! » (2013-2014) de la série Joséphine Ange gardien) ; etc.
En bon relativiste, le héros homosexuel éclate/éparpille la Vérité en une multiplicité de subjectivités, de « petites vérités individualistes », de points de vue incritiquables et tolérables : « Il y a autant de vérités que d’êtres humains. » (Yves Navarre, Portrait de Julien devant la fenêtre (1979), p. 82) ; « D’ailleurs, rien n’est grave. » (Vincent, le héros homo du roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 30) ; « Le bien, le mal n’existent pas dans le bonheur, dans le malheur. Les hommes sont des animaux, les femmes sont des animales. » (Cachafaz dans la pièce Cachafaz (1993) de Copi) ;etc. Et généralement, cette vérité parcellaire nie l’existence même de la Vérité unique : « La Vérité, y’en a pas. » (idem, p. 102) ; « Qui sur terre a le droit de nous condamner, de nous dire ce qui est bien et ce qui est mal ? » (Kévin s’adressant à son amant Bryan, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 323) ; etc.
Le personnage homosexuel se met souvent à mépriser les discours sur le vrai : il dit que ce n’est que du blabla, de l’intellectualisme, que « ça le saoule » : « Si chaque fois qu’en bavardages, nous nous laissons dériver, je crois bien que d’héritage, mon silence est meurtrier. » (cf. la chanson « Sans logique » de Mylène Farmer) ; « Les discours trop prolixes, que de la rhétorique ! » (cf. la chanson « Fuck Them All » de Mylène Farmer) ; « Quand se déshabituera-t-on de tout expliquer ? » (Brigitte Bladou interprétant le rôle du compositeur Satie, dans le one-woman-show Érik Satie… Qui aime bien Satie bien, 2009) ; « Il est agréable, de temps en temps, de ne plus penser. » (Didier, le héros hétéro, au moment de passer à l’acte homo, dans la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Ceglia) ; « ’ Tu réfléchis constamment. C’est peut-être ça le problème. Tu devrais peut-être débrancher ton cerveau de temps en temps. Regarder la télé, te relaxer. ’ Jane sourit, se rappelant combien de fois Petra lui avait dit qu’elle gaspillait son intelligence en travaillant dans une librairie. » (Petra s’adressant à son amante Jane, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 120) ; etc. Énormément de héros homosexuels mentent effrontément. Par exemple, dans la pièce Fixing Frank (2011) de Kenneth Hanes, Frank, le héros homosexuel, passe son temps à mentir à son psy ; et son compagnon fait de même : « On obtient la vérité qu’en mentant. »
Paradoxalement, même si le héros homo nie l’existence de la Vérité, il va faire de son fantasme identitaire/amoureux sa « Vérité profonde ». Une Vérité indiscutable. Par exemple, dans l’épisode 85 « La Femme aux gardénias » (2017) de la série Joséphine Ange-gardien, Albertine, l’héroïne lesbienne, a une liaison avec Lena, une chanteuse noire de jazz, alors qu’elle s’apprête à se marier avec Henri, pour faire un mariage de façade. Lena lui fait un procès au mensonge et à l’esclavage idéologique : « J’épouse Henri pour qu’on soit libres de vivre comme on l’entend. » (Albertine s’adressant à son amante Lena) « En mentant toute ta vie ? En faisant semblant d’être une autre ? » (Lena) « Mais c’est comme ça. J’ai pas le choix. » (Albertine) « Et moi, tu crois que ça m’a pas demandé du courage pour en arriver là ? Est-ce que tu as vu la couleur de ma peau ? Tu penses que c’est facile pour moi ? » (Lena) « Tout ce que je veux, c’est qu’on soit heureuses. » (Albertine)
Généralement, ce refus catégorique de la Vérité a pour corollaire la mauvaise foi, l’indifférence, le déni pur et simple, la simulation de déprime : « Ne fais pas attention à moi… » (cf. le poème « Herida… » de Néstor Perlongher) ; « Tu ne pourras rien changer. Côté sombre, c’est mon ombre. » (cf. la chanson « Et tournoie… » de Mylène Farmer) ; « De toute façon, vous ne pouvez rien pour moi. Au-dessus de moi, il y a tout le poids de mon éducation. » (une patiente lesbienne à sa psy dans la pièce Psy Cause(s) (2011) de Josiane Pinson) ; « Peut-être suis-je nympho… Je ne veux pas savoir. » (la voix narrative lesbienne dans le roman Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train (2005) de Cy Jung, p. 96) ; « De mes batailles, PaCS et marmaille, ça ne te regarde pas. » (Tania la lesbienne dans la pièce Ma Double Vie (2009) de Stéphane Mitchell) ; « Laissez-vous vivre notre histoire : on vous emmerde. » (les amants Matthieu et Jonathan s’adressant au public, dans la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H.) ; « De toutes façons, tu le sais. » (une amie lycéenne parlant de manière très ambiguë d’homosexualité à son amie Adèle, comme un secret de polichinelle qu’elle lui impose pour la tester, dans le film « La Vie d’Adèle » (2013) d’Abdellatif Kechiche) ; etc. Par exemple, dans la pièce Hétéro (2014) de Denis Lachaud, le doute est présenté comme le plus grand des dangers terrestres par le père 2, l’un des protagonistes homos.
e) L’autocensure anti-identitaire :
C’est surtout contre lui-même que le héros homosexuel dirige sa politique de censure. Il se force à ne pas s’écouter et à étouffer ses idéaux profonds : « La véritable vie d’un être n’est véritablement pas celle qu’il a menée. » (cf. le slogan écrit par Steven, le héros homo, sur le journal de son lycée, dans le film « Get Real », « Comme un garçon » (1998), de Simon Shore) ; « Je voulais des enfants, mais j’ai appris à ne jamais y penser. » (Bernadette, le personnage transsexuel M to F du film « Priscilla, folle du désert » (1995) de Stephan Elliot) ; etc.
Il se nie lui-même, par le travestissement, en se coupant de ses racines, ou en vivant une double vie faite de mensonge et de sincérité : « Je suis un homme sans histoire. » (le héros du ballet Alas (2008) de Nacho Duato) ; « Je ne crois pas que le passé compte, murmure Simon, après on va rentrer dans des trucs psychologiques, le gourou Freud, tout ça, c’est une secte pour moi. » (Simon le protagoniste homo, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 33) ; « Qui entre dans l’Histoire entre dans le noir. » (cf. la chanson « Appelle mon numéro » de Mylène Farmer) ; « Faut-il vraiment chercher à fouiller dans le tiroir des morts ? demanda Jason. Les secrets de nos ancêtres nous appartiennent-ils ? » (Jason, le personnage homosexuel du roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 235) ; « Je me suis métamorphosée, j’ai déchiré la chrysalide à pleines dents, je n’ai fait qu’une bouchée de mon ancien moi, j’ai mué comme un serpent. » (l’héroïne lesbienne du roman À ta place (2006) de Karine Reysset, p. 42) ; « Pas de passé, pas d’avenir. » (Johnny Rockfort dans la chanson « Banlieue Nord » de l’opéra-rock Starmania de Michel Berger) ; « Je ne suis pas ce que je suis. » (Iago dans la pièce Othello (1604) de William Shakespeare) ; « La discrétion sur ma vie privée était une chose strictement personnelle qu’il fallait protéger. Cette stratégie d’ailleurs avait admirablement bien fonctionné durant toute ma carrière. » (Ednar, le héros homosexuel du roman très autobiographique Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 171) ; « Tu ne penses jamais à mettre le passé dans une cave ? » (Tom s’adressant à son amant Peter, dans le film « The Talented Mister Ripley », « Le Talentueux M. Ripley » (1999) d’Anthony Minghella) ; etc.
Dans certaines œuvres homosexuelles, le personnage homosexuel décide même de changer de nom : dans le film « Far West » (2003) de Pascal-Alex Vincent, par exemple, Éric, de retour au village de son enfance, demande à ceux qui l’ont connu petit de l’appeler « Ricky » (ça fait plus fashion…) ; dans le film « Comme un frère » (2005) de Bernard Alapetite et Cyril Legann, Sébastien change de nom et se fait rebaptiser « Zack » ; dans le roman El Beso De La Mujer-Araña (Le Baiser de la Femme-Araignée, 1976) de Manuel Puig, Molina, le protagoniste homosexuel, veut que Valentín l’appelle « Carmen » ; dans le film « Je préfère qu’on reste amis » (2005) d’Éric Toledano et Olivier Nakache, Claude a pour pseudonyme « Johnny Dep » ; dans le film « Boy Culture » (2007) de Q. Allan Brocka, le héros homosexuel demande à être appelé « X » (difficile de faire plus anonyme…) ; dans la pièce musicale Érik Satie… Qui aime bien Satie bien (2009) de Brigitte Bladou, Érik Satie se surnomme « Érika Satie » ; dans le film « Pride » (2014) de Matthew Warchus, les potes de Joe l’intègrent officiellement à leur club LGBT en jetant aux oubliettes son véritable prénom, et en l’adoubant avec un pseudonyme officiel, « Bromley » ; dans le film « L’Art de la fugue » (2014) de Brice Cauvin, Romain, l’amant d’Alexis, se fait appeler « Zoltan » comme nom de scène (il est acteur de théâtre contemporain)… et en plus, il ne s’appelle même pas Romain à la base, mais Gilbert ! ; dans la pièce L’un dans l’autre (2015) de François Bondu et Thomas Angelvy, François, homosexuel, est vendeur dans un magasin de vêtements féminins et fait croire qu’il s’appelle « Steeve » ; etc. « Je me suis converti en pseudonyme. » (Harry dans le film « Los Abrazos Rotos », « Étreintes brisées » (2009) de Pedro Almodóvar) Je vous renvoie également au roman Ne m’appelez plus Julien (2003) de Jimmy Sueur, et au film « Le Dénommé » (1988) de Jean-Claude Dague.
En général, le héros homosexuel tente de détruire sa propre identité, et donc sa relation à l’autre. Comme dirait le poète Eduardo Milán dans son poème « Errar », « Dire ‘tu’ et ‘je’, c’est entrer au cirque » (Roberto Echavarren, José Kozer, Jacobo Sefamí, Medusario (1996), p. 252). « Je ne voulais pas être photographiée. Ensuite j’ai détruit les rares photos que je n’ai pas pu éviter. » (Fédora par rapport aux photos de son adolescence, dans le roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, p. 241) Par exemple, dans le vidéo-clip de la chanson « Ma Révolution » de Cassandre, le journal intime est détruit. Dans la pièce Le Frigo (1983) de Copi, Goliatha a brûlé les papiers d’identité de sa maîtresse « L. ». Dans la pièce L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer (1967) de Copi, le dossier d’identité d’Irina disparaît. Dans le roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami, Gabrielle creuse un trou noir dans son jardin pour y enterrer ses journaux intimes : « Elle jette dans le trou ses cahiers toilés, ses carnets intimes, des lettres de Marc. Elle jette ses années de jeune fille, de femme, de mère… » (p. 124)
Avec certains personnages transsexuels, on assiste même à un suicide symbolique : « Miri n’existe plus !!! » (Miriam/Lukas, l’héroïne transsexuelle F to M, dans le film « Romeos » (2011) de Sabine Bernardi)
f) Le chemin vers la réflexion sur le désir homosexuel est souvent condamné, au profit de la glorification aveugle de l’amour homo :
Très souvent, le déni identitaire des protagonistes homosexuels s’accompagne du déni du désir homosexuel, donc d’une homophobie. « C’est comme un cache-sexe, ce mot ‘gay’. » (Gérard, le héros homo de la comédie musicale Chantons dans le placard (2011) de Michel Heim) ; « Mais non !! Je ne suis pas gay !! » (Jules, le héros homo de la pièce Les Sex Friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau) ; « J’éprouvais une sorte de terreur à l’idée que mon entourage ou, pis, mon mari puissent connaître mon secret… » (Alexandra, la narratrice lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 69) ; « Je sais que nous sommes pareilles et partageons le même secret. » (idem, p. 209) ; « Tout le monde a un secret. Tu es pédé par exemple et nous n’en avons jamais parlé. » (la Comédienne s’adressant à l’Auteur, dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1986) de Copi) ; etc. Par exemple, dans la pièce Les Z’héros de Branville (2009) de Jean-Christophe Moncys, Gérard évoque « ce terrible secret » qu’est son « attirance pour les jeunes hommes ».
Le personnage – gay ou lesbien – impose un interdit sur la définition même de l’homosexualité : « Quant à savoir pourquoi je suis comme ça ? Je mourrai sans avoir trouvé ne fût-ce que l’ombre d’une explication. » (Suzanne à propos de son homosexualité, dans le roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, p. 85) ; « Je ne suis pas homo… ni hétéro, ni bi… J’suis sexuel. » (Laurent dans le one-man-show Gérard comme le prénom (2011) de Laurent Gérard) ; « L’histoire de ce film est une histoire que j’offre aux homos et aux hétéros pour nous aider tous à comprendre ce qu’il y a derrière ces deux mots, et découvrir qu’il n’y a peut-être rien à comprendre. » (Billy, le héros homo du film « Billy’s Hollywood Screen Kiss » (1998) de Tommy O’Haver); « Ne cherchez pas l’erreur que vous auriez commise. Vous n’y êtes pour rien. » (un homo anonyme de 16 ans parlant de son homosexualité à son père, dans la comédie musicale À voix et à vapeur (2011) de Christian Dupouy) ; « Trop fière et trop entière, encore. Il fallait m’accepter comme j’étais, un point c’est tout. » (idem, p. 92) ; « Je ne peux pas changer ce que je suis. » (Johnny, le héros homo s’adressant au révérend Ritchie, dans le film « Children Of God », « Enfants de Dieu » (2011) de Kareem J. Mortimer) ; « C’est comme ça et puis c’est tout ! » (Damien par rapport à son homosexualité, dans la pièce Les Deux pieds dans le bonheur (2008) de Géraldine Therre et Erwin Zirmi) ; « Nul n’a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Et je précise que c’est bien la Nature qui est seule responsable si je suis un homme oh ! comme ils disent. » (cf. la chanson « Comme ils disent » de Charles Aznavour) ; « Mourad répondit que ça suffisait comme ça, d’être une bête curieuse, un objet d’étude ou de pitié. Il n’y avait rien à expliquer. La seule chose qu’on pouvait faire, c’était constater le phénomène, et l’accepter en tant que tel. » (Mourad, l’un des deux héros homos du roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 352) ; « De toute façon, comme je l’ai déjà dit, je ne possédais aucun argument pour défendre ma sexualité. » (Ednar, le héros homosexuel du roman très autobiographique Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 201) ; « En amour, il n’y a pas de règles. » (Harold, l’un des héros homosexuel du film « The Boys In The Band », « Les Garçons de la bande » (1970) de William Friedkin) ; « Victor aime les hommes. Vous pouvez rien y changer. Et lui non plus, d’ailleurs. » (Serge, l’amant de Victor, s’adressant au père de ce dernier Dans le téléfilm Fiertés (2018) de Philippe Faucon, diffusé sur Arte en mai 2018) ; etc. Par exemple, dans le film « Love And Words », aux yeux de la traductrice, « le désir n’a pas besoin d’être exposé ». Dans le film « Pride » (2014) de Matthew Warchus, la vieille Gwen a une question innocente à poser aux lesbiennes qui viennent d’arriver dans son village, car elle n’y connaît rien à l’homosexualité : elle se fait rembarrer par tout le monde.
On remarque quasi systématiquement que la censure imposée par rapport au désir homosexuel est d’abord une auto-censure. Il s’agit de partir en croisade contre toutes les images et les « clichés » qui sont le reflet d’une pratique qui ne veut pas être identifiée. « L’archétype du pédé, un cliché sans visage. » (cf. une réplique de la comédie musicale Sauna (2011) de Nicolas Guilleminot) ; « C’est des clichés, tout ça. » (Vincent s’adressant à son ex-compagnon Stéphane, qu’il a trompé en n’assumant pas du tout son acte d’infidélité qu’il présente comme « cliché », dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson) ; « On dit que les homos font n’importe quoi. Bonjour le cliché ! » (Yoann, le héros homosexuel, dans la pièce Ma belle-mère, mon ex et moi (2015) de Bruno Druart et Erwin Zirmi) ; etc. Il arrive même que le personnage homosexuel parle de lui à la troisième personne, pour nier la responsabilité de ses actes et son identité profonde : « Il ne dira pas, non, il ne dira pas que pour cet amour il a ce désir-là. Il ne dira pas, non, il ne dira pas que dans ses bras la nuit il pleure. » (cf. la chanson « Il ne dira pas » d’Étienne Daho) ; etc. Par exemple, dans le film « Cherchez Hortense » (2012) de Pascal Bonitzer, Claude Rich, qui a couché avec des hommes, refuse de se définir comme homosexuel : « Ça fait de moi un homosexuel ? » Dans le one-man-show Entre fous émois (2008) de Gilles Tourman, Jarry emploie le langage des signes pour dire son homosexualité, et couronne le processus d’autocensure en disant : « Je suis homosexuel. Je ne l’ai pas choisi. […] Je suis une énigme. Je viens de nulle part. »
Il arrive que le héros homo efface aussi les preuves compromettantes de ses actes amoureux homo-génitaux : « Elle conclut en évoquant une encre sympathique, utilisée parfois pour la diplomatie ou les affaires quand elles réclament une certaine discrétion et à laquelle nous pourrions avoir recours. Cette encre est d’un emploi très facile : il suffit de chauffer un peu le papier, dans un petit poêlon par exemple, pour que l’écriture apparaisse. Elle mettra l’écrit le plus important au dos, sur la partie restée vierge. Et elle me demande, une fois lue, de brûler la lettre aussitôt. » (Alexandra, la narratrice parlant de sa cousine lesbienne avec qui elle a couchée, dans le roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 77)
Paradoxalement, le déni de la nature violente du désir homosexuel est souvent contre-investi dans une glorification de l’amour homosexuel, glorification tout aussi dénégatrice du Réel d’ailleurs : « Ce n’est pas un acte scandaleux, celui que nous commettons. Il ne faut pas raisonner ainsi. Ce serait raisonner faux. Et c’est inutile. […] Nous devrons tout garder secret si nous voulons préserver cette chose en nous. J’accepte d’emblée cette idée du secret qui m’enchante. » (Vincent en parlant de lui et de son amant Arthur, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 47) ; « Nul besoin de mots pour exprimer notre bonheur : le silence déployait autour de nous son voile nuptial nous livrant ainsi au gré de nos désirs. » (Ednar en parlant de son amant Dylan, dans le roman très autobiographique Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, pp. 38-39) ; « Déshabillez-vous, s’il vous plaît. Ne posez pas de questions. […] Silence ! Tu te tais ! » (Monsieur Chateigner, un client maltraitant Anthony son jeune garçon d’hôtel afin de le forcer à coucher avec lui, dans le film « Consentement » (2012) de Cyril Legann) ; « Parce que la Réalité frappe, parce que le silence entre les mots disent davantage que les mots. Ça ne peut pas être péché que d’aimer. Jamais je ne goûterai le regret, plutôt se haïr, se rendre, mourir à la guerre sainte. Ça suffit ! Et alors ? La foi sèchera mes larmes. Sûrement que le soleil s’éteint et que Lucifer me guide, et je serai une ombre comme la Tour de Babel… et ton amour, Père rappelle-toi !! L’Église promulgue que je suis une pédale de merde, si c’est ça mon péché, je suis coupable, comme une infâme Inquisition. Mais je n’ai tué personne. Je ne douterai, je ne douterai pas de moi. Non. Je ne douterai pas de moi. » (cf. la chanson « Madre Amadísima » de Haze et Gala Evora) ; etc.
C’est l’amour homosexuel que le personnage homosexuel va présenter comme un flou artistique à applaudir mais à ne surtout jamais éclaircir : « Arrête de vouloir comprendre. J’aime Loïc. Un point c’est tout. » (Guillaume dans la pièce Les Amazones, 3 ans après… (2007) de Jean-Marie Chevret) ; « C’est entre elle et moi, ça ne regarde personne d’autre. » (cf. la chanson « Entre elle et moi » des Valentins) ; « J’aime une femme et ce n’est pas discutable. » (Marion à sa fille Justine dans le téléfilm « La Surprise » (2007) d’Alain Tasma) ; « Je suis comme je suis, un point c’est tout. » (Bryan dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 397) ; « Je ne m’interroge plus sur mon homosexualité. Je la vis. » (Robbie dans le film « Dérive » (1983) d’Amos Gutmann) ; etc.
Le héros homosexuel, pour se conforter dans sa propre certitude identitaire et amoureuse, se contente de s’auto-citer, dans une tautologie presque risible tellement elle est systématique et peu argumentée : « On y est pour rien Bryan, on est né comme ça, on n’a pas choisi. » (Kévin parlant à son amant Bryan, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 323) ; « Je suis comme je suis, tu ne me referas pas. » (Bryan à sa mère, idem, p. 336) ; « On est comme on est. La terre est ronde, personne ne se demande pourquoi. Elle est ronde, c’est tout. Pour nous c’est pareil, on est comme on est ! […] On s’aimait déjà et on était déterminés. Il ne manquait plus que l’occasion… On aurait fini par la trouver. » (Bryan, idem, p. 361) ; « Et n’oublie pas, Chance. C’est une illusion dont tu dois convaincre tout le monde. À commencer par toi-même. » (le drag-queen « Claire Voyante » au héros Chance à propos de son homosexualité, dans le film « Saisir sa chance » (2006) de Russell P. Marleau) ; « Tu es comme ça ou tu ne l’es pas. » (Thierry par rapport à son homosexualité, dans la série Joséphine Ange-gardien (1999) de Nicolas Cuche, épisode 8 « Une Famille pour Noël ») ; « C’est avec les femmes seulement que je puis avoir du plaisir, et quoi que je fasse, rien n’y changera. » (Alexandra, la narratrice lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 73) ; « J’suis pédé et je le serai toujours. » (Jules, le héros homo de la pièce Les Sex Friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau) ; « On ne choisit pas qui on est. » (Nina s’adressant en pleurs à George par rapport à l’homosexualité de ce dernier, dans le film « L’Objet de mon affection » (1998) de Nicholas Hytner) ; etc.
Les remarques extérieures sur son homosexualité sont parfois accueillies par le héros gay dans une tiédeur et une mauvaise foi saisissantes. Par exemple, dans le film « Je vois déjà le titre » (1999) de Martial Fougeron, la mère de Paulo tient à son fils un discours assez jugeant mais cependant réaliste sur les amours homosexuelles : « Vous recherchez tous la même chose. Autre chose que les autres. Vous ne savez pas quoi et vous ne le trouvez pas. Vos aventures ne durent jamais longtemps. Vous passez de l’une à l’autre, et vous vous abandonnez chaque fois entièrement. Et quand c’est fini, c’est dur, c’est éprouvant. Vous n’osez pas en parler. Vous savez en sourire mais on sent que c’est pas facile. » Paulo lui répond, grisé : « On ne peut pas généraliser comme ça. » (qui résonne comme un « … Même pas vrai d’abord… »). Sa mère s’énerve : « Non mais regarde-toi ! ». Paulo s’engouffre alors dans un silence contrarié et boudeur.
Le personnage homosexuel s’auto-persuade qu’il est heureux en amour, alors que sa situation est loin d’être idéale : « J’suis heureuse maintenant. J’suis vraiment heureuse. » (Camille, la lesbienne enfermée dans une prison où elle vit une relation lesbienne, dans le one-woman-show Vierge et rebelle (2008) de Camille Broquet) ; « Je sens mon cœur contre ton poitrail. […] Je sens le battement qui s’accélère juste un peu. Je n’ai pas peur. Je n’ai pas peur. » (Vincent à son amant Arthur dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 40) ; etc. C’est même bien souvent son amant qui lui fait du chantage et le réduit à l’omerta. Par exemple, dans le film « L’Homme blessé » (1983) de Patrice Chéreau, Jean force Henri au silence par rapport à ses vols en l’embrassant sur la bouche de force. Dans le film « Children Of God » (« Enfants de Dieu », 2011) de Kareem J. Mortimer, Romeo arrive à amadouer et à contrôler son futur amant Johnny en insistant sur l’abandon et le « lâcher-prise »
Le héros homosexuel essaie parfois de faire passer sa soumission silencieuse à son amant pour de la confiance ou un merveilleux sacrifice d’amour : « Je veux qu’il sache que ça ne me dérange pas. » (Michael s’obligeant à ne pas être blessé par les multiples infidélités de son amant Ben, dans le roman Michael Tolliver est vivant (2007) d’Armistead Maupin, p. 78) ; « Ce n’est pas vrai. En fait, je suis assez heureux. » (Franz niant son insatisfaction de couple avec son amant tyrannique, Franz, dans la pièce Gouttes dans l’océan (1997) de Rainer Werner Fassbinder) ; etc. En plus, c’est en embrassant ou en se faisant embrasser sur la bouche par son partenaire qu’il l’empêche ou est empêché de parler, que le non-dit s’approfondit… et que finalement l’homophobie de l’acte homosexuel qui émerge : « Il n’y a pas de mal, je t’assure. » (Sven embrassant Éric, dans le roman L’Amant de mon père (2000) d’Albert Russo, p. 96) ; « Toi et moi, on ne s’est jamais rencontrés, ok ? On ne se connaît pas. » (Zach s’adressant à Danny suite à la nuit de sexe qu’ils ont vécue ensemble sans même prendre le temps de se connaître, dans le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza) ; etc.
Le personnage homosexuel veut donner à son autocensure l’apparence de l’amour, de la nature : « De tout temps, j’ai toujours eu envie d’avouer mon homosexualité, mais je ne trouvais pas d’explications pour dire pourquoi j’étais homosexuel. Je suis homosexuel, cela ne se justifie pas, et c’est très bien ainsi. D’ailleurs, on ne s’excuse pas de ce qu’on est naturellement. » (Ednar, le héros homosexuel, dans le roman très autobiographique Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 116) ; « Le véritable je t’aime n’est pas sonore. » (le Comédien dans la pièce Les Hommes aussi parlent d’amour (2011) de Jérémy Patinier) ; « Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l’amour infini me montera dans l’âme. Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la Nature, – heureux comme avec une femme. » (cf. le poème « Sensation » d’Arthur Rimbaud, mars 1870) ; « Je vis avec un homme. Ça ne devrait pas faire toute une histoire. Pas de remous, pas la moindre vague. À peine une chanson. […] Je vis avec un homme et je ne demande à personne de suivre mon modèle. Je ne demande pas qu’on me comprenne ni qu’on trouve ça normal. Seulement de vivre au grand jour avec celui que j’aime. » (cf. la chanson « Avec un homme » de Stéphane Corbin) ; etc.
Alors généralement, il prend son air énamouré, en faisant comprendre à son entourage que, justement, ce dernier « ne peut PAS le comprendre » : « Certaines choses sont au-delà des mots. » (une réplique du film « Amour toujours » (1995) de Gabriel de Monteynard) ; « Cette histoire qui nous réunit, elle n’est pas intelligible. Tu aurais beau la raconter avec les mots les plus simples, personne ne la comprendrait. À quoi bon parler ? » (Leo s’adressant à son amant Luca, dans le roman Un Garçon d’Italie (2003) de Philippe Besson, p. 108) ; « Si un jour il me faut répondre à des questions sur ce qui me reliait à lui, je relaterai cet épisode du jeune homme, et du regard qui a suivi. Mais, bien sûr, personne ne comprendra. Ils emploieront des mots simples, des mots de tous les jours, pour parler de nous. Mais ce ne seront pas les mots qui conviennent. Non pas qu’il soit besoin de mots compliqués ou de formules alambiquées, mais il s’agit de viser juste, de ne pas se tromper. Eux se tromperont. Ils racontent une histoire et nous en aurons vécue une autre. » (idem) ; « Voilà, ça vient de se produire devant nos yeux, cet homme de quarante-cinq ans et ce garçon de seize viennent de se rejoindre, sans un mot, sans un geste. Il n’est presque rien arrivé. Nous aurions pu ne pas le voir, passer à côté et, pourtant, c’est bien là, ce lien spécial, ça s’est fait, ça s’est construit, c’est saisissant. » (Philippe Besson, En l’absence des hommes (2001), p. 22)
On ne peut que constater le lien entre silence et narcissisme orgueilleux : « Le silence me rend presque belle. » (Lise dans la pièce Les Gens moches ne le font pas exprès (2011) de Jérémy Patinier) Et pourtant, il n’y a pas de quoi tirer une quelconque fierté du mensonge…
FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION
PARFOIS RÉALITÉ
La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :
Beaucoup de personnes homosexuelles exigent le silence et le secret autour de leur homosexualité, et parfois du viol qu’elles ont subi :
a) Le silence sur le viol :
Dans énormément de témoignages de personnes homosexuelles, le déni du viol (pas uniquement homosexuel) est clair (cf. à ce sujet, je vous renvoie à cet article très intéressant ; et bien évidemment au code « Viol » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels). Elles ont souvent intégré le discours de leurs violeurs ou des personnes qui les ont fait souffrir : « Ce qui est arrivé, oublie-le. Je ne tiens pas à ce que cela se sache et encore moins à ce que tu le prennes comme la naissance d’un amour véritable. Vous êtes ‘toutes’ les mêmes. » (un ex-amant parlant à Berthrand Nguyen Matoko du viol qu’ils se sont fait subir, dans l’autobiographie de ce dernier, Le Flamant noir (2004), p. 72) ; « Simplement la souffrance est totalitaire : tout ce qui n’entre pas dans son système, elle le fait disparaître. » (Eddy Bellegueule dans le roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, p. 13) ; « La masturbation paraît bénigne quand se posent des problèmes de viols et de relations homosexuelles. Sur ce point, c’est l’omerta, la loi du silence. » (Père Jean-Philippe Chauveau à propos du milieu carcéral, dans son autobiographie Que celui qui n’a jamais péché… (2012), p. 289) ; etc.
Elles reprennent à leur compte et intériorisent le diktat social de l’enfouissement de leur blessure. « Même lorsqu’à la fin j’eus mal, je n’ai rien dit, comme si j’avais déjà compris que tout cela devait rester secret. (Cette chose qui n’avait pas de nom.) » (Christophe Tison, Il m’aimait (2004), p. 14) ; « Il ne faut pas punir J. » (Gilles justifiant son violeur, dans l’essai Le Viol au masculin (1988) de Daniel Welzer-Lang, op. cit., p. 177) ; « Je ne jugeais pas ce comportement abominable. […] Ce secret m’accompagna pendant longtemps. Ce qu’il y avait de merveilleux dans celui-ci, c’était ces moments de plaisir charnel qui se liaient facilement au travail qui lui avait été confié. » (Berthrand Nguyen Matoko, parlant d’un viol qu’il a subi, dans son autobiographie Le Flamant noir (2004), p. 36) ; « Cette expérience m’était à tel point incroyable que, je préférais me taire, craignant sans doute de passer pour un être anormal et déséquilibré. Mais rien ne pouvait jamais m’ôter l’absolue certitude, que je n’avais pas rêvé ni été victime d’une hallucination. J’étais la victime et le témoin, c’est sûr, la cible d’un amour impossible. » (idem, p. 70) ; « J’étais très naïf et idiot, m’attachant à l’argent, et à une sorte de défi qui m’empêchait de dénoncer ma propre honte. » (Berthrand Nguyen Matoko par rapport au cercle vicieux de la prostitution, op. cit., pp. 113-114) ; « J’ai continué à participer aux réunions du groupe de parole d’hommes de Lyon. […] À plusieurs reprises, certains ont essayé de faire naître un débat sur le viol dans nos réunions. À chaque fois, les échanges se centrèrent autour du viol symbolique, du corps imaginaire… Les hommes ne parlaient pas d’eux, mais dissertaient sur le concept de viol. » (Daniel Welzer-Lang, Le Viol au masculin (1988), p. 184) ; « Le viol est une affaire d’hommes contre les femmes ? La discussion sur le viol est difficile chez les hommes, la prescription de rôles tendant à faire apparaître un discours où le corps est absent, une expression désincarnée. » (idem, p. 188) ; « Patrick m’a dit, en entretien, qu’il a déjà été violé par un homme, mais je ne me reconnais pas le droit de le dire. Dépositaire de secrets en tant qu’ethnographe, ce n’est pas la première fois que je vis cette situation. » (idem, p. 185) ; « Curieusement, chez les hommes du stage d’été, notamment chez les hommes se déclarant homosexuels exclusifs, seul un homme mentionnera le désir homosexuel comme une des causes possibles de ces agressions. » (idem, pp. 178-179) ; « La majorité d’entre nous a déjà subi des discriminations. Dans tous les pays d’Europe la loi interdit les discriminations liées à l’orientation sexuelle. Dans ce cas, pourquoi aussi peu de victimes se défendent-elles ? » (Peter Gehardt, ironique, dans son documentaire « Homo et alors ?!? », 2015) ; etc.
Lors de son concert au Sentier des Halles le 20 novembre 2011, le chanteur Hervé Nahel fait allusion à « ce silence qui pèse trop lourd depuis l’enfance ». Pendant l’interview publique que j’ai soumise à l’écrivain Jean-Claude Janvier-Modeste aux Troisièmes Rencontres Culturelles de Tjenbé Rèd le 11 octobre 2011 au Théâtre du Temps à Paris, l’auteur a nié catégoriquement une quelconque influence des trois viols pédophiles qu’il a vécus pendant son enfance sur son homosexualité d’adulte. Hallucinant.

B.D. « Kang » de Copi
Elles se forcent à banaliser et à taire le viol qu’elles ont subi, ou le fantasme de viol qu’elles ressentent en elles-mêmes. « On n’a jamais vu une femme en violer une autre. » (Paula Dumont, La Vie dure : Éducation sentimentale d’une lesbienne (2010), p. 108) ; « Je n’aurai jamais été fidèle, même si, quand je faisais l’amour, j’étais tout donné à la personne. Je ne me suis jamais attaché. Et je n’en ai jamais souffert. » (le papy fermier homosexuel dans le documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz) ; « J’ai déjà été violé trois fois, sans violences particulières, c’est pas forcément important… tu acceptes… […] J’en n’ai jamais parlé, même pas à L. (X années de vie commune). C’est pas banal. Il y a de la honte. C’est pas loin de la mort. C’était pas spécialement désagréable, en dehors de l’image que l’on a de soi. […] J’ai pas l’impression de m’être fait violer, ça aurait pu dériver… Il y avait un potentiel de violence possible, c’était une époque où moi, j’étais proche de la mort. […] C’est pas loin de nous, le viol. Le viol, c’est la violence et le reste. Chaque rapport est plus ou moins bien négocié, marqué par ces histoires-là. Ainsi, lors de… [un voyage avec des amis communs] … c’était une histoire en partie homosexuelle. Eh bien moi, je veux pas… et c’est en lien. » (Richard, homme homosexuel violé, cité dans l’essai Le Viol au masculin (1988) de Daniel Welzer-Lang, pp. 185-186) ; « Malgré les problèmes qu’elle m’a posés, je crois que mon orientation sexuelle serait la même, qu’il y ait eu abus sexuel ou non. » (Justin, 34 ans, homosexuel, abusé dès l’âge de 4 ans par son père, son oncle, et son frère aîné, cité dans l’essai Ça arrive aussi aux garçons (1997) de Michel Dorais, p. 252) ; « Ils sont revenus. Ils appréciaient la quiétude du lieu où ils étaient assurés de me trouver sans prendre le risque d’être surpris par la surveillante. Ils m’y attendaient chaque jour. Chaque jour je revenais, comme un rendez-vous que nous aurions fixé, un contrat silencieux. […] Uniquement cette idée : ici, personne ne nous verrait, personne ne saurait. […] Dans le couloir, je les entendais s’approcher, comme les chiens qui peuvent reconnaître les pas de leur maître parmi mille autres, à des distances à peine imaginables pour un être humain. » (Eddy Bellegueule parlant de ses deux agresseurs au collège, dans le roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, p. 38) ; « Le grand roux et l’autre au dos voûté me mettent un ultime coup. Ils partaient subitement. Aussitôt ils parlaient d’autre chose. » (idem, p. 41) ; « Je ne sais pas si les garçons du couloir auraient qualifié leur comportement de violent. » (idem, p. 42) ; « J’étais un efféminé qui méritait les coups. Je ne voulais pas que la surveillante me retrouve dans le même couloir, recroquevillé, le regard implorant – même si, je l’ai dit, la plupart du temps j’essayais, sans toujours y parvenir, de garder le sourire quand ils me frappaient. » (idem, p. 88) ; « J’ai senti son sexe chaud contre mes fesses, puis en moi. Il me donnait des indications ‘Écarte’, ‘Lève un peu ton cul’. J’obéissais à toutes ses exigences avec cette impression de réaliser et de devenir enfin ce que j’étais. » (Eddy Bellegueule simulant des films pornos avec ses cousins dans un hangar, idem, pp. 152-153) ; « Ce n’est pas un trouble. C’est une construction singulière de l’identité. » (Dr Agnès Condat, pendant le débat « Transgenres, la fin d’un tabou ? » diffusé sur la chaîne France 2 le 22 novembre 2017) ; etc.
Dans le film biographique « Girl » (2018) de Lukas Dhont, Lara/Victor, garçon trans M to F de 16 ans, ne semble avoir aucune intériorité : il a du mal à parler, est très introverti, ne peut pas dire ce qu’il ressent, n’a aucun avis sur rien. Il répète sans arrêt « Je ne sais pas ». Quand il est triste ou bien souffre, il a du mal à pleurer (« Je ne sais pas pourquoi je pleure. Les hormones… »), à extérioriser ses émotions ; quand il sourit, c’est très crispé. Il semble être « sans-désir », et ne sait pas qui l’attire amoureusement (a-t-il une libido ? On ne dirait pas). Son psychologue, en entretiens réguliers, essaie de le faire parler, et fait le constat qu’à tous les patients transgenres qu’il suit, il doit « tirer les vers du nez » tellement c’est difficile d’en tirer quelque chose et tellement la souffrance n’arrive pas à sortir. Il finit même par tenter de se couper le sexe aux ciseaux. Et le pire, c’est qu’il finit par déclarer à son papa bobo (Mathias) que ce qu’il vit, ce n’est « que du bonheur ». Il présente l’opération de réassignation de sexe comme la panacée. Il ne supporte pas que son propre père s’inquiète pour lui et lui pose des questions, lui demande comment ça va. Ce dernier finit par s’énerver de la censure filiale : « Je te demande comment ça va parce que tu ne me dis jamais rien ! ». À un moment donné, à une soirée « entre filles », il est encerclé par ses camarades féminines danseuses, chapeautées par la cruelle Loïs, qui le somment de se déshabiller devant elles et de leur montrer son sexe : « Montre ! Montre ! Montre ! », dans une scène d’une grande humiliation. Il ne parlera pas de ce viol collectif à son père par la suite, et s’enfermera dans le déni jusqu’au bout.
Le viol, en brisant certaines personnes homosexuelles, leur donne paradoxalement une impression d’unité. C’est le déni qui fournit temporairement l’illusion que les morceaux sont recollés. « Yves explique que lui aussi a été violé. Il l’a accepté en tant ‘qu’acte qui m’ouvrait des portes’. […] Pour Yves, c’est à ‘une époque innocente, une ouverture’, dont il a tiré profit par la suite. ‘Je découvrais le monde sexuel, je ne m’y attendais pas, j’étais pas éveillé : 14 ans, une situation où j’étais en dépendance, en voyage, l’autre avait la bourse…[…] quelqu’un du spectacle, il avait une aura, il existait une fascination, une séduction… […] Il n’y a pas eu de consentement, mais ça a été pour moi un rite initiatique. Le mec avec qui j’ai eu des soucis, je le considérais un peu comme mon père…’ » (Yves, homme homosexuel violé, cité dans l’essai Le Viol au masculin (1988) de Daniel Welzer-Lang, pp. 185-186)
Le déni du viol peut laisser place à la rêverie béate : « Nous fîmes un détour par le collège de son enfance. […] Nous fûmes reçus par le proviseur qui se souvenait de Didier et qui nous permit de visiter l’internat. Je vis qu’il voulait surtout me montrer le dortoir. Des dizaines de petits lits blancs étaient alignés dans une immense salle sombre. Il me désigna le sien puis la petite chambre du surveillant, près de la porte. Il fit des allusions à ce qui se passait la nuit dans ces dortoirs. Je compris alors, sans qu’il le dise clairement, qu’il avait subi ici la même chose que moi. Mais étrangement, il était enjoué et avait l’air de trouver que c’était un bon souvenir. » (Christophe Tison parlant de Didier, l’homme qui a abusé de lui, dans son autobiographie Il m’aimait (2004), p. 59)
Si la réflexion sur le désir homosexuel est souvent empêchée, celle sur les liens de coïncidence entre le désir homosexuel et le viol l’est encore plus ! : « L’abus sexuel n’a rien à voir avec les identités ou les orientations sexuelles, affirmées ou présumées, des protagonistes, mais plutôt avec le contexte de relation. » (Michel Dorais, Ça arrive aussi aux garçons (1997), p. 19) ; « Les malaises entourant les abus sexuels au masculin ne sont pas pour amenuiser la confusion des garçons. Certains n’arrivent que difficilement à dissocier abus sexuel et initiation (homo)sexuelle. Un garçon qui se perçoit comme étant d’orientation homosexuelle ou bisexuelle a donc plus de difficulté encore à divulguer les abus qu’il a subis. D’une part, parce qu’il craindra qu’on ne lui reproche d’avoir recherché ces contacts, puisque les relations entre hommes, il est censé aimer ça ; d’autre part, parce qu’il craindra d’accabler injustement un aîné qui l’a, d’une certaine façon, initié sexuellement et qui lui a permis, le cas échéant, de découvrir la ‘vraie nature’ de son orientation sexuelle. » (Michel Dorais, Ça arrive aussi aux garçons (1997), pp. 145-146) ; « Comment faut-il prendre les livres de Marcela Iacub ? […] Le pas vers la banalisation du viol est vite franchi en avançant que les victimes dramatisent de manière exagérée le vécu. » (Rennie Yotova, Écrire le viol (2007), p. 88) ; etc. Par exemple, dans l’essai Se dire lesbienne : Vie de couple, sexualité, représentation de soi (2010), Natacha Chetcuti reste très allusive quant à l’« association d’un éventuel désir homosexuel avec les violences sexuelles subies dans l’enfance et dans l’adolescence. » (p. 69)
b) Le silence « innocent » et béat :
Il est énormément question du secret dans les discours des personnes homosexuelles ou des personnalités auxquelles elles s’identifient : « On me reproche toujours mon prétendu silence, mais le silence est ma nature profonde. » (Mylène Farmer dans la revue Paris Match, n°2741, le 6 décembre 2001) Je vous renvoie par exemple au documentaire « Le Silence de Lesbos » (1996) de Guylaine Guidez, à l’album « La Pudeur » d’Oshen, et à cette soudaine mode bobo pour l’éloge de la pudeur.
Elles cultivent le mystère autour d’elles : « Ne serait-il pas temps que je cesse aussi de parler ? » (la phrase de conclusion d’un exposé de Michel Foucault dans son essai Dits et écrits I, 1954-1988 (2001), p. 996) ; « On peut affronter un pouvoir par attaque ou par défense : mais le retrait, c’est ce qu’il y a de moins assimilable par une société. » (Roland Barthes, Grain de voix, 1981) ; « Il ne faut pas essayer de comprendre. » (Barbie Breakout, un homme dragqueen interviewé sur le succès d’Helen Fisher auprès du public gay, dans le documentaire « Somewhere Over The Rainbow » (2014) de Birgit Herdlitschke, diffusé en juillet 2014 sur la chaîne Arte) ; « Je ne pense pas que Copi remue seulement de la boue, car il exprime des pensées profondes sur l’amour, la mort et les limites du désir. […] Il fait entendre une voix plus profonde. » (Alfredo Arias dans l’article « Alfredo Arias sur les escaliers du désir » de Marion Thébaud, dans le journal Le Figaro, publié le 8 janvier 1990) ; « Y’a pas de secret. Personne ne comprend. » (Isaac, femme F to M qui s’appelle initialement Taïla, parlant de la transidentité, dans l’émission Zone interdite spéciale « Être fille ou garçon, le dilemme des transgenres » diffusée le 12 novembre 2017 sur la chaîne M6) ; « J’aime pas dire que je suis trans. Ça ne regarde personne. » (Laura, homme M to F, idem) ; etc.
Par exemple, Roland Barthes, justement, définit lui-même son œuvre comme une « feinte indécidable » (Roland Barthes, « Lucidité », dans son essai Roland Barthes par Roland Barthes (1975), p. 111). Sa démarche littéraire consiste à « s’avancer masqué en montrant son masque du doigt. » (idem, p. 61) Le chanteur Étienne Daho reprend exactement la même image dans sa chanson « Retour à toi » en s’identifiant à cet « étranger qui avance masqué en attendant sa chance ». Le réalisateur italien Pier Paolo Pasolini qualifie son cinéma de « mystère médiéval insoluble ». Quand on lui demande des détails sur son passé, le poète argentin Néstor Perlongher répond ironiquement qu’il ne « veut pas révéler de secrets » (Néstor Perlongher, « 69 preguntas A Néstor Perlongher », cité dans le recueil d’articles Prosa Plebeya (1997), p. 20).
Le silence est présenté par beaucoup de personnes homosexuelles comme quelque chose de positif, de relaxant, voire de courageux. Il ressemble en réalité à une anesthésie, à une fausse paix, à une autocensure, à la méthode Coué (le « Je vais bien, tout va bien » du dépressif ou du pervers), à l’infantilisation : « Tout va bien se passer. » (Caroline Fourest par rapport au « mariage gay », dans l’émission Mots croisés d’Yves Calvi, sur le thème « Homos, mariés et parents ? », diffusée sur la chaîne France 2 le 17 septembre 2012) ; « J’aime la vie avec passion, j’en ai saisi toutes les opportunités au moment où elles se présentaient, je ne regrette rien de ce que j’ai vécu et j’espère avoir encore de belles années devant moi. » (cf. les dernières lignes de l’introduction de l’autobiographie Mauvais genre (2009) de Paula Dumont, p. 12) ; « Il me rendait triste. Jamais j’ai été aussi triste de ma vie. Et paradoxalement, j’ai jamais été aussi heureux de ma vie. » (André par rapport à son amant Laurent, avec qui il a vécu pendant 10 ans, dans le docu-fiction « Le Deuxième Commencement » (2012) d’André Schneider) ; « On a marché. On ne s’est pas dit grand-chose. C’était bien. Merveilleusement bien. » (Abdellah Taïa, Une Mélancolie arabe (2008), p. 48) ; « Tu m’abandonnais. Tu partais. Dix minutes après, je courais après toi dans les rues du 18e arrondissement. Rue de Clignancourt. Boulevard de Barbès. Rue Doudeauville. Rue… Et le petit pont. Et le petit banc. Tu étais là. Tu m’attendais là. Assis sur le petit banc. Je te rejoignais. Et on regardait ensemble les trains de la gare du Nord passer. Dans le silence. » (Abdellah Taïa écrivant à son amant Slimane, dans son autobiographie Une Mélancolie arabe (2008), p. 120) ; « Tu es l’homme le plus compliqué de la terre, tu le sais bien. » (Laurent s’adressant à son amant André pour le faire taire, dans le docu-fiction « Le Deuxième Commencement » (2012) d’André Schneider) ; « Bon, évitons de la jouer mélodramatique. » (André parlant à Laurent, et s’auto-censurant, idem) ; « Ce qui vous arrive n’arrive pas. Ce qui se passe n’est pas en train de se passer. » (Celia, la conservatrice de musées séduisant Bertrand, dans le docu-fiction « Le Dos rouge » (2015) d’Antoine Barraud) ; etc. Par exemple, dans le one-woman-show Mâle Matériau (2014) d’Isabelle Côte Willems, la comédienne transgenre F to M achève son spectacle barbu et en se mettant des boucles d’oreilles de diva, avec un « Et alors ? » qui lui fait quitter la salle. Fin en jus de boudin.
Certaines personnes homosexuelles confèrent au déni du viol ou à leur silence vis à vis de leur souffrance une valeur presque sacrée : « Je vais de métamorphoses en métamorphoses, de masques en masques, avec l’arrière-pensée d’épuiser tous mes doubles jusqu’à me rencontrer un jour seul, face-à-face, démasqué, devant mon âme éternelle. » (François Augiéras, Une Adolescence au temps du Maréchal et de multiples aventures, 1968) ; « La poésie n’est pas communication… Le poète fait des vers qui ne se comprennent pas. » (cf. l’article « Poesía Y Éxtasis » (1990) de Néstor Perlongher, dans le recueil d’articles Prosa Plebeya (1997) de Néstor Perlongher, p. 149) ; « Ici les femmes sont debout, parfois perdues, bousculées par la vie, mais toujours au cœur des films. Ces lesbiennes existent pour et par elles-mêmes. Elles ne servent pas de faire-valoir à un autre personnage, elles ne questionnent pas leur orientation sexuelle, elles sont femmes, elles sont lesbiennes mais ça ne suffit pas à faire un film, et c’est cet au-delà, ce plus, cet autre chose qui m’a plu. » (Marie Labory dans le catalogue du 19e Festival Chéries-Chéris au Forum des Images de Paris, en octobre 2013, p. 10) ; « Le clown, il peut tout être. Le clown, il est au-delà. » (la femme transsexuelle F to M interviewée dans le documentaire « Le Genre qui doute » (2011) de Julie Carlier) ; etc.
Beaucoup de critiques rentrent dans leur jeu en nous faisant croire au mythe du « Génie homosexuel » irrationnel, dont le silence est « génial » : cf. l’essai Ojo De Loca No Se Equivoca (2002) de Leopoldo Alas. « C’est sûr, il existe un Mystère Farmer… » (cf. la phrase de conclusion de la biographie de Mathias Goudeau Mylène Farmer, le Mystère (2003), p. 5) ; « Il n’y a pas de limites dans ce que Waters peut filmer. » (Didier Roth-Bettoni, L’Homosexualité au cinéma (2007), p. 303) ; « On ne sait pas si le groupe le plus célèbre de l’histoire de la pop aurait atteint le succès si un regard homosexuel ne s’était pas posé sur lui. » (cf. l’article « Brian Epstein » à propos du manager homosexuel des Beatles, dans l’essai Para Enterdernos (1999) d’Alberto Mira, p. 265) ; « Sans égard aucun pour l’authenticité, pour la vérité ou une quelconque intériorité, Warhol est l’artiste du pur invisible. » (cf. l’article « Andy Warhol » d’Élisabeth Lebovici, dans le Dictionnaire des Cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, p. 495) ; « Un film d’animation qui oscille entre une histoire concrète et l’expression abstraite d’émotions complexes mises en images. Car parfois, face à de telles préoccupations, les mots ne suffisent plus. » (cf. le descriptif du court-métrage « Casse-Tête » (2009) de Dana Bubakova, dans la brochure du 16ème Festival Chéries/Chéris au Forum des Images de Paris, du 12 au 21 novembre 2010) ; etc.
Par exemple, le film « Suddenly Last Summer » (« Soudain l’été dernier », 1960) de Joseph Mankiewicz est qualifié par la revue Variety comme « le film le plus bizarre qui ait jamais été fait par un studio américain ». Dans le reportage « Vies et morts de Andy Warhol » (2005) de Jean-Michel Vecchiet, Andy Warhol est même comparé au Christ. Dans son essai Folles de France (2008), Jean-Yves Le Talec présente le camp comme une « énergie » incroyable, une « force » inintelligible (p. 120). Dans l’émission « Autour de Jean Cocteau » (2004), Noël Simsolo et Dominique Païni se mettent d’accord pour penser que le film « Les Enfants terribles » (1949) de Jean-Pierre Melville est un « mystère » : ils font de Jean Cocteau un ange, un prophète dont on ne peut pas comprendre le message « transcendant ». Tamara Kamenszain dit du poète homosexuel Néstor Perlongher qu’« il incarne un point d’interrogation auquel on ne peut répondre », un mystère complet (cf. l’article Poemas Completos (1997) de Tamara Kamenszain, dans le recueil d’articles Poemas Completos (1997) de Néstor Perlongher, p. 367).
Le silence sur l’homosexualité prend la forme du soi-disant universalisme souriant entre hétérosexualité et homosexualité (cf. l’autobiographie Everybody’s Autobiography (1937) de Gertrude Stein), universalisme particulièrement prôné dans les films actuels venus des États-Unis. Sur la base du film « The Stepford Wives » (« Et l’homme créa la femme », 2004) de Frank Oz, une amie intellectuelle, fine analyste de la société nord-américaine actuelle, me décrivait avec grande justesse la censure imposée par les gens « hétéros gays friendly » à l’encontre des personnes homosexuelles : « Les Américains n’aiment pas les homos qui souffrent ; un homo ne peut être que ‘gay’ ( = gai, joyeux, de bonne humeur) – c’est d’ailleurs probablement pour cette raison que le mot a été choisi pour signifier homosexuel. C’est à ce niveau que se situe un autre basculement dans une homophobie aussi insidieuse que réelle : comme il symbolise la vie sexuelle rêvée des Américains (libre, volage, préoccupé de son look, de sa forme physique et de son hygiène, amusant, frivole, riche), l’homo n’a pas droit à la souffrance. Elle lui est interdite. C’est que, si la personne homosexuelle souffre, c’est tout le modèle de pensée américain libertin-libertaire qui s’effondre. »
En plus de la culture du mystère, c’est surtout la bonne intention sentimentaliste (« l’amour », « le désir d’enfant », « la sincérité », « l’optimisme » et « le refus de la culpabilité) qui vont servir de censure. Par exemple, dans le documentaire « Deux hommes et un couffin » de l’émission 13h15 le dimanche diffusé sur la chaîne France 2 le dimanche 26 juillet 2015, Bruno et Christophe, en « couple », se sont lancés dans l’achat d’un enfant avec une mère porteuse aux Etats-Unis, mais se rendent compte que l’opération (qui leur coûtera 100 000 euros au total) s’avère onéreuse, complexe et surtout violente. À un moment, les protagonistes de cette farce sérieuse craquent, ans s’avouer les véritables raisons du craquage. « Pourquoi tu pleures Christophe ? » demande la journaliste en voix-off. Christophe se force à cacher son véritable remord pour le travestir en optimisme forcé : « Parce que je suis très heureux. Et que dans notre pays, on ne nous laisse pas vivre cette joie-là. » (Christophe) Plus tard, la culpabilité revient et est refoulée tout aussi vite qu’elle fut lancinante : « On n’aurait pas dû. » dit Bruno ; « C’est fait. » lui rétorque sèchement son amant Christophe.
Concernant la transsexualité et la réalité de la « réassignation de sexe », on a à faire à une véritable propagande du bonheur : « Cette transition est la source d’un vrai bonheur. » (la voix-off par rapport à Jackie, homme M to F qui s’appelle initialement Jacques, dans l’émission Zone interdite spéciale « Être fille ou garçon, le dilemme des transgenres » diffusée le 12 novembre 2017 sur la chaîne M6) Il y a un déni total des suicides, de l’isolement des personnes transgenres, des risques d’embolies, de cancers, de dépendance aux drogues, de l’exploitation et de la corruption, de la prostitution, des ratages d’opérations. La haine du corps, les problèmes du passé, les viols qui motivent l’opération, sont cachés. Les personnes transgenres deviennent les consommateurs de leur propre mal-être, les dindons de la farce, la manne pour les coiffeurs et les chirurgiens : on voit tous les professionnels exploiter leur dépression. Les transgenres sont entourés de fausse amitié. Au lieu du discours « L’important c’est ton bonheur et que tu trouves l’amour » dirigé aux personnes homosexuelles, avec les transgenres, on leur dit « L’important, c’est que tu te sentes bien, que tu sois bien dans ta tête et dans ton corps/ta peau. »
c) Le silence effrayant, amusé, ou basé sur le paradoxe :

Film « The Rocky Horror Picture Show » de Jim Sharman
Je vous renvoie au documentaire « Sex Change : Shock ! Horror ! Probe ! » (1989) de Jane Jackson, au livre de photographies de Christian Girard (avec notamment une photo « Attention chien méchant »), etc.
Parfois, les personnes homosexuelles se divertissent de leurs messes basses, en invoquant l’excuse de l’humour cynique queer : « Si toutes les filles qui ont été abusées sexuellement dans leur enfance devenaient lesbiennes, ce serait vraiment la fête pour moi ! » (l’humoriste lesbienne Océane Rose-Marie, dans l’émission Dans les yeux d’Olivier, « Les Femmes entre elles », d’Olivier Delacroix et Mathieu Duboscq, traitant de l’homosexualité féminine et diffusée le 12 avril 2011 sur la chaîne France 2) ; « Je ne pense pas qu’on puisse comprendre la sexualité. De quoi s’agit-il ? Cela demeure un mystère, et c’est pourquoi c’est excitant. » (Robert Mapplethorpe cité dans l’essai Dictionnaire gay (1994) de Lionel Povert, p. 322) ; « Lèche-moi tranquille » (cf. un jeu de mots potache dans le documentaire « Des Filles entre elles » (2010) de Jeanne Broyon et Anne Gintzburger) ; « Je veux scandaliser les purs, les petits enfants, les vieillards par ma nudité, ma voix rauque, le réflexe évident du désir. » (Claude Cahun, Aveux non avenus, 1930) ; « Choquant ? Pour les homophobes. » (cf. une affiche de Journée Mondiale contre l’Homophobie, en France) ; « On a passé un temps à convaincre les gens de ne pas chercher de messages dans nos chansons. On n’a rien à dire. C’est une chanson idiote qui est faite pour s’amuser. On cherchait un truc nouveau et amusant. On venait de faire ‘YMCA’ et ‘Macho Man’. Et on voulait se marrer à faire autre chose. Et on s’est dit ‘Pourquoi pas la marine ?’. Parce que l’armée nous aurait botté le cul ! (rires) » (les Village People à propos de leur chanson « In The Navy », dans le documentaire « Sex’n’Pop, Part IV » (2004) de Christian Bettges) ; « Le ‘camp’ est un esthétisme qui ne se prend en aucun cas pour une épiphanie de la vérité. » (cf. l’article « Camp, homosexualité, cinéma » de Patrick Lavallé, dans l’essai CinémAction : Cinémas homosexuels (1983), p. 14) ; « La transgression, c’est toujours quelque chose qui m’intéresse. Dans la vie. Dans mon travail. Et c’est quelque chose que j’aime dans la culture gay en général. C’est de vraiment twister les choses, de les rendre différentes. Et en fin de compte qu’arriver à coder quelque chose, je trouve que c’est assez drôle. » (Michel Gaubert interviewé dans le documentaire « Somewhere Over The Rainbow » (2014) de Birgit Herdlitschke, diffusé en juillet 2014 sur la chaîne Arte) ; etc.
Par exemple, dans l’essai L’Homosexualité au cinéma (2007) de Didier Roth-Bettoni, à chaque fois qu’il est fait référence au camp ou au queer, le discours s’oriente vers une hilarité forcée et qui n’interprète rien. L’autocensure homosexuelle vient fréquemment dans les écrits par le recours à la satire (cf. Gertrude Stein, Djuna Barnes, Michèle Causse, etc.). Dans son essai Para Enterdernos (1999), Alberto Mira tourne en ridicule le cliché qui associe désir homosexuel et nazisme pour ne pas l’analyser : « En plus, tout le monde sait que les nazis étaient homosexuels, n’est-ce pas ? » (p. 116)
La censure du viol se présente de temps à autre sous le masque du jeu relativiste : « Mes mentors me firent découvrir une réalité nouvelle, […] une conception ludique du sexe et, en général, de la vie. » (cf. l’article « Misión Cumplida » de Leopoldo Alas, dans l’essai Primera Plana (2007) de Juan A. Herrero Brasas, p. 151) ; « Un film ou une revue pornographiques n’ont jamais tué personne. » (Senta Berger dans le documentaire « 68, Faites l’amour et recommencez ! » (2008) de Sabine Stadtmueller) ; etc.
Le déni d’actes prend alors la forme de la confidentialité ludique ! Par exemple, dans les flyer de certains speed-dating lesbiens (= rendez-vous galants « improvisés »), organisés par le site www.lesbianspeedating.com, le ton est donné : la nouvelle bourgeoisie se retrouve dans un secret très bien gardé : « Lesbian Speed Dating : Rendez-vous chic pour femmes urbaines. Speed dating réservé exclusivement aux femmes. Discrétion assurée. L’endroit sera divulgué 24 h avant l’événement… »
L’« humour » en question sert de cache au viol ou au libertinage, comme une défense (cf. je vous renvoie au code « Humour-poignard » dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels) : « Ce génie pour la découverte de formes absurdes, tragi-comiques de l’art théâtral fonctionnait comme une sorte de baume qui cicatrisait les blessures causées par ces rencontres violentes. » (Alfredo Arias, Folies-Fantômes (1997), p. 16) ; « J’ai été victime d’un viol à Marseille, tard dans la nuit. Je n’aime pas le simplisme d’un certain féminisme qui déclare que tout viol est une chose atterrante… Je serai même assez affreux pour dire que je l’ai bien vécu… C’est-à-dire que j’ai compris de quelle misère était fait cet Arabe qui m’a coincé dans un coin. C’est comme si c’était une mauvaise drague qui avait mal tourné. Je n’ai pas porté plainte contre lui. Non, j’ai causé avec lui. On est même allé boire un verre après (rire)… J’ai offert une bière à mon violeur. » (Gilles, homme homosexuel violé, cité dans l’essai Le Viol au masculin (1988) de Daniel Welzer-Lang, pp. 182-183) ; « Mais maintenant que tu as parlé… je me suis retrouvé dans une situation un peu bizarre, mais que je ne pourrais pas taxer de viol. Je me suis réveillé en train de me faire masturber par un mec alors que je dormais… Je l’ai envoyé chier et ça s’est arrêté là. C’est marrant maintenant… Je n’aurais pas mis ça, à l’époque, dans le cadre du viol… et pourtant c’est de cet ordre-là. » (un témoin homosexuel cité dans l’essai Le Viol au masculin (1988) de Daniel Welzer-Lang, p. 201) ; etc.
Puis peu à peu, la drôlerie du déni laisse place à l’agacement et à la menace ludique. Beaucoup d’auteurs homosexuels décident d’intimider l’enquêteur indiscret de leur souffrance : « On ne devrait pas prendre au pied de la lettre les détails qu’il nous offre sur sa vie et les situations qu’il décrits dans ses romans ‘autobiographiques’ : en général ce ne sont que les preuves d’une volonté de se créer une image qui change selon les époques et ses intérêts personnels. […] Quasiment rien chez Retana n’est symbolique. » (Alberto Mira au sujet de l’arrogant dandy Álvaro Retana, dans son essai De Sodoma A Chueca (2004), pp. 156-158)
Manuel Puig, le romancier argentin, refuse de prendre connaissance du contenu du livre de Susan Sontag sur le camp : « C’est comme si j’en avais peur, ou peur de prendre conscience de certaines choses dont j’ai seulement l’intuition, ou peur de ne pas être d’accord et de sentir qu’elle tripote des choses que j’aime » confiera-t-il à Emir Rodríguez Monegal (cf. l’article « El Folletín Rescatado, Entrevista A Manuel Puig » (1972), dans Revista De La Universidad De México, vol. XXVII, n°2, octobre 1975, pp. 25-35)
Dès le début de la pièce L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer (1971) de Copi (mise en scène par Cyrille Laïk et Suzanne Llabador à l’Auditorium du Conservatoire du 19e arrondissement Jacques Ibert le mardi 9 mars 2010), la comédienne qui jouera Irina nous prévient que nous allons assister à un spectacle qui n’est qu’une « énorme blague ».
De la part de nombreux créateurs homosexuels, on a droit à la même injonction : « Circulez ! Y’a rien à voir ! » : « À la fin de ce film, je pense que vous n’aurez rien à en dire. Je crois que ça se passera de commentaires… » (cf. les mots prononcés par la compagnie italienne Motus juste avant la projection du film « Salò O Le 120 Giornate Di Sodoma », « Salò ou les 120 journées de Sodome » (1975) de Pier Paolo Pasolini, et entendus à Rennes au cinéma le TNB en avril 2004) ; « Le monde se fissure, et le mystère s’épaissit… » (cf. la phrase de conclusion du documentaire « Une Vie ordinaire ou mes questions sur l’homosexualité » (2002) de Serge Moati) ; « Si le film que vous allez voir vous paraît énigmatique et incohérent, il en est de même de la vie. Il est répétitif comme la vie, sujet à de multiples interprétations. L’auteur déclare n’avoir pas voulu jouer avec les symboles, du moins sciemment. Peut-être que l’explication de ‘L’Ange exterminateur’ est que, rationnellement, il n’y en a pas. » (cf. l’avertissement écrit par Luis Buñuel juste avant la première projection de son film « L’Ange exterminateur » au Mexique en 1962, cité dans le mémoire La Imagen-Pulsión En ‘El Ángel Exterminador’ (2002-2004) de Caroline Chétail, p. 5) ; « Je déteste l’introspection. Pourquoi jeter en pâture ce qui est au tréfonds de nous ? Cela tient généralement de la poubelle. La forme dramatique se suffit à elle-même. […] Mon spectacle ne propose aucun symbole érotique. » (Copi par rapport à sa pièce Frigo, dans l’article « Au Festival d’Automne : Copi sur le ring » publié dans le journal Le Figaro du 8 octobre 1983) ; etc.
Par exemple, pour leur exposition Un Monde parfait (2006), les photographes Pierre et Gilles avaient installé un avertissement sur la porte d’entrée de la Galerie Gérard de Noirmont qui indiquait ceci : « Attention ! Des œuvres peuvent choquer un public sensible ». Juste avant la projection du film « Trannymals Go To Court » (2007) de Dylan Vade, Jihan Ferjan demande aux spectateurs de ne pas remettre en question l’« identité transsexuelle ».
Comme elles constatent que leur déni terrorisant attise encore plus la curiosité de la foule, certaines personnes homosexuelles trouvent une autre stratégie pour faire oublier leur viol ou leur souffrance : elles font preuve de chantage aux sentiments, jouent la carte du cynisme et de l’indifférence à elles-mêmes, surjouent le débordement d’émotions. « Je voudrais que vous me fassiez un petit peu confiance quand je dis que je n’attache pas à ce que je dis ou à ce que je fais une importance très grande. » (Michel Foucault, « Radioscopie de Michel Foucault », entretien avec J. Chancel en 1975, dans l’essai Dits et écrits I, 1954-1988 (2001), p. 1668)
L’autre stratégie que mettent en place certaines personnes homosexuelles pour ne pas avoir à révéler leur (fantasme de) viol, c’est celui du paradoxe : « Ce qui emporte tout, c’est la saveur du paradoxe. » (Roland Barthes dans son essai Roland Barthes par Roland Barthes (1975), p. 93) ; « Si, plutôt que d’admettre avec complaisance sa citoyenneté dans la doxa, la pensée pratiquait méchamment le biais du paradoxe ? » (Michel Foucault, Dits et écrits I, 1954-1988 (2001), p. 956) ; « Manuel Puig joue avec toutes les formes d’inversions et affirme par la négation. » (Lionel Souquet, Le Kitsch de Manuel Puig (1996), p. 88) ; « Est-ce que la contradiction est une valeur artistique, un espace ? » (le journaliste homosexuel posant des questions creuses et peu assurées à Bertrand Bonello, dans le docu-fiction « Le Dos rouge » (2015) d’Antoine Barraud) ; etc. Dans son article « Poesía Y Paradoja » sur l’essai Historia De La Literatura Gay (1998), Gregory Woods sacralise la figure des poètes gay qui « usent du paradoxe comme d’une arme et d’un bouclier contre un monde qui place l’hétérosexualité comme unique sexualité naturelle et saine. » (p. 389)
Elles disent tout et son contraire pour ne pas avoir à se positionner et à ouvrir la bouche : « Je suis un pessimiste optimiste » (Jean Cocteau cité par l’article « Le Journal de l’inconnu » de Gérard de Cortanze, dans Magazine littéraire, n°423, septembre 2003, p. 55) ; « Je suis un menteur qui dit toujours la vérité. » (toujours Jean Cocteau, cette fois en épigraphe de Portraits Souvenir) ; « Saint Laurent était capable de creuser de la profondeur derrière la couleur des choses, si profond à force d’être superficiel. » (Pierre Bergé à propos de son couple avec Yves Saint Laurent, dans la revue Têtu, n°135, juillet-août 2008, p. 54) ; « L’erreur seule enseigne la vérité. » (Jean Genet, cité dans l’article « Physique de Genet » de Philippe Sollers, sur le Magazine littéraire, n°313, septembre 1993, p. 42) ; « Je ne voulais pas qu’on voie que je venais à peine d’être une nouvelle fois rejeté. Que je m’étais trompé. Je ne voulais pas me donner en spectacle. J’avais envie d’errer, de respirer la nuit seul, de traverser cette ville où, depuis que j’avais quitté le Maroc poursuivant des rêves cinématographiques, je me redécouvrais heureux et triste, debout et à terre. » (Abdellah Taïa, Une Mélancolie arabe (2008), p. 45) ; etc.
Par exemple, le poète espagnol Luis Cernuda pratique l’« affirmation de l’utilité par l’inutilité. » (Armando López Castro, Luis Cernuda En Su Sombra (2003), p. 28) Dans son essai Performance, Género Y Transgénero (2000), Roberto Echavarren tient pour réelle et naturelle « une légèreté de l’esprit qui n’était pas programmée mais qui pourtant se produit grâce à la versatilité des milieux, la technique et l’habitude. Ce qui paraissait auparavant inadmissible et incompréhensible, opaque, acquiert sa propre possibilité et certitude. » (p. 315)
Quelqu’un qui est très fort pour simuler narcissiquement le désintérêt à soi-même, c’est l’acteur bobo Laurent Delpit. Juste avant la projection du docu-fiction « Le Deuxième Commencement » (2012) d’André Schneider lors du 18e Festival Chéries-Chéris d’octobre 2012 au Forum des Images de Paris, il a déclaré que ce film « racontait une histoire toute simple », alors qu’à l’évidence l’idylle amoureuse vécue par les deux protagonistes est super compliquée. Et pendant sa brève interview, il a passé son temps à esquiver les questions, en faisant passer son discours laconique pour de la timidité : « Je ne suis pas certain que mon point de vue soit très utile. »
L’homme paradoxal adore et hait les paradoxes (sinon, il ne serait pas paradoxal !) : « Formations réactives : une doxa (une opinion courante) est posée, insupportable ; pour m’en dégager, je postule un paradoxe ; puis ce paradoxe s’empoisse, devient lui-même concrétion nouvelle, nouvelle doxa, et il me faut aller plus loin vers un nouveau paradoxe. » (Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes (1975), p. 71) ; « Le vrai jeu n’est pas de masquer le sujet, mais de masquer le jeu lui-même. » (idem, p. 127)
d) Le silence impérieux et ennemi de la Vérité :
Bien souvent, après avoir plané, le déni homosexuel se radicalise en ordre. Un certain lobby LGBT isole, particularise, contextualise et personnifie à outrance des faits violents pour empêcher les conclusions gênantes à son sujet. Par exemple, afin de nier le lien de coïncidence entre nazisme et désir homosexuel, est avancé l’argument relativiste du danger de la généralisation : « Tous ces parcours n’en restent pas moins relativement individuels, ou plutôt individualisables. » (cf. l’article « Écrivains et collaboration » d’Emmanuel Pierrat dans le Dictionnaire des Cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, pp.123-124) ; « Tout individu doit jouir de sa vérité, de sa nature, de sa liberté. » (Jean-Louis Bory au micro de Jacques Chancel, dans l’émission Radioscopie sur France Inter, 6 mai 1976) ; etc.
Beaucoup de personnes homosexuelles montrent clairement leur opposition à la Vérité, réalité qu’elles présentent comme un « concept » abstrait et inaccessible… parce qu’au fond elles vivent encore de l’illusion de La posséder et de La garder pour elles : « On ne peut pas être baroque sans tomber dans la spirale de l’interrogation. » (Tamara Kamenszain, Historias De Amor (1995), p. 122) ; « Je ne voulais pas faire un film sur le ‘pourquoi elle fait ça ?’ : c’est juste un film d’action. Pas un film psychologique. » (Céline Sciamma, pendant l’avant-première de son film « Tomboy », au Cinéma Gaumont Opéra Premier à Paris le 14 avril 2011) ; « On ne sait jamais rien. » (Denis, le héros homosexuel du docu-fiction « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta) ; « C’est le mensonge qui me vient naturellement quand je fais mes livres. La vérité devait se loger ailleurs, emprunter une autre forme. » (Philippe Besson interviewé dans la revue Têtu, n°202, septembre 2014) ; etc.
En bons relativistes, elles éclatent la Vérité en une multiplicité de subjectivités, de « petites vérités individualistes » qu’on ne pourrait plus relier entre elles, de points de vue incritiquables et « tolérables » : « N’allez pas prendre au pied de la lettre mon ‘Art poétique’ de Jadis et Naguère, qui n’est qu’une chanson après tout. Je n’aurai pas fait de théorie. C’est peut-être naïf ce que je dis là, mais la naïveté me paraît être un des plus chers attributs du poète, dont il doit se prévaloir à défaut d’autres. » (Paul Verlaine en 1890, cité par Jean-Michel Maulpoix dans l’article « Poétique de la chanson grise », sur le Magazine littéraire, n°321, mai 1994, p. 43) ; « La réalité, c’est une somme des points de vue subjectifs sur la réalité. » (Christophe Bigot, lors de sa conférence « Différences et Médisances » autour de la sortie de son roman L’Hystéricon, à la Mairie du IIIème arrondissement le 18 novembre 2010) ; etc. Par exemple, dans son one-man-show Tout en finesse (2014), Rodolphe Sand se targue d’être « sans préjugés ».
Le jugement des actes est confondu avec le jugement des personnes. « Nous vous étonnez pas de ne pas entendre la Communion Béthanie s’exprimer sur des sujets de société : ouverture du mariage aux personnes de même sexe, homoparentalité. Ce n’est pas sa vocation d’en débattre, non pas par désintérêt, mais par fidélité à notre mission contemplative qui consiste à assurer l’urgence de la primauté de la prière. […] Nous misons sur l’accueil inconditionnel des personnes, en nous abstenant de tout jugement sur leur choix de vie, dans le respect de leur parcours. » (Jean-Michel Dunand, Libre : De la honte à la lumière (2011), p. 154) ; « Des préjugés qu’on croyait disparus ressurgissent. » (la voix-off à propos des premières années Sida, dans le documentaire « Somewhere Over The Rainbow » (2014) de Birgit Herdlitschke, diffusé en juillet 2014 sur la chaîne Arte) ; etc.
Beaucoup de personnes homosexuelles se mettent souvent à mépriser les discours sur le vrai : elles disent que les « interprétations » ou la réflexivité d’une œuvre ne sont que du blabla, de l’intellectualisme, que « ça les saoule ». Par exemple, les interprètes de la pièce Une Visite inopportune de Copi, jouée au Théâtre de la Colline en 1988, diront en conclusion : « Le spectateur prendra la pièce comme il l’entend. ».
Généralement, ce refus catégorique de la Vérité a pour corollaire la mauvaise foi, l’indifférence, le déni pur et simple, le mensonge, la censure : « Qu’on le veuille ou non, le mariage homosexuel, il faut qu’il arrive. C’est évident. » (Patrick Pelloux dans l’émission Des clics et des claques du 27 septembre 2011 sur la radio Europe 1) ; « C’est difficile d’expliquer la sensibilité ‘camp’ : ils y en a qui l’ont, d’autres qui ne l’ont pas. » (Alberto Mira, De Sodoma A Chueca (2004), p. 537) ; « Je ne pense pas qu’un débat contradictoire ait de l’intérêt pour les questions d’homoparentalité. » (Dominique Boren, co-président de l’APGL, dans l’émission Débat de midi de Thomas Chauvineau sur la radio France Inter, le lundi 16 juillet 2012) ; etc.
Ce qui est inquiétant, ce sont les nombreux dénis de Réel (à cause des bonnes intentions) qui poussent carrément les personnes homosexuelles à mentir. Nous pouvons le voir dans les cas de coming out, de formation de « couples » homosexuels improbables, et même lors des débats récents sur l’adoption, l’homoparentalité, la PMA et la GPA : « Qui est-ce qui vous a dit qu’il y avait une différence d’âges ? » (Xavier, 67 ans, parlant du « couple » qu’il forme avec son copain Guillaume, 30 ans, dans le documentaire « Cet homme-là (est un mille-feuilles) » (2011) de Patricia Mortagne)
Par exemple, lors de sa conférence sur « L’homoparentalité aux USA » donnée à Sciences-Po Paris le 7 décembre 2011, Darren Rosenblum, qui a obtenu une petite fille par GPA, est totalement dans le déni de Réalité : « Je me sentais enceinte. » dira-t-il devant tout son auditoire (et même pas pour de rire, en plus !) Ils ont joué, son copain et lui, à la loterie avec « leur » enfant puisqu’ensemble, ils ont cherché à se cacher (et à cacher, pour le coup, à « leur » fille) quel est le spermatozoïde qui a fécondé l’ovule. « On ne voulait pas savoir qui était le père biologique. On sait maintenant qui est le père biologique, mais on garde le secret. »
e) L’autocensure anti-identitaire :
C’est surtout contre elles-mêmes que les personnes homosexuelles dirigent leur politique de censure. Elles se forcent à ne pas s’écouter, et à étouffer leurs idéaux profonds. Elles se nient plus ou moins ouvertement en se coupant de leurs racines, en cherchant à effacer leur passé, et en vivant une double vie faite de mensonges sincères : « Marcel Carné s’est toujours plu à cacher sa vie privée. » (Edward Baron Turk, Marcel Carné et l’âge d’or du cinéma français 1929-1945, 2002) ; « En fait, je suis discret sur ce sujet, c’est qu’il relève de la vie intime, qu’il ne regarde que moi et, surtout, qu’il n’y a pas grand-chose à en dire ! » (Jean-Claude Brialy à propos de son homosexualité, Le Ruisseau des Singes, Éd. Robert Laffont, Paris, 2000, p. 414) ; « Mon passé se dissout, je fais place au silence. » (Paul Éluard cité dans l’autobiographie On m’a volé ma vérité (2001) de Jean-Luc Romero, p. 27) ; « Le secret, c’est le passé. » (Tennessee Williams cité dans le site Isla de la Ternura, consulté en janvier 2003) ; « Rosario Miranda n’aime pas revoir les albums de photos anciennes, parce qu’il a horreur de se voir habillé en homme. » (Fernando Olmeda, El Látigo Y La Pluma (2004), p. 228) ; « Marguerite Yourcenar ‘entre’ – ce qui est encore assez rare pour un auteur vivant – dans la Bibliothèque de la Pléiade. Elle pose des conditions assez inadmissibles, si l’on s’en tient à l’esprit des volumes de la Pléiade, mais Gallimard ne lui refuse plus rien : elle impose que l’édition ne comporte aucun appareil critique autre que ses préfaces et postfaces personnelles. On reconnaît là la volonté qu’on a vu cent fois à l’œuvre chez Marguerite Yourcenar : tout contrôler et ne pas permettre que l’on juge son travail, ses retouches, ses corrections. » (cf. l’article « Chronologie » de Josyane Savigneau, dans le Magazine littéraire, n°283, décembre 1990, p. 26) ; « Elle était presque autodestructrice avec ceux qui essayaient d’écrire sur sa vie ou sur son œuvre. » (la biographe de la sculptrice Louise Bourgeois, dans le film documentaire « Louise Bourgeois : l’araignée, la maîtresse, la mandarine » (2009) d’Amei Wallach et Marion Cajori) ; « J’ai envie d’effacer toute ma vie d’avant. » (Isaac, femme F to M qui s’appelle initialement Taïla, dans l’émission Zone interdite spéciale « Être fille ou garçon, le dilemme des transgenres » diffusée le 12 novembre 2017 sur la chaîne M6) ; « Partout où il passe, il efface son prénom. » (la voix-off, idem) ; etc.
Un certain nombre de personnes homosexuelles (Lucien Daudet, Philippe Jullian, Pierre Loti, etc.) aiment/aimeraient changer de nom, soit pour la fantaisie du pseudonyme, soit par haine de soi et de ses origines. « Je détestais mon prénom. » (Paula Dumont, Mauvais Genre (2009), p. 34) Marcel Proust, par exemple, demandait instamment à ses amis de ne pas l’appeler par son nom propre qui lui semblait peu euphonique, pour ne pas dire carrément catastrophique. À l’adolescence, Yukio Mishima décida de changer de nom (il s’appelait à l’origine Kimitake Hiraoka). Radclyffe Hall, la première femme lesbienne véritablement médiatisée, portait monocle et cravate, et se faisait appeler « John ». Les travestis ont presque tous la manie du pseudonyme. Álvaro Retana écrit ses premiers textes en 1911 dans le journal El Heraldo de Madrid sous le pseudonyme de « Claudina Regnier ». Federico García Lorca refusait qu’on enregistre sa voix. « Federico est un être anhistorique. » (Francisco García Lorca, Federico Y Su Mundo (1980), p. 137) Marcelle Auclair, dans Enfances et mort de García Lorca (1968), nous raconte qu’il mentait constamment sur son âge (p. 35). Virginia Woolf détestait qu’on la photographie et piqua une grosse colère lorsque Victoria Ocampo introduisit chez elle, en 1939, Gisèle Freud. Pierre et Gilles ne dévoilent jamais leur nom de famille, ni leur âge. C’est la date de la rencontre qui fait office d’acte de naissance : 1976. En épitaphe à son autobiographie Roland Barthes par Roland Barthes (1975), Roland Barthes écrit : « Tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman. » D’ailleurs, il ne dit pas « je » mais parle de lui à la troisième personne… comme la caricature d’Alain Delon !
Beaucoup d’auteurs homosexuels (Thibaut de Saint Pol, Wystan Hugh Auden, Oscar Wilde, Marcel Proust, etc.) refusent l’emploi du « je » dans leur écriture. Michel Foucault défend une « œuvre sans auteur, sans personne derrière » (Michel Foucault, Dits et écrits I, 1954-1988 (2001), p. 689). Manuel Puig entraîne le lecteur sur le « chemin de l’impersonnel » (José Amícola, Manuel Puig Y La Tela Que Atrapa Al Lector (1992), p. 28). Allen Ginsberg affirme qu’il ne désire pas être quelqu’un, ni même Allen Ginsberg. Jaime Gil de Biedma se dresse contre lui-même en écrivant « Contra Jaime Gil De Biedma » (1968), poème dans lequel son double schizophrénique casse l’identité du poète. Jean Cocteau pense que « Victor Hugo était fou parce qu’il disait qu’il était Victor Hugo ». Le premier roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis (qui s’appelle pourtant bien Eddy Bellegueule dans la vraie vie) est une déclaration ouverte de suicide avec soi-même et son passé prolétaire (le nouveau pseudonyme choisi est d’une bourgeoisie on ne peut plus redondante !) : « De mon enfance je n’ai aucun souvenir heureux. » (cf. la première phrase du roman, p. 13) L’auteur avoue lui-même en interview qu’il a souhaité à travers son livre « rompre avec ce qu’on avait fait de lui pour se réinventer ». Philippe Besson, dans ses romans, utilise la troisième personne du singulier pour marquer encore plus son refus de la recherche du « lien autobiographique » dans ses écrits (l’adjectif possessif de son roman Son Frère, publié en 2001, est à ce titre assez évocateur de cette autocensure). Roberto Echavarren appelle au « dépassement des différences et des identités », à la « destruction du visage » (Roberto Echavarren, Performance, Género Y Transgénero (2000), pp. 20-24 ; p. 190) : « Il ne s’agit pas de trouver l’identité de celui qui écrit, parce que l’écriture, nomade, singularise des devenirs transversaux à n’importe quelle identité. » (Roberto Echavarren, « Lo Que Está En El aire », 1998, sur le site www.lamaga.com.ar, consulté en janvier 2004) Néstor Perlongher défend « un désir de ne plus être, un désir de rupture avec l’identité » (Néstor Perlongher, « Poesía Y Éxtasis » (1990), dans le recueil Prosa Plebeya (1997), pp. 150-151). Tennessee Williams emploie souvent ce que la théorie gay littéraire a appelé la « stratégie Albertine » (en référence au personnage de Proust) qui consiste à changer le sexe du regard désirant ou de l’objet de désir pour occulter l’orientation sexuelle de l’auteur ou d’un de ses personnages. Juan Goytisolo s’attaque à la notion de Réalité et d’individualité. Il s’agit pour lui de « refuser l’identité, (de) recommencer à zéro » (Nicole Réda-Euvremer, La Littérature espagnole au XXe siècle (1998), p. 57). Bien souvent, les personnes homosexuelles confondent l’identité avec la carte d’identité (cf. les premières images du film « Happy Together » (1997) de Wong Far-Wai, le roman Pièces d’identité (1966) de Juan Goytisolo, etc.). « Quand je pense au mot ‘identité’ me viennent à l’esprit les mots ‘empreintes digitales’, ‘carte d’identité’ et toutes ces choses paranoïaques. » (Néstor Perlongher, « El Deseo De Unas Islas » (1982), dans le recueil Prosa Plebeya (1997), p. 185) L’essai Se dire lesbienne : Vie de couple, sexualité, représentation de soi (2010) de Natacha Chetcuti regorge d’aphorismes queer (lexique de l’auto-« construction », de la déconstruction identitaire).
« Vous pouvez tout raconter, mais à condition de ne pas dire ‘je’. » (cf. les propos de Marcel Proust rapportés par André Gide dans son Journal, 1887-1925) ; « Comment se nommer alors que les seuls mots pour le faire sont inadéquats ? » (Line Chamberland, Mémoires lesbiennes, citée dans l’essai Attirances : Lesbiennes fems, Lesbiennes butchs (2001) de Christine Lemoine et Ingrid Renard, p. 5) ; « Il y a quelque paradoxe à traiter Marcel Proust sous l’angle de la biographie, lui qui fonda, apparemment, sa théorie ‘contre Sainte-Beuve’ sur le refus de l’explication de l’œuvre par les épisodes et les incidents de la vie de l’auteur. » (cf. la première phrase de l’introduction au dossier consacré à Marcel Proust, dans le Magazine littéraire, n°350, janvier 1997, p. 16) ; « Je, moi, me, mon, ma, mes… ou tout est dans tout, ou rien ne vaut la peine qu’on en parle. » (Marguerite Yourcenar, Les Yeux ouverts (1980), entretiens avec M. Galey, p. 218) ; « Pour Cernuda, l’idéal serait d’être inconnu, sans identité. » (Armando López Castro, Luis Cernuda En Su Sombra (2003), p. 35) ; « Masculin ? Féminin ? Neutre est le seul genre qui me convienne toujours. » (la photographe lesbienne Claude Cahun, citée dans l’exposition « Claude Cahun » au Jeu de Paume du Jardin des Tuileries à Paris en juin 2011) ; « Je me pose des questions, moi qui ai toujours crié sur les toits n’avoir aucun problème d’identité. » (Paula Dumont, Mauvais Genre (2009), p. 16) ; etc.
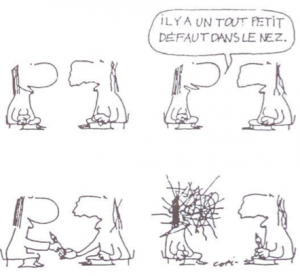
B.D. « Femme assise » de Copi
Michel Foucault est un farouche opposant à la nomination de l’identité personnelle : « Si j’ai choisi l’anonymat, ce n’est donc pas pour critiquer tel ou tel, ce que je ne fais jamais. C’est une manière de m’adresser plus directement à l’éventuel lecteur, le seul personnage ici qui m’intéresse : ‘Puisque tu ne sais pas qui je suis, tu n’auras pas la tentation de chercher les raisons pour lesquelles je dis ce que tu lis ; laisse-toi aller à te dire tout simplement : c’est vrai, c’est faux. Ça me plaît, ça ne me plaît pas. Un point, c’est tout.’ » (Michel Foucault, Dits et écrits II, 1976-1988 (2001), p. 925) En partant du principe que « l’individu est le produit du pouvoir », il s’agit de « désindividualiser » au maximum le discours (idem, p. 136). « J’essaie de répondre sans me référer à la conscience, obscure ou explicite, des sujets parlants ; sans rapporter les faits de discours à la volonté de leurs auteurs ; sans invoquer cette intention de dire qui est toujours en excès de richesse par rapport à ce qui est dit. » (Michel Foucault, Dits et écrits I, 1954-1988 (2001), p. 709) ; « Il faut penser la pensée comme irrégularité intensive. Dissolution du Moi. » (Michel Foucault, Dits et écrits I, 1954-1988 (2001), p. 957)
En général, les auteurs homosexuels (homosexuellement pratiquants) se placent hypocritement hors de leur texte ou de leurs créations, tels des Dei ex machina qui n’ont rien contrôlé : « L’idéal c’est de donner l’impression que la pièce n’a jamais été écrite. » (Jérémy Patinier, Les Hommes aussi parlent d’amour (2011), p. 25) ; « Lorsque j’écris un roman […], il s’écrit presque tout seul, après quoi je l’oublie, car je ne garde pas en mémoire mes romans. » (le dramaturge Copi, dans l’article « Copi : ‘Je suis un auteur argentin même si j’écris en français.’ : Entretien avec Raquel Linenberg », dans le journal La Quinzaine littéraire du 16 janvier 1988) ; etc.
Certains artistes gays contemporains (Renaud Camus, Guillaume Dustan, Érik Rémès, Cy Jung, etc.) inventent la « biographie sexuelle », l’autre pendant de la « littérature sans auteur » (le roman Tricks (1979) de Renaud Camus pourrait ici faire figure d’archétype). L’exhibition obligatoire, l’être-pour-le-sexe et le refus de la vie privée, que ces écrivains s’imposent, sont une autre forme d’autocensure identitaire, puisque cette fois, la voie narrative se regarde de trop près pour se voir en vérité et pour se donner réellement. « L’introversion comme l’extraversion est souvent la face cachée qui couvre le même drame. » (Jean-Claude Janvier-Modeste, en épitaphe de son autobiographie Un Fils différent (2011), p. 9) Parfois, l’utilisation systématique et vindicative du « je » (par exemple, Christine Angot, pendant la 6e Nuit Blanche de Paris à la Librairie Les Cahiers de Colette, le 6 octobre 2007, défendra le « je » – « ‘Je’, c’est l’attaquant. » – parce que précisément elle n’a pas grand chose à lui faire dire…) masque une autocensure qui s’ignore.
En général, les personnes homosexuelles tentent de détruire leur propre identité, et donc leur relation à l’autre. Par exemple, Pierre Loti détruisit ses journaux intimes. Jean Genet s’est toujours opposé à l’idée d’une biographie et il avait fait promettre à ses amis de garder le silence sur lui. Michel Foucault a caché son Sida : l’écrivain Jean-Paul Aron le lui reprochera (« C’était un silence de honte, pas d’intellectuel. »). Marcel Jouhandeau brûla ses journaux intimes : « C’était moi-même que je détruisais. Mais je le voulais. » (Marcel Jouhandeau, dans l’émission Apostrophe diffusée le 22 décembre 1978 sur la chaîne Antenne 2) Céleste Albaret, la dévouée gouvernante de Marcel Proust, fit disparaître sur ordre de ce dernier trente-deux de ses carnets. Avant de s’être assurée du silence de ses proches et d’avoir un droit de regard sur les livres actuels qui parlent d’elle, Mylène Farmer s’est d’abord farouchement opposée aux biographes (Bernard Violet, Jean-Claude Perrier, Jacques Cheminade, … ; elle fait retirer de la vente la biographie de Patrick Milo en 1989). Maintenant, les biographies sur elle peuvent pleuvoir et sont même tacitement encouragées par un effacement très étudié. « Je suis à la lettre une vieille recette de star : je n’explique rien, vous devinez tout, et j’entretiens le mystère… » (Mylène Farmer citée dans la biographie Mylène Farmer (2004) de Bernard Violet, sur le site www.fnac.com, consulté en juin 2005) Même quand certains sujets homosexuels écrivent concrètement leurs mémoires, ils disent qu’ils rédigent des fictions : « Je ne considère pas du tout l’entreprise générale de ce livre comme une autobiographie. » (Christophe Honoré, Le Livre pour enfants (2005), p. 98)
Beaucoup de personnes homosexuelles, en voulant fuir l’identité à la fois en tant que concept et en tant que réalité, s’identifient à l’actrice iconoclaste qui refuse son image médiatique de « fille trop sage comme une image » (cf. Madonna, Bette Midler, Mélissa Mars, Liza Minnelli, etc.) et qui passe le plus clair de sa carrière à massacrer le star system où elle veut pourtant rester à tout prix.
Les actrices anti-matérialistes ou les chanteuses insolentes qui « ne veulent pas être des stars » (cf. le spectacle musical Une Étoile et moi (2009) d’Isabelle Georges et de Frédéric Steenbrink, le roman Mi Novia Y Mi Novio (1923) d’Álvaro Retana, les chansons « Mes Rêves » d’Isa Ferrer, « My Love Don’t Cost A Thing » de Jennifer López, « J’envoie valser » de Zazie, « I Don’t Wonna Be A Star » de Corona, « I Outta Love » d’Anastacia, « Une Femme » d’Anggun, « Overprotected » de Britney Spears, « Substitute For Love » de Madonna, la publicité du parfum « J’adore : L’Absolu » de Christian Dior, etc.) sont souvent des icônes gay : « Je veux qu’on sache que je n’ai jamais été à l’initiative d’un fan-club. Je n’adhère pas au culte de ma personnalité. » (Mylène Farmer interviewée dans la revue Paris Match, n°2741, le 6 décembre 2001) Yolanda (le vrai prénom de Dalida) détestait son image, et disait qu’il fallait « tuer Dalida » (cf. le documentaire « Dalida » (2004) de Jean-Pierre Devillers et Éric Beaufils) : « Je veux être libre de moi-même. » (l’actrice interprétant la chanteuse Dalida dans le spectacle musical Dalida, du soleil au sommeil (2011) de Joseph Agostini) Marilyn Monroe, en voulant détruire la star qui était en elle, s’est suicidée.
Les personnages créés par les auteurs homosexuels imitent souvent ces actrices iconoclastes : « Je me moque de la presse. » (Orphée dans le film « Orphée » (1950) de Jean Cocteau) ; « Je ne veux pas être une star. Vous ne comprenez pas. Je ne suis pas une star ! » (Élie Kakou dans son one-man-show Élie Kakou au Point Virgule, 1992) Pensons à Sarah Morton, la fameuse romancière du film « Swimming Pool » (2002) de François Ozon, qui refuse de se faire reconnaître dans le métro, ou bien à Guy, le célèbre tennisman du film « Strangers On A Train » (« L’Inconnu du Nord-Express », 1951) d’Alfred Hitchcock, qui ne veut plus être repéré dans les trains. Dans la pièce Parfums d’intimité (2008) de Michel Tremblay, Luc souffre d’être confondu dans la rue avec son personnage de « zozoteux » dans la série B où il joue à la télévision.
f) Le chemin vers la réflexion sur le désir homosexuel est souvent condamné, au profit de la glorification aveugle de l’amour homo :
Très souvent, le déni identitaire s’accompagne du déni du désir homosexuel. La plupart des personnes homosexuelles – gays ou lesbiennes – et leurs suiveurs imposent un interdit sur la définition même de l’homosexualité, et font finalement preuve d’une grande homophobie : « Ça n’intéresse que moi et pas les autres. » (Fabrice à propos de son homosexualité, dans le documentaire « Les Garçons de la piscine » (2009) de Louis Dupont) ; « Choix ou destin, accident ou style de vie, l’homosexualité est plurielle. Toute proposition qui vise à l’unifier et à la réifier, mène à l’impasse. » (Élisabeth Badinter, X Y de l’identité masculine (1992), p. 169) ; « C’est un film où la question de l’homosexualité ne se pose pas, et c’est là le principal attribut de sa modernité. » (Didier Roth-Bettoni concernant le film « My Beautiful Laundrette » de Stephen Frears, dans son essai L’Homosexualité au cinéma (2007), p. 549) ; « Autre chose dont il faut se défier, c’est la tendance à ramener la question de l’homosexualité au problème du ‘Qui suis-je ? Quel est le secret de mon désir ?’. Peut-être vaudrait-il mieux se demander : ‘Quelles relations peuvent être, à travers l’homosexualité, établies, inventées, multipliées, modulées ?’ Le problème n’est pas de découvrir en soi la vérité de son sexe, mais c’est plutôt désormais de sa sexualité pour arriver à des multiplicités de relations. » (Michel Foucault, « De l’amitié comme mode de vie », 1981, dans l’essai Dits et écrits II, 1976-1988 (2001), p. 982) ; « L’homosexualité est toujours éclatée et conflictuelle. » (Didier Éribon, Dictionnaire des Cultures gays et lesbiennes (2003), p. 12) ; « Il n’existe pas de dénominateur commun essentiel et permanent qui unisse les homosexuels entre eux […], ils n’ont, en soi, rien en commun, aucun lien interne qui les rende ‘semblables’ entre eux. » (Alberto Mira, De Sodoma A Chueca (2004), p. 19) ; « Le cinéma des homosexuels ne peut pas – ne devrait pas – se réduire à un cinéma homosexuel ! […] Terence Davies un cinéaste de l’indicible. » (cf. la critique du film « The Long Day Closes », « Une longue journée qui s’achève » (1991) de Terence Davies par Pierre Philippe dans le catalogue du 19e Festival Chéries-Chéris au Forum des Images de Paris en octobre 2013, p. 85) ; « Je ne me suis pas dit : je vais traiter l’homosexualité parce que c’est quelque chose qui m’intéresse. Pour tout dire, ça ne m’intéresse pas davantage que l’hétérosexualité. Ce qui m’intéresse, c’est la sexualité. J’ai fait attention en écrivant le scénario de ne pas traiter de l’homosexualité, mais plutôt de la sexualité. Je ne comprends pas pourquoi on met un préfixe à la sexualité. […] Il était donc hors de question de tomber dans ‘Je vais faire un film sur…’. » (le cinéaste Jean-Claude Guiguet à propos de son film « Les Passagers » (1999) au magazine Ex-Æquo en mai 1999) ; « L’homosexualité est une chose importante, mais les homosexuels ne sont pas très intéressants. » (Jean-Christophe Bouvet dans l’essai Le Cinéma français et l’homosexualité (2008) d’Anne Delabre et Didier Roth-Bettoni, p. 240) ; « Je ne parle pas d’homosexualité, je parle de sexualité différente. » (le cinéaste Jacques Nolot au Magazine Sub, pendant le tournage de son film « La Chatte à deux têtes » en 2001) ; « Patrice Chéreau et André Téchiné sont tout sauf des ‘cinéastes gays’. » (Anne Delabre, Didier Roth-Bettoni, Le Cinéma français et l’Homosexualité (2008), p. 226) ; « Je ne pensais pas devoir décrire mon protagoniste en tant qu’homosexuel ou hétérosexuel. Pour moi, il est queer. Dominik n’a pas besoin de se décrire. » (Jan Komasa, le réalisateur du film « Sala Samobójców », « Suicide Room », 2011) de Jan Komasa) ; « Je suis né comme ça. Je suppose. Je ne me pose pas la question. » (le papy fermier homosexuel dans le documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz) ; « C’était un garçon charmant, affectueux, mais sa discrétion excessive m’agaçait, et pour cause ; c’était un Antillais ‘pures sucres’. Rarement dans la journée nous sortions ensemble. Il avait toujours cette crainte de tomber sur une connaissance et de devoir se justifier. Le plus embêtant était que ce garçon n’avait jamais l’esprit tranquille par rapport à cette homosexualité qui le perturbait. […] À la longue, je ne supportais plus ses jérémiades ; malgré tous mes efforts, je finis par lâcher prise. En vivant si mal son homosexualité, Hugo se mettait de fait dans la catégorie des homosexuels limite homophobes. En effet, il n’est pas rare de rencontrer ce genre de personne dans la communauté ; c’est même fréquent aux Antilles. » (Ednar, le héros homosexuel du roman très autobiographique Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, racontant sa rencontre avec Hugo dans un club privé, pp. 177-178) ; « Quand j’ai découvert cette homosexualité, je ne me suis pas posé de question. » (Laurent Kerusoré, l’acteur homo du série Plus belle la vie, dans le documentaire « Homos, la haine » (2014) d’Éric Guéret et Philippe Besson, diffusé sur la chaîne France 2 le 9 décembre 2014) ; etc.
Par exemple, dans le docu-fiction « Love And Words » (2007) de Sylvie Ballyot, selon la Traductrice (voix-off), « le désir n’a pas besoin d’être exposé ».
Certains réalisateurs homosexuels, qui jadis avaient défendu leur visibilité homosexuelle, se mettent à cracher sur les prix gays qui leur sont décernés. C’est le cas par exemple de Xavier Dolan. Et le pire, c’est qu’ils font passer leur attitude homosexuellement correcte (car toute personne homosexuelle fait cela : la marque de fabrique du désir homosexuel, c’est de se renier tout en s’annonçant et en se pratiquant) pour anti-homosexuellement correcte, pour universelle et pour non-conventionnelle.
Beaucoup de personnes homosexuelles pratiquantes, pour ne pas reconnaître la violence et la responsabilité des actes que leur fait poser leur désir homosexuel, partent en croisade iconoclaste contre les clichés utilisés par ce dernier pour se dire : « Une image peut mentir plus que 1000 mots. » (cf. l’article « Orgullo De Informar » Fernando Olmeda, dans l’ouvrage collectif Primera Plana (2007) de Juan A. Herrero Brasas, p. 143) ; « Les clichés ont la vie dure ! » (Gaël-Laurent Tilium, Recto/Verso (2007), p. 256) ; « Les clichés ont la vie dure ! » (Didier Roth-Bettoni, L’Homosexualité au cinéma (2007), p. 335) ; « Durant les débats télévisés, pourquoi un prêtre pour parler d’homosexualité ? Qu’est-ce qui légitime sa prise de parole ? De même, pourquoi un psychiatre ? Pourquoi une telle focalisation sur la ‘mère d’homosexuel’ ? […] Sa présence est une concession au stéréotype psychanalytique associant l’homosexualité à une fixation à la mère. » (Alberto Mira, De Sodoma A Chueca (2004), p. 425) ; « La 17e édition a la couleur de l’audace, de la créativité, et défend une cinéphilie LGBT rigoureuse et plus que jamais au-delà des clichés. » (Pascale Ourbih, président transsexuel M to F, ayant rédigé l’éditorial de la plaquette du 17e Festival Chéries-Chéris, le 7-16 octobre 2011, au Forum des Images de Paris) ; « Les stéréotypes sont très vivaces, même s’ils ne s’expriment pas directement. […] Ils sont encore vivants. » (Florence Tamagne pendant la conférence-débat « L’Homosexualité, un genre à part ? » organisée au Grand Auditorium de la Bibliothèque François Mitterrand le 20 janvier 2009) ; « ‘Free Fall‘ parvient à échapper à tous les clichés. » (cf. la critique du film « Free Fall » (2013) de Stephen Lacant dans le catalogue du 19e Festival Chéries-Chéris au Forum des Images de Paris, en octobre 2013, p. 26) ; « Contrairement à la majeure partie des séries dans lesquelles on croise des personnages gays, il n’est pas question ici de coming out, d’acceptation de sa sexualité ou du regard de la société sur l’homosexualité. Non, dans la série Looking, les personnages sont juste homos et on n’en fait pas une affaire d’État. […] L’homosexualité est traitée comme un détail et non l’essentiel des thématiques. Elle est loin des caricatures. » (cf. l’article « Looking sur HBO » dans le Nouvel Observateur, consulté en octobre 2014) ; « Mon travail, c’est de permettre aux élèves de surmonter leurs préjugés. » (Tristan, le prof d’anglais hétéro, dans le téléfilm « Baisers cachés » (2017) de Didier Bivel) ; etc. Par exemple, dans l’émission Radioscopie sur France Inter, diffusée le 3 avril 1969, Pierre Démeron, homosexuel de 37 ans, au micro de Jacques Chancel, s’en prend à « la série de clichés » sur « les » homos, et prône « l’absence de préjugés… pour mieux justifier une pratique homo qui n’en porte pas le nom. Dans la pièce L’un dans l’autre (2015) de François Bondu et Thomas Angelvy, « un hétéro et un homo se découvrent amoureux. Sans clichés, ni préjugés, il franchiront toutes les étapes avec beaucoup d’humour ».
On remarque que la censure imposée par rapport au désir homosexuel est d’abord une auto-censure. « Tatoué comme une bête à l’abattoir, je revêtais désormais une beauté étrange et maladive dans le grand silence de mon secret […]. » (Berthrand Nguyen Matoko parlant à la fois de son viol et de son homosexualité, dans son autobiographie Le Flamant noir (2004), p. 70) Je vous renvoie à ce propos au titre du documentaire « Je suis homo : et alors ? » diffusé 13 février 2007 sur la chaîne Arte.
Par exemple, en septembre 2013, Pierre Palmade, l’humoriste français, juste après avoir dit à la radio MFM et sur Facebook que son homosexualité le rendait « triste », a dit qu’il cherchait à « banaliser l’homosexualité » et que les causes de la communauté homosexuelle l’indifféraient (« Qu’ils se démerdent ! »).
Une des marques les plus tangibles de cette auto-censure homosexuelle ET homophobe, c’est l’usage de l’expression « homo mais pas gay ». En effet, beaucoup de personnes homosexuelles font hypocritement la fausse distinction entre l’adjectif « homo » et l’adjectif « gay », comme s’il y avait deux « milieux » homos : un chaste et un dépravé, un authentique et l’autre communautariste : « Je suis de sensibilité homosexuelle. » (l’écrivain Ron l’Infirmier dans l’émission Homo Micro diffusée le 12 février 2007 sur Radio Paris Plurielle) Tout pour ne pas regarder leur désir homosexuel en face et les actes violents qu’il leur fait poser.
Il arrive même que les personnes homosexuelles parlent d’elles-mêmes à la troisième personne du singulier : « Si vous voulez tout savoir sur Andy Warhol, regardez seulement la surface : de mes peintures, de mes films et de moi, et me voilà. Il n’y a rien derrière. » (Andy Warhol cité par l’article « Andy Warhol » d’Élisabeth Lebovici, dans le Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, p. 495) ; « Vous me demandez si je préfère être appelé ‘lui’ ou ‘elle’, et je réponds que vous faites comme vous voulez, ça m’est égal. » (l’acteur Akihiro Miwa jouant dans le film « Miwa : à la recherche du lézard noir » (2010) de Pascal-Alex Vincent, et s’exprimant sur la plaquette du 17e Festival Chéries-Chéris, le 7-16 octobre 2011, au Forum des Images de Paris) ; etc.
L’effacement du passé, de l’identité ou de l’homosexualité est régulièrement justifié par la victimisation, ou bien la diabolisation des temps anciens. « Si les homosexuels désirent le mariage, c’est qu’après tout ils reviennent d’une longue infamie, de siècles d’infamie, et qu’ils ont envie de rayer cette infamie, et qu’ils ont envie d’être reconnus. […] Et je comprends moi que des homosexuels, pour effacer cette infamie, veulent accéder à ce sacrement parce que ça les rend semblable au reste de la société. » (Pierre Bergé dans l’émission Culture et Dépendances diffusée le 9 juin 2004 sur la chaîne France 3)
L’argument de l’homophobie permet de ne pas se poser de question : « C’est aujourd’hui l’homophobie que l’on questionne plutôt que l’homosexualité. » (Jean-Yves Le Talec, Folles de France (2008), p. 77) ; « Le meilleur moyen de combattre l’homophobie, n’est-ce pas de la soumettre sans fin à la question ? » (cf. la préface d’Éric Fassin, dans l’essai Pour en finir avec l’homophobie (2005) de Julien Picquart, p. 11) ; « La persistance, dans l’imaginaire commun, de l’idée d’un lien intrinsèque entre adhésion au nazisme et orientation homosexuelle est si paradoxale qu’elle exige qu’on en interroge la genèse. Il est, tout d’abord, évident qu’il y avait des homosexuels parmi les nazis ou, inversement, des nazis parmi les homosexuels, mais cela ne signifie rien en soi. […] Aussi le paradoxe de l’identification entre nazi et homosexuel doit-il se comprendre selon une logique homophobe primaire. » (cf. l’article « Nazisme » de Michel Celse, dans le Dictionnaire des Cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, pp. 334-338) ; « C’est le résultat catastrophique de la souffrance causée par l’homophobie. » (Ednar, le héros homosexuel, dans le roman très autobiographique Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 65) ; etc.
Le chemin vers la réflexion sur le désir homosexuel est souvent condamné : John Woo s’est toujours défendu d’une lecture homosexuelle de ses créations : « Toutes ces manifestations érotiques homosexuelles sont inconscientes. » (John Woo cité dans l’essai L’Homosexualité au cinéma (2007) de Didier Roth-Bettoni, p. 658) Le réalisateur Bruce LaBruce ne soutient pas une communauté homosexuelle qu’il juge parfois inutile, et ne considère pas la politique identitaire comme une solution pour le cinéma gay. Roland Barthes dissimule son homosexualité derrière l’appellation « Déesse H ». Selon Miguel García-Posada, il ne faut pas faire de lecture « gay » des ouvrages écrits par des artistes homosexuels. Lors de la présentation de son roman Le Contenu du silence (2012), organisée à la Galerie Dazelle à Paris le 12 juin 2012, l’écrivaine bisexuelle Lucía Etxebarría refuse systématiquement d’expliquer son écrit et passe son temps à dire que tout est une question de points de vue ; elle n’apprécie pas qu’on trouve le moindre didactisme dans ses romans. La réalisatrice Chantal Akerman refuse d’être estampillée « cinéaste lesbienne ». Gaël Morel refuse que ses films délivrent un quelconque message, qu’ils soient « didactiques », qu’ils prétendent à quelque chose, surtout concernant l’homosexualité : « L’homosexualité, c’est un fait, mais en tant que sujet de film, je trouve ça profondément ennuyeux. » (Gaël Morel pendant la rencontre-dédicace à la Librairie Les Mots à la Bouche à Paris, le 16 septembre 2008, pour la sortie du film « New Wave ») Quand on demande au réalisateur Claude Pérès ses informations biographiques, il refuse d’en donner, considérant que ce qu’il y a à savoir se trouve uniquement dans son travail cinématographique. À la question « Que faites-vous dans la vie ? », il répond : « J’écris des trucs et je filme des trucs. »
« Whitman récuse avec véhémence toute possibilité d’une lecture gay de ses poèmes. » (cf. l’article « Walt Whitman » de Jean-Paul Rocchi, dans le Dictionnaire des Cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, p. 499) ; « Les romans d’Eduardo Mendecutti appartiennent davantage à la culture homosexuelle que les films de John Huston, parce qu’ils reflètent de manière plus précise certaines facettes de l’homosexualité dans notre culture. » (Alberto Mira, Para Enterdernos (1999), p. 25) ; etc.
La communauté homosexuelle, à certains moments, s’organisent pour créer une autocensure de sa propre production afin que le monde « extérieur » ne découvre pas le pot aux roses. Par exemple, il faut six mois de formation avant d’être autorisé à consulter les Archives des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence après l’admission dans la « congrégation ». On peut penser par ailleurs aux manifestations musclées d’opposition à la sortie du film « Cruising (La Chasse) » (1980) de William Friedkin, ainsi qu’à la mise à l’index de certains ouvrages homo-érotiques. Par exemple, est discrètement retiré de la chronologie de l’essai The Celluloïd Closet (1987) de Vito Russo le roman Reflection In A Goldeneye (Reflets dans un œil d’or, 1941) de Carson McCullers (cf. Gregory Woods, Historia De La Literatura Gay (1998), p. 234). Dans « Sex Revelations » (2000) de Jane Anderson, le film « The Children’s Hour » (« La Rumeur », 1961) de William Wyler est montré du doigt comme le « Film de la Honte lesbienne » à éviter.
Par exemple, pendant la projection du court-métrage « Corps-à-corps » au Festival Chéries-Chéris en octobre 2010 au Forum des Images de Paris, l’assistance majoritairement lesbienne reprochait à Julien Ralanto, le réalisateur, d’avoir abordé le lien entre désir lesbien et viol… et en réalité d’être simplement un homme : des femmes agressives lui demandaient « de quel droit il s’était accaparé ‘leur’ thème et ‘leur’ sexualité ».
Le malaise homophobe et la dissimulation des personnes homosexuelles pratiquantes viennent surtout du fait que ces dernières sont, en actes, complices de leur propre mensonge/censure : « Et le jeune homme reste sur ses gardes, soupçonne qu’on le soupçonne, feint de feindre pour mieux dissimuler ; achète des livres traitant de l’amour hétérosexuel, prend des précautions avec ses amis, évite de confier son numéro de téléphone et ne reste pas indifférent au cours des entretiens où l’on démolit les pédérastes. Dans l’obligation personnelle d’avoir recours aux subterfuges, il sombre en général dans la dissimulation. » (Jean-Louis Chardans, Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p. 12)
Paradoxalement, le déni de la nature violente du désir homosexuel est souvent contre-investi dans une glorification de l’amour homosexuel, glorification tout aussi dénégatrice du Réel d’ailleurs : « Tais-toi et baisons. » (Laurent à son amant André dans le docu-fiction « Le Deuxième Commencement » (2012) d’André Schneider) ; « J’ai pas vraiment envie d’en parler. C’est un film d’amour, voilà. Souvent, mes films ne traitent pas directement d’homosexualité. » (François Zabaleta juste avant la projection de son film « Le Cimetière des mots usés » (2011), au 17e Festival Chéries-Chéris d’octobre 2011 au Forum des Images) ; « Est-ce que c’est vraiment une vraie question inné ou acquis ? Je trouve que c’est une question absurde. [Chercher à y répondre], c’est une manière très violente d’essayer de savoir le vrai secret de l’homosexualité, comme si la sexualité avait un secret. Non. Le secret de la sexualité, c’est d’être heureux. » (Jean Le Bitoux dans l’émission Homo Micro du 13 février 2007, sur Radio Paris Plurielle) ; « Je voulais faire un film qui ne pose même pas la question de l’homosexualité. Je voulais montrer une homosexualité épanouie, sans surenchère, naturelle. » (Sébastien Lifshitz à propos de son film « Presque rien » (1999) dans l’essai Le Cinéma français et l’homosexualité (2008) d’Anne Delabre et Didier Roth-Bettoni, p. 231) ; etc.
C’est le fantasme homosexuel que les personnes homosexuelles ont tendance à présenter comme un flou artistique à applaudir mais à ne surtout jamais éclaircir. Elles tiennent un discours éthéré sur « l’Amour » ou le consentement pour imposer leur censure sur l’homosexualité (ce discours dit peu ou prou ceci : « Du moment qu’il y a de l’Amour du point de vue des amants, il n’y a rien à redire. ») : « Pour ma part, je me suis fait une règle de ne pas juger la sexualité des autres ; tant que ça se passe entre adultes conscients et consentants, je pense que rien de mal ne peut se faire. » (cf. article sur le blog Chroniques ardoriennes, http://meneldil-palantir-talmayar.blogspot.fr/2012/09/s-jetais-dieu-en-les-voyant-prier-je.html?spref=tw)
Beaucoup de personnes homosexuelles, pour se conforter dans leurs propres certitudes identitaires et amoureuses, se contentent de s’auto-citer, dans une tautologie presque risible tellement elle est systématique et peu argumentée : « Je suis comme je suis. » (Marie-Paul Belle, dans l’émission Dans les yeux d’Olivier, « Les Femmes entre elles », d’Olivier Delacroix et Mathieu Duboscq, traitant de l’homosexualité féminine et diffusée le 12 avril 2011 sur la chaîne France 2) ; « On est né comme on est. » (Stéphanie, une femme lesbienne) ; « Je suis comme je suis. » (Steve Blame en conclusion du documentaire « Somewhere Over The Rainbow » (2014) de Birgit Herdlitschke, diffusé en juillet 2014 sur la chaîne Arte) ; « Je suis comme ça et jamais je ne changerai. » (Armand de Fluvià par rapport à son « identité homosexuelle », cité dans l’ouvrage collectif Primera Plana (2007) de Juan A. Herrero Brasas, p. 84) ; « Je suis homosexuel. Un point c’est tout. » (Alexandre Delmar, Prélude à une vie heureuse (2004), p. 119) ; « On naît homo. On ne le choisit pas. Un point c’est tout. » (Philippe Robin-Volclair pendant l’intermède de son spectacle de marionnettes L’Histoire du canard qui voulait pas qu’on le traite de dinde, 2008) ; « Je ne sais pas si je suis né homosexuel et je ne veux pas me poser cette question. Je suis homosexuel, un point c’est tout. » (Jean-Luc Romero, On m’a volé ma vérité (2001), p. 28) ; « Ne me demandez pas comment ni pourquoi je suis devenu homosexuel, parce que je n’en sais rien et, en plus, je m’en fous. » (Gaël-Laurent Tilium, Recto/Verso (2007), pp. 71-72) ; « C’est comme ça et puis c’est tout ! Y’a des gens qui t’écrivent des théories. Moi, ça ne m’intéresse pas. » (Denis dans le documentaire « Une Vie de couple avec un chien » (1997) de Joël Van Effenterre) ; « Je ne me torture plus l’esprit avec des questions sans réponse, comme : ‘Pourquoi suis-je homosexuel ?’ […] Cette question est maintenant obsolète. Cela ne m’intéresse plus. » (Brahim Naït-Balk, Un Homo dans la cité (2009), pp. 110-111) ; « Au début, c’est pas évident. Mais je suis gay. C’est comme ça. J’trouve ça bête de se prendre la tête avec ça. Pourquoi est-ce que chacun de nous ne pourrait pas être comme il est, tout simplement ? » (Sacha, jeune Allemand homo, dans le documentaire « Homo et alors ?!? » (2015) de Peter Gehardt) ; etc.
Elles s’auto-persuadent qu’elles sont heureuses en amour, alors que leur situation est loin d’être idéale : « Nous avons fait l’autruche. Nous ne voulions pas, nous ne pouvions pas, à cause d’une maladie, briser nos rêves. » (Alain Sanzio abordant le déni français du Sida, dans l’essai Le Rose et le Noir (1996) de Frédéric Martel, p. 366)
La grande majorité des personnes homosexuelles veulent donner à leur autocensure l’apparence de l’amour, de la nature. Alors généralement, elles prennent leur air de victime énamourée, en faisant comprendre à leur entourage que, justement, « il ne peut PAS le comprendre » : « Personne ne comprendra comment je peux écrire cela, mais ce week-end fut le plus beau de ma vie. Sébastien, lui, le sait. Je le sais. Cette raison-là nous appartient. C’est la force de l’amour que nous venions de découvrir. » (Gaël-Laurent Tilium au moment de la découverte de la séropositivité de son copain, dans son autobiographie Recto/Verso (2007), p. 239) ; « L’homosexualité ne m’intéresse pas comme sujet de cinéma. Ce qui m’intéresse, c’est l’intimité des personnages. » (Gaël Morel dans l’article « Gaël et son clan », entretien avec Cyril Legann, dans la revue Illico, 10 juin 2004) ; etc. Par exemple, dans son journal intime Le Cahier vert, Journal, 1961-1989 (1991), Jocelyn François raconte l’amour « incompréhensible à autrui » qu’elle éprouve pour sa compagne. (Jocelyn François citée dans l’essai Dictionnaire gay (1994) de Lionel Povert, p. 198)
On ne peut que constater finalement le lien entre silence et narcissisme orgueilleux : « À mon sens, le couple lesbien, quel qu’il soit et par essence, ne correspond pas à la norme hétérosexuelle, ne la détourne pas forcément non plus, ne se définit pas forcément ‘par rapport à’… » (le témoignage d’une femme lesbienne, dans l’essai Attirances : lesbiennes fems, lesbiennes butchs (2001) de Christine Lemoine et Ingrid Renard, p. 15) Et pourtant, il n’y a pas de quoi tirer une quelconque fierté du mensonge ou de l’« égoïsme à deux »…
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.