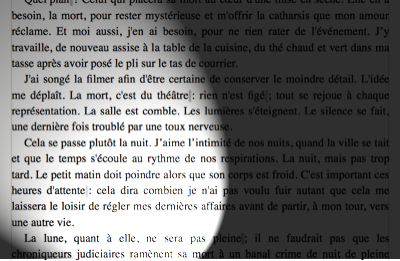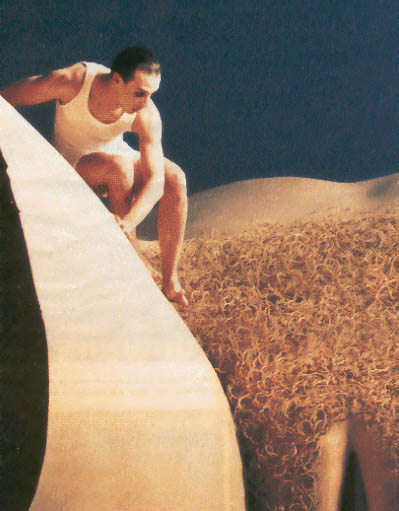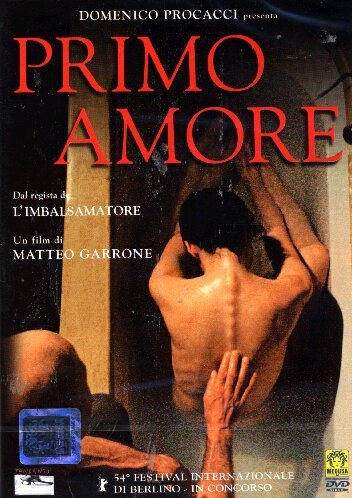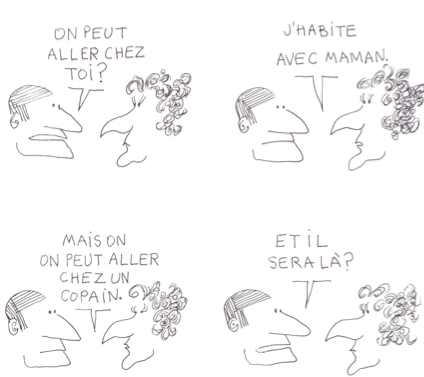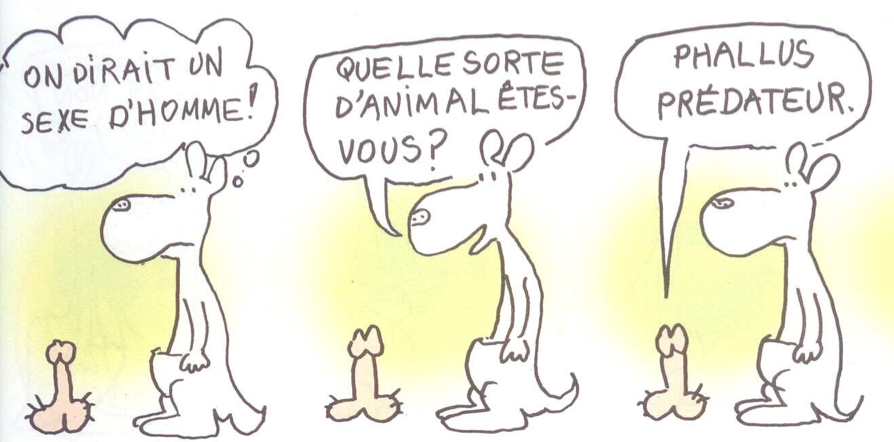Viol
NOTICE EXPLICATIVE :
Et si le secret de l’homosexualité,
c’était « juste » le viol (au pire) ou la peur de la sexualité (au mieux) ?
« Est-ce que c’est vraiment une vraie question inné ou acquis ? Je trouve que c’est une question absurde. C’est une manière très violente d’essayer de savoir le vrai secret de l’homosexualité, comme si la sexualité avait un secret. Non. Le secret de la sexualité, c’est d’être heureux » prétend dogmatiquement l’essayiste-historien homosexuel Jean Le Bitoux au micro de l’émission Homo Micro du 13 février 2007, sur RFPP. On voit bien ici la politique de l’autruche menée par la grande majorité des personnes homosexuelles et leur société à propos du désir homosexuel. Alors pour commencer, si vous le voulez bien, je vais lâcher cette bombe: Et si le secret de l’homosexualité, c’était minoritairement le viol, et majoritairement le fantasme de viol ? Ne vous inquiétez pas. Au début, ça choque ; et une fois qu’on regarde les faits, on arrête de s’offusquer, on respire, on boit frais, et tout le flou artistique qui entourait le concept d’homosexualité se dissipe.
Comment ça ? On ne vous a pas mis au courant ? On ne vous a pas dit pourquoi il faut « un peu » arrêter d’applaudir au coming out des personnes homosexuelles comme on le fait, arrêter de banaliser l’amour homosexuel comme s’il était équivalent à n’importe quel type de relations humaines à deux sous prétexte qu’on l’appelle « Amour », arrêter de vouloir faire signer à une nation entière le « mariage gay » comme s’il allait de soi ? Moi qui ai amorcé depuis l’an 2000 une étude (qui n’en est qu’à ses balbutiements, en plus) sur les liens non-causaux entre désir homosexuel et viol, moi qui suis parfois le dépositaire de confidences d’amis homos ayant été abusés sexuellement dans leur enfance (j’en connais au moins 70, ce qui est énorme ! mais comme ces confidences sont soumises en général au secret amical ou médical – dans le cas des thérapeutes –, tous ceux qui « savent » ferment leur gueule !), je vous demande pour une fois de redescendre sur Terre et d’ouvrir bien grand vos oreilles au lieu de jouer aux hypocrites ou aux ignorants.
Mais pour qui se prennent-ils, tous ces anciens amis homosexuels qui me tournent actuellement le dos parce que je passe à la télé pour dénoncer les failles du Système propagandiste pro-gay ? Ils ont de la merde dans les yeux pour se planter ainsi de cible, c’est pas possible ! À quel jeu pervers jouent tous ces pseudos « intellectuels » homosexuels, confortablement assis sur leur fauteuil universitaire (salut Louis-George Tin ! salut Natacha Chetcuti !), derrière leurs stands associatifs LGBT, dans leur studio radiophonique, à la tribune d’honneur face aux caméras pour la défense des droits des homos et la lutte contre l’homophobie, et qui osent me juger comme « un dangereux homophobe » et me regarder d’un œil torve comme si j’étais un criminel, pour la simple et bonne raison que j’ose parler de ce lien (évident mais mal connu) entre viol et homosexualité, un lien dont personne ne parle, pas même les victimes concernées !?! On marche sur la tête !
Ce sont ces militants homosexuels qui font preuve d’une véritable homophobie ! puisqu’ils sont capables d’une violence inouïe pour préserver leurs images de marque et leurs utopies amoureuses personnelles, pour censurer ces réalités violentes dont une minorité d’entre eux a été victime, et pour désigner comme « homophobe » tout individu qui révèlera au grand jour leur petite comédie de la croisade contre l’homophobie. Honte sur eux ! Et honte à ceux qui me conseillent, face à mes recherches, de « parler d’autre chose que d’homosexualité » (parce que ce thème m’enfermerait et qu’on en fait vite le tour, parce que je parlerais au nom et à la place des autres) ! Honte à ceux qui me demandent de me taire parce que ce que je peux dire, « même si c’est juste, donne du grain à moudre » à ceux qui font l’amalgame entre homosexualité et pédophilie, ou homosexualité et criminalité ! Honte à ces censeurs qui me mettent un scotch sur la bouche et qui me haïssent parce que je donnerais une mauvaise image des couples homos, des cathos homos, et que je pousserais même des jeunes en quête d’une image positive de l’homosexualité au suicide ! Honte à ces chroniqueurs-radio qui ricanent derrière mon dos et gloussent à propos de mes « codes » qu’ils ne comprennent pas ! Honte à ces critiques qui disent que mes livres seraient mal écrits, qu’ils seraient trop universitaires, « à la limite de la probité intellectuelle », et que je me sers du thème sensationnaliste du viol pour faire parler de moi ! Honte à tous ces gens ! Leurs actes parlent contre eux ! C’est leur silence sur l’homosexualité qui tue véritablement nos frères homosexuels, et non ce que je dis sur le viol !
Leur faut-il un dessin pour qu’ils comprennent ? Ne voient-ils pas qu’ils se servent du Sida, de l’« Homophobie », du soi-disant « devoir de cohésion communautaire », ou de la course aux « droits des homos », comme des cache-misère pour nourrir leur propre homophobie intériorisée et continuer à haïr leurs « amis » homosexuels dans un parfait semblant de camaraderie ? Par leur désinvolture, leur mollesse, leur ignorance, leur relativisme, ils cultivent le déni et le mensonge. J’ai envie de hurler ! OUI, j’ai la haine ! Je suis en colère devant tant d’hypocrisie sociale sur le viol, hypocrisie qu’ils nourrissent en prétextant toujours que ce sont les autres les fautifs et eux les victimes !
En 2009, j’ai reçu un mail très long d’un pédopsychiatre qui est tombé par hasard sur le site de l’Araignée du Désert, et qui m’encourageait à continuer d’écrire sur le viol, à diffuser mon message, parce qu’il suit beaucoup de patients homosexuels ; et il m’assure que la plupart d’entre eux ont été violés ou ont subi des attouchements sexuels dans leur jeunesse. Quand je lis ce genre de témoignages, qui viennent à moi sans que j’aie eu à les réclamer, je respire, parce que le vent de censure sur la souffrance est tel dans la communauté homosexuelle actuelle qu’à certains moments, j’en arriverais à douter de moi-même, à me dire que j’y vais un peu trop fort en parlant du viol en lien avec l’homosexualité, même si j’ai toujours veillé à minoriser ce thème à une poignée de personnes homosexuelles pour ne pas le transformer en généralité sur « les » homos.
Ce n’est pas la première fois qu’un membre du personnel soignant m’interpelle vivement à ce sujet. Déjà, en 2010, dans un hôpital public de Paris, lors d’une prise de sang pendant laquelle j’avais sympathisé avec une infirmière spécialisée dans les maladies infectieuses (et qui, m’a-t-elle dit, voyait défiler une flopée de personnes homosexuelles dans son cabinet), m’a coupé la parole : « Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de patients homosexuels que je rencontre ici et qui me racontent leur viol ! C’est hallucinant ! » À chaque fois qu’on me confirme dans mes découvertes, je tombe des nues. J’ai beau y être préparé, je n’arrive jamais à m’y faire ! C’est quand même fou ! Je suis pris entre la révolte de devoir taire ces révélations par respect de la confidentialité, et l’immense joie de recevoir le cadeau de la confiance que je n’attendais absolument pas et qui m’est spécialement offert, même s’il concerne un sujet très grave. Alors au fur et à mesure que j’avance dans la vie, j’emmagasine les preuves d’amour, j’emmagasine… (dans mon coffret à araignées étincelantes)… et à un moment donné, je n’en peux plus de garder tous ces bijoux pour moi ! Il n’y a plus de place. Ça déborde ! J’en détiens, des secrets lourds, qui bien souvent sont ignorés du conjoint de ces mêmes amis (qui ne lui ont rien dit du viol qu’ils ont vécu !), au point que je passe parfois aux yeux de leur « moitié » pour un dangereux « briseur de couples » ou un « fouteur de merde » si je tente ne serait-ce que de soulever un peu le couvercle de leur tambouille conjugale explosive ! Mais je sais de quoi je parle, puisque j’ai entendu les choses de mes propres oreilles, vu en tête à tête des amis me parler du drame de leur vie (que parfois ils banalisent pour « aller de l’avant », pour « croire en l’amour homo quand même »). Et ça, ça ne s’oublie jamais. J’ai écrit d’ailleurs un article du Phil de l’Araignée sur ce site, intitulé « Ari-Baba et les 40 Violés », pour raconter en détail ce que mes 90 amis homosexuels violés m’avaient confié. Pour qu’on me croie. Pour sortir enfin du tabou. Car comme le dit le sociologue Daniel Welzer-Lang (qui est allé à la rencontre de groupes de parole où se trouvait une majorité de personnes gay, et qui est resté pourtant très discret sur la question de l’homosexualité), il existe une énorme chape de plomb sur les liens non-causaux entre désir homosexuel et peur, désir homosexuel et violence, désir homosexuel et souffrance : « À les écouter, il n’est pas abusif de parler de TABOU. Il ne s’agit pas seulement de honte. […] Comment expliquer que des hommes – qui pour certains ont lutté des années ensemble, revendiquant le droit de disposer de leur corps, de leurs désirs, des hommes qui, contrairement à d’autres mâles, ont pris l’habitude de se rencontrer pour parler d’eux, de leur vie la plus intime…– n’aient jamais parlé de ces scènes de viol entre eux ? Énoncent même qu’ils n’en ont jamais discuté avec leurs compagnons après plusieurs années de vie commune… Quel est le sens de ce tabou ? » (Daniel Welzer-Lang, Le Viol au masculin, 1988) Il est temps que ça cesse. C’est pour tous mes amis homosexuels (présents et à venir) qui ont subi des violences et d’énormes drames (avant coming out, après coming out, et en général avant et après) que j’écris ces lignes. Pour qu’on ne vous oublie pas !
N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Coït homosexuel = viol », « Adeptes des pratiques SM », « Homosexuel homophobe », « Voleurs », « Violeur homosexuel », « Milieu homosexuel infernal », « Pédophilie », « Inceste », « Inceste entre frères », « Prostitution », « Oubli et amnésie », « Poupées », « Destruction des femmes », « Défense du tyran », « Entre-deux-guerres », « Amant diabolique », « Témoin silencieux d’un crime », « Déni » et « Femme vierge se faisant violer un soir de carnaval ou d’été à l’orée des bois », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.
1 – PETIT « CONDENSÉ »
Rentrons dans le vif du sujet, avec ce petit condensé du code « viol », dans lequel j’aborderai les grandes lignes de réflexion sur les liens entre désir homosexuel et viol. Pour commencer, on ne dit pas assez, dans la production intellectuelle consacrée à l’homosexualité, que quelques scientifiques se sont déjà penchés sur la question des liens entre viol et orientation homosexuelle : Stoller, Finkelhor, Johnson, Shrier, Dorais, Welzer-Lang, etc. Je vous indique plus particulièrement les témoignages de sujets homosexuels violés dans l’essai L’Homosexualité dans tous ses états(2007) de Pierre Verdrager, l’essai Ça arrive aussi aux garçons (1997) de Michel Dorais, ainsi, bien sûr, que Le Viol au masculin (1988) de Daniel Welzer-Lang, précédemment cité.
Liens entre désir homosexuel et viol :
uniquement de coïncidence
Tennessee Williams a livré ce qui me semble être une des clés de l’énigme homosexuelle à travers la réplique d’Élisabeth Taylor « Le prologue fut la clairière des chênes » prononcée dans le film « Suddenly Last Summer » (« Soudain l’été dernier », 1960) de Joseph Mankiewicz (Catherine s’est/se serait fait violer dans une forêt, et souffre d’amnésie suite à l’événement qu’elle assimile à l’homosexualité de son cousin Sébastien). Je crois en effet que le désir homosexuel est né d’un viol fantasmé – et parfois réel –, et de la hantise désirante de son retour. Le récit d’adolescence de Frédéric Mitterrand concernant un de ses camarades en fournit un exemple éloquent : « Un jour, il fait semblant de vouloir me violer pour faire rire la compagnie ; […] je me relève, j’insulte les rieurs, et je m’enfuis. Je me joue sans conviction la comédie de la blessure irréparable mais je ne triche pas longtemps, je préfère admettre la vérité : j’aimerais tellement être seul avec lui et qu’il recommence. » (Frédéric Mitterrand, La Mauvaise vie (2005), p. 193) Ensuite, le désir de viol a pu se faire acte en s’intériorisant durablement en orientation homosexuelle, à défaut de s’actualiser en viol génital.
Le mot « viol », dans le sens courant du terme, désigne des relations sexuelles imposées avec pénétration et punies par la loi comme un délit, ou bien des attouchements sexuels non mutuellement consentis par les deux personnes qui les pratiquent. Mais, à mon avis, le viol réel n’est pas réductible à la pénétration ni aux rapprochements corporels visiblement sauvages. Nous pouvons très bien violer ou être violés à distance, sans nécessairement que les corps se touchent. Par exemple, les images brutales et policées que nous montre le cinéma nous violent bien souvent dans la mesure où elles nous ôtent partiellement nos sens, notre liberté, et nous éloignent de la Réalité. À mon sens, le viol doit s’entendre également comme le fait d’être pris pour Dieu (et non une créature humaine), pour quelqu’un d’autre que soi, pour une photocopie, pour une moitié d’homme, pour un Homme invisible, pour un objet, pour un mythe.
Ce qui me fait établir des liens entre homosexualité et viol, ce sont d’abord les vécus des personnes homosexuelles (certaines ont été abusées dans leur enfance, et cela de manière numériquement peu significative), et surtout l’univers symbolique qu’elles développent dans leurs créations. Très rares sont les productions artistiques homo-érotiques où le parallèle entre viol et homosexualité n’est pas fait, où la femme violée cinématographique n’apparaît pas comme un modèle esthétique à imiter.
Plus qu’un viol réel, un fantasme
Il ne faut pas perdre de vue que le viol à l’état de désir n’est pas le viol réel, même s’il a pu être suscité par un viol réel ou un regard réifiant. Le terme de viol est fortement soumis à notre subjectivité, et parfois employé à outrance par les personnes homosexuelles. Certaines prouvent à travers leurs jeux d’acteurs grandiloquents que leur identification au viol a l’excès des fantasmes. « Je suis le viol génital. Je suis la violence pure » déclarent certains hommes transsexuels (Psychosis, dans le documentaire « God Save The Queens », La Nuit gay, diffusé sur la chaîne Canal + le 23 juin 1995. Son discours fait écho à la chanson « Travesti » de Sadia dans le spectacle musical Starmania de Michel Berger : « Je suis le sexe démystifié, je suis la violence personnifiée. »). Il est par exemple fréquent d’entendre dans la bouche des femmes lesbiennes l’amalgame entre l’amour femme-homme et le viol (selon certaines, les hommes seraient tous des violeurs en puissance !).
On connaît mal l’origine de ce fantasme de viol. Il naît sûrement de l’ébahissement de l’Homme face à la découverte de sa liberté et de son unicité. Je reprendrai les termes de Jean-Paul Sartre pour décrire l’émergence de l’homosexualité : « On ne naît pas homosexuel ou normal : chacun devient l’un ou l’autre selon les accidents de son histoire et sa propre réaction à ces accidents. Je tiens que l’inversion n’est pas l’effet d’un choix prénatal, ni d’une malformation endocrinienne ni même le résultat passif et déterminé de complexes : c’est une issue qu’on découvre au moment d’étouffer. » (Jean-Paul Sartre, Saint Genet, comédien et martyr (1952), p. 94) Beaucoup de personnes homosexuelles ont cru très tôt – et continuent de croire à l’âge adulte – qu’elles doivent troquer leur réification déifiante (par la simulation de souffrances atroces ou d’euphorie extatique) contre leur liberté si elles veulent conserver l’amour des autres. Déjà petites, elles ont développé une passion secrète, existentielle même, pour le viol, ou plutôt l’image intérieure de ce qu’elles s’imaginaient être le viol, pour retenir toute l’attention de leur entourage (remémorons-nous les simulations de crises nerveuses d’André Gide, de Yukio Mishima, de Jean Cocteau, de Marcel Proust, etc.). Beaucoup se sont dites intérieurement que leur fantasme de viol, une fois représenté sur elles-mêmes, pouvait être une manière d’être reconnues et d’exister en tant que fétiche sacré. Elles recourent à un fantasme violent pour exister aux yeux d’autrui.
Le viol dont elles parlent est souvent une impression de viol née d’un fantasme de persécution : « J’étais convaincu que j’allais être violé, brutalisé, agressé sexuellement par un homme inconnu, d’une façon qui rappelle la réalité crue d’un viol. » (Rick Moody dans À la recherche du voile noir (2004) de Nelly Kaprièlian) Ce fantasme ressemble à l’enthousiasme qu’il est fréquent d’observer chez les jeunes enfants demandant aux adultes de leur entourage « de les attraper » et de les pourchasser, même si évidemment, ils désirent sans se le formuler explicitement que le viol reste uniquement sur le terrain du jeu et de la représentation.
Le désir de viol peut être aussi l’expression d’une peur de se reconnaître aimable, de sentir un regard désirant posé sur son corps érotisé : aux yeux du violeur comme du violé potentiels, tout ce qui est corporel ou lié à l’amour est considéré comme du viol, toutes les séparations nécessaires de l’existence (la coupure avec le sein de la mère – « Je dois quitter mon unité fusionnelle avec ma génitrice et sortir du ventre maternel pour vivre. » –, la reconnaissance de la différence des sexes – « Je ne serai jamais l’autre sexe. » –, le respect de la différence des espaces – « Je suis unique et je ne serai jamais les autres. ») sont vécues comme de cruelles injustices. La sexualité est mise à distance à travers l’expression d’une angoisse de viol qui parle du sexe sans le vivre. Le viol devient alors la création verbale de celui qui ne veut pas que sa souffrance soit démasquée. Comme l’écrit à juste titre Jacques Arènes, « dans le rapport à l’autre, la perte d’estime de soi peut être ressentie comme un vol ou un viol. Tout le monde semble témoin de notre humiliation. » (Jacques Arènes, Souci de soi, Oubli de soi (2002), p. 58) L’amour, mettant en lumière une réalité désagréable, concrète ou fantasmée, semble « faire violence » (quand bien même il ne la fasse pas), parce que sans son éclairage solaire, nous ne nous serions pas aperçus de l’existence de nos ombres portées. L’autre a découvert notre douleur d’exister, nos fragilités, notre homosexualité que nous voulions à tout prix cacher, et a fait irruption dans notre intimité honteuse. Comme il nous appelle à nous ouvrir au monde, et qu’il exerce une intrusion pour entrer en relation avec nous, nous pouvons croire qu’il nous viole. Le viol est parfois l’autre nom donné à la peur de ne pas être aimé, et à l’occasion que nous offrent les autres d’en sortir.
Quelquefois, ce que les personnes homosexuelles appellent « viol » est aussi tout simplement l’expression de la divergence entre leurs désirs et ceux des autres, divergence qu’elles traduisent en termes d’opposition brutale parce qu’elles veulent leur imposer leurs propres désirs. L’esprit adolescent qui crie au viol et au fascisme pour un oui pour non est celui qui se persuade qu’on lui a tout imposé, car en réalité c’est lui qui veut imposer sa volonté au reste du monde.
Le viol fantasmé, un avant-goût improbable du viol réel
Une chose est sûre : le viol ne provoque pas automatiquement l’homosexualité. Il existe entre eux des croisements qui ne relèvent pas de la causalité. L’homosexualité peut être tantôt le fruit d’un fantasme ne renvoyant à aucun viol réel, tantôt le fruit, et quelquefois l’arbre d’un viol réel. Je prends soin de souligner ce « quelquefois », parce que tout Homme est fondamentalement libre et qu’il n’est pas uniquement le produit de ce que les épreuves de la vie ont fait de lui, il ne reproduira pas forcément les agressions qu’il a subies. Cette capacité à s’adapter aux blessures de l’existence et à rebondir après les chocs, porte un nom : la résilience. L’attitude résiliente, qui passe par une nécessaire formulation des événements ou une analyse de leurs versions imagées, soutient qu’être traité injustement n’est rien, excepté si nous ruminons inlassablement les injustices dont nous avons/aurions pâti.
Si les liens entre désir homosexuel et viol restent assurément de coïncidence, et donc peu inquiétants, on peut se demander cependant dans quelle mesure le fait de les nier en diabolisant les liens de causalité cette fois (à travers notamment une fixation sur le viol uniquement génital), ne les encourage pas à s’actualiser imparfaitement dans la réalité concrète.
L’insistance sur la génitalité concernant le viol est due au phénomène de la sacralisation-déni du viol dans nos sociétés actuelles. L’opinion publique a été habituée à ne considérer le viol que sous l’angle du génital (autrement dit le plus spectaculaire et le plus paranoïaque), et plus rarement dans son sens figuré, psychologique et symbolique. C’est une manière pour elle de ne pas en parler et de cacher/nourrir ses propres frustrations sexuelles. Le viol, en même temps qu’il est nié ou banalisé par la société voyeuriste et frigide, est vu partout : dans les regards (le fameux « délit de regard » puni par certaines lois nord-américaines), les blagues potaches, les étreintes amicales, le moindre contact physique entre femmes et hommes, etc. C’est le désir sexuel lui-même qui est la cible d’une société qui ne voit les individus que par le génital, en oubliant paradoxalement les corps.
Le viol réel est toujours à entendre comme le viol génital, bien sûr, mais il est d’abord à envisager dans son sens symbolique, c’est-à-dire dans sa version fantasmatique non-actualisée : il signifie prioritairement l’intrusion violente du mythe, des objets, de l’image déréalisée, du fantasme, du paraître, dans la Réalité. Le passage du fantasme à la réalité concrète est toujours dramatique (il aboutit au meurtre, au viol, aux agressions, etc.). Mais le désir de viol, quant à lui, n’est pas nécessairement choquant, parce que non systématiquement actualisé : comme il agit davantage sur le terrain de l’imaginaire que de la réalité concrète, contrairement au viol génital, il peut être contré par la liberté humaine. Il constitue pourtant bien une bombe à retardement, mais il n’est pas de même nature que le viol génital. Il est plutôt synonyme de discours imposé du conteur, de kitsch, de douce captation de l’imaginaire par la fantaisie, de regard idolâtre qui dit « je vais te manger… », qui demande « dévore-moi ! transperce-moi ! ».
En effet, les regards aussi peuvent violer. Dès que nous observons une personne davantage comme un objet qu’en tant qu’Homme, en privilégiant son paraître à son être, nous lui faisons violence. Par exemple, Pedro Almodóvar montre bien que le drame initial de beaucoup de personnes homosexuelles est le fait d’avoir été considérées comme des objets. Dans son film « Tacones Lejanos » (« Talons aiguilles », 1991), Rebeca (Victoria Abril) est mise à prix, en boutade, par son beau-père dans un marché. Cet événement anodin aura des retombées dramatiques puisqu’une fois adulte, elle l’assassinera pour se venger. À partir du moment où quelqu’un veut nous faire image, y compris pour nous porter aux nues, il nous viole, et ce « viol symbolique » dont parle Pierre Bourdieu n’est pas moins réel que le viol génital avec contact forcé des corps. Jean-Paul Sartre, concernant Jean Genet, ne mâchait pas ses mots quand il écrivait dans Saint Genet (1952) que « Genet, sexuellement, est d’abord un enfant violé » : « Ce premier viol, ce fut le regard de l’autre, qui l’a surpris, pénétré, transformé pour toujours en objet. Qu’on m’entende : je ne dis pas que sa crise originelle ressemble à un viol, je dis qu’elle en est un. » (p. 96) Le regard du viol n’est pas toujours désagréable : il peut être, comme le décrit Marcel Jouhandeau dans Carnets de Don Juan (1947), « plus grave qu’une nuit d’amour » (p. 96). Ce n’est pas un hasard si les scènes de viol dans les œuvres homosexuelles se déroulent généralement pendant l’été, un soir de carnaval, à l’orée d’un bois, c’est-à-dire à un moment où le jeu l’emporte sur le respect de l’Homme, où le mythe, l’air de rien, contamine la réalité concrète, où la fête carnavalesque devient accidentellement sérieuse, où la conscience humaine est au repos.
Dans mon étude du désir homosexuel, je prends le viol d’abord dans son sens symbolique étant donné qu’il est un fantasme bien avant d’être parfois un fantasme actualisé. La conscience violée ou qui désire être violée, par réflexe de survie, se crée une fiction qui va occulter, dans le rose ou bien dans le noir, la réalité désagréable qu’elle a (peut-être) vécue. Parce qu’elle a probablement été utilisée, elle va se croire fétiche magique… même si concrètement ce sceptre est brisé. Comme, selon elle, elle a été cassée en deux, divisée en deux moitiés androgyniques, elle craint que la recherche de son unité agisse comme une rupture totale avec ce qu’elle est vraiment ; et paradoxalement, elle croit que la rupture totale avec elle-même va lui permettre de ne faire plus qu’Un. Le viol devient alors, dans son esprit, son unité. C’est ce qui fait dire à Neil, le héros homosexuel du film « Mysterious skin » (2004) de Gregg Araki, que le viol pédophile dont il a été victime dans sa jeunesse l’a rendu unique. En effet, en parlant de son violeur, il lui reconnaît la découverte de son unicité : « J’étais son seul amour, son seul trophée. J’étais unique. » Le viol a le pouvoir de donner à ses victimes une impression d’unité dans la réification et la contrefaçon d’amour (= je suis un fétiche donc je suis aimé), alors que pourtant, comme le montre la scène du viol pédophile de « La Mala Educación » (« La mauvaise éducation », 2003) de Pedro Almodóvar durant laquelle le visage d’Ignacio se scinde en deux à l’écran, il cultive en elles ce désir de l’androgyne, les brise en deux, et leur annonce que sans lui elles ne valent rien.
Viol génital homo
et fracture sociale entre les femmes et les hommes
Il est clair que même si la majorité des personnes homosexuelles n’ont pas été concrètement « violées » dans le sens commun et légal du terme, certaines se sont cependant fait violer par un membre de leur famille, du même sexe qu’elles ou du sexe opposé avec lequel elles n’étaient pas consentantes. Dans les cas recensés, nous trouvons par exemple Virginia Woolf, Vincent McDoom, Lawrence d’Arabie, Manuel Puig, Jean Genet, Marc Batard, François Augiéras, Carolyn Kage, Miguel Frías Molina, Juan Soto, Aleister Crowley, David Wojnarowicz, etc. Cela transparaît par le traitement particulièrement réitéré du viol dans les fictions créées par des auteurs homosexuels. Demandez à n’importe quel psychiatre s’il a parmi ses patients homosexuels des victimes de violences sexuelles : bien qu’il ne soit pas de son ressort d’en faire une généralité, il lui est difficile de le nier. Mais nul besoin d’être spécialiste pour constater par exemple la forte représentativité des personnes homosexuelles lors des galas de charité organisés pour la lutte contre les violences sexuelles, ou bien pour écouter les confidences d’amis homosexuels qui ont été abusés dans leur adolescence. Lorsqu’on aborde la question du lien entre viol et homosexualité dans une assemblée, elle soulève généralement un tollé fascinant à voir. Puis, en fin de réunion, il arrive qu’une poignée d’individus vienne nous voir pour nous dire le bien que cela leur a fait de voir leur drame – ou leur fantasme de drame – enfin dévoilé !
Le désir de viol n’est pas proprement homosexuel : tout Homme possède, à différents degrés, des fantasmes de viol (surtout dans les moments où ça ne va pas), quelle que soit sa nature sexuée et son orientation sexuelle. Le désir du viol existe en chaque personne homosexuelle, non du fait de son homosexualité mais simplement de son humanité ; mais néanmoins il convient de rajouter que, compte tenu du fait qu’ensuite ce désir est généralement plus développé chez l’Homme blessé ou désirant être blessé que chez l’Homme moins agressé sexuellement ou au désir moins masochiste, et que les personnes homosexuelles sont dans leur majorité des individus qui ont vécu la différence des sexes comme une blessure, il semble important de dire que le désir de viol chez elles tendance à être plus particulièrement marqué.
Le désir de viol chez beaucoup de personnes homosexuelles procède très souvent d’une peur panique de la sexualité. Ce qui l’illustre le plus explicitement sont les scènes cinématographiques où sont montrés des enfants observant un viol ou bien un adulte forcé d’être témoin d’un coït violent entre une femme et homme. L’enfant-voyeur se retrouve face au sexe (qu’il croit) violé. Il symbolise ce tiers exclu du spectacle coïtal, ce dernier s’organisant souvent dans l’esprit de certaines personnes homosexuelles comme une image de guerre dans le pire des cas (Bruce Chatwin, par exemple, affirme concernant ses parents que son « enfance fut la guerre et le sentiment de la guerre »), au mieux comme un fantasme de viol fascinant. Les personnes homosexuelles ont rarement résolu leur complexe d’Œdipe, et en veulent à leurs parents (réels et surtout symboliques/télévisuels) de les avoir trahies, abandonnées. Elles ont pu les surprendre en train de faire l’amour sans amour, et sont reparties dégoûtées du sexe en croyant le connaître. « D’où naît l’angoisse devant la scène primitive ? De la démesure d’une sexualité incompréhensible à l’enfant, de l’excitation qui l’assaille, de ce que les parents s’en mêlent… L’exclusion de la scène signe l’amour trahi. Au commencement était la trahison. » (Dominique Scarfone, De la trahison, 1999) Leur désir homosexuel nous dit que les fantasmes de l’inceste et du viol n’ont pas été intégrés. Or, comme l’écrit Jacques André, « pour être vraiment libre et heureux dans sa vie amoureuse, il faut s’être familiarisé avec la représentation de l’inceste » (Jacques André, « Le Lit de Jocaste », Incestes (2001), p. 19) et la violence naturelle inhérente à toute sexualité humaine.
C’est sans doute la raison pour laquelle la majorité des personnes homosexuelles ont vécu généralement leur première rencontre génitale avec la personne aimée beaucoup plus tardivement que les individus dits « hétérosexuels ». Elles sont venues à la sexualité à reculons, « parce qu’il fallait bien », passant ainsi d’un état subi (= l’adolescence continente) à un autre (= le sexe à la chaîne). Il est assez frappant, quand on discute avec certaines femmes lesbiennes, de constater leur vision très violente de la rencontre génitale avec les hommes : elles pensent qu’elles vont « se faire prendre par le mâle » (Muriel Bonneville, Mi-ange, mi-démon (2006), p. 11). Fantasmatiquement, beaucoup de personnes homosexuelles voient leur mère souffrir pendant qu’elle est possédée par les hommes. « Pendant longtemps, j’ai été jaloux de ma mère à cause de mon grand-père ; dans mon imaginaire, je le voyais en train de la violer avec son sexe énorme ; je voulais intervenir ; et c’était impossible. » (Reinaldo Arenas, Antes Que Anochezca (1990), p. 31)
Il est probable que le viol que les personnes homosexuelles ont cru subir est celui de la séparation excessive entre les sexes, mais aussi celui de l’absence de séparation. Socialement, l’effacement progressif des espaces féminins et masculins va crescendo. La parité et la mixité sont des valeurs de plus en plus imposées – et donc menacées – dans nos civilisations, et le trouble pour celui qui essaie de se construire une identité sexuée et d’apprivoiser son corps de femme ou d’homme s’accentue. La définition sexuelle semble être laissée non plus à la Nature, à l’extérieur, à la société, à la famille, aux parents, mais à l’appréciation personnelle de l’individu qui risque, du coup, de ne plus savoir qui il est. De l’excès du partage des sexes connu dans les siècles antérieurs, nous sommes passés à un autre, tout aussi handicapant pour la réalisation de la rencontre entre femmes et hommes : le retrait de la démarcation.
Il est handicapant dans la mesure où la séparation temporaire, loin d’impliquer nécessairement la rupture, peut dans le meilleur des cas signifier « reconnaissance », « condition préalable à la relation », « espace d’échanges », « préparation de la rencontre ». Une société qui laisse ses membres se regrouper et se séparer selon les âges, les sexes, les religions, les cultures, les pays, les passions communes, les affinités, les convictions politiques, les liens familiaux, etc., est une collectivité humaine qui respire la démocratie. L’encouragement à la distinction entre les sexes n’a rien de militaire ni de « fasciste » : c’est l’empêcher à tout prix (sous couvert d’« égalité de droits » ou « des sexes » par exemple) qui devient totalitaire.
Les personnes homosexuelles, par ce qu’elles sont et désirent, expriment ce malaise social de l’indifférenciation des sexes. La plupart du temps, elles le justifient : certaines n’acceptent pas la distinction filles/garçons faite dans les écoles, les hôpitaux, au seuil des toilettes et des vestiaires, chez le coiffeur, dans les dictionnaires, etc., parce que pour elles, elle équivaut à la séparation totale entre les sexes, et plus fondamentalement à la remise en cause de leur désir d’être tous les sexes. Mais de temps en temps, inconsciemment, elles regrettent que l’effacement de cette frontière empêche les femmes et les hommes de se rencontrer.
Le désir homosexuel est l’indicateur de la blessure que la femme et l’homme s’infligent dans leur couple par l’image médiatique d’abord, et parfois dans la réalité concrète. L’homme est actuellement de plus en plus condamné à porter l’étiquette du « beauf bourrin » et ennuyeux ou du parfait prince charmant qu’il n’est pas. La femme, quant à elle, est réduite à l’image de tigresse « salope » ou de femme au foyer, blonde et soumise. L’un comme l’autre se réifient à l’image… si bien qu’au final, certaines femmes et certains hommes réels ne veulent plus se côtoyer simplement, et prétendent parfois s’autosuffire dans l’affirmation d’une homosexualité ou d’un isolement fier de lui-même. Beaucoup de femmes et d’hommes actuels s’enlisent dans le débat sexiste, ou esthétisent leur angoisse par rapport à la disparition des membres du sexe « opposé » en questionnement disco (« Où sont les Femmes ? ») n’indiquant pas un renoncement aux mythes télévisuels de l’hypervirilité ou de l’hyperféminité, mais au contraire une réinstauration de ceux-ci.
Certaines personnes homosexuelles illustrent en image que c’est en partie l’abandon des femmes par les hommes, ou l’abandon des hommes par les femmes, qui ont fait d’elles « des homos ». Il est indéniable, même si nous ne pouvons pas en faire une règle, qu’il y a énormément d’enfants de parents divorcés parmi les personnes homosexuelles, ou bien de jeunes adultes dont les géniteurs restent ensemble par convenance ou pour l’image. Il n’est pas très étonnant non plus que les militants gay les plus intransigeants sur la pureté homosexuelle soient aussi ceux qui ont un passé hétérosexuel particulièrement lourd. Ce conflit (fantasmé) entre leurs parents peut se traduire par une intériorisation identificatoire, un sentiment de bâtardise (largement mis en mots par Rosa Bonheur, Violette Leduc, Jean Genet, ou encore William Shakespeare), une affirmation officielle d’une identité homosexuelle factice qui est à l’image du clash entre leur père et leur mère. Le « Je souffre de votre (possible) désunion » se mute en « Papa et maman, je suis homo… et je garderai secret votre (désir de) divorce. »
Pour conclure, je dirais que les liens entre désir homosexuel et viol n’ont pas à être centrés sur les individus homosexuels ni même sur leurs couples. Le désir homosexuel est d’abord le signe social du manque d’amour, voire des viols, au sein de certains couples femme-hommes. C’est la raison pour laquelle il ne faut pas le banaliser, mais au contraire le considérer comme un prodigieux moyen de dénonciation des dysfonctionnements des couples hétérosexuels, pour aider justement les hommes et les femmes à mieux se rencontrer.
2 – GRAND DÉTAILLÉ
FICTION
Dans les fictions homo-érotiques, il est extrêmement fréquent, même dans celles qui veulent donner une image positive de l’homosexualité, que le personnage homosexuel ait vécu le viol ou vive dans la crainte/désir de son retour :
a) Le viol réel :

Affiche Concert « N°5 » de Mylène Farmer au Stade de France, en 2009, en tournante… pardon, en tournée
On retrouve le thème du viol dans la B.D. Du côté des violés (1977) de Copi, le film « Abuse » (1983) d’Arthur J. Bressan JR, le film « Mauvais genres » (2001) de Francis Girod (avec l’homo violé), le film « Prends-moi » (2005) d’Everett Lewis, le film « Violent » (1950) de Nicholas Ray, le roman L’Amant des morts (2008) de Mathieu Riboulet (où Jérôme se fait violer par son père), le film « La Source ou la fontaine de la jeune fille » (1960) d’Ingmar Bergman, le film « Comment le désir vient aux filles (Je suis frigide mais je me soigne) » (1972) de Max Pécas, le film « Les Mille et une nuit » (1974) de Pier Paolo Pasolini, le film « Almost Normal » (2005) de Marc Moody, le film « Les Voleurs de chevaux » (2007) de Micha Wald, le film « Only The Brave » (1994) d’Ana Kokkinos, le film « Postcards From America » (1994) de Steve McLean, le film « L’Ombre d’Andersen » (2000) de Jannik Hastrup, le film « Zatoïchi » (2003) de Takeshi Kitano (avec l’enfant violé), le film « L’Homme de cendres » (1986) de Nouri Bouzid (avec l’homo violé), le film « L’Immeuble Yacoubian » (2006) de Marwan Hamed (avec l’homo qui a été violé par le domestique nubien noir), le film « Vil Romance » (2009) de José Celestino Campusano (avec Roberto qui jadis a été violenté par son père), le roman La Cité des rats (1979) (avec le viol collectif de l’albatros), le film « Jin Nian Xia Tian » (« Fish and Elephant », 2001) de Yu Li, le film « Bénis soient ceux qui ont soif » (1997) de Carl Jorgen Kioning, le film « Mon Capitaine, un homme d’honneur » (1997) de Massimo Spano, le film « Stir » (1980) de Stephen Wallace, le film « La Capote qui tue » (1997) de Martin Walz, le film « Tianshi Xin » (1995) de Lee Fu, le film « Pixote, la loi du plus faible » (1980) d’Héctor Babenco, la série The L World (dans laquelle une des héroïnes lesbiennes est violée dans une fête foraine), le one-man-show Cet homme va trop loin (2011) de Jérémy Ferrari (avec le Père Vert, curé gay et pédophile, jadis violé par son père et par ses profs), le film « Birth 3 » (2010) d’Anthony Hickling (avec le viol dans un parking), la série Julie Lescaut (dans un des épisodes, une lesbienne y est violée), la chanson « Coming out » d’Alexis HK (« Je remercie toute l’équipe de la Gare Saint-Lazare… »), le film « Adieu ma concubine » (1993) de Chen Kaige (avec l’homo violé), le film « Bad Boys » (1983) de Rick Rosenthal, le film « Squat » (1999) de Jean-Daniel Cadinot, le film « Ghosts Of The Civil Dead » (1989) de John Hillcoat, le film « Scum » (1979) d’Alan Clarke, le film « Gutten Som Kunne Fly » (1993) de Svend Wam, le film « Le Quatrième homme » (1983) de Paul Verhoeven, le film « Night Corridor » (2003) de Julian Lee (avec l’homo violé), le film « Cheap Killers » (1998) de Clarence Fok, le film « 2 by 4 » (1997) de Jimmy Smallhorne, le film « L’Été de Kikujiro » (1999) de Takeshi Kitano (avec l’enfant violé), le film « Khroustaliov, ma voiture ! » (1997) d’Alexei Guerman, le film « Hustler White » (1997) de Bruce LaBruce et Rick Castro (avec le viol collectif), le film « Out Back » (« Le Réveil dans la terreur », 1971) de Ted Kotcheff, le film « Cowboy Jesus » (1996) de Jamie Yerkes, le film « Olivier Olivier » (1991) d’Agnieszka Holland (avec Grégoire Colin violé), le film « Au-delà du bien et du mal » (1976) de Liliana Cavani, le film « Délivrance » (1971) de John Boorman, le film « Uroki V Kontse Vesnoy » (1989) d’Oleg Kavun, le roman Un Voyage au Mont Athos (1988) de François Augiéras, le film « Strange Fruit » (2004) de Kyle Schidkner, le film « Shinjuku Kurashakai » (« Les Affranchis de Shinjuku », 1995) de Takashi Miike, les films « Les Voleurs » (1996) et « J’embrasse pas » (1991) d’André Téchiné, le film « Gigola » (2010) de Laure Charpentier, le film « Sexual Dependency » (2002) de Rodrigo Bellott, le film « Évadés » (1994) de Frank Darabont, le film « Multiple Maniacs » (1971) de John Waters, le film « El Topo » (1971) d’Alejandro Jodorowsk, le film « Fièvre à Colombus University » (1995) de John Singleton (avec la lesbienne violée), le film « Lonesome Cowboys » (1968) d’Andy Warhol, les films « Violence et Passion » (1974) et « Rocco et ses frères » (1961) de Luchino Visconti, le film « Sleepers » (1996) de Barry Levinson, le film « Priscilla, folle du désert » (1995) de Stephan Elliot, le film « Verdict » (1974) d’André Cayatte, le film « The Mudge Boy » (2002) de Michael Burke, le film « American History X » (1998) de Tony Kaye, les pièces Roberto Zucco (1989), Quai Ouest (1985), et Dans la solitude d’un champ de coton (1985) de Bernard-Marie Koltès, le film « L’Homme blessé » (1983) de Patrice Chéreau, le roman Boquitas Pintadas (Le plus beau tango du monde, 1972) de Manuel Puig, les films « Pepi, Luci, Bom Y Las Chicas Del Montón » (« Pepi, Luci, Bom et autres filles du quartier », 1980), « Hable Con Ella » (« Parle avec elle », 2001) et « Kika » (1993) de Pedro Almodóvar, la nouvelle « Fiord » (1969) d’Osvaldo Lamborghini, le film « Raping ! » (1978) de Yasuharu Hasebe (avec le viol d’un homme par un gang de motards), le film « Le Jardin des délices » (1967) de Silvano Agosti, le roman Le Viol de Lucrèce (1946) de Benjamin Britten, le roman Querelle de Brest (1947) de Jean Genet, le film « Portier de nuit » (1973) de Liliana Cavani, le film « Les Valseuses » (1973) de Bertrand Blier, le roman Tout ce qui est à toi… (2000) de Sandra Scoppettone, le film « Violent Cop » (1989) de Takeshi Kitano, le roman Le Reflet d’une ombre (2004) de Jonathan Denis, le film « 5×2 » (2004) de François Ozon, le film « Reviens, Jimmy Dean, reviens » (1982) de Robert Altman, le film « Flying With One Wing » (2002) d’Asoka Handagama, le film « Multiple Maniacs » (1970) de John Waters, le film « Mysterious Skin » (2004) de Gregg Araki, le roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar (avec Anamika, l’héroïne lesbienne violée dans un bus), le film « La Soif du mal » (1958) d’Orson Welles (avec le viol collectif), le film « Boys Don’t Cry » (1999) de Kimberly Peirce (avec le viol « correctif » de la lesbienne), le film « Él Y Él » (1980) d’Eduardo Manzanos, le film « Festen » (1998) de Thomas Vinterberg (avec Christian l’homosexuel violé), le roman Le Cœur volé (1871) d’Arthur Rimbaud, le film « Vito E Gli Altri » (1992) d’Antonio Capuano, le film « La Tendresse des loups » (1973) d’Ulli Lommel, le film « Les Désarrois de l’élève Törless » (1966) de Volker Schlöndorff, le film « Le Viol du vampire » (1967) de Jean Rollin, le film « Visage pâle » (1985) de Claude Gagnon (avec le viol collectif), le film « Sin Destino » (1999) de Leopoldo Laborde (avec l’homo violé dans son enfance), le film « Toto Che Visse Due Volte » (1998) de Daniele Cripi et Franco Maresco (avec la scène du viol collectif de l’ange), le film « Acla » (1992) d’Aurelio Grimaldi, le film « Irréversible » (2001) de Gaspar Noé, la pièce Penetrator (2009) d’Anthony Neilson (avec Dick, l’homo violé par les penetrator homosexuels), le film « Harvey Milk » (2009) de Gus Van Sant (avec Jack violenté par son père), le film « Rachel Getting Married » (« Rachel se marie », 2009) de Jonathan Demme (avec le coiffeur homosexuel abusé), le film « Claude et Greta » (1970) de Max Pécas (Claude a été violée dans sa jeunesse), le film « Baise-moi » (2000) de Virginie Despentes (avec le viol de Manu), le film « Les Amants criminels » (1998) de François Ozon (Luc est violé par un ogre), le film « AAPJMW » (2009) de Antoine+Manuel, le film « Little Gay Boy, Christ Is Dead » (2012) d’Antony Hickling (avec le viol du puceau, Jean-Christophe, à Paris), la série Mon petit renne (2024) de Richard Gadd, etc.
Par exemple, dans le film « Die Mitter der Welt » (« Moi et mon monde », 2016) de Jakob M Erwa), Glass a été mise enceinte à 16 ans aux États-Unis et vit désormais en Allemagne. Son fils, Phil, le héros homo, est fruit de ce viol. Dans le roman Julia (1970) d’Ana Maria Moix, Julia, une femme lesbienne, a été violée dans son enfance par un ami de la famille. Dans le roman A Sodoma En Tren Cobijo (1933) d’Álvaro Retana, Burney et son ami César endorment Nemesio pour le violer dans sa chambre. Mylène Farmer se fait violer dans les vidéo-clips de ses chansons « Plus grandir », « Je te rends ton amour », et « L’Annonciation ». Le viol est déclencheur de l’amour homosexuel dans le film « Drefting Gravity » (1997) de John Keitel. Dans le film « Priscilla, folle du désert » (1995) de Stephan Elliot, Félicia se rappelle d’un souvenir d’enfance : son oncle, nu dans son bain, l’a forcé(e) à plonger la main dans l’eau pour masturber son sexe, et lui a fait promettre de garder le secret. Dans la pièce Dépression très nerveuse (2008) d’Augustin d’Ollone, le Dr Labrosse, quand il était encore enfant de chœur, a été violé par le personnage qui joue le prêtre. Dans le film « Circumstance » (« En secret », 2011) de Maryam Keshavarz, Shirin, l’un des deux héroïnes lesbiennes, est forcée de voir un chauffeur de taxi (dans lequel elle est rentrée) se masturber avec son pied à elle. Dans le téléfilm « Clara cet été-là » (2003) de Patrick Grandperret, le lesbianisme de Clara survient du viol (par les mecs : le musicien, les autres garçons de la colo qui l’agressent verbalement et physiquement), de la peur de la génitalité, de la violence de la pression de la drague entre ados. Dans le film « La Vie d’Adèle » (2013) d’Abdellatif Kechiche, l’homosexualité d’Adèle naît de la pression sociale à « niquer », à « faire couple » à tout prix : les amies lycéennes d’Adèle la poussent littéralement dans les bras de Thomas, avec qui elle vivra un coït qui ne se passera pas bien. Dans la série Sex Education (2019) de Laurie Nunn, un automobiliste homophobe voit Éric, le héros homo, déguisé en travelo (« Enfoiré de gay ! »), le viole et le tabasse (c.f. épisode 5 de la saison 1). Et dans la chambre de Jackson (c.f. épisode 8 de la saison 1), les lesbiennes sont présentées comme des personnes violées et violentes : Jackson a un poster « Lesbians » où une poitrine de femme est touchée par plusieurs mains baladeuses.
Nombreux sont les personnages homosexuels qui utilisent le mot « viol » dans leurs répliques : « Le violoncelle, c’est plutôt gai/gay ! » (Camille dans son one-woman-show Vierge et rebelle (2008) de Camille Broquet) ; « Hélas ! Amour, que tu fus consterné lorsque tu vis ce temple profané. » (Voltaire, L’Anti-Giton, 1714) ; « Et bien moi, dans le poulailler, je me suis fait violer par Yves Lecoq ! » (Jean-Philippe, l’homosexuel de la pièce Coming out (2007) de Patrick Hernandez) ; « J’me suis fait violer ! » (Sébastien l’homosexuel dans la pièce Qui aime bien trahit bien !(2008) de Vincent Delboy) ; « T’as peut-être été violé. » (Corinne s’adressant au narrateur homosexuel, dans le one-man-show Jérôme Commandeur se fait discret (2008) de Jérôme Commandeur) ; « Ils ne pensaient qu’à eux-mêmes. Ils ne me voyaient pas. Ils me violaient. S’en rendaient-ils seulement compte ? C’était une routine pour eux. » (Hadda la servante noire violée, dans le roman Le Jour du Roi(2010) d’Abdellah Taïa, p. 202) ; « J’me fais violer tous les soirs par le même concombre. » (Albert dans le one-man-show Hétéro-Kit (2011) de Yann Mercanton) ; « Pawel lutta continuellement avec des sentiments de haine contre Smokrev, convaincu qu’il avait été volé et violé. » (Pawel Tarnowski, homosexuel continent, parlant de l’homosexuel pervers Smokrev, dans le roman Sophia House, La Librairie Sophia (2005), p. 308) ; « Ce que j’aurais fait à cette époque de ténèbres, d’autres me l’avaient fait. » (Pawel parlant du viol pédophile qu’il a subit par son mentor Goudron, idem, p. 441) ; « Si le viol, le poison, le poignard, l’incendie, n’ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins, le canevas banal de nos piteux destins, c’est que notre âme, hélas !, n’est pas assez hardie. » (c.f. la chanson « Au lecteur » de Mylène Farmer, reprenant Charles Baudelaire) ; etc.

B.D. « Femme assise » de Copi
Le viol dont il est question est parfois le viol social subi à l’école, au collège ou au lycée. « Mon surnom, c’est Toupie, tu sais très bien. Avec tes potes, vous me faites tourner… » (Benjamin s’adressant à son amant Arnaud, dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit) On peut citer par exemple le viol de l’homosexuel Mourad dans les vestiaires par ses camarades, dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot. Dans la pièce Ça s’en va et ça revient (2011) de Pierre Cabanis, Hugo l’homo s’est fait casser la gueule en classe de CM1 sur la cour de récré. Dans le film « No Se Lo Digas A Nadie » (« Ne le dis à personne », 1998) de Francisco Lombardi, le jeune Joaquín à 8 ans et un autre de ses camarades scouts se violent mutuellement sous une tente, et se promettent de garder le silence. Dans le film « Camionero » (2013) de Sebastián Miló, Randy est victime d’un viol collectif au lycée militaire. Dans le film « Imitation Game » (2014) de Mortem Tyldum, le mathématicien homosexuel Alan Turing s’est fait maltraiter au collège par ses camarades de pensionnat. Ils l’ont même séquestré sous un plancher de bois clouté. Dans le film « Moonlight » (2017) de Barry Jenkins, Chiron, le jeune héros homosexuel, est violenté par ses camarades parce qu’il ne sait pas se défendre et qu’il se fait traiter de « tapette » ou d’« homo ».
Mais le viol surgit surtout dans la sphère familiale. Certains héros gays ont été battus par leurs parents ou ont vu ces derniers se maltraiter. Par exemple, dans la pièce À toi pour toujours, ta Marie Lou (2011) de Michel Tremblay, Roger et ses frères sont les enfants du viol : « Comme les trois autres fois où tu m’as violée, tu m’as fait un autre petit ! » (Mari Lou, la mère de Roger, à son mari). Dans le film « Scènes de chasse en Bavière » (1969) de Peter Fleischmann, les deux protagonistes homos (Rovo, le semi-demeuré, et Abram, le héros principal) ont été maltraités. D’ailleurs, Barbara, la mère d’Abram, décrit inconsciemment les violences domestiques comme le terreau de l’homosexualité de son fils : « P’têt que j’aurais pas dû le battre comme ça. » Dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, Kévin s’est fait frapper par son père quand il était petit ; et la description des coups est suffisamment chargée d’ambiguïté (et d’inceste !) pour présenter le viol comme le détonateur du désir homosexuel du héros : « J’aurais voulu être Superman pour l’éclater. Mais un soir, il s’en est pris à moi. J’étais en CP, j’avais ramené un bulletin de notes un peu moins bon que d’habitude. Il m’a mis tout nu, m’a allongé sur le lit… j’étais terrifié. Il a défait sa ceinture et a commencé à me frapper, sans tenir compte de mon âge, comme si j’étais un adulte ou un criminel. Mais le bulletin, ce n’était qu’un prétexte. Il trouvait que j’avais l’air efféminé. À six ans ! Il me traitait de petit pédé, qu’il allait faire de moi un homme. » (p. 422)
Dans la pièce Ma belle-mère, mon ex et moi (2015) de Bruno Druart et Erwin Zirmi, Julien, le héros homosexuel, se rend compte qu’il a été violé par sa belle-mère Solange : « Pourquoi vous m’avez violé ?? » La belle-mère ricane : « Violé… Tout de suite les grands mots… » Finalement, Solange se rabat sur Yoann, l’amant efféminé de Julien. Elle lui fonce dessus, et ce dernier, au départ, résiste : « Elle voulait me violer ! C’est elle ! C’est moi qui était en-dessous. » Puis finalement, pour une affaire d’héritage, Yoann accepte de faire un gosse à la quinquagénaire.
Le viol, c’est tout simplement l’autre nom donné au manque d’amour, de désir (entre parents et enfant par exemple ; ou entre les parents). « Je cache des vérités importantes depuis que j’ai 13 ans. » (Erik, le héros homosexuel dépucelé à 13 ans, dans le film « Keep The Lights On » (2012) d’Ira Sachs) ; « J’ai toujours pensé que ce qui avait rendu Erika chaotique dans son comportement sentimental, c’est une enfance malheureuse. […] Et curieusement, elle ne semble pas avoir eu vraiment conscience de ce malheur. De son enfance, elle a toujours dit : ‘Ce n’était pas marrant, mais il y a pire.’ Évidemment, matériellement il y a pire. La première fois qu’elle a prétendu que sa mère la détestait, je ne l’ai évidemment pas crue. […] Pourtant, quand j’ai vu Elisabeth Westermann, j’ai su qu’Erika disait la vérité. Sa mère ne la détestait peut-être pas, mais elle lui manifestait une telle indifférence que cela revenait au même, ou pire. » (Suzanne, l’héroïne lesbienne du roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, p. 189) ; « Bon, d’accord, ton mari t’a violée. » (Zulma parlant à sa fille Alba dans la comédie musicale Se Dice De Mí En Buenos Aires (2010) de Stéphan Druet) Le personnage homosexuel est souvent le témoin involontaire d’un viol entre un homme et une femme, et cette scène reste gravée en lui comme un traumatisme : « Stephen avait erré jusqu’à un vieux hangar où l’on rangeait les outils de jardinage et y vit Collins et le valet de pied qui semblaient se parler avec véhémence, avec tant de véhémence qu’ils ne l’entendirent point. Puis une véritable catastrophe survint, car Henry prit rudement Collins par les poignets, l’attira à lui, puis, la maintenant toujours rudement, l’embrassa à pleines lèvres. Stephen se sentit soudain la tête chaude et comme si elle était prise de vertige, puis une aveugle et incompréhensible rage l’envahit, elle voulut crier, mais la voix lui manqua complètement et elle ne put que bredouiller. Une seconde après, elle saisissait un pot de fleurs cassé et le lançait avec force dans la direction d’Henry. Il l’atteignit en plein figure, lui ouvrant la joue d’où le sang se mit à dégoutter lentement. Il était étourdi, essayant doucement la blessure, tandis que Collins regardait fixement Stephen sans parler. Aucun d’eux ne prononça une parole ; ils se sentaient trop coupables. Ils étaient aussi très étonnés. […] Stephen s’enfuit sauvagement, plus loin, toujours plus loin, n’importe comment, n’importe où, pourvu qu’elle cessât de les voir. Elle sanglota et courut en se couvrant les yeux, déchirant ses vêtements aux arbustes, déchirant ses bas et ses jambes quand elle s’accrochait aux branches qui l’arrêtaient. » (Marguerite Radclyffe Hall, The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928), pp. 38-39) L’homosexuel croit qu’il est le résultat d’un viol. « Mon père viole Ourdhia, le couteau taillade son sexe, j’ai peur. » (Nina Bouraoui, La Voyeuse interdite (1991), p. 73) Par exemple, dans le roman La Cité des rats (1979) de Copi, le Diable des Rats apparaît à Gouri pour lui annoncer le secret de sa conception : « Je suis ton père que tu n’as pas connu ; j’ai violé ta pauvre souris blanche de mère vierge dans le caniveau de la rue de l’Ancienne-Comédie un soir de folie. » (p. 117) Dans la pièce Fixing Frank (2011) de Kenneth Hanes, Frank, le héros homosexuel, dit qu’il s’est fait battre par ses parents quand il était petit : « Mon père me frappait au visage. » Il explique que le fait que ses parents le battent tous les deux, « ça consolidait leur mariage ».
En général, le viol que subit le personnage homo concerne d’abord le/son couple, et les relations sentimentales entre héros homosexuels. Il se rapporte tout autant aux relations femme-homme qu’aux relations homme-homme ou femme-femme. Par exemple, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, R. raconte qu’il s’est fait violer par un certain Laurent, « un fils de pute qui voulait pas mourir seul et qui a violé ma jeunesse » (p. 71). Dans la pièce Gothic Lolitas (2014) de Delphine Thelliez, Rinn, l’une des héroïnes lesbiennes, force son amie Suki à l’embrasser sur la bouche, par jeu et « pour s’entraîner ». Cela finit mal car elles sont surprises par Juna et Kanojo. Suki est inanimée suite au baiser. Un peu plus tard, Rinn crie au viol à cause des actes de ses amies : « J’ai pas demandé à être tripotée comme ça. C’est pas de ma faute ! Laissez-moi ! Je ne veux pas qu’on me touche ! » Je reparle plus longuement du viol au sein du couple homo dans mon étude des codes « Coït homosexuel = viol » et « Liaisons dangereuses », ainsi que de l’homophobie homosexuelle avec le code « Homosexuel homophobe » dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels.
Il est fréquent que le viol que le héros homosexuel connaît soit tout simplement la pratique homosexuelle et qu’il soit perpétré par ses pairs homosexuels : cf. le film « Camionero » (2013) de Sebastián Miló (avec le viol collectif sur Randy au lycée militaire), etc. « Selon le rituel de nos frères de Russie, nous allons te purifier. » (les Virilius, commando d’homosexuels refoulés s’adressant à Jean-Marc, l’infiltré homosexuel, qu’ils vont torturer, dans la pièce Les Virilius (2014) d’Alessandro Avellis)
Enfin, le viol renvoie également à une violence dirigée vers soi-même, soit par la masturbation, soit par le suicide : « À l’avenir, je me violerai sur un tapis dans le pré. » (Anthony, l’un des hréos homosexuels du roman At Swim, Two Boys, Deux garçons, la mer (2001) de Jamie O’Neill) ; « Y yo / pillaba yo ! » (cf. le poème « Anales » de Néstor Perlongher); etc.
b) Le viol fantasmé (= craint et désiré) :
Comme on vient de le voir, la mention du viol ne repose pas toujours sur un viol réel. Il peut être l’expression d’une crainte de la sexualité en général et de la différence des sexes en particulier, parce que certaines personnes l’ont vue par accident abîmée (cf. je vous renvoie au chapitre « Peur de la sexualité » dans le code « Symboles phalliques » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels). Par exemple, dans le one-woman-show Wonderfolle Show (2012) de Nathalie Rhéa, l’héroïne lesbienne, en voyant arriver un homme vers elle alors qu’elle est au volant d’une voiture, croit d’abord qu’il s’agit d’un violeur, avant de découvrir que c’est un flic.

Vidéo-clip de la chanson « Mon coloc » de Max Boublil
Le désir homosexuel du personnage homo semble survenir à la suite d’un viol ou d’une diabolisation paranoïaque de la sexualité, et des hommes en particulier (chez les héroïnes lesbiennes surtout) : « On hurle, on flâne, on regarde, on triche, on vole. Et ils violent. » (Nina Bouraoui, La Voyeuse interdite (1991), p. 9) ; « Les hommes, ils m’ont fait… j’étais toute petite en plus… ils m’ont fait… RIEN. » (Océane Rose Marie dans son one-woman-show La Lesbienne invisible, 2009) ; « Il [le mari de Rani] m’apparut en imagination, un type laid au visage grêlé et aux mains sales. Riant et la prenant à son corps défendant. Soulevant son sari pour l’envahir. Poussant un brusque gémissement avant de s’endormir. Exactement comme dans un film que j’avais vu à la télé. Je voulais le tuer. » (Anamika, l’héroïne lesbienne dans le roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, pp. 58-59) ; etc.
Par exemple, dans le film « Le Sable » (2005) de Mario Feroce, par exemple, la paranoïa du viol chez Mahaut, la protagoniste lesbienne, la fait aller vers le lesbianisme (on la voit se faire accoster puis agresser par un homme sur les quais de Seine, et immédiatement après, croiser le regard de sa future promise). Dans l’épisode 86 « Le Mystère des pierres qui chantent » de la série Joséphine Ange-gardien, diffusée sur la chaîne TF1 le 23 octobre 2017, Louison, l’héroïne lesbienne, est angoissée par sa première fois (sexuelle, et avec un mec). De son angoisse d’être dépucelée va naître la conviction qu’elle est vraiment homosexuelle. Dans le roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, Suzanne traite tous les hommes de violeurs : « On ne peut pas m’objecter que mon expérience des hommes est courte : Gaston et quelques violeurs. » (pp. 84-85) D’ailleurs, quand sa meilleure amie, Anne, lui demande explicitement si elle a déjà été violée, Suzanne lui répond avec malice « Évidemment » (idem, p. 152). Dans le one-woman-show Mâle Matériau (2014) d’Isabelle Côte Willems, une femme travesti en homme, « Virgo Fortis », est pourchassée par « des soldats qui veulent la violer ». En restant célibataire et en cherchant à échapper à son sexe, elle prétend « échapper au mariage-inceste-viol ». Dans le film « Drool » (2009) de Nancy Kissam, Anora devient lesbienne parce qu’elle est maltraitée par son mari. Dans le film « Corps à corps » (2010) Julien Ralanton, c’est le même scénario : l’héroïne arrive au lesbianisme après s’être fait violer par deux inconnus dans un coin de rue.

B.D. « Kang » de Copi
Le violence cachée du couple homosexuel, calqué sur celle du couple hétéro, est devinée et crainte par beaucoup de personnages homosexuels : « J’ai échappé au viol ! » (Mimil, au moment où Jeff lui fait des avances, dans la pièce Les Babas cadres (2008) de Christian Dob) ; « Je crois que mon coloc [homosexuel] va me violer. » (cf. la chanson « Mon Coloc » de Max Boublil) ; « Pas elle ! Elle va me violer !! » (Camille face à sa nouvelle camarade de cellule carcérale Caroline, avec qui elle formera finalement un couple après sa conversion au lesbianisme, dans le one-woman-show Vierge et rebelle (2008) de Camille Broquet) ; etc. C’est parfois le regard réifiant ou un sourire violent (cf. la pièce Chroniques des temps de Sida (2009) de Bruno Dairou) qui a symboliquement violé le personnage homosexuel : « À cause de ce regard sur moi, la virginité en moi se sent soudain violée. » (cf. une réplique de la pièce Dans la solitude des champs de coton (1985) de Bernard-Marie Koltès) ; « T’as réagi comme si j’avais abusé de toi. » (Oliver rappelant à Elio la première fois où il lui a massé/touché l’épaule, dans le film « Call me by your name » (2018) de Luca Guadagnino) ; etc.
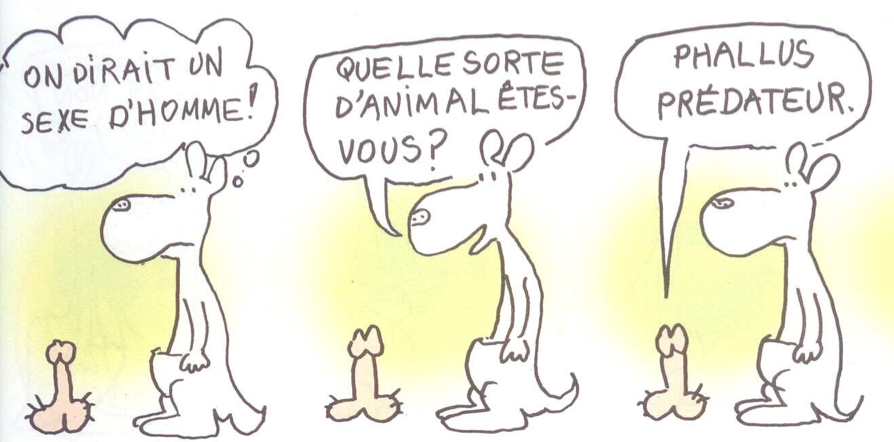
B.D. « Kang » de Copi
Parfois, le spectateur ou le lecteur peut douter de la vraisemblance de ce viol, qui ressemble davantage à un bobard ou à un conte imaginaire inventé par le héros pour se faire plaindre, pour frémir et pour exister, qu’à un viol réel. « Je me bats contre une douleur fantôme qui me hante depuis des mois, des années. » (Muriel Bonneville, Mi-ange, mi-démon (2006), p. 7) ; « J’ai peur de devenir folle. Toutes les nuits je rêve qu’on me viole. » (cf. la chanson « Les Adieux d’un sex-symbol » de Stella Spotlight dans l’opéra-rock Starmania de Michel Berger).
C’est également la superstition populaire qui associe parfois l’homosexualité au viol. Par exemple, dans le film « Kick-Ass » (2009) de Matthew Vaughn, Dave est suspecté d’être gay après avoir été retrouvé nu suite à une agression urbaine. Cela dit, toute superstition trouve son explication sur un substrat de réalité (… réalité au moins désirante).
Le plus incroyable survient quand les héros homosexuels se mettent à transformer le viol en fantasme. Comme dit Genet, ils « bandent pour le crime ». Par exemple, dans la pièce Chroniques des temps de Sida (2009) de Bruno Dairou, le héros se découvre homo après avoir été violé, mais paradoxalement, définit son homosexualité comme « une perle intérieure ». Dans la chanson « Viole d’amour » du groupe Cassandre, le viol est à la fois avoué et dénié pour l’annonce de l’amour homosexuel futur (« Il a l’âge de ton père, c’est peut-être le tien, il t’a mis en enfer ce matin. Il a violé ton cœur […]. Mais oublie ce viol d’amour car moi je t’aime. »). Dans le roman très autobiographique Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, Ednar, le héros homosexuel, couche à l’armée trois fois avec Octave, son violeur d’adolescence : « Je ressentais ce désir comme une sorte de revanche pour satisfaire égoïstement ma propre libido. » (p. 92) Dans le one-man-show Raphaël Beaumont vous invite à ses funérailles (2011) de Raphaël Beaumont, le narrateur homosexuel se rend sur un drôle de site internet, « Syndromedestockholm.com », pour y retrouver et draguer son violeur : « Quand j’étais enfant, j’ai été violé. Franchement, c’était génial. Et ce site m’a permis de retrouver la trace de mon violeur. Et je suis drôlement content d’avoir retrouvé mon grand-père. » Dans le film « Métamorphoses » (2014) de Christophe Honoré, le camionneur (Jupiter) a déjà violé Lio, et s’en prend à la jeune Europe, qui ne se dérobe même pas : « Tu as compris qui j’étais ? Je t’enlève, Europe. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Je te kidnappe. » La jeune lycéenne, au lieu de se révolter, se laisse faire : « Tu me sauves. » Dans son one-man-show Bon à marier (2015), Jérémy Lorca dit sa fascination pour Déborah, un piège-à-hommes : « C’était mon idole. » Et il se met à parodier la chanson de Nancy Sinatra « Bang-Bang » : « Vous étiez tous gendarmes et violeurs. Et je criais gang-bang. Et j’adorais gang-bang. »
Dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, la femme violée est considérée par l’héroïne lesbienne Jane comme une sœur jumelle : « Les filles qui se font violenter sont souvent hyper sexualisées. » (p. 55) ; « À partir de maintenant, Anna Mann était livrée à elle-même. Plus d’une fille sur deux était victime d’abus sexuels. C’était la façon dont tournait le monde et on n’y pouvait rien. » (idem, p. 89) ; « On aurait dit qu’elle se préparait pour un gang bang. » (idem, p. 99)
Dans le film « À trois on y va ! » (2015) de Jérôme Bonnell, Mélodie, l’héroïne bisexuelle, est avocate… mais au lieu de défendre la justice, elle se sert de son pouvoir de magistrat pour couvrir le délit ou le crime. Par exemple, face à un contrôle de police où son ami Michel manque de souffler dans un ballon alors qu’il est alcoolisé au volant, elle fait preuve de persuasion avec un policier pour échapper in extremis au retrait de permis… et ça marche. Plus tard, Mélodie a en charge un pervers qu’elle prend en pitié, qu’elle parvient à défendre en plaidoirie, en faisant passer les attouchements sexuels qu’il a fait sur une femme pour un dérapage : « Il s’agit d’un geste d’amour qui a mal tourné. » Mais à la fin du film, elle se retrouve face à une récidive beaucoup plus grave du même violeur, puisque cette fois, il est passé au viol. Elle a donc couvert et laisser courir en liberté un agresseur multi-récidiviste. Face à ses amis qui s’étonnent qu’elle ait défendu l’injustifiable, elle joue d’abord l’indifférence professionnaliste (« Bien sûr que je vais le défendre. C’est mon métier. ») avant de fondre carrément en larmes, surprise par une culpabilité inconsciente qui déborde en elle (« Je n’en peux plus de toute cette merde. Je ne sais plus à quoi m’accrocher ! ») Tout le film montre que, au même moment qu’elle vit son homosexualité, Mélodie défend à plusieurs reprises le viol : il y a une corrélation constante entre plaidoirie du viol et justification de la banalité/beauté de l’amour bisexuel/asexué.
Parfois, le héros homosexuel considère le viol comme SA Vérité profonde : « Je ne désespérais pas de lui avouer, un jour, ‘ma’ vérité. » (Ednar dans le roman autobiographique Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 181) ; « J’veux être une brouette. » (Sarah, l’héroïne lesbienne, dans le film « Respire » (2014) de Mélanie Laurent) ; « Qu’on me viole, qu’on m’attrape, j’ai besoin d’un bon coup. » (cf. la chanson « L’Hymne à l’amour » de David Courtin) ; etc.
Certains personnages homos disent explicitement qu’ils désirent le viol (et posent la question qu’on n’attendait pas : « Que faire quand on trouve notre violeur beau ? ») : « De ma vie, je ne m’étais jamais fait baiser sans le vouloir. Je sais maintenant que tout peut arriver. Et que, même sans le vouloir, on peut aimer cela. » (Bjorn, l’un des héros homos du roman Riches, cruels et fardés (2002) d’Hervé Claude, p. 154) ; « Je ne veux pas qu’elle s’introduise. J’aime être contrainte. Je ne veux pas qu’elle m’introduise. Même si elle me dit qu’elle m’aime. » (SweetLipsMesss dans le spectacle de scène ouverte Côté Filles au 3e Festigay du Théâtre Côté-Cour, en 2009) ; « Tu pries pour que ton frère, comme toi, au même moment, soit blotti dans les bras d’un beau jeune homme plein de vigueur, et qui prendrait soin de toi comme d’une poupée. » (Félix à propos d’un soldat allié, Bob, dans le roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 132) ; « La façon dont elles l’avaient traité ne le choqua point ; il trouvait les deux vieux travelos adorables, il se mit à bander. » (le prince Koulotô désirant ses deux violeurs, dans la nouvelle « Les Vieux Travelos » (1978) de Copi, p. 90) ; « Nature du décès : j’me suis fait violer par trois beaux jeunes hommes. » (Lucienne dans la pièce Quand je serai grand, je serai intermittent (2010) de Dzav et Bonnard) ; « J’aimerais bien prendre un coup. » (Jules, le héros homosexuel dont la langue a fourché car il pensait dire à la serveuse « Je vais prendre un coup », dans la pièce Les Sex Friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau) ; « J’préfère encore me faire tripoter par un prêtre comme mes copains cathos quand ils vont au caté. » (Laurent Spielvogel à propos du rabbin à qui il va rendre visite, dans son one-man-show Les Bijoux de famille, 2015) ; « Les garçons préfèrent toujours ceux qui les malmènent. » (idem) ; « Le jour, la nuit, surtout, j’aimerais qu’on me viole. Je mettrais ma parole tous les mâles sur mes genoux » (c.f. la chanson « Ah ! Si j’étais une fille ! » de Gabriello) ; etc.
L’excitation d’être violé et d’avoir été violé ressort chez tous les personnages homosexuels du roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, par exemple : « Cody dit ‘Je m’a suis fait voler. Nourdine il a tout volé, l’argent et la caméra de New York University que j’avais empruntée. Oh my god, on habitait ensemble, et cette matin, je m’est levé et tout avait disparu dans l’appartement.’ Je l’accompagne pour porter plainte. Je lui dis ‘Ça te plaît, hein, que ce mec t’ait volé ? C’est la preuve que tu avais raison d’avoir peur. Maintenant ça te fait jouir d’avoir été une femme violée et volée, c’est comme si ton rêve magique d’être une femme avait été poussé au maximum.’ Cody, pris en faute, me regarde de travers. » (Mike, le narrateur homosexuel, s’adressant à son pote gay nord-américain Cody, p. 111) ; « Cody cherche des Arabes. Il est obnubilé, il dit ‘Je sens que je pourrais être une femme avec eux parce qu’ils se servent de ton corps comme celui d’une femelle, tu vois, comme si t’étais une objet de plaisir et que tu n’existais pas comme personne.’ » (Cody, idem, p. 91) ; « Tu crois que c’est comme les pédés qui cherchent à se faire violenter dans le SM, tu finis toujours par t’apercevoir à un moment ou un autre que ce qu’ils recherchent dans cette violence contrôlée (parce qu’elle est donnée dans un cadre sexuel strict) c’est de vivre ce qu’ils ont le sentiment de mériter en tant que pédé. Genre je suis pédé, je mérite de me faire tabasser, je me fais honte, steplé, tabasse-moi pour que je sois en concordance avec moi-même. Tu crois pas ? » (Polly, op. cit., p. 47) ; « Vianney consent à une rencontre, chez moi, mais il ajoute ‘Les yeux bandés. Tu ne dois jamais voir ma laideur repoussante.’ J’accepte. Les jours qui précèdent la rencontre, je les passe dans un état de surexcitation incroyable. Le jour prévu, à l’heure prévue, il frappe trois coups contre la porte, notre code secret. Je place mon bandeau, et j’ouvre en me demandant si je n’ouvre pas ma porte à un voleur, un tueur de sang froid ou un violeur. Peut-être que j’en aurais envie… » (Mike racontant son « plan cul » avec un certain Vianney, op. cit., p. 84) ; « Polly [l’héroïne lesbienne] dit que le sida n’est pas une fatalité, que les pédés doivent arrêter de penser qu’ils le méritent. ‘C’est faux, c’est même archi-faux, affirme-t-elle, c’est comme quand vous pensez que vous méritez de vous faire agresser. Faut arrêter avec tout ça, on ne mérite pas le sida ni de se faire agresser quand on est pédé. Par contre, on peut se demander si cette propension des pédés à croire ça ne cache pas plutôt une forme d’auto-homophobie intériorisée.’ Elle a tort. » (Mike, op. cit., pp. 72-73) ; etc.
Dans la pièce Ma première fois (2012) de Ken Davenport, c’est quand sa copine lui résiste (« Arrête, lâche-moi ! ») qu’une des héroïnes lesbiennes se dit encore plus excitée (« Ça, ça me fait bander comme un cheval ! »). Dans la pièce Les Gens moches ne le font pas exprès (2011) de Jérémy Patinier, Lourdes demande à son public qu’il la fouette, la batte, et la viole. On retrouve le rêve d’être violé dans le film « Girls Will Be Girls » (2004) de Richard Day. Dans la pièce Tante Olga (2008) de Michel Heim, l’héroïne toute heureuse d’avoir été violée par « le Cosaque ». Dans la pièce String Paradise (2008) de Patrick Hernandez et Marie-Laetitia Bettencourt, Louna fait croire qu’elle a été violée pour exister aux yeux de ses amies. Dans la pièce La Mort vous remercie d’avoir choisi sa compagnie (2010) de Philippe Cassand, au moment où Omar arrive chez Marcel pour lui demander l’hospitalité (« Allez, ouvre, j’vais pas t’violer. »), ce dernier lui répond en boutade : « Ah… c’est dommage… » Dans la pièce Chroniques d’un homo ordinaire (2008) de Yann Galodé, Didier, face à son psy, décrit le cambriolage dont il aurait été l’objet, comme un viol (on découvre ensuite que ce vol était en réalité fictif, pur produit de son imagination, simplement pour le plaisir d’avoir à crier « Au viol ! ») : « Donc j’ai été violé !!!… mais bien sûr au sens figuré ! J’parle de mon appartement ! […] Ils n’ont rien volé. Mais ils auraient pu ! » Dans la pièce Jerk (2008) de Dennis Cooper, il est fait référence à « l’obsession de violence » chez les personnages. Dans la pièce Dépression très nerveuse (2008) d’Augustin d’Ollone, le Dr Labrosse fantasme de se faire violer par un jeune Sénégalais de 16-17 ans appelé « Babacar ». Dans le film « Strangers In A Train » (« L’Inconnu du Nord-Express », 1951) d’Alfred Hitchcock, Bruno va essayer d’étrangler une vieille femme bourgeoise désirant connaître la sensation d’étouffement. Dans le film « L’Inconnu du lac » (2012) d’Alain Guiraudie, tous les personnages homosexuels désirent le viol et finissent par défendre l’amant qui va les violer/assassiner : Franck, le héros, soutient Michel jusqu’au bout ; et Henri, après avoir couché avec Michel pour préserver Franck, avouera dans son dernier souffle : « J’ai eu ce que je cherchais. » Dans le film « Xenia » (2014) de Panos H. Koutras, Dany, le héros homosexuel efféminé, attise, par sa provocation, la haine de ses agresseurs homophobes et met de l’huile sur le feu en les insultant. Dans le film « Homme au bain » (2010) de Christophe Honoré, quand Emmanuel commence à violenter le jeune étudiant en histoire qu’il va finalement violer (« Tu veux pas que je te fasse mal, non ? »), ce dernier, après un court moment d’hésitation, lui répond sérieusement : « Ben… je sais pas…[…] Ça me gêne pas, la brutalité. » Dans la pièce Les Faux British (2015) d’Henry Lewis, Jonathan Sayer et Henry Shields, Thomas, le héros homosexuel, semble être tout excité de vivre des situations mortelles même fantasmées : « Quelqu’un a fermé la porte. Mon Dieu ! Nous sommes piégés !!! »
L’évocation du viol fantasmé est une technique de drague : le libertin homosexuel joue la victime pour mieux approcher sa proie, l’apitoyer. « Je me suis cyniquement engouffrée dans la brèche qu’elle m’offrait, et je lui ai parlé de mes violeurs. Il était temps, finalement, que ces garçons servent à quelque chose, et dans ce cas précis à justifier mon dégoût des hommes. Du dégoût des hommes au goût des femmes, il n’y a qu’un pas. » (Suzanne par rapport à Agnès, dans le roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, p. 225) ; « J’ai pris ce que tu m’as donné, de mon plein gré. Ce n’est pas de ta faute, Thérèse. » (Carol, l’héroïne lesbienne consolant son amante Thérèse en pleurs, culpabilisant d’avoir couché avec elle, dans le film « Carol » (2016) de Todd Haynes)
Par exemple, dans le roman Accointances, connaissances, et mouvances (2010) de Denis-Martin Chabot, Marcel fait croire à Frédéric qu’il s’est fait violer, pour l’attirer à lui : « Marcel rapplique en expliquant qu’il a rencontré, dans la rue, un couple de garçons, il y a de ça deux jours. Il les a suivis chez eux. Ils l’ont saoulé ou drogué. Il ne se souvient pas du reste de la soirée ou de la nuit. Il s’est réveillé sur un banc, dans une station de métro, alors qu’un policier l’a secoué pour le chasser. Il a mal partout, surtout au cul. Il croit avoir été violé. Ils lui ont aussi pris son portefeuille. » (p. 22) On apprend un peu plus loin qu’il s’agit d’un mensonge amoureux fondé sur la victimisation : « Peut-être par remords d’avoir abusé de la situation, il lui écrit pour tout avouer, d’abord que le récit de Toronto était tout à fait faux, qu’il n’avait jamais quitté Montréal, qu’il s’agissait d’une histoire inventée de toutes pièces pour le rendre plus intéressant à ses yeux. » (p. 23) Pourtant, cela n’empêche pas Marcel de récidiver avec un autre amant, Bertrand : « Ce courriel contrarie Marcel au point qu’il fait attendre sa réplique à son tour pendant toute une semaine. Il envoie alors un message dans lequel il reprend son histoire de fugue à Toronto, son viol et son vol, la même qu’il avait inventée pour Frédéric. » (p. 39) Il faut savoir que le viol est une technique de drague très employée par les personnages homosexuels des fictions pour se faire aimer.
Dans le film « Guillaume et les garçons, à table ! » (2013) de Guillaume Gallienne, Guillaume, le héros bisexuel, pour échapper au service militaire et à l’armée, invente tout un tas de sévices (il plaisante avec le calembour « Sévice militaire », d’ailleurs) qu’il a/aurait subis de la part de ses frères, ses camarades d’école (« Ils étaient 119 sur moi ! »), rapport qui se révèle dissuasif puisque le médecin militaire finit par l’exempter de son devoir d’État : « Il a imaginé des choses tellement immondes qu’il a écrit un rapport de 4 pages. »
Le plus curieux, c’est que parfois, le personnage homosexuel va se persuader d’avoir trouvé son unité dans la brisure du viol (réel) qu’il a subi. « Je plongeai dans la rivière. Baissant l’échine, je remontai un champ de vigne voisin, quand je sentis la masse de l’homme, comme un carapaçon de laine, me plaquer au sol en plein soleil. La chaleur de sa poigne se propagea jusqu’à mon cœur, et figea ma volonté. Il murmura à mon oreille les mots étrangers du manque et du désir. Il me lécha la nuque et le cou. Il écarta mes fesses et y colla ses joues râpeuses pour m’enduire de salive, tout en caressant mes hanches. J’avais plus que la chair de poule, mon corps tremblait tout entier comme si je n’étais plus qu’un cœur énorme, badoum, badoum… […] Quelque chose se tordait et craquait en moi. » (la voix narrative de la nouvelle « La Carapace » d’Essobal Lenoir, Le Mariage de Bertrand (2010), p. 15) ; « Je me sens si différent. Comme si avant, j’avais un corps mais j’étais pas dedans. » (Didier après son expérience homo, dans la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Ceglia) ; « Je n’aimais pas son haleine à l’odeur de bière et de cigarette. […] Quand j’ai été dans sa bouche, j’ai trouvé ça divin. J’ai oublié qui j’étais. » (le jeune Mathan parlant de sa première fois homosexuelle, dans la pièce Un Cœur en herbe (2010) de Christophe et Stéphane Botti) ; etc.
Par exemple, dans le one-(wo)-man show Désespérément fabuleuses : One Travelo And Schizo Show (2013) du travesti M to F David Forgit, le viol et le désir de viol sont tellement imbriqués que le spectateur ne sait plus si c’est du lard ou du cochon : « On m’a encore droguée au GHB ! J’attire cette drogue ! » (la mère) ; « Bien sûr qu’on a abusé de moi ! 30 fois selon l’urgentiste ! Il aurait manqué plus que ça ! » (idem). Tous les personnages vivent leur viol scabreux comme une renaissance et un moment de jouissance incroyable. Par exemple, la jeune lycéenne transgenre M to F Gwendoline a été violée par « deux tapettes » racailles (dont un certain Mounir) dans une cave, et déclare que pour toutes les filles, « le viol et la double pénètr’, c’est le minimum ! » : « Aaaah… les tournantes, c’était vraiment génial ! ». Elle présente le viol comme le coup de grâce qui lui rend sa sainteté et sa virginité (on entend résonner l’« Alleluia » de Haendel) : « Je réalise qui je suis et quel sera mon destin ! »
c) Le personnage homosexuel ou gay friendly aime pousser le cri du viol en imitant l’actrice terrorisée des films d’épouvante :
N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Appel déguisé », « Emma Bovary « J’ai un amant ! » » et « Clown blanc et Masques » dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.
Ce qui m’a mis sur la piste des liens non-causaux entre désir homosexuel et viol, c’est l’insistance des artistes homosexuels à représenter et à s’identifier à l’actrice violée cinématographique.
La figure de la femme violée, notamment, revient très souvent, comme si les héros homosexuels (et leurs auteurs !) cherchaient à s’y identifier (cf. je vous renvoie surtout aux codes « Femme allongée », « Femme-Araignée » et « Femme vierge se faisant violer un soir de carnaval ou d’été à l’orée des bois » dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels) : cf. le film « Du sang pour Dracula » (1972) de Paul Morrissey (avec la défloration de la petite Perla), le film « La Piel Que Habito » (2011) de Pedro Almodóvar (avec un père qui opère sa fille après qu’elle se soit fait violer), le film « La Reine Margot » (1994) de Patrice Chéreau, le roman Les Liaisons dangereuses (1782) de Choderlos de Laclos, le film « Ascetic : Woman And Woman » (1976) de Kim Shu-hyeong, la pièce Baby Doll (1956) de Tennessee Williams (où Archie viole Mégane), le film « Club de femmes » (1936) de Jacques Deval (avec Juliette violée), la comédie musicale Les Miséreuses (2011) de Christian Dupouy (où le Thénardier dit à sa femme qu’il « l’a violée un soir près de Versailles »), le film « La Vie privée de Sherlock Holmes » (1970) de Billy Wilder (Gabrielle, la femme violée amnésique), la chanson « Last Night » de Britney Spears, la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi (avec Solitaire, la femme violée et abandonnée), le film « Praia Do Futuro » (2014) de Karim Aïnouz (avec Dakota, la femme poursuivie par Ayrton), etc.
« Cette fille, Virginie, violée sur la place, et bien c’est moi. […] J’ai toujours été un peu joueuse avec les touristes… […] T’imagines ce que c’est, un viol ?? T’imagines pas ?? C’est l’inverse de donner la vie. On vous prend la vie. Un sentiment de mort. » (Léa, l’héroïne hétérosexuelle de la pièce Scènes d’été pour jeunes gens en maillot de bain (2011) de Christophe et Stéphane Botti) ; « Je suis sentimentale et parfois femme fatale. » (cf. la chanson « Je suis toutes les femmes » de Dalida) ; « Alejandro, please, just let me go ! » (Lady Gaga dans sa chanson « Alejandro ») ; « Je je suis si fragile qu’on me tienne la main ! » (cf. la chanson « Libertine » de Mylène Farmer) ; « Sauvez-moi ! Quand il me soulève et qu’il me prend la main, ma voix se dérègle ! » (cf. la chanson « Sauvez-moi ! » de Jeanne Mas) ; « Elle me montre la première page d’Ici-Paris : une imitatrice de Marilyn Monroe s’est pendue dans sa cellule dans la prison de Regina Celi à Rome : c’est Marilyn, la mienne ! » (le narrateur homosexuel du roman Le Bal des Folles (1977) de Copi, p. 51) ; « Dorita se donna à lui [Silvano] pour la première fois la nuit des adieux, dans la salle de classe, sur le bureau de Silvano, tandis que la pluie fouettait les carreaux. Dorita était vierge. L’expérience fut douloureuse pour tous les deux. » (Copi, La Vie est un tango (1979), p. 12) ; « Rien n’est plus émouvant qu’une belle femme qui souffre. » (Anamika, l’héroïne lesbienne du roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, p. 77) ; « C’était comme si certaines filles portaient une marque secrète que seuls les pervers pouvaient voir. Une fois qu’elles avaient été abusées, d’autres salauds parvenaient à le sentir d’une façon ou d’un autre, et ils les pistaient pour prendre leur tour. […] ‘Pourquoi est-ce que tu cherches sans cesse des excuses à ces hommes ? Ils ont cherché à gagner ta confiance pour abuser de toi. Même le prêtre ; il a préféré ignorer quel âge tu avais. Tu ne fais pas du tout dix-sept ans. Au fond de son cœur, il savait que tu étais trop jeune. Tu ne le vois pas ? ’ » (Jane, l’héroïne lesbienne s’adressant à la jeune Anna, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 242) ; « Encore une fois l’histoire d’une femme trompée. Une de plus… » (Atos Pezzini, homosexuel, parlant des Noces de Figaro, dans le film « Marguerite » (2015) de Xavier Giannoli) ; etc. Par exemple, à la fin du téléfilm « Le Clan des Lanzacs » (2012) de Josée Dayan, on apprend que le requin d’entreprise qu’est devenue Élisabeth (Fanny Ardant) a été violé dans son adolescence. Dans le film « Incidences » (2012) d’Andromak, Anne a été victime d’un viol dès son plus jeune âge. Dans le film « Le Roi de l’évasion » (2009) d’Alain Guiraudie, Armand, homo de 43 ans, empêche le viol d’une jeune femme, Curly, menacée par quatre jeunes hommes. Dans le film « La Robe du soir » (2010) de Myriam Aziza, Juliette, l’héroïne lesbienne, subit un viol d’intimité : son grand frère Adrien rentre dans sa chambre alors qu’elle se déshabille. Dans le one-(wo)man-show Charlène Duval… entre copines (2011), le travesti M to F Charlène Duval s’identifie à Tina Turner, la femme battue par son mari. Dans la pièce Le Cheval bleu se promène sur l’horizon, deux fois (2015) de Philippe Cassand, Catherine, part dans la forêt et y croise un homme diabolique avec « une tête de fou, démoniaque, le sexe à l’air », qui la fait hurler. Tous les personnages de la pièce avouent leur fantasme de viol : « Les sales types, les voyoux comme Herbert, j’adore ça. » (Fabien, le jeune héros homosexuel)

Film « Cabaret » de Bob Fosse
On retrouve ce goût homosexuel pour le cri de la femme violée cinématographique dans le film « Cabaret » (1972) de Bob Fosse (avec Sally aimant hurler au passage des trains), les film « Suddenly Last Summer » (« Soudain l’été dernier », 1960) de Joseph Mankiewicz ou bien « Reflection In A Goldeye » (« Reflets dans un œil d’or », 1967) de John Huston (Elizabeth Taylor y poussent des cris d’anthologie), le film « Passion » (1964) de Yasuzo Masumara (avec le personnage de Mitsuko), la chanson « And I Hate You » de Mélissa Mars, le poème « Cri écrit » (1925) de Jean Cocteau, le film « Strangers On A Train » (« L’Inconnu du Nord-Express », 1951) d’Alfred Hitchcock, le film « L’Attaque de la Moussaka géante » (1999) de P. H. Koutras (avec l’affiche géante d’une actrice de film d’épouvante sur le mur de la chambre), le film « Psycho » (« Psychose », 1960) d’Alfred Hitchcock (avec la scène de Marion sous la douche), le film « Girls Will Be Girls » (2004) de Richard Day (avec l’affiche « My Fair Evie »), le film « La Flor De Mi Secreto » (« La Fleur de mon secret », 1995) de Pedro Almodóvar (avec le concours télévisuel du meilleur cri d’effroi), le film « The Others » (« Les Autres », 2001) d’Alejandro Amenábar (avec Nicole Kidman, la femme violée hurlante), le film « Faster, Pussycat ! Kill ! Kill ! (1985) de Russ Meyer, le film « Office Lady Rape : Disgrace ! » (1990) d’Hisayasu Sato, le film « Sudden Fear » (1952) de David Miller (avec Joan Crawford), le film « Screaming Mimi » (1958) de Gerd Oswald, le film « La Plainte de l’Impératrice » (1990) de Pina Bausch, la comédie musicale Panique à bord (2008) de Stéphane Laporte, les chansons « Fallait pas commencer » de Lio ou « Embrasse-moi Idiot » de Bill Baxter (avec les cris des choristes), la chanson « Me Persigue un Chulo » de Las Ketchup, etc. Par exemple, dans la pièce La Famille est dans le pré (2014) de Franck Le Hen, la sonnerie de téléphone portable de Graziella, la présentatrice-télé, ce sont des cris continus de femme agressée.
Le viol ressemble alors davantage à une posture esthétique tragi-comique qu’à un viol réel : « Il ne me reste qu’à […] hurler qu’on m’a violé et que je vais tout répéter à mes très violents frérots. » (Vincent Garbo qui veut incriminer le prêtre qu’il a perverti, dans le roman Vincent Garbo (2010) de Quentin Lamotta, p. 134) ; « Au secours ! Au viol ! » (le gode vibreur parlant, dans le one-man-show Raphaël Beaumont vous invite à ses funérailles (2011) de Raphaël Beaumont) ; « Papa, ils ont violé mon cœur ! » (cf. la chanson « Libertine » de Mylène Farmer) ; « T’es tellement fou que tu pourrais tous nous violer ! » (Pénélope dans le one-man-show Jérôme Commandeur se fait discret (2008) de Jérôme Commandeur) ; « Ne râlez pas comme ça ! On dirait qu’on vous égorge ! » (une réplique de la pièce Loretta Strong (1974) de Copi) ; « Je suis absolument bouleversée, il vient de m’arriver une chose atroce ! Je me suis fait violer par mon chauffeur, c’est le mari de ma gouvernante, ce sont des gens terrifiants, elle s’habille en gitane pour me faire honte lors de mes réceptions. Elle surveille tous mes gestes, je l’ai surprise à me photographier dans ma baignoire ! Et son mari est un colosse qui m’a violée à deux reprises ! » (« L. » à Hugh dans la pièce Le Frigo (1983) de Copi, p. 13) ; « Quel enlèvement ? Vous avez avalé l’histoire de cette morveuse ? […] La simulation du viol est sa spécialité. » (le Gros en parlant de Graciela à Silvano, dans le roman La Vie est un tango (1979) de Copi, pp. 63-64. C’est moi qui souligne) ; « Jane pensait avoir rêvé de Greta, la mère d’Anna, qui reposait sous le plancher du deuxième étage, mais dans son rêve Greta se mélangait avec des putes d’Alban et la fille assassinée du film ; la façon dont ses yeux s’étaient écarquillés quand le couteau s’était enfoncé. » (Jane, l’héroïne lesbienne du roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 79) ; etc. Dans la pièce Arthur Rimbaud ne s’était pas trompée (2008) de Bruno Bisaro, la voix narrative lesbienne exprime son envie de pousser le cri des petites filles aux garçons qui les poursuivent sur la cour d’école : « Que vous ne nous attrapiez pas ! »
Dans les romans de Thibaut de Saint-Pol, en général, transparaissent justement les fantasmes de persécution homosexuels. On voit que l’auteur, tout masculin qu’il soit, aime particulièrement jouer les Grandes Folles perdues fugitives, se mettre dans la peau de la Drama Queen aux prises avec un ignoble Méchant de dessin animé. C’est palpable dans À mon cœur défendant (2010), où son héroïne Madeleine est poursuivie par un Nazi… et c’est afffffreux : « Je dois quitter Paris au plus vite ! À n’importe quel prix. […] Désemparée, ne sachant pas où aller. […] Pour la première fois de ma vie, je sens la mort qui plane sur moi. Il faut fuir, et vite. » (pp. 20-21) ; « Je voudrais tellement lui dire ce qui m’est arrivé aujourd’hui ! Comment vais-je réussir à garder mon secret ? » (Idem, p. 22) ; « Je risque ma peau. Pour qui ? Pour quoi ? Je n’ai que vingt-quatre ans ! » (idem, p. 49) ; « Je suis la maîtresse d’un espion, d’un traître, d’un ennemi ! » (idem, p. 78) ; « Comment le sort a-t-il pu mettre un Boche sur ma route ? […] Comme je regrette ces nuits d’ivresse ! […] Je suis en danger. Où que j’aille, les nazis me rechercheront. » (idem, p. 78) ; « J’étouffe ! Je me revois dans les bras de cette brute. Grâce au ciel, j’ai échappé au pire. » (idem, p. 86) ; « Ai-je eu raison de fuir ? » (idem, p. 136) La vierge effarouchée s’exprime !
Dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, on retrouve cette même identification esthétisante au viol : je me suis amusé à relever toutes les fois où Lord Bigot a employé l’adjectif « atroce » (… et tous les autres adjectifs avec des « r » ou des « a » dedans, dont la communauté homosexuelle raffole : « affreux », « affligeant », « abominable », « désastreux », « glauque », « pathétique »…). D’ailleurs, ce n’est pas un hasard que dans ce même roman, l’identification à la femme violée soit si marquée (cf. le viol d’Irène par Trudel, ou encore le récit de Bathilde s’identifiant à lady Philippa) : « J’avais rêvé que j’observais le viol de lady Philippa par les vitraux brisés de la chapelle. En même temps, j’étais lady Philippa moi-même. » (p. 303)
Soit parce qu’ils ont vécu un viol réel, soit parce qu’ils ont au moins vécu un effondrement identitaire qui les angoisse et les appelle à vouloir être dominés et être quelqu’un d’autre ( = l’actrice violée sublimée par le cinéma et qui redevient forte en se vengeant), beaucoup de héros homosexuels cherchent à s’identifier et à se faire violer par la femme machiste phallique : « Je ferai comme une fille qui se défend. » (cf. la chanson « Le Grand Secret » d’Indochine) Je vous renvoie évidemment au code sur Catwoman dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels.
d) Le drame du personnage homosexuel est d’être pris pour un objet ou de désirer être un objet :
N.B. : Je vous renvoie aux codes « Pygmalion » et « Poupées » dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.
Je vous renvoie aussi au film « Showboy » (2002) de Christian Taylor et Lindy Heyman, au film « Adieu forain » (1998) de Daoud Aoulad-Syad, au film « Prends-moi » (2005) d’Everett Lewis, etc. Par exemple, dans le film « Les Mille et une nuit » (1974) de Pier Paolo Pasolini, Zoumourroud est vendue sur un marché aux esclaves. Idem pour Rebeca (Victoria Abril) dans le film « Tacones Lejanos » (« Talons aiguilles », 1991) de Pedro Almodóvar. Dans le film « No Se Lo Digas A Nadie » (1998) de Francisco Lombardi, Joaquín, le héros homosexuel, à 15 ans est traité de « poupée de porcelaine » par son père. Dans la pièce très autobiographique Mi Vida Después (2011) de Lola Arias, Vanina, l’héroïne lesbienne, dit avoir souffert d’être utilisée comme « faire-valoir » par son père militaire. On retrouve le thème de l’identification du « je » homosexuel à un fétiche immolé dans les chansons « Marchand de fleurs » des Valentins, « Le Brasier » d’Étienne Daho. Le personnage homosexuel exprime souvent son impression d’être réifié, ou son désir d’être consommé : « On se le passe de mains en mains, le Vincent, de bras en bras, tel un joujou Celluloïd, et personne alentour, jamais personne pour le sauver de cette inadmissible emprise sur son corps. » (cf. le roman Vincent Garbo (2010) de Quentin Lamotta, p. 39) ; « Tanguy s’était habitué à être ballotté par-ci, par-là… » (Michel del Castillo, Tanguy, (1957), p. 182) ; « Ne suis-je que fausse monnaie ? » (un personnage homosexuel de la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel) ; « Tu vas me faire le plaisir de t’endurcir, mon fils ! » (le Père 2 homo s’adressant à son fils homo Gatal, dans la pièce Hétéro (2014) de Denis Lachaud) ; « Je ne suis pas un homme et je n’ai pas le droit d’être une femme. Je suis un jouet, on a ignoré que j’ai un cœur ! » (Reine Gertrud dans le film « Hamlet » (1921) de Sven Gade) ; « Me voilà objet. » (Julien dans la pièce Une rupture d’aujourd’hui (2007) de Jacques-Yves Henry) ; « Je suis de la terre glaise, on fait de moi ce que l’on veut, de la terre malléable à merci. Je ne sais pas ce que je suis. » (Cécile dans le roman À ta place (2006) de Karine Reysset, p. 42) ; « J’ai vraiment un corps de base. Si j’étais une voiture, je serais sans option. Mon père m’a eue en soldes. C’est un radin. » (Shirley Souagnon dans son concert Free : The One Woman Funky Show, 2014) ; « Je ne criais jamais, j’étais tellement heureuse d’être ton objet, d’exister. » (Cécile à son amante Chloé, idem, pp. 39-40) ; « J’adore qu’on profite de moi. […] Personne ne me force. » (Matthew Ferguson, le gigolo du film « Eclipse » (1995) de Jeremy Podeswa) ; « J’ai envie d’être l’outil de sa jouissance. » (la narratrice lesbienne du roman Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train (2005) de Cy Jung, p. 65) ; « Je voudrais être un objet. » (Cyril dans la pièce Parce qu’il n’avait plus de désir (2007) de Lévy Blancard)
L’esthétisme artistique réifiant altère chez les héros homosexuels l’impression d’être violés et utilisés… alors que pourtant, c’est souvent le cas.
FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION
PARFOIS RÉALITÉ
La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :
a) Certaines personnes homosexuelles ont vécu réellement le viol génital :
Je vous renvoie à l’essai Une Vie violente (1959) de Pier Paolo Pasolini, à l’ami gay violé dans l’autobiographie Quitter la ville (2000) de Christine Angot, à l’essai L’Envers des cimes (1996) de l’alpiniste Marc Batard, au dossier de témoignages de sujets homosexuels violés dans la revue Histoires d’Elles (n°3, février 1978), aux témoignages de l’essai Le Viol au masculin (1988) de Daniel Welzer-Lang et de l’essai L’Homosexualité dans tous ses états (2007) de Pierre Verdrager, au documentaire « Viol : elles se manifestent » (2014) d’Andrea Rowling-Gaston (où plusieurs intervenantes sont lesbiennes). Je rappelle aussi qu’il y a eu une campagne féministe contre le viol en 1976 en France (et chacun sait combien les mouvements lesbien et féministe se télescopent).

Toile de Francis Bacon
Un certain nombre de personnes homosexuelles ont déjà pu être violées au sein de leur famille, par la violence d’un inceste, par le divorce des parents, par l’abandon amical ou familial, par le visionnement d’images porno qui a blessé en elles l’image de la différence des sexes, par un mariage malheureux : « La jeunesse du futur poète [Oscar Wilde] s’écoule, non pas dans le calme, mais dans les échos et les remous d’un scandale qui désagrège sa famille : la maîtresse de son père fait du chantage, intente un procès aux Wilde en prétendant avoir été endormie au chloroforme puis violée par sir William. Les amis de collège d’Oscar, qui suivent le procès dans les journaux, ne lui épargnent aucun détail… ‘Voilà donc où conduit ce grossier amour des hommes pour les femmes, à cette boue !’ écrira-t-il plus tard, en parlant de cette lamentable affaire. » (Jean-Louis Chardans, Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p. 170) ; « À sept ans, ce garçonnet [Ednar] subit des attouchements sexuels de la part d’un collègue de travail de son père. Malheureusement, sachant que personne ne s’intéresserait à son problème, il ne put se confier. Man Éloi (Adesse), sa mère, ne détectait pas les soucis de son fils, ni à quel point il était martyrisé par son frère. Il ne put jamais trouver les mots pour exprimer son désarroi et sa souffrance. […] Et voilà qu’en plus de toutes ces difficultés, un autre drame s’ajouta à son calvaire. Une nouvelle tentative d’agression sexuelle perpétrée par Octave [23 ans], l’un des meilleurs copains de son frère Hugues. À onze ans, la vie d’Ednar commençait par une descente aux enfers, cet abîme qui déjà le convoitait en le livrant à la merci et à l’incompréhension des personnes censées l’aimer et le protéger. Affecté par ce sentiment de culpabilité, cet enfant ne put dévoiler les secrets trop lourds à porter dans son cœur. Jamais dans sa famille il n’osa avouer son malheur dans le sous-bois. Il en parla à demi mots à ses copains de classe, qui eux non plus n’avaient pas le droit de répéter ces choses-là aux grandes personnes. À l’époque, il n’était pas permis aux jeunes enfants de dénoncer les perversités ni les égarements des anciens. […] Ce traumatisme inavouable fut l’un des plus grands secrets de sa vie. Et lorsqu’il devint adulte lui-même, il évoqua cette mauvaise rencontre comme ‘l’incident’ qui n’aurait jamais dû être […]. Décidément, le malheur s’acharnait sur cet enfant ; l’adolescent venait d’avoir treize ans, lorsqu’il tomba dans un autre piège. Cette fois un ancien collègue de son père l’attira chez lui dans un guet-apens ; lorsqu’il comprit le but de l’invitation, il voulut s’enfuir. L’homme le retint ; il se débattit, parvint à se libérer et, enjambant la fenêtre, il s’enfuit et escalada le mur du cimetière voisin. Dans le crépuscule, il prit la poudre d’escampette pour échapper au viol. L’homme le poursuivit, en vain. Là non plus, il ne put se confier à un adulte et, pire, c’est lui qui culpabilisait. » (Jean-Claude Janvier-Modeste, dans son roman très autobiographique Un Fils différent (2011), où il raconte à travers son personnage Ednar les trois viols pédophiles qu’il a subis dans l’adolescence, pp. 12-14) ; « Mon cousin a profité de moi. Mon cousin avec qui il s’est passé des choses… très dures. C’était avec lui que j’ai perdu une partie de moi. Une fois mariée avec lui, il m’a fait payer le fait que j’aie été avec une fille avant. Il m’a séquestré. Il y a eu des coups. J’étais juste un corps. » (Amina, jeune femme de 20 ans, lesbienne, de culture musulmane, dans le documentaire « Homos, la haine » (2014) d’Éric Guéret et Philippe Besson, diffusé sur la chaîne France 2 le 9 décembre 2014) ; « Sexuellement, ça se passait de manière catastrophique. » (Irène, une femme lesbienne de 65 ans, jadis mariée avec un homme, idem) ; « Je pourrais également être prostitué – et même travesti, navré si cela vous choque. Violé à l’âge de 12 ans, j’ai grandi dans une famille où l’inceste était monnaie courante. Les hommes de mon enfance – à commencer par mon père – n’étaient pas à la hauteur. Pire, ils auraient dû me dégoûter d’être un homme. » (Père Jean-Philippe Chauveau, Que celui qui n’a jamais péché… (2012), p. 17) ; « Ces souffrances profondément déstabilisatrices ont souvent pour origine un passé de viols et de violences. » (Père Jean-Philippe parlant des personnes transsexuelles, idem, p. 233) ; « ‘J’aurais voulu naître femme. Rendez-moi mon vrai corps.’ Voilà ce que les transsexuels demandent aux médecins. Christopher, par exemple. J’avais un feeling spécial avec lui car ses parents étaient alcooliques et j’imaginais sans mal les sévices de son enfance. Il a commencé la prostitution à 14 ans, Porte Dauphine. Il s’est retrouvé ligoté et violé par plusieurs mecs en même temps. Un jour, il a décidé de se faire opérer pour devenir transsexuel. » (idem, p. 245) ; « La transsexualité ça a sauvé ma vie parce que ça m’a permis de rejeter un corps qui avait été violé. » (Sébastien/Victoria, homme trans M to F de 43 ans, dans le documentaire « Pédophilie, un silence de cathédrale » (2018) de Richard Puech) ; etc.

Pour ce qui est des cas de personnes homosexuelles violées connues, je vais tenter de vous en dresser la liste, même si elle est très incomplète (d’autant plus qu’entre le viol réellement effectif et le ressenti du viol, la frontière est ténue). Par exemple, le chanteur homo argentin Miguel Frías Molina a été abusé par un prêtre dans sa jeunesse. Frank Worthen a été violé et est homosexuel. À l’université, Andrew Comiskey contracte une maladie vénérienne et est victime d’un viol collectif à son domicile. Le romancier Juan Soto, à 12 ans, a été violé par un soldat italien. Le comédien homosexuel Jean Marais ou bien encore le philosophe Michel Foucault ont été abusés dans leur adolescence. Dans l’essai de Fernando Olmeda El Látigo Y La Pluma (2004), on peut lire le récit d’Isabel, une femme lesbienne violée. Dans le documentaire « Verzaubert » (1993) de Dorothee Van Diepenbroick, on nous montre une femme lesbienne qui a été violée par son beau-père. Le poète mystique anglais Aleister Crowley est abusé dans sa jeunesse par un ecclésiastique de Trinity College. Marc Batard, alpiniste homosexuel, a été violé par son oncle. L’écrivain français Jean Genet est violé dans le centre pénitentiaire où il est interné pendant son adolescence : il raconte cette expérience dans Le Journal du voleur, en 1949. Durant sa jeunesse, l’écrivain François Augiéras est violé par son oncle, puis par ses précepteurs. En avril 1871, Arthur Rimbaud se fait violer dès son arrivée à Paris par une bande de soldats de la Commune. L’acteur Vincent McDoom a été violé par son oncle. Virginia Woolf a été l’objet d’agressions sexuelles de la part de ses deux demi-frères, George et Gerald Duckworth. La première expérience de l’amour que le journaliste britannique J. R. Ackerley raconte dans Mon Père et moi (1968) est celle des menaces d’attouchements sexuels du responsable du dortoir auxquelles il résiste. S’en suit une autre expérience peu de temps après avec un camarade où cette fois, il réprime son dégoût et s’habitue peu à peu à trouver cela normal. En novembre 1917, Lawrence d’Arabie est capturé lors d’une opération de reconnaissance à Deraa. Dans Les Sept piliers de la sagesse (1916), il explique comment il est torturé et violé par un officier turc, puis par ses hommes : « Cette nuit, dans le Déraa, la citadelle même de mon intégrité personnelle a été irrévocablement perdue. » (Lawrence d’Arabie cité dans le Dictionnaire des homosexuels et bisexuels célèbres (1997) de Michel Larivière, p. 213) Dans son autobiographie Libre (2011), Jean-Michel Dunand relate comment il s’est fait toucher par un homme plus vieux que lui dans les toilettes publiques du sanctuaire de Lourdes. Dans le documentaire « Católicos Gays » de l’émission Conexión Samanta sur la chaîne Play Cuatro (juin 2011), un des intervenants, Vicente, a été violé par un prêtre à l’âge de 13 ans. Le témoignage Franck ou le sida vaincu par l’espérance (1987) de Daniel Ange, expose que Franck, homosexuel, a été violé étant enfant. À 12 ans, la photographe lesbienne Claude Cahun est victime d’une agression à caractère antisémite et sera retirée du lycée de Nantes. Dans le documentaire « Vivant ! » (2014) de Vincent Boujon, Mateo, homosexuel et séropositif, raconte qu’il a été violé à l’âge de 15 ans, dans un bar gay, par « un type qui avait mis une saloperie dans son verre ». Il dit qu’il ne se souvient plus de rien. Pour ce qui me concerne, j’ai été encerclé par la quasi totalité des garçons de ma classe de 5e au collège Jeanne d’Arc de Cholet (France) et me suis fait « gentiment » passer à tabac. Dans le documentaire « Bixa Travesty » (2019) de Kiko Goifman et Claudia Priscilla, Linn, jeune homme brésilien travesti en femme, avoue avoir été « abusée ».
L’hypothèse du viol comme stimulus du désir homosexuel avait déjà été soulevée par Aristote dans Éthique de Nicomaque (-335). Plutarque fait également mention du viol concernant l’étiologie de l’homosexualité dans Dialogue sur l’amour (Ier siècle ap. J.-C.). Bien plus tard, Proudhon met à tort le lien entre homosexualité et viol sur le terrain de la causalité : « Sans aller jusqu’à la mort, je regrette que cette infamie qui commence à se propager parmi nous, soit traitée avec autant d’indulgence. Je voudrais qu’elle fût, dans tous les cas, assimilée au viol, et punie de vingt ans de réclusion. » (Proudhon, Amour et mariage, 1858)
À notre époque, on continue de parler du viol homosexuel, même si ces discours restent particulièrement méconnus et minoritaires. Par exemple, le chercheur américain David Finkelhor n’hésite pas à affirmer que les garçons agressés avant l’âge de 13 ans auraient quatre fois plus tendance que les autres à revivre des expériences homosexuelles (David Finkelhor, « Four Preconditions : A Model », dans Child Sexual Abuse : New Theory And Research, 1984). À la lumière de leur expérience clinique, les psychologues Johnson et Shrier constatent que beaucoup plus de garçons agressés par des hommes se désigneront plus tard comme homosexuels ou bisexuels – six à sept fois plus, en moyenne – que de garçons qui furent agressés par des femmes (R. L. Johnson et D. K. Shrier, « Sexual Victimisation Of Boys : Experience At An Adolescent Medecine Clinic », dans Journal Of Adolescent Health Care, n°6, 1985, pp. 372-376). Une thérapeute américaine, Susan Wachob (citée par E. Jansen, « Daddy Dearest », dans la revue Genre, n°21, septembre 1994, p. 37), fait remarquer que les garçons « pré-homosexuels » sont des victimes toutes désignées d’abus sexuels. Dans le documentaire « Homo et alors ?!? » (2015) de Peter Gehardt, le réalisateur se dessine en train de se rendre dans une boîte gay appelé « Violence ». Et plus tard, il relève ceci : « D’après une étude publiée par l’Union Européenne, plus d’un quart d’entre nous ont été passés à tabac au moins une fois, et 29% ont vécu une agression sexuelle. »
Beaucoup de personnes homosexuelles se sont retrouvées en situation de viol, comme l’explique Gore Vidal dans ses Mémoires (1995) : « Il y avait de dangereux hommes plus âgés, comme celui qui s’était assis à côté de moi au Keith’s Theater et avait posé sa main sur mon entrejambe. Je m’étais enfui. Tous les garçons que j’ai connus avaient eu une expérience similaire. » (p. 428) Et la question de l’activité ou de la passivité lors du coït n’est pas centrale. Je me souviens par exemple de ce jeune homme du Québec, qui a été abusé parce qu’il est tombé dans un guet-apens, et qui m’a écrit ces quelques lignes le 4 avril 2011 dernier (prouvant qu’on peut très bien être violé tout en se retrouvant en apparences dans la position de « l’actif ») : « La question sur l’homosexualité me secoue depuis plus de 14 ans aujourd’hui. Depuis bien longtemps, j’ai voulu comprendre cela. Je n’en savais pas grand-chose, jusqu’au moment ou par faiblesse, peur, – je ne sais pas comment le dire – je suis tombé, je dis bien, je suis tombé dans un piège. Une personne adulte, de plus de dix ans que moi, m’a introduit dans ce monde d’homosexualité. La personne m’a violé, bien que ce soit moi qui jouais le rôle de l’homme… »
Dans le film biographique « Girl » (2018) de Lukas Dhont, Lara/Victor, garçon trans M to F de 16 ans, se maltraite lui-même en voulant devenir quelqu’un d’autre, en se droguant, en « affaiblissant son corps » (expression tirée du film) : il ne se nourrit plus, ne dort quasiment plus, s’impose des cours de danse classique qui lui détruisent les pieds et la santé, se coupe le sexe aux ciseaux. Sa prof-chorégraphe, Marie-Louise Wilderijckx, est témoin de cette maltraitance (« Je sais que tu souffres. […] Tu ne te facilites pas la tâche, hein ? Vraiment pas. »), que Lara s’impose beaucoup plus à lui-même qu’elle ne vient des autres… même si, à un moment donné, à une soirée « entre filles », il est encerclé par ses camarades féminines danseuses, chapeautées par la cruelle Loïs, qui le somment de se déshabiller devant elles et de leur montrer son sexe : « Montre ! Montre ! Montre ! », dans une scène d’une grande humiliation. À un moment donné, à une soirée « entre filles », il est encerclé par ses camarades féminines danseuses, chapeautées par la cruelle Loïs, qui le somment de se déshabiller devant elles et de leur montrer son sexe : « Montre ! Montre ! Montre ! », dans une scène d’une grande humiliation.
Le viol que certaines personnes homosexuelles ont vécu a pu être un viol social, une dictature vécue lors de leur cursus scolaire ou du climat social oppressant où elle ont évolué. « J’avais souffert d’abus dans mon enfance, de harcèlement scolaire, je n’avais pas une très bonne relation avec ma mère. » (Christine Bakke, ex-ex-lesbienne, interviewée à Denver, dans le Colorado, fin 2018, dans l’essai Dieu est amour (2019) de Jean-Loup Adénor et Timothée de Rauglaudre, Éd. Flammarion, Paris, p. 79) ; « Copi, lui, reflète cette part obscure de la culture argentine : une violence qui n’a jamais été résolue. » (Alfredo Arias dans l’interview « Copi, ma part obscure » d’Hugues Le Tanneur, pour le journal Eden du 6 janvier 1999) ; « Enfant, Yves Saint Laurent a été maltraité par ses camarades d’Oran. Il se réfugiait dans les toilettes. » (Janie Samet dans le documentaire « Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld : une guerre en dentelles » (2015) de Stéphan Kopecky, pour l’émission Duels sur France 5) ; etc. Par exemple, dans son autobiographie Folies-fantômes (1997), Alfredo Arias raconte les bizutages qu’il a connus avec son compagnon Ernestino au collège militaire argentin : « Ils épiaient surtout les plus faibles : nous [Ernestino et moi] appartenions à ce lot. Ils se jetaient alors sur leurs proies, avec une réserve de tortures ‘inoffensives’, telles que le rasage des poils du pubis quand ils ne nous vidaient pas le contenu d’un tube de pâte dentifrice dans l’anus. Ou bien encore ils y introduisaient des craies et des bougies. Ces viols n’étaient pas considérés comme des crimes, mais comme des divertissements totalement acceptés. » (p. 190)
Et plus tard, à l’âge adulte, il arrive souvent que le viol que vivent les personnes homosexuelles se réactualise (à travers des rencontres « amoureuses » entre sujets dits « mûrs ») étant donné que la violence de l’épisode d’enfance n’a pas été reconnue par la victime. Ça n’en retire pas pour autant la brutalité de ce nouveau viol… même si celle-ci se pare de « responsabilité » et d’un drôle de ravissement. « ‘Tu m’appartiens désormais’, me dit-il. C’était des mots d’homme, des mots possessionnels et j’en avais la cognition. À seize ans, je n’étais plus le même. J’avais soudainement comme une impression de vide, ce vide qui semblait être ma mort et mon humiliation. […] Qu’étais-je devenu, pour un jour, une nuit, toute une vie ? […] Si je n’avais pas l’intention de ressembler à une fille, bien que certaines filles passent complètement inaperçues après un viol, c’est que cette situation de ‘Tel est pris, qui croyait prendre’, désignait un cauchemar marqué à jamais. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 70)
Il est temps que notre société reconnaisse aux hommes (et notamment aux personnes homosexuelles nées garçons) le statut de personne violée, quand tel est vraiment le cas. « Lorsque j’ai été invité au stage d’été, dont le thème était l’identité masculine, j’ai hésité à prendre mon magnétophone. La relecture des quelques notes prises sur le viol d’hommes, sur les rapports entre viol et homosexualité m’a amené à élaborer l’hypothèse que peut-être les homosexuels (ils étaient largement majoritaires dans ce stage prévu pour une rencontre d’homo-hétérosexuels) pourraient me donner des informations. […] Je recommençai l’expérience : sur les 8 hommes interrogés, 4 me décrivirent des scènes de viol où ils étaient acteurs, 3 en étaient victimes et 1 avait été agresseur. » (Daniel Welzer-Lang, Le Viol au masculin (1988), pp. 181-182) ; « Je pourrais multiplier les traces discursives qui démontrent que le viol d’hommes existe hors des milieux carcéraux ou militaires. […] Les responsables du service de recherche du ministère de la Justice (Centre de sociologie du droit, CNRS) me disaient leur étonnement au vu des résultats d’une enquête récente de victimisation auprès de 11 000 personnes en France : pour 40 personnes déclarant avoir subi des agressions sexuelles, un quart étaient des hommes. » (idem, p. 190) ; « En 1977, lorsque les féministes engageaient la campagne contre le viol, quelques cas de viols d’hommes apparaissaient, très liés à cette mouvance sociale. » (idem, p. 180) ; « Il est généralement très difficile de savoir si l’orientation homosexuelle ou bisexuelle d’un jeune homme fut antérieure ou ultérieure à son agression, la plupart des abus survenant en bas âge. » (Michel Dorais, Ça arrive aussi aux garçons (1997), p. 110) ; « Sera-t-on étonné d’apprendre que les participants à cette étude ont révélé avoir eu des fantasmes de nature homosexuelle dans une proportion de deux cas sur trois, quelle que soit par ailleurs leur orientation sexuelle affirmée ? » (Michel Dorais, parlant de ses 30 études de cas de jeunes hommes abusés par un homme dans leur enfance/adolescence, idem, pp. 186-187) ; « Les recherches nord-américaines les plus récentes avancent que un garçon sur six serait victime d’abus sexuels. […] Parmi certains sous-groupes plus vulnérables de la population masculine, la proportion de victimes d’abus sexuels serait encore plus élevée. Une enquête menée par la même commission Badgley auprès de 229 jeunes prostitués indique pour un tiers de ces garçons, le premier rapport sexuel avait eu lieu lors d’une agression sexuelle. […] Les garçons d’orientation homosexuelle ou bisexuelle pourraient aussi être – ou avoir été – davantage sujets à des agressions sexuelles. D’après une enquête menée par le magazine gay ‘The Advocate’ (n°661-662, 23 août 1994) auprès de ses lecteurs (2500 questionnaires en retour), 21% des répondants considéraient en effet avoir été victimes d’abus sexuels avant l’âge de 16 ans. » (idem, pp. 31-32)
Et aux sceptiques qui me diront : « Ouais, mais ce que tu dis sur les homos, c’est pareil pour les hétéros… Tout hétéro a pu vivre ses premières expériences sexuelles comme un viol, car c’est toute la sexualité humaine qui est violente », je leur répondrais que le viol, même s’il n’est pas spécifiquement homosexuel, qu’il ne concerne qu’une minorité de personnes homosexuelles (moi même, je n’ai jamais été violé, au sens « sale » et « légal » du terme !), et qu’il ne sera jamais (et heureusement) « homosexualisable », est quand même plus présent et plus marqué dans les sphères bisexuelles qu’ailleurs. Ce n’est pas moi qui le sors de mon chapeau pour diabolisée l’union homosexuelle. C’est une tendance prouvée par les statistiques (même si le défaut des statistiques, c’est qu’elles encouragent à la causalité, alors que le lien entre désir homosexuel et viol n’est ni causal ni systématique) : « Les personnes ayant déjà eu des pratiques homo-bisexuelles ont beaucoup plus souvent que les autres subi des rapports sexuels contraints (tentatives ou rapports imposés) : 45,4% des femmes homo-bisexuelles contre 14,9% des femmes hétérosexuelles, 23,9% des hommes homo-bisexuels contre 3,9% des hommes hétérosexuels. » (Enquête sur la sexualité en France (2008) de Nathalie Bajos et Michel Bozon, p. 262) « Les attouchements sexuels sont rapportés par 12,9% des femmes et 4,1% des hommes. […] Ils surviennent très majoritairement pendant l’enfance ou l’adolescence : 50% des femmes concernées ont subi ces attouchements avant l’âge de 10 ans et 50% des hommes avant l’âge de 11 ans. Près de la moitié des attouchements ont été immédiatement suivis d’une tentative de rapport forcé ou d’un rapport forcé (50% pour les femmes, 44% pour les hommes). […] Au total, les femmes rapportent trois fois plus souvent que les hommes avoir été confrontées à une agression à caractère sexuel, qu’il s’agisse d’un attouchement, d’une tentative ou d’un rapport forcé : 20,4% des femmes et 6,8% des hommes de 18-69 ans. […] Parmi les personnes qui ont vécu ces agressions, 59% des femmes et 67% des hommes ont subi des premiers rapports forcés ou tentatives à moins de 18 ans. […] Chez les hommes, c’est dans le groupe âgé de 35 à 49 ans que les individus disent avoir subi le plus de rapports forcés avant la majorité (plus de 4% des hommes de cet âge, et 77% de ceux qui ont connu des rapports forcés. […] Les personnes qui ont eu des partenaires du même sexe déclarent beaucoup plus de rapports forcés que les personnes qui n’ont eu que des partenaires de l’autre sexe. Ainsi, 44 % des femmes ayant eu des rapports homosexuels dans leur vie déclarent avoir subi des rapports forcés ou des tentatives (contre 15% des hétérosexuelles), dont 31% avaient moins de 18 ans la première fois ; c’est le cas de 23% des hommes qui ont eu des rapports homosexuels (contre 4,5% des hétérosexuels), dont 15% avaient moins de 18 ans la première fois. » (idem, pp. 385-389) ; « Il est dérangeant de constater qu’alors que moins de 4% de garçons (en population générale) ont été victimes d’agressions sexuelles de la part d’hommes adultes, une étude majeure récente démontre que le taux de victimes d’agression sexuelle par des hommes adultes dans une population d’hommes homos et bisexuels était presque dix fois supérieure (35%). Il est également rapporté que 75% des hommes homosexuels ont eu une première expérience homosexuelle avant l’âge de 16 ans, contre 22% d’expérience hétérosexuelle précoce chez les hommes hétérosexuels. » (cf. l’article de Jeff Johnston)
Ce lien entre viol et homosexualité dérange évidemment la majorité des personnes homosexuelles pratiquantes, qui d’abord s’étonnent, avant de s’énerver parce qu’elles-mêmes ont la bêtise de le causaliser : « À croire que tous les gays italiens, ou presque, sont des jeunes gens abusés et violés, des prostitués ou des travestis, quand ce n’est pas les trois à la fois… » (Didier Roth-Bettoni en observant la production cinématographique homosexuelle en Italie, dans L’Homosexualité au cinéma (2007), p. 482)

B.D. « Femme assise » de Copi
On apprend parfois les viols de l’enfance de manière accidentelle, au détour d’une « banale » crise conjugale (vécue par une personne homosexuelle encore en transition avec son passé « hétérosexuel »), crise présentée comme une révélation « libérante » d’homosexualité. On parle à peine des antécédents violents de jeunesse : ils sont même enfermés dans des crochets qui les transforment en anecdotes ! : « Ça n’allait pas avec mon mari, je suis allée voir une conseillère conjugale car je me posais des questions sur moi. […] Elle m’a dit : ‘Est-ce que tu n’as pas pensé que tu pouvais être homosexuelle ?’ Et alors là, c’était comme si d’un seul coup, j’étais rincé et que d’un seul coup, je voyais clair. Donc à partir de ce moment-là, je voulu en parler à mon mari. Mais je n’y arrivais pas, je ne trouvais pas les mots. J’avais une ou deux amies à l’hôpital où je travaillais et avec elles je discutais de ce que j’avais subi étant jeune [Elle parle de violences sexuelles subies dans l’enfance]. » (Agathe, femme lesbienne de 48 ans, interviewée dans l’essai Se dire lesbienne : Vie de couple, sexualité, représentation de soi (2010) de Natacha Chetcuti, pp. 67-68. C’est moi qui souligne) La reconnaissance de l’influence du viol dans l’apparition du désir homosexuel sera souvent zappée, au profit d’une glorification de l’amour homosexuel nouveau et d’une remise en cause du mariage femme-homme. Encore une fois, on préfère ne pas regarder la réalité en face.
b) Le viol fantasmé (= craint et désiré) :
La mention du viol chez les personnes homosexuelles ne repose pas toujours sur un viol réel. Il peut être l’expression d’une crainte de la sexualité en général et de la différence des sexes en particulier, parce que certaines personnes l’ont vue par accident abîmée (cf. je vous renvoie au chapitre « Peur de la sexualité » dans le code « Symboles phalliques » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels) : « Un jour, chez des amis, alors que les parents étaient fort occupés à deviser dans le fond du parc, je fus le témoin d’une véritable orgie enfantine, à laquelle, d’ailleurs, je ne pris aucune part, me sentant trop décontenancé à la vue des petites filles. Des frères, des sœurs, d’autres garçons se livraient à des expériences sexuelles très poussées et je garderai toujours en mémoire le spectacle de la sœur d’un de mes camarades ‘utilisée’ par quatre garçons à la suite… Cette scène (qui se renouvelait, d’ailleurs, paraît-il, à chacune des réunions familiales, à l’insu des parents, naturellement) fut interrompue, ce jour-là, par l’entrée intempestive de la mère de l’une des fillettes… Ce fut un beau scandale. Il y eut des scènes pénibles. Un procès faillit en résulter mais, au cours des interrogatoires, chacun se tira d’affaire par des mensonges. Cet épisode aux couleurs crues s’imprima profondément dans mon esprit et me fit, plus que jamais prendre en horreur les filles et les femmes. » (Jean-Luc, 27 ans, homosexuel, dans Jean-Louis Chardans, Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p. 79)
Cependant, le rapport des sujets homosexuels pratiquants est d’attraction-répulsion. Une sorte de mélange (inextricable ?) entre peur et attirance. Il arrive que le viol réel et ses étapes préliminaires soient présentés par certaines personnes homosexuelles comme un conte de fée ou sous l’angle d’un jeu amico-artistico-amoureux, comme pour en édulcorer la violence (cf. je vous renvoie à la partie « Déni du viol » dans le code « Déni » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels). « Comment une vie bascule à travers une main qui s’aventure… Je suis devenue une vraie femme. » (Thérèse, 70 ans, parlant de sa toute première fois lesbienne, où une ancienne camarade de classe dévergondée l’a dépucelée, dans le documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz) Par exemple, dans le documentaire « La Dany : la Diva du Parc Bolivar » (2010) de Julie Giles et Jim Giles, la Dany est un artiste de rue trans M to F de Medellín en Colombie : il improvise des shows avec des descriptions crues et comiques de kidnapping, viols, infidélités. Et dans le documentaire « Beauty And Brains » (2010) de Catherine Donaldson, on voit que les concours de beauté sont une manière pour certaines personnes transgenres du Népal de camoufler/vaincre les viols et les abus qu’elles ont réellement subis.
Entre désir et viol et passage à l’acte, la frontière est très floue. Par exemple, dans son autobiographie Le Flamant noir (2004), Berthrand Nguyen Matoko, homosexuel, raconte comment il s’est fait violer à l’adolescence par son confesseur, un certain père Basile. Fait étonnant : le viol pédophile ne semble pas horrible à ses yeux : « Le temps nous enveloppa dans un tourbillon difficile à définir, celui de la léthargie du bonheur. J’avais fini par me dévoiler comme une fleur qui étale ses pétales en plein soleil. » (p. 34) ; « Dans son office où il me recevait les après-midi, il y avait non seulement de quoi manger et boire, mais également un piano où je m’amusais à jouer n’importe quoi et n’importe comment. » (idem, p. 35) ; « Je ressentais parfois du dépit d’être ainsi désacralisé, parce que le père Basile aidait des barrières à s’affranchir de leur idée de la réalité. » (idem, p. 36). La relation entre le violeur et le violé a même pris une tournure spirituelle : « Pour m’éviter de sombrer dans un chagrin qui risquait d’éveiller de nombreux souvenirs, il se contentait de marquer une priorité par des prières. […] Inconsciemment nos rapports se fortifiaient par le pouvoir infini de Dieu. » (idem, p. 38) Plus tard, dans ses relations homosexuelles adultes, la violence du viol sera amortie par les sentiments, le consentement mutuel et la satisfaction éphémère de la séduction : « Un sentiment de honte et de culpabilité vint adoucir cette douleur dans les derniers instants de doutes affreux, d’où jaillirent des idées d’orgueil féminin : Mon corps plaisait. » (idem, p. 68)
Concernant le désir violent, je crois que le fantasme de viol peut aussi faire violence, et dire un viol qui l’a précédé. « Il [Copi] était en train de répéter un monologue : les péripéties d’un astronaute perdu dans l’espace après avoir été violé par les rats de je ne sais quelle planète. » (Alfredo Arias, Folies-fantômes (1997), p. 12) Ce n’est pas pour rien si Jean-Paul Sartre écrit que l’imaginaire est l’autre nom du « mal » ! Dans son essai Homoparenté (2010), le psychanalyste Jean-Pierre nous explique à juste raison qu’il existe « une autre violence : le refus du réel » (p. 115)
Par exemple, dans le roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, le désir de viol, la sublimation de la violence, et la complicité paradoxale d’Eddy Bellegueule sont palpables, aussi bien quand il se fait violer par deux camarades de classe au collège, qu’ensuite quand il se fait sodomiser par ses cousins dans un hangar, puis à l’âge adulte lorsqu’il s’essaie (en vain) à l’hétérosexualité et qu’il décide d’assumer de pratiquer l’homosexualité avec des hommes censés le brutaliser pour lui donner la force masculine qu’il n’aurait pas : « Ils sont revenus. Ils appréciaient la quiétude du lieu où ils étaient assurés de me trouver sans prendre le risque d’être surpris par la surveillante. Ils m’y attendaient chaque jour. Chaque jour je revenais, comme un rendez-vous que nous aurions fixé, un contrat silencieux. […] Uniquement cette idée : ici, personne ne nous verrait, personne ne saurait. […] Dans le couloir, je les entendais s’approcher, comme les chiens qui peuvent reconnaître les pas de leur maître parmi mille autres, à des distances à peine imaginables pour un être humain. » (p. 38) ; « Le grand roux et l’autre au dos voûté me mettent un ultime coup. Ils partaient subitement. Aussitôt ils parlaient d’autre chose. » (p. 41) ; « Je ne sais pas si les garçons du couloir auraient qualifié leur comportement de violent. » (p. 42) ; « J’ai senti son sexe chaud contre mes fesses, puis en moi. Il me donnait des indications ‘Écarte’, ‘Lève un peu ton cul’. J’obéissais à toutes ses exigences avec cette impression de réaliser et de devenir enfin ce que j’étais. » (pp. 152-153) ; « J’ai d’abord imaginé que je lui faisais l’amour, à elle, Sabrina, sachant qu’une pareille image ne pouvait pas me faire bander. Puis j’ai imaginé des corps d’hommes contre le mien, des corps musclés et velus qui seraient entrés en collision avec le mien, trois, quatre hommes massifs et brutaux. J’ai imaginé des hommes qui m’auraient saisi les bras pour m’empêcher de faire le moindre mouvement et auraient introduit leur sexe en moi, un à un, posant leurs mains sur ma bouche pour me faire taire. Des hommes qui auraient transpercé, déchiré mon corps comme une fragile feuille de papier. J’ai imaginé les deux garçons, le grand aux cheveux roux et le petit au dos voûté, me contraignant à toucher leur sexe, d’abord avec mes mains puis avec mes lèvres et enfin ma langue. J’ai rêvé qu’ils continuaient à me cracher au visage, les coups et les injures ‘pédé’, ‘tarlouze’ alors qu’ils introduisaient leur membre dans ma bouche, non pas un à un mais tous les deux en même temps, m’empêchant de respirer, me faisant vomir. Rien n’y faisait. Chaque contact de Sabrina avec ma peau me ramenait à la vérité de ce qui se passait, de son corps de femme que je détestais. » (p. 193) La morbidité à l’état brut.
Il est difficile d’isoler le viol fantasmé du viol réel. Celui qui désire le viol, on l’apprend en découvrant peu à peu son histoire, est bien souvent quelqu’un qui a connu le viol ou qui est proche d’en commettre un. Cependant, je me dois, au nom de notre inaliénable liberté humaine et de la probabilité du lien homosexualité/viol, d’aborder aussi le viol en tant que désir uniquement, ou subjectivité. « La violence, c’est d’abord ‘les violences’, physiques et symboliques, celles que l’on sent, que l’on voit et que l’on interprète comme telles. » (cf. l’article « Violence » de Sébastien Chauvin, dans le Dictionnaire de l’homophobie (2003) de Louis-Georges Tin, p. 422. C’est moi qui souligne) Par exemple, Diane de Margerie évoque le « désir d’agression » inhérent à la personnalité de Yukio Mishima (Yukio Mishima, Correspondance 1945-1970 (1997), p. 22). Dans l’affaire Matthew Shepard, l’adolescent homosexuel (séropositif) nord-américain sauvagement assassiné en 1998 dans le Wyoming, il a été prouvé l’élan d’attraction étrange et masochiste de Matthew envers ses deux agresseurs qu’il a essayé de draguer avant que ces derniers ne le battent à mort. En 1971, la féministe Susan Griffin frappe l’opinion publique en déclarant : « Je n’ai jamais pu me débarrasser de la peur du viol. » (Susan Griffin, « Rape : The All-American Crime », Remparts, septembre 1971) Aussi étrange que puisse paraître le syndrome de Stockholm (celui qui consiste à dire qu’une victime d’agression défend parfois son agresseur), un certain nombre de personnes homosexuelles ne sont pas réfractaires à l’idée de viol, voire recherchent le viol (entre peur et désir, la frontière est mince !) : « Je rêve d’être kidnappé, attaché, offert, je rêve d’être à la merci. » (Christophe Honoré, Le Livre pour enfants (2005), p. 55) ; « Pour moi, le viol, avant tout, a cette particularité : il est obsédant. J’y reviens tout le temps. […] J’imagine toujours pouvoir un jour en finir avec ça. […] Impossible. Il est fondateur. De ce que je suis en tant qu’écrivain, en tant que femme qui n’en est plus une. C’est en même temps ce qui me défigure, et ce qui me constitue. » (Virginie Despentes, King Kong Théorie (2006), p. 53) ; « Les femmes préfèrent les salauds, nous aussi parfois. » (Pascal Sevran, Le Privilège des jonquilles, Journal IV (2006), p. 75) ; « Y avait-il chez moi une certaine attirance pour ce plaisir bestial et interdit ? […] J’avais aussi compris que j’y trouvais un plaisir malsain. » (Brahim Naït-Balk, Un Homo dans la cité (2009), pp. 58-61) ; « J’allais devenir célèbre en me faisant kidnapper. » (Brüno dans le docu-fiction « Brüno » (2009) de Larry Charles) ; « Lola Sola se débat. Mais on comprend tout de suite qu’elle aime ça. Qu’elle aime un homme puissant. » (Alfredo Arias dans l’essai Folies-fantômes (1997), p. 253) ; « Par instants, je m’attendais à le voir me sauter dessus et me faire violer après m’avoir roué de coups… Rien de tout cela ne se produisit. » (Jean-Luc, 27 ans, homosexuel, dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, p. 101) ; « Une certaine proportion d’homosexuels sont dans une sublimation de la séropositivité ou revendiquent une séroconversion volontaire […]. La séropositivité permet d’annoncer son homosexualité, de faire en quelque sorte partie du ‘club’. » (Thomas Montfort, Sida, le vaccin de la vérité (1995), p. 30) ; « J’ai rêvé que je me faisais violer par des hommes et au final ils m’avaient tué. J’ai aussi rêvé que je suis avec un homme, j’ai eu une forte érection, mais dans le rêve, nous étions allongés corps contre corps. Il me serrait dans ses bras comme si c’était un père, comme si c’était l’énergie qui me manquait et pas le corps qui m’attirait. Ça me procurait une sécurité qui m’a mis en érection, qui me redonnait mon sexe dans toute sa force. J’ai aussi rêvé d’un jeune homo qui était excité à côté de moi, et par haine envers lui, je lui ai parlé comme s’il était un gars pervers qui voulait mon doigt dans son cul, en le traitant de salope. Et je m’exécute avec mépris, et je ressors mon doigt plein de merde avec un profond dégoût de cette situation. » (cf. le mail d’un ami homo, Pierre-Adrien, 30 ans, reçu en juin 2014) ; « Dans cette fascination du chef et de la force, il y avait beaucoup de féminité latente, une certaine forme d’homosexualité. Au fond, chez la plupart de ces intellectuels fascistes, je pense à Brasillach, à Abel Bonnard, à Laubreaux, à Bucard, il y avait le désir inconscient de se faire enculer par les S.S. » (Emmanuel Berl s’adressant à Patrick Modiano, cité dans la biographie Ramon (2008) de Dominique Fernandez, p. 140) ; etc.
Dans son Journal (1889-1939), André Gide définit l’homme inverti comme celui qui « dans la comédie de l’amour, assume le rôle d’une femme et désire être possédé » (p. 671).
Dans son autobiographie Une Mélancolie arabe (2008), le romancier Abdellah Taïa affiche sans complexe son soutien pourtant choquant au viol, quand il raconte ses premières expériences sexuelles avec les hommes qui l’ont violé : « Il croyait que j’avais peur. Ce qu’il me proposait m’allait très bien. […] Je me sentais bien, bizarrement bien, et je ne luttais pas contre ce bien-être. » (pp. 15-17) ; « Je ne dormais pas. J’attendais. Couché sur le ventre, j’essayais de retrouver dans ma tête des images du chef barbu de la bande qui, je devais me rendre à l’évidence, m’avait séquestré. » (idem, p. 18) ; « Je dois toutefois avouer que, même en plein enfer, une partie de moi était heureuse, aimait ça, ce machisme, cette dictature… Je me disais alors : ‘C’est ça l’amour, c’est ça l’amour… j’ai de la chance… Il faut tenir le coup… C’est ça l’amour…’ » (idem, p. 117.)
Dans son autobiographie Retour à Reims (2010), Didier Éribon décrit les lieux de drague communément fréquentés par la population homosexuelle comme la scène privilégiée – et malgré tout aimée, c’est ça le pire ! – du viol (autant homophobe qu’homosexuel) : « On est confronté dans ces lieux de drague, hélas, à de multiples formes de violence. On y croise des gens bizarres ou des demi-fous et il faut être sur ses gardes. Et surtout on s’expose à être l’objet d’agressions physiques par des voyous ou bien à des fréquents contrôles d’identité par la police, qui y pratique un véritable harcèlement. Cela a-t-il changé ? J’en doute. […] Les lieux gays sont hantés par l’histoire de cette violence : chaque allée, chaque banc, chaque espace à l’écart des regards portent inscrits en eux tout le passé, tout le présent, et sans doute le futur de ces attaques et des blessures physiques qu’elles laissèrent, laissent et laisseront derrière elles – sans parler des blessures psychiques. Mais rien n’y fait : malgré tout, c’est-à-dire malgré les expériences douloureuses que l’on a soi-même vécues ou celles vécues par d’autres et dont on a été le témoin ou dont on a entendu le récit, malgré la peur, on revient dans ces espaces de liberté. » (pp. 219-221)

Film « L’Amour violé » de Yannick Bellon
Beaucoup de femmes lesbiennes ont un « passé hétéro » chargé, qu’elles préfèrent taire quand il s’agit de justifier de le mettre en lien avec la découverte de leur homosexualité, et grossir quand il s’agit de diaboliser la gent masculine. « Ma mère était inquiète pour moi, parce qu’elle savait que j’avais beaucoup souffert avec mon ancien amant, donc elle devait se dire que c’était de sa faute si j’étais devenue lesbienne. » (Lise, femme lesbienne de 30 ans, dans l’essai Se dire lesbienne : Vie de couple, sexualité, représentation de soi (2010) de Natacha Chetcuti, p. 103) Mais quand on creuse un peu, on découvre assez vite que leur dénonciation du viol ne se base pas sur la réalité, ni sur des preuves tangibles. Leur obsession pour le viol rejoint la paranoïa misandre (= anti-hommes). Par exemple, Susan Brownmiller et Andrea Dworkin affirment que le viol fait partie intégrante de la sexualité masculine (cf. citées dans l’essai X Y de l’identité masculine (1992) d’Élisabeth Badinter, p. 212) Puisque selon elles le patriarcat et ladite « domination masculine » sont des données universelles indiscutables, elles en viennent à penser que tous les hommes sont des violeurs potentiels ! « Tout homme est un violeur en puissance. » (cf. Manifeste de juin 1976, dans la revue Le Quotidien des femmes, n°10, vendredi 25 juin 1976, cité dans l’essai Les Lois de l’amour : Les politiques de la sexualité en France (1950-2002) (2002) de Janine Mossuz-Lavau, p. 240) ; « C’est pas de notre faute si on est violées. » (Anne Zelensky dans le documentaire « Debout ! : Une Histoire du Mouvement de Libération des Femmes 1970-1980 » (1999) de Carole Roussopoulos) ; « J’ai très vite renoncé à passer à l’acte parce que j’étais confrontée au regard de garçons imbus de leur supériorité et je sentais que je serais ‘baisée’. » (Paula Dumont, Mauvais Genre (2009), p. 82) ; « Je suis partie aux États-Unis avec un pote. Et un jour dans une boîte, j’ai failli me faire violer et là je me suis dit : ‘Non, je ne suis pas un homme, mais habillée comme cela ça ne me correspond pas, il y a quelque chose qui ne va pas.’ Et la séduction que j’exerçais à l’égard des hommes ne me plaisait pas, leur regard ne me plaisait pas. Pas parce qu’ils étaient libidineux, mais parce que je ne voulais pas cela avec les hommes. Pour moi, les hommes c’était mes frères. Alors, la seule fois où j’ai embrassé un homme (j’ai eu quelques flirts comme ça), j’avais l’impression d’une relation incestueuse, tu vois un truc tu touches avec la langue et tu as l’impression de ramasser des fraises, tu vois ? (rires). » (Gaëlle, une femme lesbienne de 37 ans, dans l’étude Se dire lesbienne : Vie de couple, sexualité, représentation de soi (2010) de Natacha Chetcuti, pp. 80-81) ; « Je suis consciente de vivre dans une société où les femmes ont une place à part et où, du jour au lendemain, on peut m’attaquer, m’agresser, me violer, où je n’ai pas encore mon salaire comme mon collègue masculin. Donc je suis une femme et j’ai aussi la sensibilité d’une femme lesbienne. » (Lidwine, femme lesbienne de 50 ans, idem, p. 90) Comme l’explique très bien Tony Anatrella dans Le Règne de Narcisse (2005), « l’idéologie du gender consiste à informer toute femme du fait que la pénétration hétérosexuelle, étant un pouvoir de l’homme sur la femme, est une violation. » (p. 123)
Le problème majeur que pose cette obsession du viol chez beaucoup de femmes lesbiennes, c’est qu’au lieu d’aider à la reconnaissance du viol (et donc à la reconnaissance de la nature semi-aimante semi-violente du désir homosexuel) pour mieux y remédier, elle contribue à sa banalisation. Comme l’écrit à juste raison Michel Schneider dans La Confusion des sexes (2007), « si tout est viol, rien ne l’est. » (p. 48)
Le viol peut d’ailleurs être (non sans raison, même s’il ne s’agit pas ici de justifier la démarche, bien sûr ; je ne fais qu’expliquer) une présomption des personnes homophobes sur les personnes homosexuelles : il arrive par exemple qu’un homme macho, blessé dans sa virilité (bisexuel refoulé certainement), va se mettre à traiter la femme lesbienne de « mal baisée » ou l’homme gay de « vieux gars coincé » pour camoufler une blessure au niveau de sa propre sexualité (comme on peut le constater dans l’émission d’Olivier Delacroix et Mathieu Duboscq Dans les yeux d’Olivier, du 12 avril 2011, sur France 2, où Jessica, lesbienne, se fait insulter par ses agresseurs en des termes certes injustifiés mais mine de rien particulièrement signifiants : « Sale gouine ! Tu t’es fait violer par ton père ! »). Ce qui est pervers dans l’histoire du lien entre homosexualité et viol, c’est que celui-ci est généralement occulté par la communauté homosexuelle, notamment parce qu’il est parfois employé comme justificatif et comme moteur de viols dits « correctifs » opérés par les agresseurs bisexuels/homophobes à l’encontre de leurs presque-jumeaux homosexuels qu’ils prétendent « corriger de leur déviance sexuelle ». Dans certains cas dramatiques, un viol se rajoute à l’autre, tout simplement parce que, que ce soit du côté homophobe comme du côté homosexuel (deux camps qui se font miroir et qui n’en forment qu’un, en réalité), le lien de coïncidence entre le désir homosexuel et le viol est à la fois ignoré et causalisé. On peut citer comme exemples de faits divers scabreux (et si rarement analysés !) les viols des individus transsexuels en Amérique du Sud (et ailleurs), ainsi que le tout récent viol « correctif » de la militante lesbienne de 24 ans Noxolo Nogwaza en Afrique du Sud, survenu en mai 2011. Comme le constate Jeanne Broyon et Anne Gintzburger dans leur reportage « Des Filles entre elles » (2010), « les lesbiennes agressées, c’est monnaie courante. » Et cela ne va pas aller en s’arrangeant si on ne fait que constater ce viol dans une victimisation qui transforme à tort la nation lesbienne en martyre de la « domination masculine/homophobe » !
Le viol est, pour certains militants LGBT, le trophée ou le fond de commerce qui permettra de se victimiser et donc de gagner tous les combats politiques et économiques (contre la prétendue « domination masculine ») : « Avant, on avait le Sida. Maintenant, on a des psychopathes ou des espions qui peuvent nous violer. » (Xav, l’un des héros homosexuels de la pièce La Mort vous remercie d’avoir choisi sa compagnie (2010) de Philippe Cassand) Par exemple, dans le documentaire « Debout ! » (1999) de Carole Roussopoulos, on voit clairement que les femmes féministes, lesbiennes ou non, sont attirées par la « femme violée du bout du monde », afin de se servir d’elle comme « opportunité » pour prouver l’oppression machiste qui les domine/dominerait. : « Les femmes battues, c’était parfait ! Parce que si les femmes étaient battues, c’est bien parce qu’il y avait quelqu’un pour les battre. » (Annie Sugier)
c) Le cri de la femme violée :
La figure de la femme violée, notamment, revient très souvent, comme si les personnes homosexuelles cherchaient à s’y identifier : cf. la tournée de concerts Fatale (2011) de Britney Spears, etc. « Cette résurgence du thème de l’androgyne à la fin du XIXe siècle est peut-être le revers de l’obsession de la femme fatale. » (cf. l’article « Monsieur Vénus et l’ange de Sodome : L’androgyne au temps de Gustave Moreau » de Françoise Cachin, dans l’ouvrage collectif Bisexualité et différence des sexes (1973), p. 90) ; « Tu n’étais pas contente de me voir pleurer, mais j’éprouvais une tendresse particulière pour la Princesse indienne de Patagonie. Le jour où on l’a fait prisonnière et où la sorcière de la tribu ennemie lui a arraché ses boucles d’oreilles, j’ai trouvé le monde injuste. J’aurais voulu pouvoir voler jusqu’à la Terre de Feu et la reprendre aux mains d’êtres aussi sauvages. Je sais : c’était un feuilleton radiophonique. Mais il me donnait un avant-goût des atrocités à venir. » (Alfredo Arias s’adressant à sa grand-mère, dans l’autobiographie Folies-Fantômes (1997), pp. 157-158) ; etc. Comme je le montre abondamment dans mes travaux, même si bien sûr on ne peut pas dire que toutes les personnes homosexuelles ont été violées, en revanche on peut constater que le fantasme de viol est l’autre nom des désirs homosexuel et hétérosexuel : les icônes d’identification des personnes homosexuelles (pratiquantes ou sur le point de l’être) sont celles de la femme violée cinématographique (plus une chanteuse ou une actrice interprètera ce rôle sur les écrans, plus elle a des chances d’être choisie comme « icône gay ») ou du violeur Superman asexué (le cowboy et toutes les figures donjuanesques de l’Éternel Masculin).
Par exemple, dans le documentaire « Francis Bacon » (1985) de David Hinton, Francis Bacon dit être fasciné par les bouches criantes des films d’épouvante. Michael Jackson, quant à lui, a esthétisé ses petits cris aigus en les intercalant dans beaucoup de ses chansons. Gore Vidal, dans ses Mémoires – Palimpseste (1995), raconte comment le cri de l’actrice de film d’épouvante l’habite éternellement : « À la fin de Fall River Legend d’Agnès de Mille, le hurlement de Norma Kaye, au moment où elle se lève au centre de la scène, la robe couverte du sang de ses parents, résonnera toujours dans ma tête comme un vrai cri. » (p. 198) Dans son autobiographie Le Livre pour enfants (2005), Christophe Honoré fait de même quand il parle d’Isabelle Adjani lors d’une émission de radio qu’ils doivent faire ensemble : « Elle m’offre une grimace hurlant la peur, l’angoisse et je la crois, je suis de son côté, dans l’effroi. » (p. 11)
Soit parce qu’elles ont vécu un viol réel, soit parce qu’elles ont au moins vécu un effondrement identitaire qui les angoisse et les appelle à vouloir être dominées et être quelqu’un d’autre ( = l’actrice violée sublimée par le cinéma et qui redevient forte en se vengeant), beaucoup de personnes homosexuelles cherchent à s’identifier et à se faire violer par la femme machiste phallique : « Je crois que si les hymnes gays sont souvent interprétés par des femmes, c’est parce qu’on peut tout à fait s’identifier à elles, à leur position d’opprimées. Et opprimées, elles le sont toujours, malheureusement. C’est pour ça qu’on est enclin à s’identifier à une femme qui se défend, qui garde la tête haute. » (Barbie Breakout, dragqueen, interviewé dans le documentaire « Somewhere Over The Rainbow » (2014) de Birgit Herdlitschke, diffusé en juillet 2014 sur la chaîne Arte) ; « C’est des filles qui sont comme des garçons. Elles n’ont pas froid aux yeux. Elles sont fortes. » (Michel Gaubert, idem) ; « Les icônes gays ont souvent un destin tragique. Elles chantent des chansons impressionnantes, excessives, mais elles ont une existence difficiles parce qu’elles vivent constamment sous le regard du public. On entend sans cesse parler d’elles dans les médias. On sait que leur vie amoureuse est un fiasco. Ce sont des vies assez tragiques. Et c’est ce qui les rend attirantes à nos yeux. » (Steve Blame, idem) Par exemple, la chanteuse Madonna, qui est l’égérie gay mondiale le plus connue, a craché le morceau : elle a été violée à l’âge de 19 ans à New York. Idem, dernièrement, avec Lady Gaga, violée elle aussi à 19 ans. Le viol ou l’étiquette de victime justicière que le viol cinématographique ravit les personnes en panne d’identité et orgueilleuses. Je vous renvoie à la partie « Mélodrame » du code « Emma Bovary ‘J’ai un amant !’ » dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels.
d) Le drame intime des personnes homosexuelles est d’être prises pour des objets ou de désirer être objet :
Si on prend le temps d’écouter simplement les personnes homosexuelles, on lit très souvent dans leur propos l’histoire intime d’une exploitation, d’un viol, d’une instrumentalisation consentie : « C’est difficile pour moi d’avoir une vision saine de l’homosexualité. Les hommes que j’ai aimés m’ont toujours abandonné après s’être servis de moi. » (Justin, 34 ans, abusé dès l’âge de 4 ans par son père, son oncle, et son frère aîné, cité dans Ça arrive aussi aux garçons (1997) de Michel Dorais, p. 251) ; « Je suis un bouchon au fil de l’eau, un naufragé qui tente de s’agripper à une bouée de sauvetage, on peut faire de moi ce que l’on veut, je suis prêt à toutes les aventures. » (Frédéric Mitterrand, La Mauvaise vie (2005), p. 154) ; « On a tous envie d’être objet. » (un témoin homosexuel cité dans Le Viol au masculin (1988) de Daniel Welzer-Lang, p. 55) ; « Des fantasmes de viol […], moi aussi j’en ai. » (Gilles, idem, p. 131) « Je pense aux photos que je laisse derrière moi. […] Ces photos que je réservais à qui ? Un photographe professionnel ? Oui, et qui me prendrait en main, je n’aurais pas le choix, me dénuderait, exposerait enfin mon corps mince, rose imberbe, ferait de moi un modèle offert et vicieux, une si jeune pute. Évidemment qu’on ne racontera pas au petit frère mon impressionnant potentiel pour devenir idole. » (Christophe Honoré, Le Livre pour enfants (2005), pp. 51-52) ; « J’avais désormais une image. Une étiquette officielle. Un label. Le garçon efféminé. La petite femme. On allait passer sur moi. On allait chaque jour et de plus en plus abuser de moi. » (Abdellah Taïa, Une Mélancolie arabe (2008), p. 28) ; etc.
Je vous parlais un peu plus haut de cette étonnante impression d’unité et de « bonheur » que la victime d’un viol trouve dans sa réification sacralisante… même si elle ne s’aperçoit pas qu’elle a été traitée comme un trophée inerte brisé. On retrouve ce réenchantement du viol à travers les mots de Christophe Tison, écrivain racontant comment il en est arrivé à « aimer » son agresseur pédophile parce qu’il a été adoré/détruit par lui : « Didier m’accueillait comme si j’étais l’enfant-roi. » (Christophe Tison, Il m’aimait (2004), pp. 20-21) ; « Je ne me représentais que les plaisirs que ce séjour chez lui m’apportait. Cette liberté d’enfant-roi, d’enfant choisi et chéri. D’enfant qui se décompose et se morcelle doucement. (La peur tirait son fil et me décousait, et me décousait…) » (idem, pp. 49-50)
L’esthétisme artistique réifiant altère chez beaucoup de personnes homosexuelles l’impression d’être violées et utilisées… alors que pourtant, c’est souvent le cas.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.