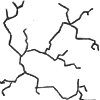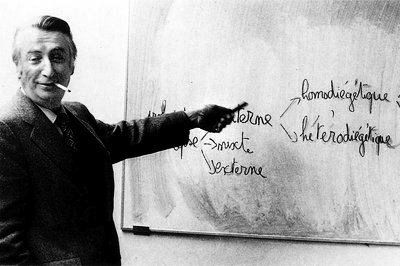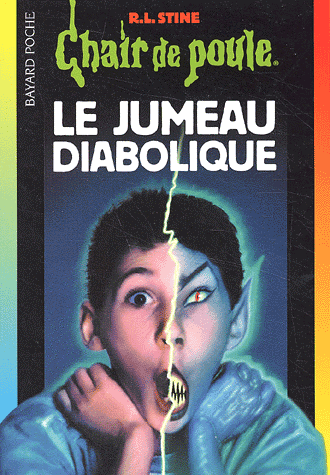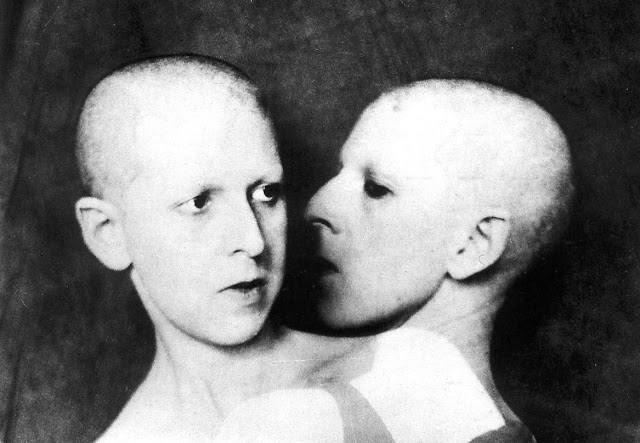Désir désordonné
« Je suis un mutant, un nouvel homme, je ne possède même pas mes désirs, je me parfume aux oxydes de carbone, et j’ai peur de savoir comment je vais finir. » (Francis Cabrel, « Ma place dans le trafic »)
NOTICE EXPLICATIVE :
L’Église catho serait la seule à dire que les actes homos sont intrinsèquement désordonnés ? Pas du tout. Les personnes homos l’ont dit avant Elle !
Qu’est-ce que le désir homosexuel et quel est son sens ? Voilà pour moi la vraie question qui vaille le coup en matière d’homosexualité. Le reste (l’identité homo, l’amour homo, la communauté homo, la culture homo) se légitime beaucoup moins, et ne trouve sa raison d’être que parce que le désir homosexuel existe ; c’est bien la seule chose dans l’homosexualité dont on soit sûr qu’elle existe, d’ailleurs. Par conséquent, si un phénomène est présent, y compris « en suspension », il peut s’étudier en tant que réalité (désirante, fantasmatique, symbolique). Je suis un des rares qui pensent que le désir homosexuel, même s’il ne s’essentialise pas en espèce (« les » homosexuels) ni en amour éternel (l’« amour homosexuel »), a quand même une nature et ses caractéristiques propres… qu’il partage bien souvent avec le désir hétérosexuel.
N’étant pas fondé sur les quatre rocs du Réel que sont la différence des sexes, la différence des générations, la différence des espaces et la différence entre Créateur et créatures, il était à prévoir que ce désir homosexuel – qui rejette clairement la différence de sexes (et un peu moins les deux autres différences) –, s’il est pratiqué, ne trouve pas son canal, ait du mal à s’incarner, et s’éparpille dans tous les sens, pour s’actualiser de manière désordonnée et partielle dans les réalité humaines et relationnelles. Quand l’Église catholique dit que les actes homosexuels sont « intrinsèquement désordonnés », Elle a plus que jamais raison, quand bien même, vue de loin, cette expression ecclésiale résonne comme « intrinsèquement homophobe », car certains ne cherchent pas à la comprendre.
Le désir homosexuel est l’expression du climat fortement anti-naturaliste de nos sociétés actuelles qui encouragent l’individu à s’éloigner du Réel pour rejoindre les paradis virtuels, à vider ses actes de leur portée symbolique, et à dissocier l’être du faire, le corps de l’esprit, les actes de leurs sens. Même si la schizophrénie n’est pas l’apanage du désir homosexuel, je crois que celui-ci fait partie, avec le désir hétérosexuel, des plus puissantes forces humaines écartelantes qui existent. Si j’avais à en donner une seule définition, je pourrais dire que le désir homosexuel tend davantage à la désunion réifiante de l’être qu’il habite qu’il ne veille à son unité humanisante. C’est la raison pour laquelle bon nombre de personnes homosexuelles l’associent inconsciemment ou volontairement à la schizophrénie.
Souvent, dans leurs discours, elles ne dissocient pas le désirant du désiré ; elles croient qu’elles ne doivent leur existence qu’à elles-mêmes et qu’elles sont leurs désirs. « Ce que nous désirons, c’est qu’on nous désire. » (Néstor Perlongher, « El Sexo De Las Locas » (1983), p. 34) En somme, elles adoptent une conception unilatérale et égocentrique du Désir : « Le désir ignore l’échange, il ne connaît que le vol et le don » (p. 219) écrivent Gilles Deleuze et Félix Guattari dans leur Anti-Œdipe (1972/1973). Il n’est plus lié à l’unité ni à la vie puisqu’elles le comparent narcissiquement à la schizophrénie ou à elles-mêmes.
« L’homosexuel » est, comme dirait Hugo Marsan, l’allégorie d’un « désir fantôme ». Il correspond à la créature littéraire nommée l’androgyne, décrite pour la première fois par Platon dans son Banquet (380 av. J.-C.), ou à l’être imaginaire créé par la science il y a un peu plus d’un siècle, en 1869. Quand cette créature habite l’Homme, parce que celui-ci désire s’y identifier, elle le blesse et le divise. C’est là sa particularité. L’androgyne est l’autre nom de la souffrance. C’est pourquoi Patrice Chéreau et Hervé Guibert, dans leur grande intuition, ont donné à la personne homosexuelle le nom cinématographique d’« Homme blessé ».
Tout mon travail sur le désir homosexuel m’a déjà permis de dégager 7 caractéristiques principales du désir homosexuel, qui montrent par le bon sens (et non des arguments religieux) que l’intuition de l’Église catholique sur la nature désordonnée, fragile, et violente du désir homosexuel, est inspirée et avérée. À mon avis, le désir homosexuel :
1 – est un désir de viol (et parfois le signe d’un viol réel)
2 – traduit un éloignement du Réel (surtout par rapport aux 4 « rocs » du Réel cités ci-dessus)
3 – est un désir d’être objet
4 – dit une peur d’être unique (… donc d’être aimé/d’aimer)
5 – est un désir de se prendre pour Dieu (on revient à la haine de soi)
6 – est un désir idolâtre (c’est-à-dire pour et contre lui-même : il mériterait de s’appeler « homophobie » ou « absence de désir »)
7 – est un désir de fusion-rupture (sincère mais non vrai, amoureux mais non aimant, identique au désir hétérosexuel et tout aussi violent que lui ; moins fort que le Désir du couple femme-homme aimant)
Ces 7 points sont le fruit de toutes mes études d’« homosexologue ». C’est mon E = MC2 à moi, la formule de ma Bombe « H » (« Homosexualité ») ! Et il n’y a pas de copyrights. Vous pouvez les récupérer et les ré-utiliser à loisir, car ils vous seront très utiles et éclairants. Ils illustrent bien pourquoi il y a désordre dans le désir homosexuel, et que celui-ci n’est que le voyant rose d’un désordre social beaucoup plus étendu dans les couples hétérosexuels.
Pour compléter ma réflexion sur le désir homosexuel, je vous encourage fortement à lire ce qui se passe côté complexité, cette fois du point de vue du couple homosexuel et de l’amour homosexuel (et non plus simplement sur un plan individuel, ou du point de vue du désir homosexuel, comme je vais vous l’expliquer ici), avec les codes « Manège », « Appel déguisé », « Liaisons dangereuses », et avec la partie sur la « Schizophrénie » de mon code « Doubles schizophréniques » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels.
N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Liaisons dangereuses », « Se prendre pour Dieu », « Doubles schizophréniques », « Milieu psychiatrique », « Appel déguisé », « Déni », « Androgynie Bouffon / Tyran », « Viol », « Moitié », « Amant diabolique », « Amant narcissique », à la partie « Diable au corps » du code « Ennemi de la Nature » et à la partie « Fatigue d’aimer » et « Ennui » du code « Manège », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.
FICTION
Le désir homosexuel (tout comme le désir hétérosexuel) est le signe d’un désir divisant et schizophrénique, d’une blessure.
a) Tout désir est considéré par le héros homosexuel comme un dieu auquel il faut se soumettre :
Dans les fictions traitant d’homosexualité, une grande place est laissée au désir : cf. le film « L’Heure du désir » (1954) d’Egil Holmsen, le film « L’Homme de désir » (1969) de Dominique Delouche, le film « I Want What I Want » (1971) de John Dexter, le film « Nincsen Nekem Vagyam Semmi » (« C’est ce que je veux et rien d’autre », 2000) de Kornel Mundruczo, le recueil de poèmes La Realidad Y El Deseo (La Réalité et le Désir, 1936) de Luis Cernuda, le film « La Ley Del Deseo » (« La Loi du Désir », 1986) de Pedro Almodóvar, la pièce Confidences (2008) de Florence Azémar (avec Stéphane, le héros homosexuel, travaillant dans la « Compagnie du Désir », qui monte des spectacles pour enfants), le film « Basic Instinct » (1992) de Paul Verhoeven, le film « À mon seul désir » (2023) de Lucie Borleteau, etc.
Mais quel type de désir le héros homosexuel défend-il ? Des grands désirs (amour vrai, amitié, engagement de couple, fidélité, rêves, promesses, don entier de soi aux autres, abandon de sa personne, actions de charité concrètes pour les autres, obéissance et service, combats pour la vie, liberté audacieuse encadrée par la raison, Dieu, etc.) ou bien des petits désirs (fantasmes, passion, imaginaire, sentiments, état amoureux, sincérité, envies, goûts, pulsions, instincts, bonnes intentions, plaisirs éphémères des sens, bien-être, etc.) ? Dans son cas, on se situe davantage dans les petits désirs, ceux qui anesthésient la révolte de ne pas donner un sens plus profond à sa vie, ceux qui compensent le manque des grands désirs, ceux qui ne favorisent pas l’unité et la conscience mais au contraire qui accentuent le désordre. L’élan homosexuel du héros ressemble davantage à une absence de désir (ou à un manque de confiance en soi) qu’à un désir, en fait : « Je sais pas ce que je veux. […] Je sais qu’aimer toute une vie, c’est tellement rare ! » (Didier, le héros bisexuel après sa nuit d’« amour » avec Bernard, dans la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Ceglia) ; « Je l’aime et je ne l’ai pas choisi. » (cf. la chanson « Je l’ai pas choisi » d’Halim Corto) ; « Je m’étais profondément attaché à lui et ne cherchais pas à savoir jusqu’où irait notre relation. » (Ednar par rapport à son amant Grégoire, dans le roman Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 143) ; « C’est vrai que je ne suis pas tout à fait sûr de savoir ce que je recherche. » (Benji, l’un des héros homosexuels de la comédie musicale Sauna (2011) de Nicolas Guilleminot) ; « Je ne sais pas à quoi ça rime de défendre les droits gays, mais je le fais pour les autres. » (Mark, le chef LGBT du film « Pride » (2014) de Matthew Warchus) ; « Je ne sais pas ce que je veux. Je n’ai jamais su dire non. » (Thérèse, l’héroïne lesbienne, s’adressant en pleurs à son amante Carol, dans le film « Carol » (2016) de Todd Haynes) ; « Moi qui avais déjà si peu d’affinité avec ma propre existence… » (Jean-Claude Janvier-Modeste, Un Fils différent (2011), p. 133) ; « Ednar ne vivait que pour survivre. Il avait tant morflé dans sa jeunesse, qu’il avait fini par se détester lui-même car il ne s’était jamais senti réellement bien dans sa peau. » (idem, p. 141) ; « J’étais une épave. Je me sentais vraiment mal. » (Emory, le héros homo efféminé évoquant son adolescence, dans le film « The Boys In The Band », « Les Garçons de la bande » (1970) de William Friedkin) ; etc.
En général, le personnage homosexuel parle du désir comme d’une formidable énergie – à consommer la plupart du temps égoïstement (ou à la rigueur à deux, avec son partenaire temporaire) –, d’une puissance euphorisante, d’un désordre jouissif irréprochable… même s’il est bien en peine après de justifier par les mots pourquoi chez lui une telle fascination pour l’éclatement, mis à part en sentimentalisant, en esthétisant, ou en politisant à l’extrême son idolâtrie. D’un air éthéré ou malicieux, après avoir idolâtré l’ordre, il prône arbitrairement « l’ordre du désordre », la « révolution de l’inversion », la « vérité » des improvisations et des errances d’un désir capricieux pseudo inattendu : « L’ordre, c’est la beauté. » (Rudolf, l’un des héros gays du film « Boys Like Us » (2014) de Patric Chiha) ; « Le Nouvel Ordre a triomphé. Tous les homos, les maudits, sont pourchassés. » (Luca dans le spectacle musical Luca, l’évangile d’un homo (2013) d’Alexandre Vallès) ; « L’ordre n’était pas toujours un masque. » (Jane, l’héroïne lesbienne du roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh) ; « J’ai eu finalement pas mal de temps pour m’habituer au désordre. » (le héros homosexuel de la pièce Chroniques des temps de Sida (2009) de Bruno Dairou) ; « L’ordre est la vertu des médiocres. » (Gabriele, le héros homosexuel du film « Una Giornata Particolare », « Une Journée particulière » (1977), d’Ettore Scola) ; « Un Junkie, c’est quelqu’un qui aime beaucoup le désordre. » (Pablo dans le film « La Ley Del Deseo », « La Loi du désir » (1987), de Pedro Almodóvar) ; « La première chose qui frappa Stephen dans l’appartement de Valérie fut son splendide et vaste désordre. […] Rien ne se trouvait là où il aurait dû être, et la plupart des choses se trouvaient là où elles n’auraient pas dû se trouver. » (Stephen, l’héroïne lesbienne du roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 321) ; « Jason revoyait avec une épouvante émue la blessure de Mourad. Mais face au spectacle de sa tour d’ivoire en ruine, il n’éprouvait pas que de la douleur. Il ressentait aussi une extase inconnue. Une sorte de soulagement paradoxal, très doux, en même temps qu’enivrant. Le désordre avait aussi ses grâces. » (Jason découvrant son homosexualité et son amour pour Mourad, dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 245) ; « La règle, c’est qu’il n’y a pas de règles. » (Juna, l’une des héroïnes lesbiennes de la pièce Gothic Lolitas (2014) de Delphine Thelliez) ; etc.
Chez le personnage homosexuel s’opèrent deux mouvements apparemment opposés. D’un côté, il va dire qu’il possède parfaitement ses désirs (ce sera le culte de la subjectivité volontariste et individualiste) et que ces derniers ordonnent au Réel : « Une personne est d’autant plus authentique qu’elle ressemble à ce qu’elle a toujours rêvé d’être intensément. » (le transsexuel Agrado dans le film « Todo Sobre Mi Madre » (« Tout sur ma mère », 1998) de Pedro Almodóvar) ; « J’étais désirer-être. » (cf. le poème « Incurable » (1996) de David Huerta, p. 121) ; « Ne jamais rien sacrifier à sa propre cohérence. » (Adèle, la « fille à pédé », dans la pièce Sugar (2014) de Joëlle Fossier) ; « J’vis ma vie comme je le ressens ! » (Dany dans le film « Sexe, gombo et beurre » (2007) de Mahamat-Saleh Haroun) ; « Qu’on soit homo, hétéro, bi, mono, l’essentiel est de vivre ma vie comme on le souhaite. » (Fabien Tucci, homosexuel, dans son one-man-show Fabien Tucci fait son coming-outch, 2015) ; « L’esprit fort est le roi. Il règne ainsi sur la matière. » (cf. la chanson « Méfie-toi » de Mylène Farmer) ; etc. Mais d’autre part, comme il constate que ses désirs ne sont pas des ordres, et qu’il n’est pas Dieu, il se transforme en marionnette passive de ses petits désirs. Il se livre pieds et poings liés à la pulsion : « Depuis cette nuit-là, elles [Gabrielle et Émilie] s’écrivent, s’interrogent sans relâche sur la nature de leur sentiment, sur ce fol élan réciproque que rien ne laissait prévoir. » (Élisabeth Brami, Je vous écris comme je vous aime (2006), p. 12) ; « C’est arrivé comme ça. […] Ça arrive par surprise. » (Marie avouant qu’elle est tombée amoureuse d’Aysla, dans le téléfilm « Ich Will Dich », « Deux femmes amoureuses » (2014) de Rainer Kaufmann) ; « C’est incroyable, la force de ça. » (Claude en parlant de son désir de draguer, dans le film « Déclin de l’Empire américain » (1985) de Denys Arcand) ; « Comment exprimer le plaisir de parler au gré de nos désirs ? » (c.f. la chanson « La Parole » de Charpini et Brancato) ; « Je suis totalement gouvernée par mon désir. C’est embêtant. » (Lola, l’héroïne lesbienne en couple avec Vera… mais aussi Nina, dans la pièce Géométrie du triangle isocèle (2016) de Franck d’Ascanio) ; « Ne penses-tu pas que l’objet du désir ne prend pas trop de place dans notre vie ? » (Vera s’adressant à Lola, idem) ; « C’est le désir. Ça ne se contrôle pas. » (David Miller dans le film « La Vanité » (2015) de Lionel Baier) ; « Vénus a allumé dans le corps d’Hyppomène et d’Atalante un désir auquel il leur était impossible de résister. » (Orphée dans le film « Métamorphoses » (2014) de Christophe Honoré) ; « Très souvent dans ma vie, ce que je prévois n’arrive jamais. C’est toujours au moment où je m’y attends le moins que tout bascule dans l’horreur. Quand je crois au bonheur, le temps et les événements, qui nous ignorent, en décident autrement et rien ne se passe comme prévu. Mais inversement, de sinistres soirées selon mes prévisions, finirent en feux d’artifices. » (Bryan, l’un des héros homosexuels du roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 27) ;« Et puis un jour, l’autre moitié de moi s’est réveillée. On ne peut rien faire contre ça. » (Martin, le héros homosexuel s’adressant à son ex-femme Christine, dans la série Joséphine Ange-gardien (1999) de Nicolas Cuche, épisode 8 « Une Famille pour Noël ») ; « Je suis épatée, émerveillée par mes désirs, subjuguée au point que je deviens docile à la toute puissance du fantasme. » (la voix narrative du roman Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train (2005) de Cy Jung, p. 30) ; « Le courant est en train de m’emporter. » (Santiago à son amant Miguel, dans le film « Contracorriente » (2011) de Javier Fuentes-León) ; « Je me suis laissé entraîner par la marée. » (idem) ; « Fallait-il […] que je me livre à la force ? Je vais me livrer, impuissant pour ma part, à cette force. » (Adrien, le héros homosexuel du roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, p. 37) ; « C’est bizarre : On a cette chose en soi et on ne la combat pas, car on l’ignore. » (Martha, l’une des deux héroïnes lesbiennes, à Karen, dans le film « The Children’s Hour », « La Rumeur » de William Wyler) ; « Sur le moment, je perdais le contrôle. Et après, je me rendais compte de ce que j’avais fait. » (Vincent, le héros homosexuel ayant des accès de violence avec son ex-compagnon Stéphane, dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson) ; « Ce que tu ressens en ce moment, c’est cette force qu’on ne peut pas arrêter. » (Heck, le mari malheureux de Rachel, découvrant avec impuissance l’homosexualité de sa femme Rachel, dans le film « Imagine You And Me » (2005) d’Ol Parker) ; etc. Par exemple, dans le roman Vincent Garbo (2010) de Quentin Lamotta, Emmanuel a « la manie du rangement des désordonnés profonds » (p. 152). Dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson, le jeune héros homosexuel Vincent recouche sans trop de conviction avec son ex-amant Stéphane, de 20 ans son aîné… et leur nuit de sexe laisse place à l’incertitude : « Tu crois qu’on sera heureux un jour ? » « Ces choses-là se décident sans nous, j’en ai bien peur. » lui rétorque Stéphane (c’est la dernière réplique de la pièce, qui montre combien le désir homosexuel fuit le Désir).
« Pawel cherche la source de cette douleur. Essaie de la comprendre. L’homme que je cherche est en moi. Quel est cet homme ? Est-ce l’icône de mon père perdu ? Est-ce donc cela la source de la blessure primitive : la sensation laissée par l’absence du père.[…]Même si la racine de cet amour est bonne, comme l’est la racine de tout autre amour humain, son tronc et ses branches ont été courbés. Je ne sais pas pourquoi je suis attiré par ce désir déréglé. J’en souffre. Mais je refuse d’appeler l’arbre courbé un arbre droit. » (Pawel Tarnowski, homosexuel continent, repoussant son élan physique et sentimental envers le jeune David, dans le roman Sophia House, La Librairie Sophia (2005), p. 419) ; « Ce désir n’est pas bon, chuchota Pawel. Mais où puis-je aller pour y échapper ? » (Pawel après avoir vu David nu, idem, p. 472) ; « Il y a une partie bonne et l’autre partie est une blessure infligée par le sitra ahra. » (Pawel parlant de son élan homosexuel, idem, p. 477)
Dans le roman Harlem Quartet (1978) de James Baldwin, mis en scène par Élise Vigier en 2018), Julia devient, très jeune, une femme pasteur évangélique promotionnant l’ordre (son grand slogan, c’est « Mets ta maison en ordre ! »). Elle insiste sur ce concept car en réalité, elle subit le grand désordre chez elle puisque son père la viol : « La maison de Julia est dans un désordre indescriptible. » dit-elle. L’ordre dont il est question est donc, en filigrane, le viol.
b) Le désir homosexuel entraîne le héros homosexuel dans le désordre :
La soumission du personnage homosexuel à ses petits désirs est souvent marquée par un trouble qui fendille l’identité et l’amour, une impression d’être son propre esclave, de ne pas être maître de sa vie ni libre, de ne pas être unifié. Ce n’est pas un hasard si le lexique du désordre revient comme un leitmotiv dans les œuvres homosexuelles : cf. le roman El Desorden (1965) de Terenci Moix, le film « Le Désordre » (1961) de Franco Brusati, le roman Mes désirs font désordre (2003) de Nicolas Dutriez, le film « Vierge, ascendant désordres » (2004) d’Erwan Chuberre, le film « Les Enfants du désordre » (1989) de Yannick Bellon, le roman Dans le désordre (2012) de Claude Régy et Stéphane Lambert, la nouvelle « Désordre » (1929) de Thomas Mann, le roman Le Désordre du Temple (2011) d’Antoine Blocier, le film « Désordres » (2013) d’Étienne Faure, le film « Les Pâtres du désordre » (1968) de Nico Papatakis, la prestation de SweetLipsMesss lors de la scène ouverte Côté Filles au troisième Festigay du Théâtre Côté Cour de Paris (avril 2009), le film « Kaboom » (2010) de Gregg Araki, le roman Désordres (2017) de Jonathan Gillot, la chanson « Veux-tu danser ? » de Michel Rivard, etc. « Mon Dieu, quel désordre ! Je n’arrive plus à m’y retrouver ! » (Jeanne dans la pièce La Journée d’une Rêveuse (1968) de Copi) ; « Jamie était une piètre ménagère, et très désordonnée ; si elle faisait la cuisine, elle mettait tout sens dessus dessous. » (Jamie, une des protagonistes lesbiennes, dans le roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 462) ; « J’ai jamais vu un mec qui avait l’air aussi propre sur lui et qui était autant bordélique. » (Polly, l’héroïne lesbienne par rapport à son meilleur ami gay Simon, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 13) ; « Ordre et discipline. » (Jarry parlant du tatouage de Jean-Claude, le commissaire de police, dans son one-man-show Atypique, 2017) ; « Tu es censé être un chien ordonné. » (Citron parlant tout seul à son chien, dans le film « La Parade » (2011) de Srdjan Dragojevic) ; « C’est le bordel dans ma vie. Il faut que je mette un peu d’ordre. » (Julien, le héros bisexuel, dans la pièce Ma belle-mère, mon ex et moi (2015) de Bruno Druart et Erwin Zirmi) ; « Tu crées la pagaille autour de toi. » (sir Harold Nicolson) « Je ne suis pas dans la pagaille ! » (Vita Sackville-West, lesbienne, répondant à son mari, dans le film « Vita et Virginia » (2019) de Chanya Button) ; « Les bombes à retardement servent à semer le désordre. » (Tommaso, le héros homosexuel parlant de sa grand-mère décédée et insoumise, dans le film « Mine Vaganti », « Le Premier qui l’a dit » (2010) de Ferzan Ozpetek) ; « Toi et moi, on a des choses à mettre en ordre tous les deux. » (Rosa s’adressant à Julien dans le film « Rosa la Rose : Fille publique » (1985) de Paul Vecchiali) ; « Occupe-toi d’abord du désordre de la nuit… » (Marie insinuant à son mari Alexandre qu’il lui aurait caché ses tendances homosexuelles, dans le film « Pédale douce » (1996) de Gabriel Aghion) ; « L’Amour est un désordre. » (c.f. la chanson « Monsieur Vénus » de Juliette) ; etc.
Par exemple, dans le roman At Swim, Two Boys (Deux garçons, la mer, 2001) de Jamie O’Neill, Anthony MacMurrough, en caressant les cheveux ébourrifés de son jeune prostitué Doyler, qualifie ce dernier de « désordonné… vraiment… ». Dans le film « Jonas » (2018) de Christophe Charrier, Jonas, le héros homosexuel, a déclenché une baston dans un club gay The Boys qu’il fréquente habituellement. Les flics venus l’arrêter déroulent son passif délictueux : « Apparemment, c’est pas la première fois que tu fous le bordel au Boys… ». Dans le film « A Moment in the Reeds » (« Entre les roseaux », 2019) de Mikko Makela, Leevi, le héros homosexuel finlandais, dit qu’il a quitté son pays pour vivre librement son homosexualité loin de sa famille à Paris, mais décrit sa vie parisienne comme « agitée ».
Le désir homosexuel incite à l’éclatement symbolique du corps et du cœur : cf. le roman Le Cœur éclaté (1989) de Michel Tremblay, le film « Les Corps ouverts » (1998) de Sébastien Lifshitz, etc. « Jésus veut que j’aie une vie ordonnée. » (Tom, homosexuel croyant, dans la pièce Les Vœux du Cœur (2015) de Bill C. Davis) ; « Mon corps est moins pur que mon âme, je le disperse et je l’offre. » (Max Jacob dans le film « Monsieur Max » (2007) de Gabriel Aghion) ; « Cette femme a dû commettre beaucoup de désordre dans le cœur des hommes. » (Stan par rapport à la femme au collier de perles, dans la pièce Big Shoot (2008) de Koffi Kwahulé) ; « Au milieu, il y a cette publicité qui me fait froid dans le dos, où l’on voit une jeune femme se désagréger. Je touche Chloé pour vérifier qu’il ne lui manque rien. […] Je voudrais tant qu’elle se rassemble, cesse de s’éparpiller, de partir en miettes. » (Cécile à propos de son amante Chloé, dans le roman À ta place (2006) de Karine Reysset, p. 64) ; « Nous devrions faire le bilan de nos déviations » (Lola l’héroïne lesbienne s’adressant à son amante Vera, dans la pièce Géométrie du triangle isocèle (2016) de Franck d’Ascanio) ; etc. Dans les fictions, en général, l’élan homosexuel n’est pas facteur d’ordre ni d’unité. Par exemple dans Le Banquet (380 av. J.-C.) de Platon, concernant le désir homosexuel, il est justement question d’un « amour désordonné ». Dans le film « Après lui » (2006) de Gaël Morel, les premières images filmées sont celles d’une chambre (la chambre du protagoniste homosexuel Matthieu) en complet désordre. Dans le film « Romeos » (2011) de Sabine Bernardi, Miriam/Lukas, l’héroïne transsexuelle F to M est définie en tant que « Gender Identity Desorder » par son médecin. Dans le film « Toute première fois » (2015) de Noémie Saglio et Maxime Govare, Jérémie, le héros homo qui ne s’était jamais posé la question de remettre en cause son homosexualité, voit sa vie chamboulée par l’amour d’une femme : on le voit essayer de partager en deux une carcasse de poulet… comme pour illustrer le déchirement qu’est le désir bisexuel.
Le désir homosexuel porte en germe la rupture plus que l’unité, d’une part au cœur de l’individu qui le ressent, et d’autre part dans le couple homosexuel : « L’amour, si tu savais, c’est du désordre. » (Franck dans la pièce Mon Amour (2009) d’Emmanuel Adely) ; « Partout, je sens ton odeur, ton désordre. » (Vincent s’adressant à son amant Arthur, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 158) ; « Nous sommes deux femmes qu’un désir de partage rassemble. » (la narratrice lesbienne du roman Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train (2005) de Cy Jung, p 41) Le désir homosexuel ne semble pas favoriser la correspondance et la simultanéité des désirs de chacun des deux amants du couple : « Les gestes que tu attends de moi ne répondent pas à ce que nous attendons de nous. » (Pierre dans le roman La Peau des Zèbres (1969) de Jean-Louis Bory, p. 186) ; « Ce qui me rend heureux te rend triste. » (une réplique du film « L’Homme blessé » (1983) de Patrice Chéreau) ; « C’est quand même vachement déstabilisant. » (Damien évoquant ses expériences homosexuelles, dans la pièce Soixante degrés (2016) de Jean Franco et Jérôme Paza) ; « Je ne suis même pas homo. Il y a deux ans, j’ai juste aimé follement l’homme de la vie de l’ancienne femme de la mienne. Depuis, tout est rentré dans l’ordre. » (Rémi parlant son histoire avec l’hétéro Damien, le copain de son ex Marie, idem) ; etc.
Le héros homosexuel a tendance à décrire son penchant homosexuel comme un désir compliqué, difficile à gérer : cf. le roman La Confusion des sentiments (1928) de Stefan Zweig, le film « Cap Tourmente » (1993) de Gérard Ciccoritti, le film « Contradictions » (2002) de Cyril Rota, le roman Le Cœur entre deux chaises (2012) de Frédéric Monceau, le film « The Love Paradox » (2000) de Clifton Ko, le roman Los Ambiguos (1922) d’Álvaro Retana, la chanson « L’Inconstant » d’Étienne Daho, les films « Désirs volés » (1997) et « Le Désir en ballade » (1989) de Jean-Daniel Cadinot, le roman Le Désir fantôme (1999) d’Hugo Marsan, etc. « Je suis trop compliquée. » (Peyton, l’héroïne lesbienne parlant à son amante Elena, dans le film « Elena » (2010) de Nicole Conn) ; « Avec toi, je me sens mal. Je mens. Je me sens dure. Tu me donnes le mauvais rôle. » (Sarah s’adressant à son amante Charlène, dans le film « Respire » (2014) de Mélanie Laurent) ; « Si au moins je me comprenais moi-même. » (Charlotte, l’héroïne lesbienne du film « À trois on y va ! » (2015) de Jérôme Bonnell) ; « Vous, vous êtes plutôt compliqué. » (Antonietta s’adressant à son ami homosexuel Gabriele, dans le film « Una Giornata Particolare », « Une Journée particulière » (1977) d’Ettore Scola) ; « C’est diablement déplaisant pour moi [de vous désirer]. » (Virginia Woolf s’adressant à son amante Vita Sackville-West, dans le film « Vita et Virginia » (2019) de Chanya Button) ; etc.
Il fait vivre des « humeurs vagabondes » (cf. la chanson « L’Adorer » d’Étienne Daho) et entraîne le personnage homosexuel dans l’espace fluctuant de la non-identité, de la dualité : « L’ambiguïté, c’est ton truc. » (Clara à son meilleur ami homo JP, dans la série Clara Sheller (2005) de Renaud Bertrand, l’épisode 1 « À la recherche du prince charmant ») ; « En fait, je ne sais pas trop comment je suis. Je ressens des trucs bizarres. » (Florence, l’héroïne lesbienne de la pièce Confidences (2008) de Florence Azémar) ; « J’aime les filles et les garçons, j’aime tout ce qui est bon. Je suis bi… zarrement faite. » (Anne Cadilhac, Tirez sur la pianiste, 2011) ; « Stephen [l’héroïne lesbienne] était parfois hypersensible et souffrait en conséquence. » (Marguerite Radclyffe Hall, The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928), p. 62) ; etc.
Par exemple, dans le roman N’oubliez pas de vivre (2004) de Thibaut de Saint Pol, le héros homosexuel, parlant de lui-même à la deuxième personne du pluriel, fait référence à « une force confuse » (p. 12 puis p. 46) ; « Il y a cette voix en vous qui vous oblige. Comment leur parler de la voix ? […] Comment leur faire entendre que c’est votre nature ? » (idem, p. 135) Dans la pièce Arthur Rimbaud ne s’était pas trompée (2008) de Bruno Bisaro, la voix narrative pose la question de l’impossibilité de l’union entre les amantes homosexuelles, en se demandant quelle est la nature paradoxale de la force de séparation qui les régit, et qui est pourtant censée les unir : « Mais qui tire en arrière ?!? Quel homme ? Quel enfant mort-né ? Quel bouffon ? » Dans le film « Bulldog In The Whitehouse » (« Bulldog à la Maison Blanche », 2008) de Todd Verow, le président des Etats-Unis bute face à la même énigme : Pourquoi le désir homosexuel est pour et contre lui-même ??? « Depuis que je suis petit, on me dit qu’aimer un homme c’est mal. Mais on ne m’a jamais dit pourquoi. Vous pouvez me le dire ? Bobby dit qu’il n’y a rien de mal à ça… que tout le monde a besoin d’aimer quelqu’un, et que son sexe n’a pas d’importance. Alors pourquoi je ne peux pas l’aimer ? » Dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, Bryan, le héros homosexuel, se dit « torturé » (p. 393) : « J’ai l’esprit tortueux. » (idem, p. 328) ; « J’ai toujours envie de te voir et d’être à tes côtés mais dès que tu t’approches de moi, je n’ai qu’une envie : celle de fuir, de t’ignorer, de passer près de toi sans te voir. Comment peut-on être aussi compliqué ? Pourquoi mon esprit me commande-t-il le contraire de ce que mon corps réclame ? Pourquoi ai-je peur de toi ? » (Bryan à son amant Kévin, idem, p. 210) Dans le film « La Vie d’Adèle » (2013) d’Abdellatif Kechiche, Emma, l’une des héroïnes lesbiennes, se qualifie « d’un peu bizarre » comme fille.
D’une certaine manière, le désir homosexuel se place contre l’ordre naturel, social, et divin… et le personnage homosexuel le devine, bien souvent dans la révolte : « Dieu, qui a créé le ciel et la terre, aurait pu décréter qu’un frère et une sœur pouvaient se marier, que deux femmes pouvaient procréer ensemble. Dans Sa façon d’ordonner le monde, Il aurait pu donner à ceux qui sont les plus proches la possibilité de s’accoupler. Il aurait ainsi offert à Ses créations un bien-être plus grand. Pour quelle raison, alors, ne l’a-t-Il pas fait ? » (Ronit, l’héroïne lesbienne du roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, p. 174) On retrouve dans son discours des réminiscences du péché originel : « Ses yeux étaient immenses, ses cheveux tombaient en désordre sur ses épaules. La peau de son ventre faisait des plis, rentrait en elle-même. Je me suis rendu compte que nous étions nues. » (Ronit, l’héroïne lesbienne décrivant sa copine Esti après leur nuit d’amour, idem, p. 243)
Le désir homosexuel écartèle parce qu’il opère un double mouvement de vie et de mort : « Je ferme les yeux sur nos dernières nuits. Qui nous sépare ? Qui nous unit ? » (cf. la chanson « J’attends » de Mylène Farmer) ; « T’es déchirée ? Déjà ? » (Bernard, le héros homosexuel s’adressant au transsexuel M to F Géraldine dans la pièce Nous deux (2012) de Pascal Rocher et Sandra Colombo) ; etc. Dans son poème « Unidad En Ella », l’écrivain espagnol Vicente Aleixandre nous parle justement de la dualité des désirs homosexuel et hétérosexuel, qui sont un seul et même « désir d’amour ou de mort ».
C’est la raison pour laquelle le désir homosexuel est souvent défini/représenté dans les fictions par une blessure, une cicatrice, une balafre : cf. le roman La Vie blessée (1989) d’Hugo Marsan, le film « L’Homme blessé » (1983) de Patrice Chéreau, le film « La Brèche de Roland » (2000) d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu, la chanson « Escargot » d’Éric Mie, le film « Fracture du myocarde » (1990) de Jacques Fansten, la chanson « Point de suture » de Mylène Farmer, le film « Torn Curtain » (« Le Rideau déchiré », 1966) d’Alfred Hitchcock, le roman De Perlas Y Cicatrices (1998) de Pedro Lemebel, le film « Les Souffrances » (2001) de Louis Dupont, le roman Blessés (2005) de Percival Everett, le film « Riparo » de Marco Simon Puccioni, le film « Les Blessures assassines » (2000) de Jean-Pierre Denis (avec les sœurs incestueuses), le film « Prora » (2012) de Stéphane Riethauser (la grande plaie dans la cuisse de Jan, le héros homo), le roman L’Âge blessé (1998) de Nina Bouraoui, le film « Blessure » (2011) de Johan Vancauwenbergh, la série britannique Beautiful People (2009) de Jonathan Harvey (avec l’épisode « Ma première balafre », en anglais « How I Got My Gash »), le film « Separata » (2013) de Miguel Lafuente, le roman Blessés (2013) de Percival Everett, la chanson « La Blessure » d’Emmanuel Moire, etc.
Dans le film « Jonas » (2018) de Christophe Charrier, Nathan, l’un des héros homosexuels, porte une cicatrice sur la joue. Elle intrigue son amant Jonas : « Il a une cicatrice qui va de là à là. » révèle-t-il à ses parents, de retour du collège. Et elle semble être la marque de l’homosexualité de Nathan, puisque la maman gay friendly de ce dernier l’aime beaucoup et tente de la faire aimer aussi à Jonas : « Tu sais que je l’adore, ta cicatrice, mon chéri. Elle te donne plein de charme. C’est pas Jonas qui dira le contraire. Hein, Jonas ? » Pour expliquer cette balafre, Nathan fait croire à son amant qu’il a été abusé dès la classe de CM1 dans son école catholique de Saint Cyprien par un prêtre, qui l’aurait forcé à lui faire une fellation et qu’il aurait mordu au sexe… et ce prêtre, en représailles, lui aurait donné un coup de calice coupant au visage : « Du coup, il a pris la coupe qui était posée sur l’autel. Schlaaa… Il m’a fait ça. » On découvrira que l’entaille que Nathan porte sur sa joue ne vient pas du coup de calice, mais d’un lynchage collectif qu’il a subi aux autos tamponneuses à l’âge de 9 ans dans un parc d’attractions appelé Magic World. En effet, il s’est fait tamponner par une meute de voitures qui l’a chargé, au point que Nathan a été éjecté de sa voiture et s’est fait défigurer : « Et schlaaack ! La joue coupée en deux, sur la barrière de protection. » dira la maman de Nathan. La balafre de Nathan signera son arrêt de mort puisqu’à la fin, le prédateur homo qui tue le jeune homme dans sa voiture le flatte d’abord de manière perverse par rapport à celle-ci : « Elle est mignonne la petite cicatrice… »
« Je passe par toute la gamme de la souffrance. Tant de malheur. » (Vera dans la pièce Gouttes dans l’océan (1997) de Rainer Werner Fassbinder) ; « L’enfant sent en lui qu’il est porteur d’une minuscule fissure. C’est une chance et une souffrance. » (Damien, le travesti M to F parlant de lui-même par une métaphore, dans le pièce Brigitte, directeur d’agence (2013) de Virginie Lemoine) ; « Je suis passé de l’autre côté du miroir. J’ai recollé mes morceaux. » (Mr Alvarez, qui dit avoir retrouver son unité en se travestissant en femme, idem ; il va quand même voir ensuite avec son nouvel ami – transgenre comme lui – Damien un film expérimental nommé « Éclat de viande »…) ; « Oui, tu as des cicatrices mais ce n’est pas grave. Ta vie serait plus simple si tu arrêtais de te torturer. » (Michael, le héros homo se moquant de son colocataire gay aussi, Harold, passant des heures devant sa glace à se mettre des crèmes, dans le film « The Boys In The Band », « Les Garçons de la bande » (1970) de William Friedkin) ; « Mais il n’oubliera jamais cette cicatrice que tu lui as faite. » (Michael s’adressant à Alan par rapport à Justin, idem) ; « Alors Didier, pour toi, est-ce qu’on peut refermer une cicatrice ? » (le présentateur télé s’adressant à Didier, l’un des héros homos, dans la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Ceglia) ; « J’aime la cicatrice. » (le jeune Mathan, homosexuel, dans la pièce Un Cœur en herbe (2010) de Christophe et Stéphane Botti) ; « C’est l’attirance de deux femmes avec la même blessure. » (Klaus parlant des deux personnages lesbiens d’Helena et Sigrid dans le film « Sils Maria » (2014) d’Olivier Assayas) ; « Toutes les cicatrices se rouvrent. » (Junn, la mère de Kai le héros homosexuel, dans le film « Lilting », « La Délicatesse » (2014) de Hong Khaou) ; « La différence, c’est que toi tu n’es pas stigmatisée. » (Adineh l’héroïne transsexuelle F to M s’adressant à Rana la femme mariée, dans le film « Facing Mirrors : Aynehaye Rooberoo », « Une Femme iranienne » (2014) de Negar Azarbayjani) ; « Tous les hommes sont des ignobles soldats allemands avec une cicatrice dans la lèvre. » (Alfonsina, l’ouvreuse dans un ciné porno, dans la pièce Le Cheval bleu se promène sur l’horizon, deux fois (2015) de Philippe Cassand) ; « Tu rouvres cette vieille blessure. » (Virginia Woolf s’adressant à son amante Vita Sackville-West revenant amoureusement à la charge, dans le film « Vita et Virginia » (2019) de Chanya Button) ; etc.
Par exemple, dans la pièce Un Cœur en herbe (2010) de Christophe et Stéphane Botti, Mathan, le héros homosexuel de 19 ans, dit avoir un lien secret avec Albator. Dans la pièce Fatigay (2007) de Vincent Coulon et dans le film « Bug » (2003) d’Arnault Labaronne, le pirate Albator est le personnage préféré du héros homosexuel. Dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, Polly, l’héroïne lesbienne ressemble au fameux pirate : « Elle rejette en arrière la mèche qui vient lécher son visage d’Albator moderne comme au ralenti et j’ai peur qu’elle veuille que l’on fasse l’amour ensemble. » (p. 14) Dans le film « Après lui » (2006) de Gaël Morel, Franck chante « Albator » au chat de Matthieu, nommé Stelly (Stelly était d’ailleurs la protégée d’Albator). Dans le film « C.R.A.Z.Y. » (2005) de Jean-Marc Vallée, Torturé par son homosexualité, Zachary, le jeune héros homosexuel, se dessine le même éclair sur le front que David Bowie. Dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1985) de Copi, Vicky Fantomas est une femme avec une cicatrice sur la joue gauche, avec une attelle à la jambe ; elle a été victime d’un attentat au drugstore (et peut-être qu’elle-même portait la bombe). Dans le spectacle musical Luca, l’évangile d’un homo (2013) d’Alexandre Vallès, Luca ne comprend pas pourquoi il souffre (« Sur mon poitrail, aucune cicatrice. ») et pourtant, il se sent coupable de quelque chose. Dans le film « Rosa la Rose : Fille publique » (1985) de Paul Vecchiali, Yvette évoque l’existence d’un type surnommé « Dédé la Balafre » : « On l’appelle Dédé. Et parfois, on lui dit ‘La Balafre’. » Dans le roman The Girl On The Stairs (La Fille dans l’escalier, 2012) de Louise Welsh, les deux héroïnes principales, à savoir Jane (lesbienne en couple avec Petra) et la jeune Anna (13 ans), ont la même éraflure sur le visage, à cause d’un lanceur de pierres qui a sévi autour de leur immeuble : « joue éraflée » (p. 33) ; « Jane se sentit un peu dépassée. Il était possible que la fille et elle aient été victimes du même lanceur de pierres. » ( p. 44) ; « Jane songea une nouvelle fois à Anna, à l’ecchymose au-dessus de son œil qui reflétait presque la sienne. » (p. 54) ; « Vous avez une coupure sur le visage. » (un flic s’adressant à Jane, idem, p. 147) ; etc. Dans le film « The Talented Mister Ripley » (« Le Talentueux M. Ripley », 1999) d’Anthony Minghella, Tom, le héros homo, s’exerce au décryptage graphologique de l’écriture de l’homme qu’il aime, Dick : « C’est une blessure. » dont les lettres de Dick seraient signe. Dans le film « Call me by your name » (2018) de Luca Guadagnino, c’est au moment où Oliver sort avec le jeune Elio que sa plaie sur l’aine gauche se réouvre : « Je crois que ça s’infecte. » Dans le film « Moonlight » (2017) de Barry Jenkins, Chiron, le jeune héros homosexuel, au moment où il ressent une attirance pour son camarade Kevin, lui découvre sur la joue une petite plaie. Je vous renvoie bien évidemment au code de la « Moitié » dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels.
Il est signifiant que beaucoup de personnages homosexuels s’auto-proclament blessés de la vie, déchirés au niveau du désir et de l’amour, entre leur conscience et leurs actes sexuels : « Nous, les écorchés du cœur » (Louis II de Bavière dans la pièce Le Roi Lune (2007) de Thierry Debroux) ; « Je suis déchiré. » (Malcolm, le héros homosexuel du roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, p. 121) ; « Ici, les gens sont atypiques, on dit qu’ils sont fous, déments, déviants, cinglés, moi je crois qu’ils sont plutôt fêlés. C’est comme une blessure, c’est comme une coupure. » (Cécile à propos des habitants de l’hôpital psychiatrique où est internée son amante Chloé, dans le roman À ta place (2006) de Karine Reysset, p. 76) ; « Je ne suis pas mort… mais je suis séparé. » (Antonin Artaud, « Les Nouvelles révélations de l’être », 1937) ; « Au-delà de son orientation sexuelle, il percevait chez lui une fragilité. » (Adrien, le héros homosexuel du roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, p. 111) ; « Tu vas craquer. Tu es déjà plein de fissures. » (Georges à Zaza dans la pièce La Cage aux Folles (1973) de Jean Poiret, version 2009 avec Christian Clavier et Didier Bourdon) ; « l’homme blessé » (dans la pièce Chroniques des temps de Sida (2009) de Bruno Dairou) ; « De l’alcool ! Du coton ! Des ciseaux ! Du sparadrap ! Ça m’a l’air très mauvais cette blessure ! » (Fougère dans la pièce Les Quatre Jumelles (1973) de Copi) ; « C’est vrai qu’elle n’a rien, Fougère. C’est une petite blessure qu’elle a. C’est du cirque. » (Joséphine dans la pièce Les Quatre Jumelles (1973) de Copi) ; « Je ne sais pas quoi penser de tout ça… Vraiment pas. Tout ce que je sais… Tout ce qu’on m’a appris… dit que c’est mal. Pourtant, l’autre soir, j’étais bien. C’est vrai. Je suis complètement paumé. J’ai l’impression d’être déchiré de l’intérieur. » (Seth dit à son amant David, dans le film « And Then Came Summer » (2001) de Jeff London) ; etc.
Le personnage homosexuel ne parle pas forcément d’une blessure. Il se cantonne à la définir comme un mal-être invisible, une faiblesse, une fragilité, une défaillance : « Je ne peux pas vous guérir. Votre tourment n’est pas dû à la maladie. » (Dr Apsey, le psy du héros homosexuel Frank, dans la pièce Fixing Frank (2011) de Kenneth Hanes) ; « Je suis trop fragile et beaucoup trop désirable. » (le transsexuel Roberto/Octavia La Blanca dans la pièce Se Dice De Mí En Buenos Aires (2010) de Stéphan Druet) ; « Je je suis si fragile qu’on me tienne la main. » (cf. chanson « Libertine » de Mylène Farmer) ; « J’ai besoin qu’on me tienne la main. Je suis fatiguée. […] J’me sens tellement seule, fragile, et provisoire. » (Charlène Duval lors de son one-(wo)man-show Charlène Duval… entre copines, 2011) ; « J’aime les garçons un peu fragiles. » (un protagoniste homo dans la comédie musicale À voix et à vapeur (2011) de Christian Dupouy) ; « J’avais oublié combien elle était fragile. Sur le moment, j’ai été incapable de penser à autre chose ; appuyée contre moi, elle reposait entre mes bras et sur ma poitrine, et je la sentais à peine tant elle était légère. » (Ronit par rapport à son amante Esti, dans le roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, p. 142) ; « Il est tellement sensible. » (Marie-Muriel parlant de son fils aîné homosexuel Matthieu-Alexandre, dans la pièce 1h00 que de nous (2014) de Max et Mumu) ; « Je suis un garçon très sensible et attentionné. » (Max, idem) ; « Nous sommes très fragiles. Nous tombons. Nous échouons. Mais est-ce que c’est plus grave que ça ? » (le narrateur de la performance Nous souviendrons-nous (2015) de Cédric Leproust) ; « Tu préfères avoir un visage couvert de furoncles ou un mari un peu trop sensible ? » (Solange s’adressant à sa fille Zoé marié à un homme bisexuel, dans la pièce Ma belle-mère, mon ex et moi (2015) de Bruno Druart et Erwin Zirmi) ; « Je suis fragile, moi. J’ai eu les oreillons petit. » (Yoann, le héros homosexuel, idem) ; « Mon fils est un garçon fragile. Il ne faut pas le tourmenter. » (la mère d’Adrien s’adressant à Anna par rapport à son fils homo, dans le film « Frantz » (2016) de François Ozon) ; « T’es un peu fragile, toi… » (Léonard s’adressant à Jonas, le héros homosexuel, après avoir bu de l’alcool ensemble, dans le film « Jonas » (2018) de Christophe Charrier) ; « Ton ami est un garçon très émotif. » (Jean s’adressant à son fils Otis par rapport à son camarade homo Adam, dans l’épisode 1 de la saison 1 de la série Sex Education (2019) de Laurie Nunn) ; « T’es tendre et fragile pour me rendre docile. » (c.f. la chanson « Pas un garçon » d’Emmanuelle Mottaz) ; etc. Par exemple, dans la pièce Jardins secrets (2019) de Béatrice Collas, Maryline, l’héroïne bisexuelle, décrit Gérard son mari violent et qui l’a violée comme « un être beaucoup plus sensible qu’on ne le croit ».
Parfois, le héros homosexuel se dit torturé par un désir incompréhensible, malveillant, mystérieusement insatisfaisant : cf. le film « Me Siento Extraña » (1977) d’Enrique Marti, le film « Petite fièvre des 20 ans » (1993) de Ryosuke Hashiguchi, etc. Dans le film « Un Tramway nommé Désir » (1950) d’Élia Kazan, par exemple, Blanche associe le désir homosexuel à un « désir brutal » allant aussi rapidement qu’un tramway. Dans la pièce Le Funambule (1958) de Jean Genet, le protagoniste parle de son désir « qui s’apparente à la mort ». Dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta, Denis, le héros homosexuel, évoque une « brûlure froide ». L’émoi homosexuel fait parfois souffrir : « J’ai ressenti un flux. Comme un coup de poing. Avec un peu de tristesse. » (Mario dans la pièce Quand mon cœur bat, je veux que tu l’entendes… (2009) d’Alberto Lombardo) ; « Le désir est à la racine de tous les maux. » (une réplique du film « Fire » (2004) de Deepa Mehta) ; « De temps en temps, ses yeux s’emplissaient de larmes à cause de son douloureux désir. » (Stephen, l’héroïne lesbienne du roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 205)
Le désir homosexuel, de par sa nature d’élan désunifiant, peut avoir une parenté avec la schizophrénie : il arrive que le personnage homosexuel « s’absente sur place », ne connecte plus ses actes avec son cœur ou sa conscience : « Je le vois bien que vous êtes là. Mais moi, est-ce que je suis là, moi ? Voilà le problème. » (Jeanne au Vrai Facteur dans la pièce La Journée d’une rêveuse (1968) de Copi) ; « Qu’est-ce qu’il m’arrive ? Aujourd’hui je ne sais pas ce qu’il m’arrive. » (idem) Le vent du désordre homosexuel donne parfois l’impression d’unité dans l’écartèlement, car il apporte quelques petites compensations (la tendresse, la compagnie et la fin de la solitude, le bien-être sensitif et érotique, etc.) : « M. Fruges sentit un souffle chaud sur son oreille […] Alors des douleurs le poignirent aux jointures de ses membres, comme si on l’eût écartelé, mais cette torture cessa d’un seul coup pour être suivie d’une curieuse sensation de bien-être répandue dans toutes parties de son corps. » (Julien Green, Si j’étais vous (1947), p. 143) ; etc.
Mais au final, le désir homosexuel est présenté comme un désir sauvage, violent, passionnel, qui rend incontrôlable une personne qui, en temps normal, est plutôt équilibrée : cf. le film « Wilde Side » (2003) de Sébastien Lifshitz, le roman Alexis O El Significado Del Comportamiento Uraño (1932) d’Alberto Nin Frías, le roman Chanson sauvage (1918-1921) de Claude Cahun, le film « Relatos Salvajes » (« Les Nouveaux Sauvages », 2015) de Damián Szifron, le roman Les Garçons sauvages (1971) de William S. Burroughs, le roman Sauvage (2011) de Nina Bouraoui, le film « The Wild Dogs » (2002) de Thom Fitzgerald, la chanson « Walk On The Wild Side » de Lou Reed, le film « Le Messie sauvage » (1972) de Ken Russell, le film « Wild » (2015) de Troye Sivan, le film « Sauvage » (2019) Camille Vidal Naquet, etc. « J’ai des impatiences et des amuseries d’enfant sauvage. » (Vincent Garbo dans le roman éponyme (2010) de Quentin Lamotta, p. 9) ; « Tu as l’air d’un sauvage de Bornéo. » (la mère de Idgie, s’adressant à sa fille lesbienne, dans le film « Fried Green Tomatoes », « Beignets de tomates vertes » (1991) de John Avnet) ; « Vous êtes des bêtes sauvages ! » (Lucie s’adressant à Martine, Michèle et Jules, dans la pièce Les Sex Friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau) ; « J’suis une sauvage ! » (cf. la chanson « And I Hate You » de Mélissa Mars) ; « J’avoue : je me suis trompée ! J’ai dépensé des millions à te vouloir excentrique, bien élevée en liberté, en même temps sauvage et chic, cultivée et anarchique ! » (Solitaire à sa fille lesbienne Lou, dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « Quand je dis que je ne suis pas fiable, je suis lucide. » (Cécile, l’héroïne lesbienne du roman À ta place (2006) de Karine Reysset, p. 142) ; « C’est un maniaque du désordre, celui qui a fait ça. » (Omar en parlant de l’agresseur homosexuel/homophobe de Xav dans la pièce La Mort vous remercie d’avoir choisi sa compagnie (2010) de Philippe Cassand) ; « S’il y en a qui connaît l’animal qui est en moi, c’est bien toi, non ? » (Pierre s’adressant à son amant Benjamin dans la pièce Le Fils du comique (2013) de Pierre Palmade) ; « Tu es irréel et moi animal. » (Bryan s’adressant à son amant Kévin, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 212) ; etc. Par exemple, dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta, Luther, l’un des héros homosexuels, a pour parfum Eau Sauvage de Dior. Dans le roman The Girl On The Stairs (La Fille dans l’escalier, 2012) de Louise Welsh, le skinhead efféminé est décrit comme « un Peter Pan sauvage » (p. 95). Dans le film « Mommy » (2014) de Xavier Dolan, la mère de Steve le héros homo porte le parfum Eau Sauvage de Christian Dior.
Le désir désordonné tourmente, met le personnage homosexuel dans tous ses états. « Il vous est apparu si désemparé. […] Qu’est-ce qui peut bien l’avoir conduit à cet état ? » (la voix narrative du roman N’oubliez pas de vivre (2004) de Thibaut de Saint Pol, p. 191) ; « Ils [« les pédés »] sont flous, excessifs, durs. » (les quatre personnages homosexuels de la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel) ; « C’est comme un mal en moi qui m’effraie qui me tord. » (cf. la chanson « Les Voyages immobiles » d’Étienne Daho) ; « Je suis super mal en ce moment. » (Clara, perdue dans sa sexualité et son orientation sexuelle, et qui commence à coucher avec n’importe qui et à faire n’importe quoi, dans le téléfilm « Clara cet été-là » (2003) de Patrick Grandperret) ; etc. Dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, Bryan, le héros homosexuel, décrit sa transformation en Jean-qui-rit/Jean-qui pleure sous l’effet désordonné de l’amour homo : « Des moments sublimes où régnaient en moi une joie et une confusion absolue. Des instants d’angoisse qui basculaient toujours de façons inattendues en allant de la panique à d’intenses moments de bonheur. À chaque fois, je rentrais la tête dans les étoiles, partagé par des envies successives de rire ou de pleurer, parfois les deux ! » (p. 360) Dans la pièce Les Faux British (2015) d’Henry Lewis, Jonathan Sayer et Henry Shields, Thomas, le héros homosexuel, vivait une relation amoureuse cachée avec Charles, un homme décrit comme un alcoolique suicidaire : « Cet homme vivait dans une grande souffrance ».
Le désir homosexuel apparaît comme un désir effréné, compulsif, difficilement contrôlable, peu libre et libérant : « Les pédés sur le net ne pensent qu’au cul. » (Nono dans la pièce « Copains navrants » (2011) de Patrick Hernandez) ; « Fatalement, Grégoire savait tout cela [= mes infidélités], mais il misait sur le temps qui, selon lui, me ferait émerger du désordre de ma vie sentimentale. » (Ednar parlant de son amant, dans le roman Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 144) ; « En somme, le plus difficile dans notre histoire amoureuse était de pouvoir maîtriser mon irrésistible instabilité qui perturbait notre couple après quatre années de vie commune. » (idem, p. 155) ; « Je m’approchai et lui présentai ma boîte à capotes aux emballages bariolés. Pour vivre dans l’indépendance et le désordre, ne fallait-il pas user de cette monnaie-là ? » (le narrateur homosexuel dans la nouvelle « La Chambre de bonne » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 59) ; « Il y a quelque chose en moi qui me dévore C’est une rage sans limite. Je n’ai aucune explication pour ça. » (João, le héros homosexuel du film « Madame Satã » (2001) de Karim Ainouz) Par exemple, dans la pièce On la pend cette crémaillère ? (2010) de Jonathan Dos Santos, François, l’homosexuel, dit qu’il a pour habitude d’« assouvir tous ses fantasmes » : il fonctionne au carburant de l’envie, comme s’il était le pantin de ses pulsions.
Dans le roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, à travers le discours de la narratrice lesbienne, Alexandra, on voit tout à fait la voracité et le manque de liberté impulsés par la force désirante homosexuelle : « Je ne suis pas avertie et connais peu des forces étranges qui se manifestent quelquefois en moi. Elles me submergent d’un désir si soudain que mon ventre me réclame le soulagement qu’il lui faut. […] À certains moments, mon vice est le maître de tout. » (p. 28) ; « Je veux trouver par moi-même ce qu’il me faut, ne dépendre de rien d’autre que de mon propre désir. » (idem, p. 38) ; « J’eus des chaleurs et des poussées d’une intensité terrible. J’avais besoin d’un soulagement rapide. Trop nerveuse pour me maîtriser, en pleine crise, j’étais à l’affût du moindre sourire me permettant d’espérer le corps d’une femme qui, comme moi, serait dans cette quasi douleur du manque de chair et prête à s’offrir sur l’instant. […] Jusqu’où me mènerait cette force si exigeante ? » (idem, p. 44) ; « À ce moment, il m’apparut que seule la force – ou plutôt le chantage – me permettrait d’obtenir ce que maintenant j’en voulais : du plaisir. » (idem, p. 49) ; « Ma mauvaise nature m’avait appris que mon plaisir était plus grand quand il était pris sans prudence, à l’instant où il se présentait. Voilà maintenant que je pensais contre la réalité, m’imaginant comme une femme qui vivrait avec une autre femme, dans, si j’ose dire, la sécurité d’un couple. […] Il me fallait assouvir cette faim que j’avais du féminin. D’autant que je prenais conscience que seul le corps, chez les femmes, m’intéressait. Je ne me sentais pas capable d’aimer vraiment. Mon désir se manifestait dès que le corps d’une autre me paraissait accessible, me souciant seulement du plaisir que j’en espérais. On ne peut pas appeler cela de l’amour. En société, j’imaginais les femmes qui m’entouraient déshabillées et offertes, et très vite, dans un état presque halluciné, je leur prêtais des postures ou des situations que je n’ose décrire, même dans mon carnet… Ma cruauté, dans ces instants, me préparait à l’idée qu’un jour je n’aurais plus vraiment de limite et que mon ‘vice’ m’avalerait entièrement. Je combinais et raisonnais de plus en plus en fonction de lui, sentant bien que, quand j’étais dans ces étranges dispositions, en crise, comme on dirait, c’était lui qui déterminait tout ce que je pensais et faisais. J’avais imaginé un moment demander à la petite voisine de passer me voir afin de faire ensemble ce que je l’avais obligée à faire seule devant moi, sachant combien j’aimais à outrepasser la pudeur des autres, pour le plaisir que son viol me donnait. Cette envie ne me quittait pas, mais je devais résister, c’était trop risqué. […] J’avais peur de moi. Quand je sentais monter ce besoin de chair, peu m’importaient les moyens et la figure de celle qui me donnerait ce qu’il me fallait. » (idem, pp. 56-57) ; « Je suis préoccupée car je sais que ces moments où il ne se passe rien sur le plan qui m’intéresse font monter en moi, dans l’ombre, des désirs trop forts et trop soudains qui me pousseront à agir, sans que je puisse résister. » (idem, p. 75) ; « Cette bizarre disposition qui me pousse résolument vers les femmes n’entraîne-t-elle pas celles qui m’entourent, comme une mauvaise herbe prendrait possession d’un jardin auparavant bien ordonné ? Une sorte de maladie qui se propagerait, pervertissant les esprits et les corps, mais aussi ouvrant les cœurs et révélant les âmes ? » (idem, p. 97-98) ; « Je compris que les amies allemandes de ma cousine étaient mues par une force invisible qui exigeait que le plaisir qu’elles prenaient des femmes se répandît, si possible, dans l’univers entier, et que pour parvenir elles comptaient beaucoup sur la contagion. » (idem, p. 110) ; « Lorsque dans sa lettre j’ai lu le mot « envie », j’ai eu instantanément une forte poussée de désir. » (idem, p. 131) ; etc.
Le désordre dont il est question dans les œuvres homosexuelles est bien souvent synonyme de « viol » consenti, de débauche délectable : « Nos cent rats de la soldatesque dormaient en désordre. » (Gouri dans le roman La Cité des Rats (1979) de Copi, p. 147) ; « Alors, le silence revient dans la chambre de mon enfance. Je regarde les volets fermés sur la fenêtre ouverte […] et le lit où nous nous trouvons étendus, dans le désordre des draps de famille, ceux où figurent les initiales des noms du père et de la mère, comme des armoiries ridicules. Je regarde ce tout petit monde qui n’est pas à notre mesure, ce lieu étrange où je n’imaginais pas perdre ma virginité, cet espace incertain où nous tanguons délicieusement. » (Vincent en parlant de son couple avec Arthur, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 68) ; « Le jeudi, j’ai fait quelque chose de mal. […] J’ai senti la culpabilité me brûler le visage tandis que je demandais la chose en question, et dans ma tête une petite voix disait : ‘Celle-là, elle n’est pas pour toi. […] Tu essaies de voler ce que tu ne désires même pas.’ Parce que tu t’y connais, en désir ? Ça, au moins, c’est notre domaine, pas le tien. Et pourquoi tu parles de voler ? Je l’ai trouvée la première. » (Ronit, l’héroïne lesbienne, entend une voix maléfique avec qui elle dialogue, au moment où elle prétend voler le cœur d’Esti, une femme mariée, dans le roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, pp. 223-224) ; etc. Par exemple, dans le roman La Vie est un tango (1979) de Copi, il est question du « corps en désordre » (p. 151) d’Arlette. Dans le nouvelle « La Mort d’un phoque » (1983) de Copi, le narrateur se fait trucider la bite « au milieu d’un désordre phénoménal (les tables cassées parmi les bouteilles arrosées de confettis) » (p. 22)
Le héros homosexuel va même jusqu’à dire que son désir homosexuel est démoniaque et qu’il faut s’en méfier parce que lui-même ne le maîtrise pas. C’est son « doux démon », en quelque sorte : cf. la chanson « Protect Me From What I Want » du groupe Placebo, la pièce Sortilegio (1942) de Gregorio Martínez Sierra, la chanson « Mon démon » du Teenager de la comédie musicale La Légende de Jimmy de Michel Berger, la chanson « Beyond My Control » de Mylène Farmer, etc. « Le serpent aussi donnait des ordres de l’ordre de l’ordre, si j’ose dire. » (Gouri dans le roman La Cité des Rats (1979) de Copi, p. 107) ; « Je me bats contre une douleur fantôme qui me hante depuis des mois, des années. » (Muriel Bonneville, Mi-ange, mi-démon (2006), p. 7) ; « Longtemps, Adrien avait cru ce penchant, ce mauvais penchant, surmontable. Dieu serait plus fort que son désir. Il saurait même dissiper, extirper jusqu’à sa racine ce mal profond. Il avait bien fini par comprendre, de guerre lasse, que la blessure resterait longtemps. » (Hugues Pouyé, Par d’autres chemins (2009), p. 25) ; « À n’en pas douter, quelque chose a été profondément bouleversé en moi et je ne suis plus celle que j’étais avant de poser le pied sur votre île. Aurais-je bu un philtre à mon insu ? » (Émilie à son amante Gabrielle, dans le roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami, p. 143) ; « Laisse-toi cueillir âme sœur exquise, à la marge limite banquise, le désordre des sens, le démon qui te pique, comme la nature chimique de mon attachement à toi. » (cf. la chanson « Les Fleurs de l’interdit » d’Étienne Daho) ; etc. À la fin de son roman Le diable au corps (1923), l’écrivain français Raymond Radiguet, évoque la présence d’un « homme désordonné ».
Le désir homosexuel entraîne parfois le héros homosexuel (et son amant fictionnel) dans des sentiers escarpés inattendus et désagréables : « Et bien tu peux lui dire de ma part qu’il [le désir] nous a fait un sale coup. » (Arnaud à son amant Mario, dans la pièce Quand mon cœur bat, je veux que tu l’entendes… (2009) d’Alberto Lombardo) Par exemple, dans la chanson « Réveiller le Monde » de Mylène Farmer, il est question du « souffle démon ».
FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION
PARFOIS RÉALITÉ
La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :
a) Tout désir est considéré comme un dieu auquel il faut se soumettre :
Beaucoup de personnes homosexuelles laissent une grande place au désir dans leurs discours et leurs vies. Actuellement, elles ont d’ailleurs tendance de le rebaptiser « droit » (« désir » et « droit » commencent par la même lettre : ça doit être pour ça…). Selon une certaine pensée homosexuelle et féministe, le corps humain n’aurait pas d’importance. Nous serions davantage des anges que des humains. Nous ne serions que des émotions, des sensations, des êtres désincarnés, de purs esprits : « Le désir n’a pas de genre biologique. » (Stéphanie Arc) ; « Le sexe anatomique n’a pas d’importance. C’est l’individu qui compte. La Nature ne dit rien du désir. » (Michèle Ferrand) ; « Vous ne croyez pas que l’Amour est plus important que la biologie ? » (Jean-Marc Morandini face à Albéric Dumont, dans la matinale d’Europe 1, mardi 16 septembre 2014) ; etc. C’est la raison et la (non-)volonté plus que les corps qui dirigeraient le Monde. « Queer est plus généralement cet art même du déplacement, touristique ou zoophilique, stylistique ou corporel, l’art d’être où rien ne vous attend. » (François Cusset, Queer Critics (2002), p. 15)
Mais de quel « désir » parlent-elles, au juste ? Des grands désirs (amour vrai, amitié, engagement de couple, fidélité, rêves, promesses, don entier de soi aux autres, abandon de sa personne, actions de charité concrètes pour les autres, obéissance et service, combats pour la vie, liberté audacieuse encadrée par la raison, Dieu, etc.) ou bien des petits désirs (fantasmes, passion, imaginaire, sentiments, état amoureux, sincérité, envies, goûts, pulsions, instincts, bonnes intentions, plaisirs éphémères des sens, bien-être, etc.) ? Dans le cas des sujets homosexuels, on se situe malheureusement davantage dans les petits désirs, ceux qui anesthésient la révolte de ne pas donner un sens plus profond à sa vie, ceux qui compensent le manque des grands désirs, ceux qui ne favorisent pas l’unité et la conscience, mais au contraire qui accentuent le désordre. « J’ai d’abord imaginé que je lui faisais l’amour, à elle, Sabrina, sachant qu’une pareille image ne pouvait pas me faire bander. Puis j’ai imaginé des corps d’hommes contre le mien, des corps musclés et velus qui seraient entrés en collision avec le mien, trois, quatre hommes massifs et brutaux. J’ai imaginé des hommes qui m’auraient saisi les bras pour m’empêcher de faire le moindre mouvement et auraient introduit leur sexe en moi, un à un, posant leurs mains sur ma bouche pour me faire taire. Des hommes qui auraient transpercé, déchiré mon corps comme une fragile feuille de papier. J’ai imaginé les deux garçons, le grand aux cheveux roux et le petit au dos voûté, me contraignant à toucher leur sexe, d’abord avec mes mains puis avec mes lèvres et enfin ma langue. J’ai rêvé qu’ils continuaient à me cracher au visage, les coups et les injures ‘pédé’, ‘tarlouze’ alors qu’ils introduisaient leur membre dans ma bouche, non pas un à un mais tous les deux en même temps, m’empêchant de respirer, me faisant vomir. Rien n’y faisait. Chaque contact de Sabrina avec ma peau me ramenait à la vérité de ce qui se passait, de son corps de femme que je détestais. » (Eddy Bellegueule dans le roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, p. 193) L’élan homosexuel est davantage un manque de désir qu’un désir, en fait : « Plus j’avançais, plus je me rendais compte que rien ne me prédisposerait d’une facilité dans mes rapports avec les autres garçons. Ces rapports effectivement, contribuaient à m’instruire que je rentrais dans une société dont le grand principe est le refoulement. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 74) ; « Le transsexuel est généralement un individu sans volonté. » (Jean-Louis Chardans, Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p. 342) ; « Qu’est-ce que je veux au juste ? Je ne peux pas lui répondre, je ne le sais plus moi-même. » (Frédéric Mitterrand, La Mauvaise Vie (2005), p. 337) ; « Que de fois tu m’as dit qu’il valait mieux faire la liste de ce que j’aime, plutôt que celle – interminable – de ce que je n’aime pas ! » (Denis Daniel, Mon Théâtre à corps perdu (2006), p. 65) ; etc.
En général, le désir désordonné – ils diront « amoureux », « improvisé », « artistique », « révolutionnaire » – est considéré comme un dieu : « Copi défend le plus grand des désordres, et c’est cette anarchie antisociale et festive, qui se branle de tout, que l’on devrait revendiquer. » (Marcial Di Fonzo Bo dans l’article « Le plus Bo des Argentins » de Franck Sourd, sur le journal Les Inrockuptibles du 30 mars 2005) ; « Je suis pour l’ordre. Vive l’ordre ! … Évidemment, l’ordre le plus raffiné est celui qui fait la plus grande place au désordre ! » (Renaud Camus dans le documentaire « L’Atelier d’écriture de Renaud Camus » (1997) de Pascal Bouhénic) ; « Contre la droite et l’ordre moral : nos désirs font désordre. » (cf. un tract LCR que j’ai vu à la Gay Pride de Paris en 2008) ; « Il est de l’ordre en forme de désordre. » (Jean Cocteau dans le documentaire « Cocteau/Marais : un couple mythique » (2013) Yves Riou et Philippe Pouchain) ; « Tout le bazar indispensable aux happenings de Mirna. » (Alfredo Arias, Folies-Fantômes (1997), p. 282) ; « C’était un peu n’importe quoi dans tous les sens. » (Philippe Morillon parlant des soirées orgiaques de la boîte gay du Palace dans les années 1980, dans le documentaire « Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld : une guerre en dentelles » (2015) de Stéphan Kopecky, pour l’émission Duels sur France 5) ; etc.
Par exemple, dans le docu-fiction « Christine de Suède : une reine libre » (2013) de Wilfried Hauke, la Reine Christine, pseudo « lesbienne », défend auprès de Descartes les vertus de « l’amour déréglé » homosexuel. Ernst Röhm, dès 1928, écrit ses Mémoires d’un traître et confie : « Étant immature et mauvais, je suis plus en faveur de la guerre et du désordre que de l’ordre bourgeois bien élevé. […] J’affirme d’emblée que je ne fais pas partie des braves gens et que je n’ai aucune envie de leur ressembler. » (p. 267 et p. 362)
Est souvent exprimé par les personnes homosexuelles le désir d’être le Désir, ou bien une déification des désirs personnels au détriment des désirs collectifs. Par exemple, Michel Foucault souhaite privilégier « le lien du désir à la réalité » et non celui de la Réalité au désir (Michel Foucault, « Préface » de L’Anti-Œdipe, dans l’essai Dits et Écrits II, 1976-1988 (2001), p. 136). Dans son article « Avatares De Los Muchachos De La Noche » (1989), le poète argentin Néstor Perlongher se prend pour son désir : « Dérive du Moi, dérive du désir. » (pp. 46-47) L’identification à son désir traduit une conception égocentrique de l’amour, qui ne fonctionnerait qu’en circuit fermé : « Nous ne voulons pas qu’on nous pourchasse, ni qu’on nous arrête, ni qu’on nous discrimine, ni qu’on nous tue, ni qu’on nous soigne, ni qu’on nous analyse, ni qu’on nous explique, ni qu’on nous tolère, ni qu’on nous comprenne : ce que nous voulons, c’est qu’on nous désire. » (Néstor Perlongher, « El Sexo De Las Locas » (1983), p. 34) Se cache en toile de fond de cette auto-sacralisation orgueilleuse un mépris de soi : par exemple, dans son essai King Kong Théorie (2006), Virginie Despentes se définit comme une personne « plus désirante que désirable » (p. 11).
En général, les personnes homosexuelles parlent du désir comme d’une formidable énergie – à consommer la plupart du temps égoïstement (ou à la rigueur à deux, avec son partenaire temporaire) –, d’une puissance euphorisante, d’un désordre jouissif irréprochable… même si elles sont bien en peine après de justifier par les mots pourquoi chez elles une telle fascination pour l’éclatement, mis à part en sentimentalisant, en esthétisant, ou en politisant à l’extrême leur idolâtrie pour Eros. « Je me rendais compte, moi, que c’était toute ma personne, tout mon désir refoulé depuis toujours, qui m’entraînait dans cette situation. Je brûlais d’excitation. » (Eddy Bellegueule simulant des films pornos avec ses cousins dans un hangar, dans le roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, p. 152) D’un air éthéré ou malicieux, elles prônent arbitrairement « l’ordre du désordre », la « révolution de l’inversion », la « vérité » des improvisations et des errances d’un désir capricieux pseudo inattendu : « Le désordre est le principe anti-social par excellence. » (cf. l’article « Apologie du désordre » de Mohamed Belmorma, publié dans la revue Minorités.org, 9 juillet 2011) ; « Les choses sont venues dans le désordre. » (Pierre Bergé parlant à la fois de sa relation avec Yves Saint-Laurent, et de la progression de ses collections, dans le documentaire « Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé : l’Amour fou » (2010) de Pierre Thoretton) ; etc. Le romancier Érik Rémès dit avoir « un problème très infantile vis-à-vis de la loi, de l’ordre » (cf. l’article « Érik Rémès, écrivain » de Julien Grunberg, sur le site www.e-llico.com consulté en juin 2005).
Dans les discours, est très souvent confondu le désir libre avec le consentement (« Le désir justifie tout, pourvu qu’il soit partagé. » déclare par exemple Cathy Bernheim dans son autobiographie L’Amour presque parfait (2003), p. 191). Or, ce sont deux choses bien distinctes. La réciprocité et la liberté apparente que semble comprendre le consentement mutuel ne sont que poudre aux yeux pour ne pas se regarder mal agir. Car se mettre d’accord pour poser une action amoureuse et sexuelle à deux, même si on se dit adultes vaccinés, sincères, amoureux, et apparemment conscients des actes qu’ils posent, n’est pas une garantie de bien agir, ni une assurance d’agir librement. Pour prendre des exemples précis, une prostituée et son client peuvent très bien se mettre d’accord « sur le papier » pour respecter une parfaite transparence dans la consommation mutuelle : l’acte qu’ils poseront restera une exploitation ; pareil pour le cas des couples homosexuels où chacun des deux partenaires va voir ailleurs : quand bien même ils estiment qu’ils ont le droit de s’être infidèles à partir du moment où ils se le disent (certains voient même cette franchise comme une nouvelle preuve d’amour qui va renforcer leur couple déjà à l’article de la mort ! un comble…), la violence de l’infidélité reste inchangée. Ce n’est pas les intentions, la franchise, le consentement, la transparence, la sincérité, qui font la justesse d’un acte ; c’est aussi l’acte en lui-même. En sacralisant leurs petits désirs au détriment de la reconnaissance des actes, beaucoup de personnes homosexuelles signent à leur insu l’arrêt de mort du vrai Désir, et s’exposent à se soumettre à la pulsion, aux fantasmes amoureux, aux affres de la passion sentimentale éphémère, à l’absence de liberté. Elles se rendent compte qu’elles posent des choix sans conscience et sans liberté : « C’est mes choix et je ne les ai pas choisis. » (la phrase d’Amina, une jeune femme lesbienne de 20 ans, venant conclure le documentaire « Homos, la haine » (2014) d’Éric Guéret et Philippe Besson, diffusé sur la chaîne France 2 le 9 décembre 2014)
C’est comme si, chez elles, s’opéraient deux mouvements apparemment opposés. D’un côté, elles vont dire qu’elles possèdent parfaitement leurs désirs et que ces derniers ordonnent au Réel. Mais d’autre part, comme elles constatent que leurs désirs ne sont pas des ordres, et qu’elles ne sont pas Dieu, elles se transforment, pour noyer leur orgueil ou leur déception, en marionnettes passives de leurs petits désirs. Elles se livrent pieds et poings liés à leurs instincts, comme subjuguées par leur propre orgueil : « Le désir rend souvent aveugle et nous sommes des proies tellement faciles ! » (Denis Daniel, Mon Théâtre à corps perdu (2006), p. 119) ; « C’est, je pense, l’intérieur qui commande. » (Pierrot, le papy fermier de 83 ans, dans le documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz) ; « Chacun peut être ce qu’il veut. » (Victoria Broackes interviewée dans le documentaire « Somewhere Over The Rainbow » (2014) de Birgit Herdlitschke, diffusé en juillet 2014 sur la chaîne Arte) ; etc.
b) Le désir homosexuel : un désir intrinsèquement désordonné :
En réalité, les personnes homosexuelles ne maîtrisent pas autant qu’elles le disent leur désir. En effet, elles veulent s’en rendre les objets d’avoir trop cherché à posséder leur(s) objet(s) de désir. Naît souvent de ce rapport idolâtre et passionnel au désir un trouble, une impression d’être son propre esclave (ou, ce qui revient au même, esclave de ses pulsions). « Tel un jeu de Yo-Yo, je désespérais et reprenais courage en face de ce mal de vivre. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 57) ; « Aveuglé par cette impression de m’être arraché à un mal qui jusque-là m’avait semblé incurable, j’oubliai quelque temps la résistance du corps. Je n’avais pas envisagé qu’il ne suffisait pas de vouloir changer, de mentir sur soi, pour que le mensonge devienne vérité. » (Eddy Bellegueule dans le roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, p. 174) ; « Je peux pas me contrôler. » (Yves Saint-Laurent parlant de ses pulsions sexuelles et de son addiction à la drogue, dans la biopic « Yves Saint-Laurent » (2014) de Jalil Lespert) ; « Je ne savais pas encore que quelque chose en moi ne tournait pas rond. » (Rilene, femme lesbienne dans le documentaire « Desire Of The Everlasting Hills » (2014) de Paul Check) ; « Je sentais déjà au fond de moi que quelque chose ne tournait pas rond. » (le dessinateur homo Ralf König, dans le documentaire « Du Sollst Nicht Schwul Sein », « Tu ne seras pas gay » (2015) de Marco Giacopuzzi) ; etc. Ce n’est pas un hasard si le lexique du désordre revient comme une marotte dans leurs discours : cf. le documentaire « Zucht Und Ordnung » (« Law And Order », 2012) de Jan Soldat), l’essai Gender Trouble (Trouble dans le genre, 1990) de Judith Butler, la biographie Désordres : Lettre à un père (2012) d’Elsa Montensi (où la fille écrit à son père homosexuel), au documentaire « Çürük – The Pink Report » (2010) d’Ulrike Böhnisch, à l’essai Disorders (2020) de Joseph Sciambra ; etc. « Qu’est-ce que l’homosexualité dans une famille, comment y réagit-on, quelles conséquences ce désordre entraîne-t-il ? » (cf. l’interview de Franco Brusati par Claude Beylie, dans la revue L’Avant-Scène Cinéma, n°277, 1er décembre 1981) Je vous renvoie au nom de la maison d’édition Laurence Viallet – Désordres (Musardine) publiant des auteurs homosexuels, à l’essai La Famille en désordre (2002) d’Élisabeth Roudinesco, etc. Dans leur essai Le Cinéma français et l’homosexualité (2008), Anne Delabre et Didier Roth-Bettoni définissent le film « L’Homme blessé » (1983) de Patrice Chéreau comme un « film des désordres du désir » (p. 227). Dans la pièce musicale Érik Satie… Qui aime bien Satie bien (2009) de Brigitte Bladou, le compositeur homosexuel Érik Satie est surnommé « l’Ange du Bazar ». Dans l’avant-propos des Cahiers (1919) de Vaslav Nijinski, Christian Dumais-Lvowski aborde la question des « désordres intérieurs » du célèbre danseur étoile homosexuel.
En règle générale, même si ce n’est pas toujours très conscient, il est fait référence à un désir homosexuel compliqué, difficile à gérer, peu viable, qui fragilise et rend paradoxal celui qui le ressent durablement : « On constate que l’homosexualité fait problème à l’homosexuel, alors même que le coming-out est devenu chose courante. » (Jean-Pierre Winter, Homoparenté (2010), p. 198) ; « Si le mot ‘paradoxe’ devait être incarné, il prendrait alors inévitablement l’apparence de Stéphane. » (Alexandre Delmar, Prélude à une vie heureuse (2004), p. 48) ; « Tu es l’homme le plus compliqué de la terre, tu le sais bien. » (Laurent en parlant de manière infantilisante à son amant André, frustré de son indifférence, dans le docu-fiction « Le Deuxième Commencement » (2012) d’André Schneider) ; « Pendant l’Occupation, je fus, bien entendu, l’ami de nombreux officiers allemands. J’évitais ainsi la déportation et pus, grâce à mes relations, ouvrir mon premier magasin d’antiquités. Ces quatre années furent, quoique comparativement plus calmes, une longue suite d’aventures sentimentales, fort compliquées, selon ‘notre tradition’. » (Jean-Luc, 27 ans, homosexuel, dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, p. 86) ; « Plusieurs fois, je tentai le diable, courant les rues, les squares, le soir, à la recherche d’âmes sœurs. J’eus en quelques semaines plusieurs expériences homosexuelles fort diverses, brèves ou compliquées. J’en ressortis affreusement blasé et dégoûté. Je me disais à moi-même : ‘S’agit-il véritablement d’inhibitions ou était-ce une disposition effectivement invertie ?’ » (idem, p. 111) ; etc. Selon les mots de Bernard Grasset, Marcel Proust était « l’homme le plus compliqué de Paris » (cf. l’article « Proust au miroir de sa correspondance » de Luc Fraisse, dans le Magazine littéraire, n°350, janvier 1997, p. 32). Dans le documentaire « Stefan Sweig, histoire d’un Européen » (2015) de François Busnel, il est question de la permanente « intranquillité » qui habite Stefan Sweig. Je vous renvoie également à l’article de Didier Lestrade intitulé « La Folle compliquée », publié sur Minorités le 10 juillet 2011.
Dans son documentaire « Cet homme-là (est un mille-feuilles) » (2011), Patricia Mortagne demande à son père de 67 ans (qui a fait un coming out tardif) : « Si tu avais pu ne pas vivre ton homosexualité, tu l’aurais fait ? » ; et ce dernier lui fournit une réponse paradoxale : « Sûrement : ça perturbe énormément, quand même. »
Le désir homosexuel n’est pas de tout repos : « Depuis l’âge de 16 ans, je savais que j’étais vraiment attirée par les femmes, je le savais, je le sentais ce truc-là. C’était assez paradoxal, parce que la première connaissance que j’ai eue de l’homosexualité, j’étais plutôt prête à la rejeter, à l’éviter. » (Laura, une femme lesbienne de 49 ans, dans l’essai Se dire lesbienne : Vie de couple, sexualité, représentation de soi (2010) de Natacha Chetcuti, p. 52) ; « Moi je me dis, je viens d’un milieu plutôt intello, alternatif, où a priori, c’était possible d’assumer ça plutôt facilement, et en fait je me suis grave pris la tête pendant dix ans et je ne sais pas pourquoi. » (Louise, femme lesbienne de 31 ans, idem, p. 54) Par exemple, dans son autobiographie Libre : De la honte à la lumière (2011), Jean-Michel Dunand se définit comme un « adolescent bouillonnant de vie et meurtri par ses contradictions ». (p. 19)
Il n’est jamais simple, au niveau du désir sexuel, de s’éloigner du corps, et en particulier du corps humain sexué. Cela implique parfois des douleurs physiques, mais surtout une perte de joie, une tourmente intérieure, comme le montrent ces propos : « Travailler pour me retrouver pratiquement à découvert chaque mois, personne pour m’aider, peur de pas pouvoir tenir le coup dans ma solitude, et plus ce gros problème d’homosexualité qui me ronge au plus haut lieu dans mon corps, jusqu’à des maux de têtes, diarrhées quotidiennes, sorte de dégoût et de fatalisme. Voila ma situation actuelle. […] Alors je me dis que je dois accepter d’être homo mais je ne trouve pas attirant le corps d’un homme, mais que si j’ai cette vision c’est que émotivement inconsciemment j’ai envie d’aller vers ça et que j’ai dû faire un déni d’homosexualité dans l’enfance et que ça m’a complètement fragmenté dans ma vie. Beaucoup de psys expliquent ceci aussi car aller contre sa propre nature qui est en premier lieu notre sexualité, ben c’est la destruction assurée dans toute notre vie et notre être. […] Dès que ma mère a appris qu’elle était enceinte de moi elle a hésité à me garder. Vient ensuite la naissance où l’accouchement fut une boucherie tant pour elle en perfusion de sang et moi avec l’oreille déchirée, je suis arrivé dès le départ dans la souffrance. […] Maintenant je ne suis même plus attiré par quelques corps que ce soit, comme si j’étais un asexué sans âme, comme si la tristesse avait pris possession de tout mon être. […] Une fois, seul en leur présence, je trouve de la tristesse, du vide, un sentiment de malaise – c’est inexplicable – mélangé à un système de pensée de perversité et d’égoïsme (moi-je). Je me sens mal a l’aise à leurs cotés. Comme si c’était la mort, l’extinction. Je me rends compte en les observant qu’ils sont malheureux intérieurement. Même s’ils sont passés du cotés homosexuel, ils sont restés toujours tristes en eux mêmes. Pas qu’on ne les comprenne pas, même si ça peut en faire partie, mais comme si il y a un problème d’incarnation dans la matière. » (cf. le mail d’un ami Pierre-Adrien, 30 ans, reçu en juin 2014)
Je crois en effet que le désir homosexuel incite à l’éclatement symbolique du corps et du cœur : « Je ne suis pas contradictoire, je suis dispersé. » (Roland Barthes, « La Personne divisée », dans l’essai autobiographique Roland Barthes par Roland Barthes (1975), p. 127) Dans l’émission Radioscopie sur France Inter le 6 mai 1976, Jean-Louis Bory au micro de Jacques Chancel, avoue qu’il a toujours été amoureux dans toutes ses relations, mais q’il s’agissait d’un « amour assez dispersé ». Soit dit en passant, on entend souvent dans le discours des personnes homosexuelles le désir de « s’éclater » dans les fêtes, dans la consommation de drogues, dans les passions amoureuses. Les verbes « tomber amoureux » ou « adorer » l’emportent sur celui d’« aimer (s’engager) ». On reste dans le registre de la passion amoureuse, aussi puissante qu’éphémère et déstructurante.
Le désir homosexuel (tout comme le désir hétérosexuel) est le signe d’un élan divisant, d’une blessure identitaire et affective : cf. la photo Andy Warhol avec cicatrices (1969) de Fischer.
Parfois, les personnes homosexuelles se décrivent comme un pirate avec une cicatrice, et s’identifient aux visages coupés. « Mireya [l’héroïne de la série La Vie désespérée de Mireya, la Blonde de Pompeya] taillade le visage du Morocho, son homme, avec une bouteille de vin Mendoza qu’elle a cassée sur le comptoir en étain du café El Riachuelo. Mireya court désespérée dans la rue. Il pleut des cordes. La blonde s’appuie contre un réverbère et pleure à chaudes larmes. Ses pleurs se mélangent aux gouttes de pluie. » (Alfredo Arias, Folies-Fantômes (1997), p. 247) ; « Sur le front de Slimane, il y a quatre rides. Au bout de son nez, il y a comme une petite fissure. Slimane dit que sa grand-mère Maryam a la même. » (Abdellah Taïa parlant de son amant Slimane, dans son autobiographie Une Mélancolie arabe (2008), p. 104) ; etc. Par exemple, elles disent leur passion pour le manga japonais Albator et ce personnage est parfois utilisé comme pseudonyme sur les sites de rencontres Internet.
L’action de se couper le visage n’est pas à prendre dans son sens littéral, mais à mon avis, à interpréter comme un refus d’accepter son identité humaine, et plus largement la réalité de la sexualité. Pour certaines personnes homosexuelles, la découverte de la différence des sexes a parfois été bêtement vécue comme un coup de hache, une séparation définitive de l’Amour (femme/homme, mais aussi créature/Créateur). C’est le cas de l’écrivain Jean Genet, par exemple. « Il ne meurt pas. La conscience reflue, Genet renaît de ses cendres ; la tante-fille, coupée en deux par le couteau d’abattoir, se recolle. » (Jean-Paul Sartre, Saint Genet (1952), p. 133)
De par sa nature de force désunifiante, le désir homosexuel peut même avoir une parenté avec la schizophrénie (cf. je vous renvoie au code « Doubles schizophréniques » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels). Je ne me ferai pas que des amis en énonçant cela (je rappelle, pour la petite histoire, que l’Association Psychiatrique Américaine – APA – décida en 1973 aux États-Unis de rayer l’homosexualité de sa liste des « désordres mentaux »), mais tant pis : c’est de l’observation de terrain. Il arrive que certaines personnes homosexuelles « s’absentent sur place », présentent des traits de bipolarité psychiques, ou, sans aller jusqu’à ses extrêmes pathologiques, soient simplement lunatiques et bien atteintes par la névrose. Il suffit de faire un tour sur les sites de rencontres homos sur Internet pour constater que les trois quarts de la population interlope adoptent des attitudes névrotiques qui laissent perplexe… À force de discuter avec les internautes, on se demande même si ces forums sociaux ne sont pas des hôpitaux psychiatriques non-agréés, des ersatz de groupes de thérapie collective, des nids de névrosés, ou des mouroirs du désir, tant les « dials » n’ont très souvent ni queue ni tête, et qu’on ressort de ce Salon de l’Illétrisme généralisé en finissant par croire que « les gays et les lesbiennes sont tous chelous ». De même, les lieux de drague et de désir homos constituent pour la plupart des espaces du viol consenti et organisé, où se développent des blessures et des désordres plus ou moins visibles : « Les lieux gays sont hantés par l’histoire de cette violence : chaque allée, chaque banc, chaque espace à l’écart des regards portent inscrits en eux tout le passé, tout le présent, et sans doute le futur de ces attaques et des blessures physiques qu’elles laissèrent, laissent et laisseront derrière elles – sans parler des blessures psychiques. Mais rien n’y fait : malgré tout, c’est-à-dire malgré les expériences douloureuses que l’on a soi-même vécues ou celles vécues par d’autres et dont on a été le témoin ou dont on a entendu le récit, malgré la peur, on revient dans ces espaces de liberté. » (Didier Éribon à propos des parcs et de jardins, dans son autobiographie Retour à Reims (2010), p. 221) Les lieux d’homosociabilité disent en général les errances et le caractère désordonné du désir homosexuel.
Dans son essai Le Règne de Narcisse (2005), Tony Anatrella identifie chez les sujets homosexuels un symptôme de dépression, d’effondrement de la personnalité ou de la volonté : « Celui-ci [le sujet homosexuel] se manifeste par des comportements incohérents, capricieux, autoritaires et instables. Ainsi un rendez-vous prévu la veille est refusé le lendemain matin. » (p. 64) Ce n’est pas faux que de le dire.
En 1932, Freud démontre bien, dans son étude « Sur quelques mécanismes névrotiques dans la jalousie, la paranoïa et l’homosexualité » que, souvent, le sujet se convertit à l’attirance des personnes de même sexe que lui à la suite d’une meurtrissure narcissique. D’ailleurs, certaines personnes homosexuelles osent, à de rares occasions, montrer leur plaie existentielle, même si leur aveu reste encore très codé et symbolique : « Je porte désormais une alliance. J’y ai fait graver un signe qui symbolise une fracture. » (Jean-Michel Dunand, Libre : De la honte à la lumière (2011), p. 144) ; « De mon enfance je n’ai aucun souvenir heureux. […] Simplement la souffrance est totalitaire : tout ce qui n’entre pas dans son système, elle le fait disparaître. » (Eddy Bellegueule dans son roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, p. 13) ; « À la vérité, nous sommes tous plus ou moins victimes, à la base, d’une blessure d’amour, du véritable amour humain. Blessure que, dans la plupart des cas, nos mères ne surent pas soigner. Notre nature de faibles nous a conduits à négliger à notre tour cette plaie que nous avions le devoir de panser. Ainsi négligée (disons le mot : entretenue), la blessure est devenue un ulcère chronique et le mal affreux ne cesse d’en suinter, comme un pus d’amour perverti, fétide, et nauséabond. » (Jean-Luc, homosexuel de 27 ans, dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, p. 92) ; « Pendant de longs jours, j’eus l’impression d’être guéri : la vision ignoble de ce garçon, que je croyais viril, les images de cet homme singeant la femme en présence d’un autre homme tout aussi efféminé, tout cela endormait en moi toute velléité de recommencer. Toutes mes aventures, je les avais eues ou menées sous le signe de cette domination : en un mot, je ne m’étais jamais vu moi-même. Sensible et féminin, désirant d’impossibles caresses, j’eus alors la révélation que l’on n’est pas fait pour cela ; je sus qu’il y avait, en cet individu, quelque chose de détruit, comme en moi-même. Une sorte de timidité sexuelle faisait de nous ‘les invertis’, des monstres, des malades. Ainsi, il m’arrivait parfois de ne pas croire à ma propre homosexualité. » (idem, p. 110)
Certaines personnes homosexuelles dévoilent leur fragilité, leur sensibilité à fleur de peau… même si immédiatement après, elles jouent les fières : c.f. le one-man-show Sensiblement viril (2019) d’Alex Ramirès.
Par exemple, dans son autobiographie Mauvais Genre (2009), l’écrivaine lesbienne Paula Dumont se désarme devant son lecteur, se met à nu en disant que ses aventures amoureuses lesbiennes sont révélatrices chez elle d’une « grande fragilité dans le domaine sentimental » (pp. 114-115) ; « Si mon homosexualité consiste à chercher à combler la carence affective dont j’ai souffert quand j’étais petite, je me demande aujourd’hui s’il ne vaut pas mieux renoncer à la quête, vouée d’avance à l’échec, d’une compagne susceptible de panser les blessures de la petite fille que j’ai été il y a plus de cinquante ans. Car la gamine en souffrance sera de toute manière toujours là, à gémir sur ses plaies… »
Certaines personnes homosexuelles disent être torturées par un élan malveillant. Il est même parfois défini comme un désir sauvage, violent, passionnel, qui rend incontrôlable une personne qui, en temps normal, est plutôt équilibrée. Par exemple, dans l’excellent article « El Pez Doncella » de Manuel Rivas, publié dans le journal El País le 18 octobre 1998, l’Ève masculinisé, dans le nouvel ordre anthropologique imposé par la post-modernité, donne naissance à un drôle d’Adam, un « homme sauvage » homosexuel. Le désir homosexuel, dans la mesure où il tend vers l’asexuation, rejoint le monde animal, bestial, minéral, barbare (je vous renvoie au documentaire « Mortel désir » (1992) de Mario Dufour). Le peintre Paul Gauguin, par exemple, avait déjà souligné « le côté androgyne du sauvage, le peu de différence de sexe [qu’il y a] chez les animaux. ». Il n’est pas le seul. Certains auteurs homosexuels associent le désir homosexuel à la sauvagerie : « L’homosexuel demeure un loup, libre et fier, farouchement indépendant et sans doute encore sauvage, et rien ne l’oblige à se faire chien, animal domestique, embourgeoisé et de bonne compagnie. » (Dominique Fernandez, Le Loup et le Chien, 1999) ; « Concha était belle comme un félin sauvage, sans âge, puissant, toujours prêt à bondir. » (Arias en parlant du trans Concha Bonita dans l’essai Folies-Fantômes (1997) d’Alfredo Arias, p. 30) ; « Mon maître d’école fit remarquer à mes parents que je souffrais d’un manque d’affection et de tendresse qui démontrait à ses yeux, l’évolution d’une personnalité renfermée, amère, et presque sauvage. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 21) ; « Ce qui me plaisait plutôt, c’était de ressembler à Philomène dans sa féminité. En effet, sa façon de marcher, de s’habiller ou de se tenir, dégageait un moment de magie qui me séduisait. Je la comparais de surcroît à une fleur sauvage, poussée au milieu d’une plate-forme cultivée. » (idem, p. 48) ; etc.
Certaines personnes homosexuelles vont même jusqu’à dire que leur désir homosexuel est démoniaque (parfois parce qu’il a été considéré comme tel par autrui) : cf. je vous renvoie à la partie « Diable au corps » du code « Ennemi de la Nature » dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels. « Je sentais chaque centimètre de mon corps me distendre et m’étirer. Indéfiniment. De me sentir possédé, je me mis à pleurer. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 69) ; « La prière de délivrance ne m’apporta aucun répit et eut pour seul effet de convaincre mes condisciples que le diable avait son mot à dire dans l’hystérie dont j’avais fait preuve. On me proposa de renouveler ce type de prière. Dès qu’on m’imposait les mains, je criais, mes gestes étaient désordonnés, mon corps agité de soubresauts. » (Jean-Michel Dunand, Libre : De la honte à la lumière (2011), p. 88) ; « J’ai grandi caché dans mon secret. Longtemps je me suis blotti en lui comme s’il me protégeait d’une menace indistincte. Il a fini par faire partie de moi. […] Un poison me rongeait […] Le vrai nom de ce venin, l’homosexualité, je n’en avais aucune idée. » (Brahim Naït-Balk, Un Homo dans la cité (2009), p. 13) ; « J’étais dans l’horreur de ma propre confusion. Je la voyais bien. Je la comprenais parfaitement. Je marchais avec elle en silence, en bataille, jamais en paix. Je n’y pouvais rien, j’étais dominé par cette force supérieure, invisible, inconnue, et qui m’entraînait vers le chaos intime. Je voyais de temps en temps en moi l’image de ma sœur Lattéfa qu’on disait possédée. Qui l’était. » (Abdellah Taïa, Une Mélancolie arabe (2008), p. 86)
L’écrivain français André Gide définit justement « l’inverti » comme celui qui « dans la comédie de l’amour, assume le rôle d’une femme et désire être possédé ». (André Gide, Journal, 1889-1939, p. 671) En réalité, ce n’est pas le désir homosexuel qui est diabolique, mais uniquement la liberté que l’on emploie pour l’actualiser et s’y adonner. Pour le dire autrement, ce n’est pas tant le désir homosexuel qui est désordonné que le rapport idolâtre, réifiant et essentialisant à ce désir homosensible.
D’une certaine manière, le désir homosexuel, s’il est figé en espèce ou en amour éternel, se place contre l’ordre naturel, social, et divin… et les personnes homosexuelles le devinent, bien souvent dans la révolte : « Rien au monde n’était insolite : les étoiles sur la manche d’un général, les cours de Bourse, la cueillette des olives, le style judiciaire, le marché du grain, les parterres de fleurs… Rien. Cet ordre, redoutable, redouté, dont tous les détails étaient en connexion exacte avaient un sens : mon exil. C’est dans l’ombre, sournoisement, que jusqu’alors j’avais agi contre lui. Aujourd’hui, j’osais y toucher, montrer que j’y touchais en insultant ceux qui le composent. » (Jean Genet, Le Journal du Voleur (1949), p. 206) Il est cependant fort probable que le désordre homosexuel soit le parfait miroir d’un désordre social qui se fait passer pour « ordre » ( = l’hétérosexualité), mais qui, dans son durcissement, cache mal sa fragilité et son désordre interne. En effet, les opposants au désir homosexuel, dans leur empressement à ranger l’homosexualité dans la catégorie des désordres sociaux à éradiquer comme une mauvaise herbe, s’inculpent eux-mêmes à leur insu. Par exemple, actuellement, l’armée turque considère l’homosexualité comme un « désordre mental » et réforme les jeunes hommes gays du service militaire (cf. le documentaire Çürük – The Pink Report (2010) d’Ulricke Böhnisch) Certains promoteurs de l’éducation-guérison des personnes homosexuelles, considérant que le désordre du désir homosexuel peut être redressé et désappris, diabolisent beaucoup trop la nature désordonnée des penchants homosexuels – en tressant un scénario-catastrophe d’extinction de race humaine, ou bien en cultivant le binarisme manichéen simpliste entre civilisation et barbarie – pour ne pas prouver leur propre désordre. « Imaginons quelques instants le chaos dans lequel plongerait l’humanité si la moitié féminine de la population du monde se refusait à la moitié masculine. Ne serait-ce pas là un désordre fondamental pour la population masculine du monde entier ? C’est un tel désordre que vit la population GEI face à la population hétérosexuelle qui se refuse à elle. » (Chekib Tijani parlant des personnes homosexuelles, dans son essai 700 millions de GEIS (2010), p. 68) Il n’y a que l’amour et le respect des personnes qui finalement ordonnent le désordre, l’assouplissent, le consolident et jouent avec comme de la terre molle et malaxée. Les obsédés de l’ordre hétérosexuel (soi-disant « naturel ») et du désordre homosexuel, en voulant éradiquer la glaise homosexuelle, avortent pour le coup leur projet de sculpture humaine vivante, et se privent de leur propre matière première. Ils font au bout du compte la même erreur que la majorité des personnes homosexuelles : ils réduisent celles-ci à leur désir homosexuel, créent une espèce homosexuelle qui n’existe pas (même si c’est en termes de « construction culturelle » à démanteler, de « pathologie guérissable », de parfaite antithèse d’une hétérosexualité dite « naturelle », qu’ils la présentent), et entretiennent les désordres humains observables dans tous les couples homosexuels ET hétérosexuels.
Le désir homosexuel, en tant que tel, est un désir désordonné dans le sens non pas moralisant et figé du terme « désordre » (« désordonné » ne veut pas dire « mauvais »), mais plutôt dans son sens évolutif, transitionnel (transitionnel jusqu’à un certain point : toujours dans le cadre des possibles humains et humanisés), libre. Il est désordonné parce que « primitif », « informe », « peu développé », « adolescent », « non encore abouti », « non encore modelé et façonné », « perfectible ». Dans la Bible, et spécialement la Genèse, le tohu-bohu – désignant un état de grand désordre avant la Création du monde – n’est pas quelque chose de négatif, ni de diabolique, ni de mauvais (d’ailleurs, en soi, le mal n’existe pas : on ne peut parler que d’absence du bien). Le tohu-bohu est le désordre avant l’arrivée et l’Ordre de Dieu. Le désordre est chronologiquement originel, enfantin, flasque, mais du point de vue de l’Éternité et de l’essence, il n’est pas originel. Seul le Bien est l’alpha et l’oméga de la vie, est essentiel et premier. Le désordre homosexuel s’inscrit donc dans une perspective d’évolution et de chemin vers l’ordre. Comme le tas de terre glaise qui n’a pas été encore travaillé et embelli par les mains du Sculpteur. Le désir homosexuel, s’il est compris, est la matière première utile d’une belle œuvre à venir.
Enfin, pour parachever le tableau du désir homosexuel en tant que désir divisé contre lui-même, il faut se méfier de son apparente douceur qu’il affiche comme « fragile ». On voit bien, même dans les faits réels, que cette fragilité d’apparat présentée par bon nombre de personnes homosexuelles comme une identité à respecter, est un alibi doucereux et hypocrite pour se justifier d’être encore plus violent qu’à l’habitude. On a pu le constater lorsque l’humoriste lesbienne Muriel Robin, pour présenter son autobiographie intitulée Fragile lors de l’émission On n’est pas couchés de Laurent Ruquier diffusée le 20 octobre 2018 sur la chaîne France 2, s’est comportée de manière absolument odieuse face au jeune chroniqueur homo Charles Consigny, à propos d’un désaccord sur la GPA (Gestation Pour Autrui). Qui a cru que les gens qui mettaient en avant leur « fragilité » étaient doux ? Ils sont les seuls à le croire !

Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.