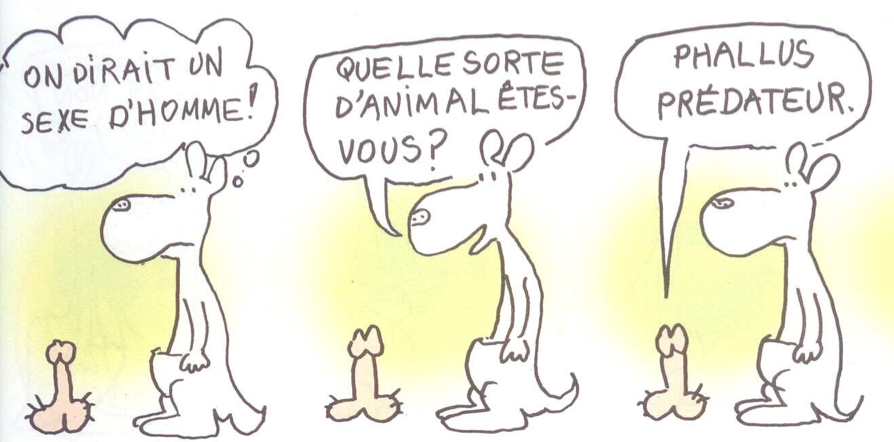Liaisons dangereuses
NOTICE EXPLICATIVE :
« On est tous des anges appelés à baiser chastement ensemble ! »
À mon avis, beaucoup de couples homosexuels sont, du point de vue du comportement, les répliques humaines presque vivantes du Vicomte de Valmont et de la Marquise de Merteuil, le fameux tandem libertin bisexuel des Liaisons dangereuses (1782) de Choderlos de Laclos. C’est ce qui explique l’attrait naturel de nombreuses personnes homosexuelles pour ce roman. La guerre des sexes, en apparence égalitaire, que se mènent ces deux anciens amants, consiste à asservir l’autre par la voie de la séduction, d’abord par personnes interposées, puis frontalement. Ce duo, tout fictionnel qu’il soit, est à prendre au sérieux dans la mesure où il est l’illustration symbolique de la nature duelle d’un désir homosexuel qui peut avoir des implications concrètes souvent violentes sur les comportements amoureux s’il n’est pas conscientisé. Comme l’écrit Jean-Paul Sartre, les personnes homosexuelles sont connues pour leur « méchanceté [en amour] en partie de ce qu’elles disposent simultanément de deux systèmes de références : l’enchantement sexuel les transporte dans un climat platonicien. » (Jean-Paul Sartre, Saint Genet (1952), p. 146) Elles peuvent alors gérer leurs relations conjugales comme on joue aux jeux de société : avec la cruauté des Précieuses de Salon du XVIIIe siècle.
La réalité amoureuse de certains couples homosexuels a souvent la froideur et la méchanceté du couple littéraire libertin Valmont/Merteuil, même si cette violence est contrebalancée par l’intention romantique, un souhait de bien paraître, et un désir d’amour sincère. Beaucoup de personnes homosexuelles considèrent la relation amoureuse comme une communion idyllique… mais aussi comme un bras de fer mi-ludique mi-sérieux, une bataille à gagner par tous les moyens. Parmi elles, je distinguerais deux types de joueurs amoureux, qui finalement n’en sont qu’un : les sincères, qui se piquent au jeu de leurs stratégies d’amour – élaborées ou peu élaborées –, et les marquises, c’est-à-dire les cyniques pures, qui vont amener les acteurs de leur comédie amoureuse à se détruire sans qu’elles-mêmes se sentent concernées, et qui se font également piéger par leur sincérité et leur intellect.
N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Médecines parallèles », « Putain béatifiée », « Quatuor », « Trio », « Amant diabolique », « Symboles phalliques », « Prostitution », « Carmen », « Amoureux », « Homosexualité noire et glorieuse », « Curé gay », « Femme fellinienne géante et pantin », « Violeur homosexuel », « Fusion », « Corrida amoureuse », « Homosexuel homophobe », « Couple criminel », « Femme et homme en statues de cire », « Promotion ‘canapédé’ », « Duo totalitaire lesbienne/gay », « Adeptes des pratiques SM », « Androgynie bouffon/tyran », « Doubles schizophréniques », « Désir désordonné », à la partie sur le mépris de la continence dans le code « Solitude », à la partie « le bien par le mal » du code « Se prendre pour le diable », et à la partie « Strangulation » du code « Coït homosexuel = viol », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.
1 – PETIT « CONDENSÉ »
Les Fils de Valmont et Merteuil
Toute la fantasmagorie homo-érotique porte à croire que les personnes homosexuelles pratiquantes sont les fils de Valmont et de Merteuil. Les répliques partiellement et imparfaitement incarnées des Marquis de Sade et des Précieuses de Salon. Des amoureux et non des aimants, des sincères et non des acteurs de la Vérité, des libertins et non des gens libres.
Dans ce petit « condensé », je vais justement essayer de décrire les différentes stratégies amoureuses des libertins homosexuels (sachant que nous les retrouvons presque à l’identique dans les cercles d’amour hétérosexuel). Il existe une gradation entre elles. Je distinguerai les stratégies élaborées, les stratégies peu élaborées, et enfin les stratégies sincèrement et intellectuellement bien élaborées mais inconsciemment mal élaborées.
A – Les stratégies d’amour élaborées
Les individus homosexuels qui se croient plus futés que les autres, ceux que j’appellerais « les sincères », les Hommes qui possèdent parfois une expérience de conjugalité homosexuelle forçant le respect, les vieux beaux ou les jeunes premiers en recherche d’« une relation sérieuse et profonde », etc., ont une connaissance accrue de ces stratégies libertines élaborées qu’ils jugent bien plus nobles que les stratégies mondaines qu’ils attribuent à bon nombre de coureurs de pantalons du « milieu homosexuel »… sauf à eux-mêmes ! Leur technique de drague se veut moins grossière que celle du débauché à la recherche d’un simple « plan cul », car ils désirent, parce que leur code moral d’esthètes surdoués l’exige, faire l’amour… mais pas aussi naïvement que tout le monde. Ils ne sont pas « tout le monde » ! Eux, ils ne baisent pas que pour le sexe, ni pour des idéaux d’amour mièvres… même si dans les faits, c’est quand même le cas. L’amour est un art dont eux seuls détiendraient les clés. À l’occasion, ils s’offrent le luxe de revenir dans les moments de misère affective aux stratégies d’amour peu élaborées. Mais en général, ils s’orientent vers les stratégies libertines compliquées, ascétiques, comme la majorité des personnes homosexuelles d’ailleurs. Selon eux, amour égale complication jouissive, même s’ils aspirent profondément à la simplicité. C’est bien là leur drame.
a) La stratégie de la folle perdue :
La première technique d’amour du libertin homosexuel est l’usage de la pitié. En jouant le rôle de la folle perdue, il se présente d’office comme fragile pour apitoyer sa proie, et surtout pour lui/se donner l’illusion que l’affichage de l’échec équivaut à la conjuration de celui-ci. La mélancolie est chez lui une technique de drague. Il voit en elle un engagement de vie : souffrir est son destin, et sera son amour. C’est pourquoi, avec son air de chien battu, il demande à sa victime de lui faire le plaisir de lui prouver qu’il vaut encore quelque chose en acceptant de coucher avec lui dans la soirée. Implicitement, en la flattant sur sa beauté et sur sa soi-disant « exceptionnalité » surhumaine, il opère un chantage aux sentiments, et même parfois au suicide (« Si tu ne m’aimes pas, je me tue. »). En amour, le libertin homosexuel est prêt à l’humiliation. Il pense qu’il doit se soumettre ou soumettre pour aimer vraiment. Il n’est pas rare d’ailleurs que les jeunes adultes homosexuels exploitent ce besoin de soumission chez certains papys gays soucieux de jouer les Mère Teresa pour les sortir de l’impasse. Une telle situation ne peut pas être appelée de l’amour, ni même de la solidarité, tant elle nourrit deux narcissismes, celui du bon samaritain, et celui du malade mi-réel mi-imaginaire.
Nous trouvons conjointement à la stratégie de la pitié une technique qui lui est proche : celle de la mélancolie. Dans beaucoup de cas, l’amour dans le couple homosexuel s’avance par la voie du chagrin, de la défaillance. Ce que le libertin homosexuel aime chez son partenaire, c’est en grande partie son mal-être, ses propres fantasmes de mort. Il vénère les yeux qui répriment leurs larmes, qui ont la dignité d’échapper à la théâtralité grandiloquente, qui expriment la force dernière des situations d’extrême faiblesse, qui pleurent la condition humaine avec la petite retenue qui les rend poignants, qui disent la douleur d’exister étouffée, qui donnent vraiment envie de sangloter à leur place (on retrouve tout à fait cela dans un film comme « Huit femmes » (2002) de François Ozon).
L’union homosexuelle obéit souvent à la conscience mutuelle d’un opprobre, d’une essence divine de loser. Nous pouvons lire dans la confrontation des fragilités des amants homosexuels une non-rencontre, la volonté d’être compris par l’autre dans sa souffrance au point de le blesser, un appel au secours qui n’en est pas un puisque beaucoup d’entre eux souhaitent moins être aidés que d’entraîner leur partenaire dans leur précipice. C’est curieux, ces « je t’aime » qui ressemblent davantage à des « Nous ne croyons plus en l’Amour à deux » qu’à des « Nous croyons en l’Amour ensemble », même si paradoxalement le libertin homosexuel et sa proie se jurent mutuellement de se faire changer miraculeusement d’avis sur l’Amour dans un élan combatif.
Le libertin homosexuel recherche ce partage dans la souffrance, tout en le trouvant insupportable. Il déplore que son bonheur doive passer par le malheur. Il ne peut voir l’attendrissement de son partenaire sur ses larmes de défaillance que comme un amusement sadique, un arrivisme déplacé, une incompréhension totale, une douceur étouffante. Il sait bien au fond que les Hommes ne peuvent pas aimer uniquement sous prétexte qu’ils détestent ou pleurent ensemble.
Voyant que son couple devient de plus en plus complexe, l’amoureux homosexuel sombre dans la théâtralité et tente de mettre en scène son propre éloignement de l’amant. C’est en même temps une stratégie pour tester son entourage amoureux (ce dernier va-t-il le retenir ?), et une croyance sincère (il pense vraiment qu’il est un être maudit, oublié par l’amour). Il lui arrive alors de jouer les vieilles Maréchales de Strauss qui n’aiment que dans l’abandon et la distance déchirante. L’une des sources d’inspiration homosexuelle est évidemment le mélodrame et la tragédie classique. Le libertin homosexuel connaît par cœur la mise en scène mélancolique de l’amour homosexuel, mais la blâme/parodie surtout chez les autres. En revanche, quand lui-même devient théâtral en amour, il ne s’en aperçoit généralement pas. Au contraire, il mord à l’hameçon de sa propre comédie. Il tombe mal amoureux en croyant être fou d’amour, parce qu’il se persuade que dans ses différentes liaisons sentimentales, il est le seul à aimer véritablement comme il faut.
Il s’abandonne ainsi à l’esthétisme narcissique déprimé. Au cœur des pires tempêtes du dépit amoureux, au plus noir de ses nuits de désespoir, il se prend homo sans le savoir. Cheveux au vent, ou emmitouflé dans son petit pull marine au bord de sa piscine dorée, il ne se voit pas méditer théâtralement sur une feuille morte tombant d’un arbre, exécuter sa propre promenade chorégraphique au ralenti dans sa ville, pleurnicher sur lui-même à la vue des petits bonheurs simples de la vie (un enfant qui joue dans un parc, les familles heureuses, les passants insouciants, etc.), s’émouvoir sur son courage surhumain d’aimer la vie malgré tout ce qu’elle lui ferait soi-disant « subir », se laisser déborder par des extases panthéistes face à la Nature cruelle. Il cache sa (fausse ?) souffrance par la célébration esthético-sentimentale de celle-ci. Au lieu de prendre réellement de la distance par rapport à l’objet du deuil, il s’y identifie dans l’émotionnel et se soustrait au travail de détachement par la mise en scène parodiée du départ. Il adore les créations de la solitude, des adieux larmoyants, de l’amour impossible.
Le libertin homosexuel refuse l’amour et fait passer cette attitude lâche et orgueilleuse pour un sacrifice héroïque, ou une essence de dieu damné. Dans la distance, il enjolive et pleure une relation avec un regretté amant qu’en réalité il n’aurait jamais aimé si celui-ci avait été accessible et vivant. Il est prêt à se priver d’aimer et même à considérer ses futures conquêtes amoureuses comme des objets de vengeance et d’expiation de ce cruel coup du sort qu’il ne veut surtout jamais digérer, plutôt que de regarder la réalité en face. Il tient à son malheur et à son amour désincarné plus qu’à l’amour qu’il chante pourtant à tue-tête.
Nous pouvons nous interroger sur la raison d’une telle comédie. Elle peut s’expliquer en partie par le fait que le libertin homosexuel se convainc que l’amour vrai ne peut pas se dissocier de la souffrance et de la mort. Il s’agit d’une croyance absurde, puisque l’amour vrai, même s’il se manifeste parfois dans des situations d’épreuves, n’a jamais eu besoin de la souffrance ni de la mort pour exister. Mais beaucoup de personnes homosexuelles s’obstinent à la rendre effective par l’intermédiaire de l’esthétique.
Pour le libertin homosexuel, la véritable passion se trouve dans la tyrannie doucereuse. « La première forme de l’amour est respect, timidité, terreur. » (Marcel Jouhandeau, « Chronique d’une passion », cité dans l’émission Apostrophe, sur la chaîne Antenne 2, le 22 décembre 1978) Il définit l’Amour comme une force incontrôlable qui soumet et assigne un destin de despote ou de martyr. Il rêve d’être possédé par l’Amour, ou de faire de ce Dernier un instrument de pouvoir.
b) La stratégie de la peste :
Pour se venger de lui-même parce qu’il s’est laissé croire à sa faiblesse de folle perdue, le libertin homosexuel va, pour attirer les prétendants, prendre le total contre-pied de sa première tactique de séduction qui consistait à se montrer fragile. Il se décide à masquer sa dépression par la prétention. Il éprouve par exemple une sorte de fierté à s’isoler dans les recoins des bars gays, à ne pas aller draguer directement les autres (d’ailleurs, il déteste le mot « drague »), simplement pour ne pas prendre le risque d’être congédié, et pour avoir le plaisir de se faire éternellement désirer. Il a honte de prétendre à l’Amour, d’être fougueux ou passionné, car pour lui, aimer, c’est davantage une faiblesse qu’une force. L’une des règles d’or de ses manœuvres amoureuses est l’interdiction d’aimer ou de se laisser aimer. L’amour réciproque, c’est une abomination à ses yeux : « Mon amour à moi n’aime pas qu’on l’aime » laissera-t-il souvent entendre. Le but du jeu n’est pas d’aimer réellement mais de feindre l’Amour, d’écraser l’autre par l’art de la séduction courtisane, de promettre le ciel étoilé sans y voler. Paradoxalement, c’est pour cacher qu’il considère l’Amour comme une affreuse maladie, qu’il cherchera à tout prix à tomber maladivement amoureux.
Menée à terme, la chaîne de la sincérité conduit bien souvent le libertin homosexuel à la destruction de l’amant et à son auto-destruction. Il se dit tellement que sa bonne foi le sauvera du mal qu’il croit pouvoir tout se permettre pour aimer, même les pires manigances (le mensonge, la jalousie, la tromperie, l’humiliation de son copain en public, les menaces de mort, la soumission, la vengeance, etc.). Les seuls hommes qui l’intéresseraient amoureusement sont objectivement impitoyables avec lui. Et ceux qui s’intéressent à lui alors que lui ne s’intéresse pas vraiment à eux, il les trouve mièvres, pathétiques, et donc dignes d’être détruits. La méchanceté qu’il exerce sur son amant n’est pas seulement à mettre du côté de la volonté mauvaise. Elle lui apparaît comme une forme de charité : il souhaite protéger celui qu’il prétend aimer/qui prétend l’aimer de lui-même, en suscitant chez ce dernier la pitié – quand il a la force de la faiblesse – ou bien la haine – quand il ne veut pas paraître faible. L’élan d’amour du libertin peut alors tourner au drame. Dans l’iconographie homosexuelle, l’amour homosexuel est souvent montré comme un combat violent ou mortel. Et la fiction se fait parfois réalité.
Si et seulement si cette stratégie libertine est transposée dans la réalité concrète, la relation conjugale homosexuelle devient un enfer à vivre. Entre les amants homosexuels, on constate que c’est souvent l’« amour vache ». Il faut se méfier des couples mythiques montrés en exemple par la communauté gay actuelle (Gilbert et George, Marais et Cocteau, Hudson et Christian, Jacob et Sachs, Wilde et Douglas, Chapman et Sherlock, Mead et Benedict, Radiguet et Cocteau, Britten et Spears, Brémond d’Ars et Solidor, Stéphane et Rinieri, Bacon et Dyer, etc.). Quand nous commençons à nous pencher sur leur biographie, nous découvrons qu’en réalité leur relation, même très passionnelle, a été la plupart du temps synonyme de vagabondage sexuel, de pénible cohabitation, de liaison très orageuse, de lourde complexité, de trahisons successives, voire de meurtre (Pelosi et Pasolini, Halliwell et Orton, Verlaine et Rimbaud, etc.).
Quand les unions homosexuelles sont plus pacifiées et que les amants ont tout de même suffisamment de conscience pour se retenir de s’égorger l’un l’autre, la violence est contenue différemment. Leur soif de meurtre ne dépassera généralement pas le seuil du fantasme, mais la violence restera tout de même présente. Souvent, on remarque que dans de nombreux couples homosexuels (mais c’est sensiblement la même chose parmi les couples hétérosexuels) la soumission de l’un et la domination de l’autre ont atteint un degré de synchronisation dans le consentement presque militaire. Ce qui fait violence dans la majorité des unions homosexuelles que nous pouvons être amenés à rencontrer, ce sont les simulacres d’amour – l’infantilisation souriante, la complicité singée, l’exaspération contenue (les défauts de l’autre agacent plus qu’ils n’attendrissent…), l’humour cynique dénué d’émerveillement, les paroles sardoniques, les caresses automatiques, la promotion de la « bonne entente sexuelle » au sein du couple, la répétition suspecte des « réconciliations sur l’oreiller », le mutisme obéissant de l’un des deux concubins, l’excès totalitaire de l’autre, l’ambiance feutrée et rangée de l’appartement, la constante compétition, le manque de confiance et d’écoute, les rapports de force ludiques, etc. –, bref, tout ce qui fait que le conflit ne peut pas être ouvert alors qu’il est manifestement larvé. En règle générale, si le couple homosexuel ne doit pas susciter l’inquiétude, il n’invite pas vraiment à l’enthousiasme ni à la joie, c’est le moins qu’on puisse dire…
B – Les stratégies d’amour peu élaborées
Peu à peu, le libertin homosexuel se lasse de ses stratégies compliquées qui finissent par surcharger ses amours d’artifice et de calcul. La complexité en amour, ça va bien un moment, mais il aspire à la légèreté, à la simplicité, et au naturel. Il va donc chercher à mettre en place des stratégies peu élaborées, censées rééquilibrer la balance. En réalité, celles-ci traduisent la même fuite de soi que les stratégies élaborées.
a) La stratégie de la consommation sexuelle :
Commençons par la stratégie qui se sait peu élaborée ou qui se veut inexistante : celle de la consommation sexuelle pure et dure. Elle est adoptée par le libertin homosexuel qui ne prétend pas aimer quand il s’unit génitalement avec quelqu’un. Elle n’exigerait de lui qu’une seule vertu : l’indifférence. Il va un moment dans les lieux de consommation sexuelle classiques (saunas, bars, boîtes, backrooms, sex-shops, jardins publics, etc.), et en ressort soulagé, apparemment sans regrets. Le contrat de son aliénation a été écrit préalablement à sa place par le supermarché gay, et lui n’avait plus qu’à signer en bas. En réalité, cette stratégie n’est simple qu’en intentions, car le sexe dit « sans loi » établit au contraire des commandements tacites – anonymat, clandestinité, mensonge, banalisation, prohibition de l’engagement, détachement sentimental absolu, enchaînement aux pulsions, etc. – faisant partie de la rigide « algèbre du besoin » décrite par Burroughs dans Le Festin nu (1959), et ne compliquant les existences qu’après-coup.
Parfois, le libertin a quand même la petite dose de savoir-vivre pour maquiller ses bas instincts par un semblant de patience tolérant les préliminaires un peu longuets de la rencontre sexuelle avec l’ami internaute à peine connu. La promenade bâclée en ville, le chocolat dans le salon de thé, la discussion de fin de soirée…, ne sont qu’un gentil petit apéritif pour satisfaire le vernis éthique que l’union fiévreuse des corps est censée faire voler en éclats le soir même. Avant de finir par dire ou faire comprendre à sa proie qu’il veut « baiser », le libertin monte tout un beau discours fondé sur le mépris du « milieu homosexuel » (qu’il connaît pourtant très bien…), saupoudre le tout d’analyses sociologiques à deux balles (« C’est fou, le culte du corps chez les homos… »), et lui montre l’orgueil qu’ils peuvent en tirer ensemble (« Nous deux, c’est différent des ‘relations milieu’ »). Souvent, sa méthode de séduction dissimule un plan de revanche : il consomme et jette ses amants pour se venger de toutes les fois où d’autres l’ont/l’auraient utilisé.
Il arrive que le libertin homosexuel s’attache à un « pote de baise » (selon sa propre dénomination) un peu plus longtemps que prévu et pour un moment volontairement indéfini. Pour se consoler mutuellement de leur parcours sentimental complexe et vide, tous deux décident alors de se laisser une période d’essai, de « test » amoureux, mais sans grande conviction ni désir sérieux de s’engager. Leur union ne tient qu’à un fil. C’est au premier qui craquera parce qu’il n’aura pas eu le courage d’attendre que la rupture vienne de son compagnon de fortune.
La stratégie de la consommation sexuelle ne concerne pas uniquement les adeptes du défoulement physique. Même le libertin homosexuel fidèle et ascétique laisse souvent entendre qu’entre son compagnon et lui, c’est le génital qui l’emporte sur l’amour, que leur union tient majoritairement à la « bonne entente sexuelle » et au besoin réciproque de tendresse. Dans certains couples, le sexe empêche les mots de répudiation, qui pourraient être libérateurs, d’être prononcés, prolongeant ainsi un peu plus le calvaire d’être aussi mal accompagné. Comme éthiquement, beaucoup de personnes homosexuelles sont gênées de reconnaître qu’elles sont plus attachées au sexe qu’à l’Amour, elles font souvent passer leurs instincts sexuels pour des sentiments authentiques (je bande donc j’aime). C’est pourquoi elles n’ont pas l’impression d’être infidèles, y compris lorsqu’elles vont « voir ailleurs ».
Le phénomène de l’infidélité est particulièrement accru au sein de la communauté homosexuelle. Les personnes homosexuelles ont en général plus de partenaires sexuels que les personnes dites « hétéros ». D’après l’enquête ACSF, le nombre moyen de partenaires s’élevait en 1991-1992 à 11 pour les personnes « hétéros » et à 13,7 pour les personnes homos. Parmi les moins de 30 ans, les personnes homos ont souvent collectionné une cinquantaine d’amants, les personnes « hétéros » moins d’une vingtaine (Janine Mossuz-Lavau, La Vie sexuelle en France (2002), p. 372). Il apparaît effectivement que les premières se caractérisent en moyenne par une moindre propension à développer des liens durables avec un partenaire privilégié.
Mais il n’y a même pas besoin des statistiques pour le démontrer. Il suffit de constater les faits sur le terrain. En temps normal, on peut voir que beaucoup de personnes homosexuelles de notre entourage se consomment entre elles, multiplient les aventures sexuelles ponctuelles, passent insensiblement de l’amitié à l’amour avec leurs « ex ». Rien qu’en faisant un tour sur les chat de rencontres Internet, on est frappé du nombre d’hommes mariés qui recherchent des « plans cul », de garçons déjà en couple avec un autre homme (… mais qui parfois l’avouent bien tard) partis draguer ailleurs. La pratique de l’échangisme dans les « milieux » gays ou lesbiens n’est pas rare. Certains pensent que le « sexe à plusieurs » sauvera leur couple sans le remettre totalement en cause. Se créent lexicalement de nouvelles unions et des combinaisons inédites (les couples à trois sont baptisés « trouples » ; il est question de « plurisexualités »…).
La difficulté à inscrire le couple homosexuel sur la durée et la qualité s’explique par la nature même du désir homosexuel. Celui-ci tend davantage vers la désunion et la déréalisation de l’amour que vers l’union. J’abonde dans le sens de Reinaldo Arenas quand il affirme que « le monde homosexuel n’est pas monogame ; presque par nature, par instinct, il tend à la dispersion, aux amours multiples, à la promiscuité parfois. » (Reinaldo Arenas, Antes Que Anochezca (1990), p. 90) Comprendre que l’infidélité fait partie de l’élan naturel du désir homosexuel pourrait être salutaire si ceux qui font ce constat lucide ne s’en servaient pas ensuite pour se décharger de toute responsabilité. Malheureusement, trop parmi eux se disent que, puisque l’infidélité est comprise dans leur désir homo-érotique et qu’ils sont indiscutablement homosexuels, ils n’y peuvent rien s’ils butinent d’une fleur à l’autre… : ils seraient donc naturellement justifiés ! « Notre mémoire et notre cœur ne sont pas assez grands pour pouvoir être fidèles » écrivait Marcel Proust (Marcel Proust cité sur le site suivant, consulté en juin 2005). Or, bien sûr, l’infidélité n’est pas une caractéristique profonde des personnes homosexuelles mais une caractéristique du désir homosexuel seulement.
L’infidélité parmi les personnes homosexuelles, dans un sens, n’est pas méprisable, parce qu’elle met en lumière un désir paradoxal qui mérite d’être écouté et analysé. Elle peut être dans certains cas un appel au secours déguisé, une recherche désespérée de sens, une volonté de clarté maladroitement demandée. Il n’est pas rare que certaines personnes homosexuelles trompent leur copain pour lui prouver et se prouver à elles-mêmes les lacunes ou les lourdeurs de la structure conjugale homosexuelle. Le multi-partenariat, le vagabondage sexuel, l’habitude de la consommation sexuelle, etc., ne sont pas à diaboliser. Généralement, ceux qui condamnent les pratiques infidèles sont les mêmes qui les exécutent en douce et qui ne les reconnaissent pas. Ce n’est pas par principe que l’infidélité doit nous gêner, pas plus qu’au nom de l’image sociale, ou d’un attachement à un discours moral ou religieux. Ce qui doit attirer notre attention, ce sont uniquement les personnes et leur bonheur. Ce qui est gênant dans l’infidélité, c’est le mal-être palpable chez ceux qui trompent et qui sont trompés. La fuite du couple traduit chez certaines personnes homosexuelles une profonde insatisfaction qui s’exprime mal puisqu’elle ne demande pas à se résoudre mais au contraire à être réparée en acte par un autre mensonge, l’infidélité, et en intention, par une pensée mièvre. Nous ne verrons le véritable visage du libertin homosexuel qu’à partir du moment où nous comprendrons que dans son esprit, l’infidélité se veut acte d’amour.
b) Le fascinant paradoxe du libertin homosexuel :
Nous touchons là au paradoxe du libertin homosexuel. Entre libertinage et ascèse, Valmont condamne le plaisir sexuel à l’obsession ou à la frustration. Sa course au sexe et à la reconnaissance par l’image dévoile son insatisfaction et son perfectionnisme caché. Son refus catégorique de l’hyper-sexualité dit aussi sa focalisation sur le génital. Il incarne tour à tour la célébration excessive de la sexualité et sa négation dans l’intellectualisme ou le volontarisme. Ne perdons pas de vue que derrière le Vicomte de Valmont se cache la Marquise de Merteuil, « la lesbienne » amoureuse de Cécile de Volanges, dissimulant son mépris du corps et sa frustration d’amour par une maîtrise quasi-parfaite d’elle-même, celle qui privilégie le devoir conjugal sur l’amour, l’esprit sur le plaisir génital, même si elle réitère sans cesse dans son discours l’idée de jouissance. C’est pourquoi on rencontre bien plus d’individus frustrés sexuellement parlant chez les personnes homosexuelles et hétérosexuelles, pourtant forts consommateurs de sexe, que chez les femmes et les hommes qui s’aiment d’un amour vrai sans se priver (ni abuser) des bonnes choses génitales.
Les personnes homosexuelles ne sont pas des obsédés sexuels : au contraire, leur désir érotique est très ascétique, et leur quête sexuelle ne relève pas seulement, comme le croient beaucoup de gens, d’un défoulement instinctif incontrôlé. Le sexe pour le sexe, cela n’a jamais intéressé personne, même et surtout ceux qui le laissent croire par leur mode de vie et leurs paroles. Derrière le consommateur assidu des backrooms et des saunas, la star du porno, ou l’internaute avide de « plans sexe » farfelus, se cache en général un homme frigide et romantique qui cherche inlassablement l’amour vrai, et qui doit porter un désir lui imposant davantage l’obstination, l’inventivité et le volontarisme que le lâcher-prise. À mon avis, les mots « libertinage » et « ascèse » mériteraient d’être marqués comme synonymes dans la prochaine édition du Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon. Un jour, un homme homosexuel m’a fait à juste titre cette remarque (sans s’excepter lui-même dans le tableau) : « J’en ai vu évoluer des gays, de manière fulgurante, des grands principes à un certain libertinage… Ceux qui avaient les plus grands ‘principes’ romantiques étant en général d’ailleurs ceux dont la ‘séance de rattrapage’ est souvent la plus impressionnante !!! » Je reste convaincu que la majorité des personnes homosexuelles n’ont pas renoncé au purisme en cultivant dans l’expérimentalisme sexuel leurs vieux rêves fleur bleue de virginité. Elles pourraient dire, comme Olivier Py : « J’étais au bordel comme au cloître. » (Olivier Py, L’Inachevé (2003), p. 41)
C – Les stratégies sincèrement et intellectuellement bien élaborées, pratiquement et inconsciemment mal élaborées
Nous en venons à parler de la troisième catégorie des stratégies du libertin homosexuel, celles qui ont trait au paradoxe de la sincérité. En dissociant la fidélité sentimentale et la fidélité génitale/corporelle, et en plaçant la première bien au-dessus de la seconde, le libertin homosexuel pense très sincèrement aimer et être chaste, même quand il va voir ailleurs et qu’il n’aime pas vraiment. À force de self control, il ne se voit plus agir et ne maîtrise plus la course à l’amour qu’il avait méthodiquement organisée.
Ne voyant ses actions qu’à travers le prisme de ses bonnes intentions, il lui est difficile de mesurer que ce n’est pas les valeurs en elles-mêmes qu’il désire mettre sincèrement en pratique dans ses amours qu’il doit remettre en cause (« s’accepter soi-même », « défendre la diversité », « accueillir la différence », « aimer l’autre de tout son cœur et tel qu’il est », etc.), mais le détournement qu’il en fait. Par exemple, la générosité n’a jamais impliqué de se laisser vider son compte en banque par son amant ; l’amour de la beauté n’a jamais imposé la soumission au sexe ; l’acceptation de soi n’a jamais demandé la caricature du coming out ; etc. Le libertin homosexuel a du mal à saisir que l’amour n’est pas que l’intention d’aimer, et que, comme le dit le fameux adage, « l’enfer est pavé de bonnes intentions ».
a) Les caprices du désir homosexuel :
La discordance entre sincérité et acte, imposée par le désir homosexuel, fait que, bien souvent, les personnes homosexuelles deviennent compliquées en amour, alors qu’en temps normal, elles sont pourtant souvent connues pour être mesurées, drôles, de bon conseil, et maîtresses d’elles-mêmes.
À chaque fois que nous tombons homosexuellement (ou hétérosexuellement) amoureux, nous sommes d’humeur plus triste et plus euphorique qu’à l’habitude. Être homosexuellement amoureux, je crois vraiment que cela ne va à personne. Globalement, le désir homosexuel ne nous simplifie ni ne nous apaise. Il existe souvent un réel décalage entre la profonde sympathie que l’on peut ressentir pour les sujets homosexuels de notre entourage et l’impression détestable qu’ils nous laissent quand on les voit en couple homosexuel avec quelqu’un. C’est comme si, une fois qu’ils obéissaient à leur désir homosexuel, ils n’étaient plus vraiment eux-mêmes, devenaient possessifs, obsessionnels, pathétiques, théâtraux, superstitieux, excessifs, autoritaires, calculateurs, maniaco-dépressifs, impatients, mélancoliques, fragiles, frénétiques, superficiels. Plus le libertin homosexuel est intelligent et sincère, plus il vit mal sa métamorphose en folle perdue ou en homme psychorigide, car il s’attribue à lui-même le dédoublement paradoxal de sa personnalité quand il devrait l’assigner majoritairement à son désir de surface. Il mesure combien il peut devenir psychopathe en « amour », et cherche à prouver à ses amants qu’« en vrai, il est plus cool et plus drôle » que lorsqu’il s’identifie à « l’homosexuel » et qu’il cherche à aimer homosexuellement. Mais ce n’est que peine perdue : chercher à expliquer à l’excès la vanité de la complexité homosexuelle (en écrivant « le mail de trop », en se confondant en excuses ou en explications intellectualisantes sur l’homosexualité), pour en acte la démentir, c’est finalement la justifier et se couvrir encore plus de ridicule dans la contradiction.
b) Le désir amoureux sincèrement théâtral :
Le principal problème du désir homosexuel est qu’il rend les personnes qu’il habite « sincèrement théâtrales ». Les deux termes qui composent cette drôle d’expression valent, je crois, leur pesant d’or, et je n’en ai pas trouvé jusqu’à présent de meilleurs pour décrire le paradoxe du libertin homosexuel. Il est capital de comprendre que le désir homosexuel est avant tout un amour sincérisé, et que beaucoup de personnes homosexuelles désirent réellement être aimées et aimer, même par le biais de l’artifice, du mensonge, de la mort et de la souffrance. Si la sincérité et la bonne intention n’existaient pas dans le couple homosexuel, celui-ci n’aurait plus sa raison d’être ni sa beauté. Or il mérite parfois que nous tenions compte de sa nature d’amour excessivement intentionnalisé. Quand je dis que les personnes homosexuelles sont sincèrement théâtrales ou théâtralement sincères, c’est dans la mesure où à la fois leur sincérité n’est pas à prendre au sérieux puisqu’elle est théâtrale, mais où il faut aussi en tenir compte car elle n’est pas que théâtrale : elle peut amener les individus à agir concrètement, et pas toujours constructivement quand leurs intentions aveuglent leur conscience de mal faire.
Comme d’une part personne n’incarne complètement le personnage mythique du libertin homosexuel, et que d’autre part le désir homosexuel traduit aussi une volonté de bien faire (même si les moyens concrets qu’il met en place ne s’accordent pas toujours avec les buts exposés), je pense que nous devons prendre les personnes homosexuelles un peu au sérieux et reconnaître une part de l’authenticité de leur amour. Il ne s’agit pas de croire en elles comme elles « s’y croient », mais simplement d’y croire comme il faut. Quand Michel Foucault souligne l’existence de la « profonde comédie de l’homosexualité » (la biographie Michel Foucault (1989) de Didier Éribon, citée dans l’essai Le Rose et le Noir (1996) de Frédéric Martel, p. 128), il a raison de ne pas lésiner sur l’importance de l’adjectif « profonde ». Il n’est pas rare d’être témoin de l’acharnement de certains individus homosexuels à aimer leur copain jusqu’au bout (même si par ailleurs ils lui en font voir de toutes les couleurs pour qu’il les quitte…). Leur choix de la solution par défaut, autrement dit de la vie de couple homosexuel (ou hétérosexuel), est loin d’être uniquement une décision prise à la légère, un signe de lâcheté de leur part, un refus clairement volontaire de l’éthique. Il est partiellement éthique en sincérité, mais non en acte. Comment ne pas en tenir compte et ne pas être touché par cette persévérance à construire un amour artificiel ? Entre courage et justification de la couardise, entre lucidité et refus de voir, beaucoup de personnes homosexuelles illustrent toute l’ambiguïté du désir homosexuel qui incite à renoncer à la perfection au nom de la perfection. C’est la raison pour laquelle nous devons malgré tout nous laisser toucher par cette théâtralité de quatre sous homosexuelle, passer par-dessus sa sophistication orgueilleuse. La mise en scène de souffrances ou de sincérité amoureuse n’est pas qu’un spectacle idiot et prétentieux. Dans les cas où la tristesse et l’amour passionné sont excessivement scénarisés, une souffrance réelle se nie et se dit. Derrière la théâtralité homosexuelle, il y a parfois l’expression d’un vécu relationnel complexe, le récit d’amours tourmentées ou d’un torturant fantasme de viol. Beaucoup de personnes homosexuelles trouvent la succession des échecs amoureux dans leur vie affective absolument désolante parce qu’elles sont dans le fond très sensibles et romantiques, et qu’elles aspirent à trouver le « Grand Amour » avec beaucoup de sincérité. Même si leur détresse est quelquefois risible étant donné qu’elle reprend mot pour mot le script de la femme-objet télévisuelle, elle n’en est pas moins un peu réelle. Les sujets homosexuels les plus « théâtralement sincères » sont ceux que nous devrions préférer parce qu’ils se rendent objectivement détestables pour que nous ne découvrions pas leur plaie béante d’exister. Leur comédie n’enlève rien à leur sincérité et à leur dignité humaine. Voilà le drame – ou plutôt le miracle ! – de l’homosexualité.
Cependant, même si la sincérité explique beaucoup de choses, elle n’excuse pas tout. Nous pouvons vouloir le bien des autres sans le faire. Et c’est très souvent parce que le libertin homosexuel ne contrôle plus sa théâtralité, ou qu’il accorde tout pouvoir à ses bonnes intentions et à sa tristesse, qu’il opère parfois des actes violents contraires à sa conscience.
Sa technique d’approche amoureuse est sensiblement toujours la même : sur le terrain des sentiments, il fait passer l’artifice pour du naturel, le programmé pour du spontané. Ainsi, pour gagner le cœur de sa proie, il prêche discrètement le faux pour savoir le vrai, ou bien joue la chanson de la fausse humilité et de la simplicité de l’amour. Il tient exactement l’honnête discours du sénateur du film « Twist » (2004) de Jacob Tierney et Adrienne Stern, qui loue les services des prostitués tout en prétextant la gratuité : « Je ne veux pas de sexe avec toi. Je veux juste discuter. » Il fait tout pour dissimuler ses manigances. Et pourtant, il aura tout orchestré, fera passer sa stratégie séductrice pour un destin incontrôlable et un miracle d’amour. L’apparente simplicité des sentiments qu’il propose, les privilèges flatteurs qu’il se donne l’impression de distribuer, ses fausses confidences déversées sous forme d’écriture automatique dans les mails ou les messageries de portable, sa patience et son impatience artificielles, ses simulations de troubles exprimés en silences dramaturgiques, ne sont que poudre aux yeux et impliqueront parfois une dette d’amour ou une redoutable demande de sacrifice. Le libertin homosexuel cherche à produire ce qu’il croit être du « naturel » mais qui n’en est pas exactement, pour ensuite se persuader lui-même qu’il aime d’un amour fou et authentique. Il aura programmé ce qui ne se programme qu’en partie : l’amour. Il « sincérisera » le théâtral pour dire ensuite que son théâtre amoureux fantasmé est réalité. Pour lui, la Vérité se fait, et son créateur, ce n’est autre que lui, même si ensuite, il s’effacera hypocritement devant son ouvrage raté par honte de sa prétention à se prendre pour Dieu. Il pense pourtant échapper aux malversations opérées sur l’amour en les intellectualisant à outrance et en mettant en garde les autres contre celles-ci. Le drame du libertin homosexuel, c’est qu’il finit par croire en son rôle d’amoureux éperdu, et que la contrefaçon qu’il opère sur les sentiments humains lui apparaît très souvent comme authentique. Il fait passer la sincérité avant l’honnêteté, si bien qu’il mord à l’hameçon de sa comédie de crooner bourgeois-bohème, de Don Juan torturé par l’amour.
Si la proie du libertin homosexuel a le malheur de lui révéler que sa stratégie d’amour n’est pas aussi naturelle et probe qu’il l’aurait souhaitée, si elle refuse de rentrer dans son jeu faussement gratuit, la réaction de ce dernier peut se révéler d’une violence extrême, surtout quand il est déjà « casé » avec un compagnon avec qui il prétend vivre l’amour fou, même si ce n’est pas le cas étant donné qu’il cherche à flirter ailleurs. À ses yeux, il ne drague pas quand il drague : il aime, tout simplement ! Quand il passe d’un corps à l’autre, c’est, selon lui, uniquement par besoin (limite « sacrifice charitable » !), et non par gaieté de cœur. « Je dois te préciser, chère amie, que ce genre de recherche hasardeuse et de fougue ne me plaisait guère. La ‘drague’ n’était pas une drogue pour moi, mais une nécessité. » (Denis Daniel, Mon théâtre à corps perdu (2006), p. 81)
C’est bien parce que l’usage amoureux de la sincérité peut maquiller les plus bas instincts humains qu’André Gide s’exclame : « Que cette question de la sincérité est irritante ! Sincérité ! » (André Gide, Les Faux-Monnayeurs (1925), p. 84) Beaucoup de personnes homosexuelles basculent sans s’en rendre compte dans la bassesse du libertin homosexuel qui justifie son choix de la solution par défaut par le simple fait de se montrer à lui-même qu’il a été capable de reconnaître avec humilité et lucidité qu’il ne choisissait pas la meilleure solution possible. « Je ne fais pas l’erreur comme les autres parce que je l’ai comprise, donc mon intellect et ma sincérité me donnent le droit de la faire » pense-t-il. Cela fait un bon bout de temps qu’il s’est torturé à peser le pour et le contre concernant son couple homosexuel. Il croit connaître mieux que sa société et que ses semblables d’orientation sexuelle les limites des relations homosexuelles. Il n’est pas sans ignorer qu’il ne s’y prend pas au mieux pour aimer dès qu’il emprunte le chemin de son désir homosexuel. Il connaît la honte suprême de se servir sciemment de ses médiocrités et de la justification excessive de celles-ci par l’intellect ou la sincérité pour ensuite conquérir ses amants. Mais non ! Il se pardonne à lui-même ! Il se persuade qu’on ne lui en voudra pas d’avoir essayé d’aimer ! Le résultat compte… mais il serait secondaire par rapport à l’intention, croit-il.
Pour se punir de tomber homosexuellement amoureux, le libertin homosexuel est même capable de projeter sur la personne qu’il convoite ses propres attentes malhonnêtes, mais de manière agressive : inconsciemment, il se rue sur les premiers défauts observés à la hâte chez elle afin de l’écarter de sa vie et de s’illustrer héroïquement par sa capacité d’analyse et son volontarisme ascétique. Une manière comme une autre de se prouver à lui-même qu’il a la force d’âme pour rejeter les sollicitations, qu’il n’est pas aimable (amoureusement et homosexuellement parlant), et que sa proie n’a pas à tenter quoi que ce soit avec lui. Dès le départ, il souhaite freiner ses pulsions homosexuelles, s’empêche d’être impatient pour connaître son amant, condamne la fougue des premiers instants de la rencontre, nie à tout prix le glissement de l’amitié à l’amour, considère l’envie pressante de le séduire – même s’il ne l’a vu qu’une soirée – comme une psychopathie. Il mesure ses élans. Il ne sera pas, à ses yeux, celui qui se risquera à dire « je t’aime » à tout va ! Tomber amoureux dans la seconde, cela lui paraît trop excessif, adolescent, irréaliste, … homosexuel !
Prodigieux mélange d’intentions : il essaiera en même temps de repousser la personne aimée, et par l’argumentation justifiée de sa démarche de rejet, de l’attirer à lui. Il est même capable d’écrire un livre décrivant le désir homosexuel et ses travers pour se donner le droit de ne pas appliquer ce qu’il a vu à juste titre, pour acheter son amant homosexuel, et troquer la part de Vérité qu’il a entrevue contre le mensonge. Il a le pouvoir de disserter de manière juste sur l’homosexualité, mais de se servir de sa réflexion et de ses bonnes intentions pour faire et justifier les erreurs qu’il décrit, en pensant ne pas les commettre « comme les autres ». Il place en quelque sorte la sincérité ou l’intellect avant les actes et l’amour des Hommes. C’est d’ailleurs ce déchirement intérieur qui le rend malheureux toutes les fois où il décide de croire en l’amour homosexuel, et minable aux yeux des prétendants qu’il essaie de convaincre qu’il ne fait pas ce qu’il fait sous prétexte qu’il ne veut pas le faire. Il n’ignore pas que le désir homosexuel n’est pas son désir profond et qu’il ne l’unifie pas. Il s’en rend compte rien qu’à ses propres réactions : dès qu’il cherche à tomber homosexuellement en amour, il se transforme en comédien déprimé et pathétique, alors qu’en temps normal, il est connu au regard des autres pour être quelqu’un de lucide. Mais il ne fait pas ce qu’il dit de juste… parce que sa seule erreur est d’avoir cru en la toute-puissance de sa propre volonté. Il est sincère sans être vrai ; il n’est qu’amoureux en s’imaginant aimer profondément ; il est bien intentionné sans faire de ses bonnes intentions des actes justes.
L’Homme habité par un désir homosexuel sait qu’en disséquant finement l’homosexualité et ses limites, il s’expose à s’éloigner radicalement ou à se rapprocher au plus près de l’impossible incarnation humaine de « l’homosexuel », à se mentir totalement à lui-même (si, en actes, il choisit de s’écarter de ce qu’il a découvert, sous prétexte qu’il a vu juste), ou au contraire à être en accord avec ce qu’il est profondément (s’il suit jusqu’au bout ses idéaux, et fait ce qu’il dit). La réflexion lucide sur le désir homosexuel n’est donc pas sans conséquences dramatiques ou extraordinaires. Elle pose l’ultimatum du « que ton oui soit Oui » biblique. Elle oblige à un choix entier incertain, à l’acceptation que la frontière entre suprême lâcheté et folie du courage de s’accrocher à l’insondable Réalité soit temporairement indécidable. On appellera ce fossé comme on voudra : « orgueil suprême et détestable » ou « merveilleuse expérience de sa liberté ». Mon cœur opte pour la seconde définition.
2 – GRAND DÉTAILLÉ
FICTION
a) Le roman de Choderlos de Laclos inspire le personnage homosexuel :
Il est fait régulièrement mention des Liaisons dangereuses dans les fictions traitant d’homosexualité : cf. le roman Les Liaisons dangereuses (1782) de Choderlos de Laclos, le roman Les Enfants terribles (1929) de Jean Cocteau, la chanson « Beyond My Control » de Mylène Farmer, le tableau Confrontation harmonique (1996) de Christopher Cheung, le film « L’Escalier » (1969) de Stanley Donen, la pièce Jouer avec le feu (1892) d’August Strindberg, le film « Le Petit César » (1930) de Mervyn LeRoy, le film « Invitations dangereuses » (1972) d’Herbert Ross, la pièce Quartett (1980) d’Heiner Müller (avec les deux personnages des Liaisons dangereuses), le film « They Only Kill Their Masters » (1972) de James Goldstone, le film « Oh ! My Three Guys » (1994) de Derek Chiu, la pièce Qui aime bien trahit bien ! (2008) de Vincent Delboy, la chanson « Un Bonheur dangereux » d’Étienne Daho, la pièce Géométrie du triangle isocèle (2016) de Franck d’Ascanio (avec le quatuor machiavélique Vera/Pierre-André/Nina/Lola), etc.
Il arrive que le personnage homosexuel se compare directement à la Marquise de Merteuil ou au Vicomte de Valmont : « Dans sa fouille sur les rayonnages, Gabrielle a retrouvé un roman de Jean Giono, Angelo, qu’elle avait lu dans sa jeunesse. […] Étrange comme la vie vous joue des tours… En vieillissant, c’est fou, elle s’est mise à ressembler au personnage de la marquise de Théus ! » (Élisabeth Brami, Je vous écris comme je vous aime (2006), p. 58) ; « Tu étais dans la lune, Vicomte ? » (Antonin lisant les Liaisons dangereuses à son amant Hubert, dans le film « J’ai tué ma mère » (2009) de Xavier Dolan) ; « Elle me paraissait bien jeune pour jouer les Valmont. » (Suzanne en parlant de son amante Héloïse, dans le roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, p. 309) ; « Paul et François ne se turent pas une minute. Chacun abandonnait une partie de sa personnalité, s’efforçait de ressembler à l’autre. C’était à qui cacherait son cœur. Ils prenaient le masque des personnages des mauvais romans du XVIIIe siècle dont les Liaisons dangereuses sont le chef-d’œuvre. » (Raymond Radiguet, Le Bal du Comte d’Orgel (1924), p. 68) ; « Je sais que certaines rencontres peuvent mal tourner, comme je sais aussi que la frontière est très fine entre le jeu de la séduction et pourquoi pas quelque chose de dangereux. » (Mélodie, l’héroïne bisexuelle justifiant le viol en plaidoirie à la cour, dans le film « À trois on y va ! » (2015) de Jérôme Bonnell) ; etc. Par exemple, dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi, Pédé est surnommé « Vicomte » par Martin. Dans le film « La Vie d’Adèle » (2013) d’Abdellatif Kechiche, Thomas, le copain furtif de Adèle, l’héroïne lesbienne, avoue que le seul roman qu’il a lu et aimé de sa vie, ce sont Les Liaisons dangereuses de Laclos. Dans la pièce Mon frère en héritage (2013) de Didier Dahan et Alice Luce, Gabriel, l’écrivain homosexuel cite à loisir Choderlos de Laclos.
On retrouve le duo androgynique caressant et manipulateur des libertins dans le roman Les Nettoyeurs (2006) de Vincent Petitet, avec les figures de Mérovinge, le chef d’entreprise pernicieux, et sa (compagne ? complice ?) Nathalie Stevenson, « la balafrée de luxe » (p. 244), blonde, grande et mince, portant un smoking noir Saint-Laurent (comme les garçonnes lesbiennes) : « Nathalie pense comme moi. Tu sais qu’elle ne se trompe jamais, il lui suffit de voir une personne quelques minutes… Même si elle juge un peu à la cravache. » (Mérovinge, p. 214) ; « Leur obscure et défunte relation le hantait toujours. Il désirait lui plaire encore, non pour la conquérir, mais par désir enfantin de ne pas décevoir cette ancienne et violente maîtresse. » (p. 215) ; « Antoine s’attarda sur la fraîche balafre qui barrait la joue de Nathalie Stevenson. » (p. 240)
Dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, dépeignant une ambiance digne d’un salon de Précieuses, le personnage de la belle Amande est mis à l’honneur et représente tout à fait la Marquise de Merteuil, parce qu’elle aussi persifle sans arrêt avec sa meilleure amie Karen (qu’elle ne tardera pas à trahir, d’ailleurs), joue l’entremetteuse malsaine entre Irène (sa naïve camarade de classe) et Trudel (leur professeur à la fac), commence à perdre son œil comme dans le célèbre roman de Laclos : « [Amande était] D’exécrable humeur parce que, disait-elle, elle n’avait pas eu ses dix heures de sommeil, elle était convaincue que sa première ride, aperçue quinze jours plus tôt dans la glace de son poudrier, était en train de s’installer pour de bon, sous son œil gauche. » (p. 30) Quand vient son tour de relater son histoire, elle avoue elle-même qu’elle calque ses manœuvres relationnelles sur le roman de Laclos (« Il fallait rester dans le ton Liaisons dangereuses. », idem, p. 100), au point que Jason, le héros homosexuel, s’exclame à son propos : « Tu es digne de la Merteuil ! » (idem, p. 103) Dans L’Hystéricon, on retrouve le meurtre de Valmont par Merteuil dans la relation entre Yvon, l’archétype du séducteur hétérosexuel, et la dangereuse Groucha, qui finit par le châtrer : « Mais je garde le meilleur pour la fin, mon petit Yvon. Le produit de la dernière salve du pendu marque aussi la fin de ta propre carrière de don Juan. Grâce à ce cocktail à base de mandragore pilée, tu ne pourras plus nuire à la gent féminine. Je t’ai coupé le sifflet. C’est fini, les prouesses libertines. Tu resteras impuissant jusqu’à la fin de ta vie. Ça t’apprendra à préférer les fillettes remplies de vin aux vraies femmes de chair et de sang. » (Groucha à Yvon, idem, p. 267) Tout le roman est construit comme Les Liaisons dangereuses, avec la mort sociale de Merteuil – ici, d’Amande – à la fin de l’intrigue (p. 422).
Il semble que l’homosexuel fictionnel est le fils de Valmont et de Merteuil, les parents-objets séducteurs : « Sa mère était très jolie et son père était ‘très bien’. » (Tanguy, le héros homosexuel du roman Tanguy (1957) de Michel del Castillo, p. 19) ; « Je sentais dans la nuit le regard enveloppant de mon maître, doux comme sa main tendue, et aussi l’autre regard incisif, menaçant et effrayé, celui de sa femme. Qu’avais-je à faire dans leur secret ? Pourquoi tous deux me plaçaient-ils, les yeux bandés, au milieu de leur passion ? Pourquoi me mêlaient-ils à leur conflit insaisissable, et pourquoi chacun d’eux déposait-il dans mon cerveau son ardent faisceau de colère et de haine ? » (Stefan Zweig, La Confusion des sentiments (1928), p. 84) ; « Noces absurdes et truquées par des femelles-mâles et des mâles-femelles ! » (la narratrice lesbienne du roman La Voyeuse interdite (1991) de Nina Bouraoui, p. 130) ; « Dans le royaume des hommes je suis LA souillure, sur l’échiquier des dames, le pion en attente caché derrière une reine hautaine qui choisira seule le bon moment pour se déplacer. Là, aveugle et naïve j’irais buter contre un des cavaliers noirs… Pour l’instant, j’arrive à me dédoubler : je suis pion et joueuse à la fois. » (idem, p. 61) ; « Tout mon lundi je le passe avec Fabrice pour pas rester avec Irène et Franck. Ces deux-là s’entendent trop bien dans le malheur qui les rassemble. Méchants l’un pour l’autre, ils sont devenus, chaque jour un peu plus, inséparables. » (la voix narrative dans le roman Le Crabaudeur (2000) de Quentin Lamotta, pp. 72-73) ; « Je n’avais pas l’intention de me faire passer pour un homme, mais tu connais Tielo, il adore plaisanter. Il trouvait hilarant que je puisse piéger une fille hétéro, sans parler du fait, bien sûr, que lui aussi cherchait à lever des filles hétéros. Alors au bout d’un moment, on s’est mis à aller dans des clubs hétéros et je faisais semblant d’être son frère Peter. » (Petra s’adressant à son amante Jane, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 82) ; etc.
Dans la pièce Confidences entre frères (2008) de Kevin Champenois, par exemple, Damien est le fils écartelé de Valmont et Merteuil (en l’occurrence Amélie et Samuel) : « Tranché entre vous deux, mon cœur s’est retranché. » dira-t-il. Dans le téléfilm « La Confusion des genres » (2000) d’Ilan Duran Cohen, Alain symbolise tout à fait l’homosexuel puisqu’au moment où Marc tente de violer Babette, il s’interpose et se retrouve pris en sandwich entre les deux hétéros, en devenant pour le coup le témoin privilégié du viol entre la femme-objet et l’homme-objet. Dans la pièce Elvis n’est pas mort (2008) de Benoît Masocco, John, la femme lesbienne, se retrouve également coincée entre l’homme-objet (Elvis Presley) et la femme-objet (Marilyn Monroe).
Il ne faut pas oublier qu’avant de se déclarer une guerre sans merci (entre eux et contre le sexe que représente l’autre), Valmont et Merteuil étaient anciens amants. « Au fil des années, entre Marc et elle [Gabrielle, l’héroïne lesbienne], la passion s’était lentement transformée en une charmante amitié amoureuse. » (Élisabeth Brami, Je vous écris comme je vous aime (2006), p. 54) Ils ne font que reporter leur propre haine d’eux-mêmes sur la sexualité en général.
Dans la pièce Commentaire d’amour (2016) de Jean-Marie Besset, Mathilde et son meilleur ami homo Guillaume ont une relation épistolaire mi-amicale mi-amoureuse extrêmement toxique : à la fois ils sont incapables de vivre en couple, à la fois ils rejettent toutes les opportunités humaines (hétérosexuelles ou homosexuelles ou bisexuelles) extérieures à leur binôme. Ils sont toujours sur le registre de la conquête : « Toutes ces relations se sont passées sous mon règne. Toutes ces relations ont été commentées par moi. » (Mathilde en parlant des relations amoureuse de Guillaume) ; « Je me voyais régner sur ta vie. […] J’ai essayé de te trouver un nouveau mari. » ; etc. Mathilde décrit la famille comme « l’enfer du quotidien ordinaire » : « Tout vaut mieux que cet inexorable modèle. »
Les intrigues choisies par certains écrivains et réalisateurs homosexuels ressemblent étrangement aux Liaisons dangereuses. On retrouve en effet beaucoup de triangles ou de quatuors amoureux dans les fictions homosexuelles : cf. le film « Niño Pez » (2009) de Lucía Puenzo, le film « Chéri » (2009) de Stephen Frears, le film « Sans moi » (2007) d’Olivier Panchot, le film « La Tourneuse de pages » (2006) de Denis Dercourt, le film « Toy Boy » (2009) de David MacKenzie, le roman Les Nettoyeurs (2006) de Vincent Petitet (avec le repas d’Antoine passé en compagnie des trois « rois de la casse gratuite » : Ondine, Ivan, Eva), le film « Grande École » (2003) de Robert Salis, le vidéo-clip de la chanson « Power Of Goodbye » de Madonna (avec la partie d’échecs), la pièce En circuit fermé (2002) de Michel Tremblay, les pièces Jules César (1599) et Othello (1604) de William Shakespeare, l’opéra Eugène Onéguine (1879) de Piotr Ilitch Tchaïkovski, le téléfilm « Le Clan des Lanzacs » (2012) de Josée Dayan (avec Élisabeth la veuve calculatrice et son séduisant bras-droit homo Brahim), etc. « Et si on construisait une maison à deux niveaux avec Aysla et Dom ? » (Marie s’adressant à son mari Bernd, concernant le couple hétéro Dom/Aysla, alors que Marie a une liaison lesbienne secrète avec Aysla, dans le téléfilm « Ich Will Dich », « Deux femmes amoureuses » (2014) de Rainer Kaufmann)
Par exemple, dans le film « Como Esquecer » (« Comment oublier ? », 2010) de Malu de Martino, un trio amoureux étrange s’instaure entre Julia (prof d’anglais à la faculté), son élève Carmen (qui la drague ouvertement et qui s’introduit carrément dans sa vie privée), et Helena la future amante de Julia (qui couchera avec Carmen un soir). Finalement, aucune des trois relations amoureuses ne se concrétisera durablement. Dans la pièce Gouttes dans l’océan (1997) de Rainer Werner Fassbinder, le trio libertin Véra/Léopold/Ana entraîne Franz jusqu’au suicide. Dans le film « Un Mariage à trois » (2009) de Jacques Doillon, un chassé croisé amoureux s’établit également entre les quatre protagonistes : Harriet, l’héroïne lesbienne, a été la maîtresse d’Auguste (tous les deux se demandent « pourquoi ils ont été si destructeurs ») et ne veut surtout pas d’enfant ; Auguste manipule le jeune Théo et se fait prendre à son propre jeu ; quant à Fanny, elle est présentée par Harriet comme sa « fille spirituelle » (Fanny finit par l’embrasser sur la bouche). Harriet décrit la complexité de ces expériences sentimentales et sensuelles comme une construction artistique « intéressante », une performance théâtrale : « Ces quatuors, on va les jouer avec une intensité, une émotion… »
Dans la pièce Géométrie du triangle isocèle (2016) de Franck d’Ascanio, Lola fait croire à son amante Nina qu’elle « n’est pas faite pour le couple » pour mieux l’utiliser comme encas extraconjugal. « Tu ne sais jamais rien. » (Lola) Nina se plie un certain temps à l’amour asexué et libertin que lui propose Lola, déjà en couple avec la machiavélique Vera : « Dans le fond, t’as raison. Ça ne m’a jamais réussi de mélanger amour et sexualité. » lui avoue Nina. Mais l’exploitation ne durera pas si longtemps : « Rien n’est simple avec vous. » (Nina s’adressant à Lola et Vera) ; « Je crois que vous êtes malades toutes les deux. » conclut Nina au couple lesbien Vera/Lola qui a essayé de la manipuler. Elle finit par partir : « Allez-y ! Vous n’arriverez pas à me détruire. »
Le film « Portrait de femme » (1996) de Jane Campion reprend exactement la structure de l’intrigue des Liaisons dangereuses. Serena, la femme lesbienne, fut l’ancienne amante du perfide Osmond (pendant 7 ans), et ensemble, ils se définissent comme « les mauvais » (« Tu m’as rendu aussi mauvaise que toi. » dit Serena à Osmond) qui conduisent secrètement les couples de leur entourage au malheur et à la rupture. Par exemple, Serena jette la belle et intelligente Isabelle (secrètement amoureuse d’elle) dans les bras d’Osmond, et empêche la faisabilité du jeune couple Rosier/Pansy, pourtant éperdument amoureux. Osmond enferme sa fille Pansy au couvent, et maltraite Isabelle. Toute l’orchestration machiavélique de ces deux courtisans homosexuels (Serena est fascinée par Isabelle ; Osmond a tout du collectionneur homo impuissant et misogyne) fait qu’ils s’entendent dire au début du film : « Vous êtes capables de tout, Osmond et vous. Vous êtes dangereux. »
b) Le couple homosexuel est explosif, compliqué, et s’organise sous forme de rapport de forces destructeur : le personnage homosexuel applique les stratégies de l’accès à l’amour par le mal
La transposition de la structure conjugale homosexuelle sur les Liaisons dangereuses traduit bien l’animosité qui existe dans beaucoup de couples homosexuels des fictions. En général, l’amour homosexuel n’est pas représenté comme un amour évident, serein, plein, apaisant. C’est même le début des ennuis : « J’avais déjà compris que ce couple-là aussi, c’était un drôle d’assortiment. » (François, un des personnages homosexuels du roman, Riches, cruels et fardés (2002) d’Hervé Claude, p. 122) ; « Se prendre la tête : les lesbiennes adorent ça ! » (Florence, l’héroïne lesbienne de la pièce Confidences (2008) de Florence Azémar) ; « Mes sentiments m’effrayent ! Je suis obnubilé par ce garçon. Je ne le connais pas, je ne sais rien de lui mais je crois que je l’aime. Comment est-ce possible ? » (Bryan parlant de son « flash » amoureux pour Kévin, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 32) ; « Un garçon qui aime un garçon, ce n’est jamais simple. » (idem, p. 33) ; « J’ai toujours envie de te voir et d’être à tes côtés mais dès que tu t’approches de moi, je n’ai qu’une envie : celle de fuir, de t’ignorer, de passer près de toi sans te voir. Comment peut-on être aussi compliqué ? Pourquoi mon esprit me commande-t-il le contraire de ce que mon corps réclame ? Pourquoi ai-je peur de toi ? » (Bryan s’adressant à son amant Kévin, idem, p. 210) ; « Petra marqua une pause, entrant indiscutablement dans le rythme familier de leurs querelles. » (Jane, l’héroïne lesbienne en couple avec Petra, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 68) ; « Hier soir, nous nous sommes disputés une fois de plus avec Jimmy. » (Arthur parlant de son amant Jimmy dans le roman Harlem Quartet (1978) de James Baldwin, mis en scène par Élise Vigier en 2018) ; « La porte s’ouvrit soudain et Jane sursauta, même si elle savait que c’était Petra. » (idem, p. 79) ; « C’est compliqué. » (Marco par rapport à sa rupture amoureuse avec Franck, dans le film « Footing » (2012) de Damien Gault) ; « Mais si t’arrêtais de te mettre dans des histoires impossibles, on n’en serait pas là. » (Naïma, la « fille à pédé(s) » s’adressant à son ami homo Valentin, dans le film « Saint Valentin » (2012) de Philippe Landoulsi) ; « Tu sais très bien que la vie que tu m’offres n’est faite que de pleurs, de déchirures et de tracas. » (Fanchette s’adressant à son amante Agathe, dans la pièce Les Amours de Fanchette (2012) d’Imago) ; « Tu sais bien qu’il ne faut pas qu’on se voie. Ce serait peut-être pire. » (Gabriele s’adressant à son ami homosexuel Marco, dans le film « Una Giornata Particolare », « Une Journée particulière » (1977) d’Ettore Scola) ; « Des fois, avant l’entraînement, elles faisaient des bras de fer. ‘Je t’aime/Je t’aime/Je t’aime/Je t’aime’. » (Océane Rose Marie, La Lesbienne invisible, 2009) ; « Carole, tu me fais peur. » (Thérèse, l’héroïne lesbienne s’adressant à son amante Carol, dans le film « Carol » (2016) de Todd Haynes) ; « Pourquoi en veux-tu toujours plus ? » (Virginia Woolf s’adressant à son amante Vita Sackville-West l’invasive, dans le film « Vita et Virginia » (2019) de Chanya Button) ; « Tu as l’air d’une conquérante. » (idem) ; etc.
D’ailleurs, on voit que certains couples homosexuels, avant de se former, se soumettent un test, apparemment ludique, mais qui prend des airs de défi : cf. le film « Plutôt d’accord » (2004) de Christophe et Stéphane Botti, le film « À cause d’un garçon » (2001) de Fabrice Cazeneuve, le film « L’Homme que j’aime » (2001) de Stéphane Giusti, etc. Qui est le chat de la souris ? Mystère…
Tout ce qu’on sait, c’est que l’amant se montre abusif, bizarre, dangereux, « too much » comme on dit : « If excessif, accro, compulsif ; if, adhésif, over réactif ; if exclusif et trop émotif ; if impulsif qui est le fautif ? […] If négatif, maladif, inexpressif et plus vraiment vif, cherche le motif. If évasif, approximatif ; if c’est plus l’kif de jouer le calife ; if trop nocif et trop addictif ; if fugitif, maniaco dépressif. » (cf. la chanson « If » d’Étienne Daho et Charlotte Gainsbourg) ; « Dès lors, Stephen pénétra dans un monde complètement nouveau, qui tournait sur l’axe de Collins. C’était un monde plein de continuelles et émouvantes aventures : des ivresses, des joies, d’incroyables tristesses, mais aussi un bel endroit pour s’y précipiter, comme un papillon qui courtise une chandelle. Les jours allaient de haut en bas ; ils ressemblaient à une balançoire qui s’élève au-dessus du faîte des arbres, puis retombe dans les profondeurs, mais rarement, sinon jamais, tient le milieu. » (Stephen, l’héroïne lesbienne du roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 27) ; « Mais quand on tombe amoureux on devient tous un peu fous. » (Ahmed dans la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi, p. 134) ; « L’Amour, ça me fait tourner la tête. » (le Méchant du film « Les Incroyables Aventures de Fusion Man » (2009) de David Halphen) ; « Quand un flirt innocent se transforme en dangereuse liaison… » (cf. le résumé du film « My Name Is Love » (2008) de David Färdmar dans le catalogue du 19e Festival Chéries-Chéris au Forum des Images de Paris, en octobre 2013, p. 65) ; « Il y a quelque chose en toi qui cloche. Tu demandes une dévotion totale. » (Virginia Woolf s’adressant à son amante Vita Sackville-West l’invasive, dans le film « Vita et Virginia » (2019) de Chanya Button) ; etc.
Très souvent, l’amour est envisagé comme un bras de fer par les amants homosexuels : « Je crois qu’il était meilleur que moi. » (Elio parlant de son amant Oliver, dans le film « Call me by your name » (2018) de Luca Guadagnino) ; « Je veux vous dire que, lorsque je déclare que ceux qui aiment et ceux qui ont du plaisir ne sont pas les mêmes, je signale simplement que, dans une relation amoureuse, souvent, il en est un qui donne et l’autre qui prend, un qui s’offre et l’autre qui choisit, un qui s’expose et l’autre qui se protège, un qui souffrira et l’autre qui s’en sortira. C’est un jeu cruel parce qu’il est pipé. C’est un jeu dangereux parce que quelqu’un perd obligatoirement. » (la figure de Marcel Proust s’adressant à Vincent dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, pp. 164-165) ; « Je vous aime tant que je me prends à haïr… » (Mary s’adressant à son amante Stephen, dans le roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 495) ; « Kanojo doit vraiment être très intime avec Juna. Pourtant, quand elles sont en groupe, on a l’impression qu’elles ne se supportent pas. » (Suki dans la pièce Gothic Lolitas (2014) de Delphine Thelliez) ; « C’est nous les œufs brouillés. » (Océane Rose-Marie parlant à sa compagne avec qui il y a de l’eau dans le gaz, dans son one-woman-show Chaton violents, 2015) ; « Je confesse que je vous déteste ! Je confesse que je déteste Tom ! » (Bryan, le héros homosexuel s’adressant au père Raymond, dans la pièce Les Vœux du Cœur (2015) de Bill C. Davis) ; etc.
Dans son roman La Chasse à l’amour (1973), Violette Leduc définit ses amantes comme des êtres tristes et « frénétiques ». Dans le film « Je te mangerais » (2009) de Sophie Laloy, on voit « l’amour dévorant » d’Emma, étudiante en médecine, pour Marie, une jeune pianiste du Conservatoire de Lyon. Dans la pièce Sugar (2014) de Joëlle Fossier, William engueule son amant Georges à cause de ses absences : il lui dit qu’il est fou d’amour pour lui, mais avec une agressivité qui laisse entendre le contraire : « Tu te fous de moi ! Ça fait cinq ans que tu m’abreuves de mensonges ! Marre ! Marre ! Marre ! Marre d’être englouti dans ta double vie ! » Il le maltraite verbalement et physiquement. Dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit, Benjamin et Arnaud, en couple, n’arrêtent pas de se prendre le chou et de s’insulter : « Connard, va ! Trou de balle ! » (Arnaud) ; « L’enfant de catin ! » (Benjamin) ; « On s’est encore engueuler. On va encore se foutre sur la gueule. » (Arnaud).
Dans le roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, le « comportement chaotique » et « l’agitation sentimentale » (p. 231) caractérisent le personnage lesbien d’Erika : « C’est vrai qu’elle était dangereuse, Erika, à cette époque. On aurait pu croire qu’elle avait tué la petite fille au regard tragique qui demandait si on l’aimait. Elle s’emballait, avait des coups de foudre, faisait des serments éternels auxquels elle croyait. Puis elle s’apercevait que cette femme, finalement, n’était pas celle qu’elle attendait et elle la quittait. » (idem, p. 203) ; « Erika n’avait pas changé, finalement. Comme au temps de Belfort, elle en faisait trop. Et elle était éprise de la seule personne capable de sentir cette pression et de ne pas la supporter facilement. Et cela créait une sorte de cercle vicieux, classique au demeurant. Héloïse, effrayée, reculait. Erika avançait d’autant. Mais comment lui faire modifier son comportement ? […] J’avais eu tort de penser qu’Erika avait évolué. Le fond de son caractère était resté le même : passionné, possessif. » (idem, p. 270) ; « C’était vraiment une tourmentée. » (idem, p. 282) La relation amoureuse qu’Erika entretient avec son amante Suzanne se nourrit d’un drôle de combustible : « Il y avait ce désir violent, qui ne nous quittait pas, et que nous satisfaisions très souvent. » (idem, p. 203)
Quelquefois, le héros homosexuel vit mal sa métamorphose en homme paradoxal. « Pourquoi mon cœur, qui n’a pas d’yeux, s’agite-t-il autant quand je te croise […] ! Quelle réaction chimique déclenche cette agitation ? » (Bryan s’adressant à son amant Kévin par rapport à l’amour, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 306) ; « Je n’avais jamais été jaloux, avec toi, je suis devenu exclusif ! Cet amour-là est trop violent, il fait trop mal. Je croyais que l’amour était quelque chose d’agréable, qui nous grandissait. Mais celui que je ressens pour toi, me fait parfois l’effet inverse, il me détruit ! Pourquoi ? Puisque ça fait si mal, faut-il avoir peur d’aimer ? » (idem, p. 417) ; « Lorsque je pense à vous, mon cœur bat plus fort, mon corps s’étonne et s’émerveille. Quelle est donc cette folie ? » (Émilie à son amante Gabrielle, dans le roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami, p. 19) ; « Le problème, c’est que les mecs me faisaient tourner la tête. » (Stéphane, le héros homosexuel de la pièce Confidences (2008) de Florence Azémar) ; « J’ai pas l’habitude de coucher comme ça avec un inconnu… » (Matthieu, après avoir trompé son copain Jonathan alors qu’il l’idéalisait, dans la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H.) ; « Depuis trois mois, c’est l’enfer. Herbert est violent, armé, totalement imprévisible. » (Fabien à propos de son attitude avec son amant Herbert, dans la pièce Le Cheval bleu se promène sur l’horizon, deux fois (2015) de Philippe Cassand) ; etc.
Le héros homosexuel adopte une conception totalitaire et superstitieuse de l’Amour, selon laquelle Il ne se choisirait pas, s’imposerait comme une évidence, et tomberait sur n’importe qui comme un « fabuleux destin » : « À vrai dire, je n’ai jamais cherché l’amour, mais j’ai toujours pensé qu’il me tomberait un jour du ciel. » (Ednar, le héros homosexuel, dans l’autobiographie romanesque Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 132)
L’amour homosexuel fictionnel ressemble parfois à une dictature, à une bataille, à une stratégie conquérante, où l’art de séduire empiète sur la personne aimée (je vous renvoie au chapitre sur la conception scientifique de l’amour dans le code « Médecines parallèles » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels) : « En réalité, je suis plus excité par la conquête que par le terrain conquis. » (Dominique, le héros homosexuel du roman Les Julottes (2001) de Françoise Dorin, p. 25) ; « C’est triste à dire mais il faut être un peu stratège en amour. » (Laurent Spielvogel imitant André un type qui le drague dans un hammam, dans son one-man-show Les Bijoux de famille, 2015) ; « Je décidai de devenir le polytechnicien de l’amour. » (Eugène, le héros homosexuel du one-man-show Un Barbu sur le net (2007) de Louis Julien) ; « Dans le car qui me ramenait chez moi, je décidai que trois était le chiffre parfait. Avec deux liaisons, on était écartelé entre deux choix simples. Il y avait là quelque chose de linéaire. J’étais en train de lire un livre en vogue sur la théorie du chaos, d’après lequel le chiffre trois impliquait le chaos. Je désirais le chaos parce que grâce à lui je pourrais créer mon modèle personnel. Je regardais les beaux objets fractals illustrant le volume et voyais Sheela, Linde et Rani dans l’un d’eux, s’amenuisant au fur et à mesure, le motif se répétant à l’infini. Je refermai le livre, convaincue d’avoir choisi la façon de mener ma vie. Le chaos était la physique moderne, c’était la science d’aujourd’hui. » (Anamika, l’héroïne lesbienne pensant à ses trois amantes – Sheela, Linde, et Rani – dans le roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, pp. 64-65) ; « Moi, ce que je veux, c’est de la conquête. » (Lionel dans le film « Comme des voleurs » (2007) de Lionel Baier) ; « L’amour est un champ de bataille. » (Nico dans le film « Another Gay Movie » (2006) de Todd Stephens) ; « La guerre est là. Elle a ton visage, Arthur. » (Vincent s’adressant à son amoureux, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 35) ; « Entre nous deux c’est la guerre. Notre histoire qui se traîne par terre, c’est la haine et c’est la bataille. Enfin bref, tous deux on déraille. Pourtant je sais qu’tu m’aimes encore. Nous sommes à couteaux tirés. Ça va finir par éclater. Regards en coin et méfiance. Mal à l’aise et désespérance. Pourtant tu sais qu’j’t’aime encore. Il y a de l’eau dans le gaz. Ça me fait craquer, ça te déphase. On s’fait du mal, on s’fait la gueule. Je te quitte et tu me laisses seul. Il y a de l’huile sur le feu, et l’on joue à ce petit jeu. » (cf. la chanson « On s’fait la gueule » d’Étienne Daho) ; « C’est bien le curieux de la nature humaine qui porte souvent plus d’intérêt à la conquête qu’à ce qui pourtant déjà existe, si beau, dans sa maison. » (Alexandra, la narratrice lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 70) ; « J’aime séduire et dominer. » (Lacenaire dans la pièce éponyme (2014) de Franck Desmedt et Yvon Martin) ; « Avec Jacques, j’allais tricher un peu, beaucoup, passionnément. » (le jeune Mathan dans la pièce Un Cœur en herbe (2010) de Christophe et Stéphane Botti) ; « L’Amour vient de faire perdre la guerre à l’Allemagne. » (Alan Turing, le mathématicien homosexuel, dans le film « Imitation Game » (2014) de Mortem Tyldum) ; etc.
Par exemple, dans le film « Sils Maria » (2014) d’Olivier Assayas, Sigrid profite de son amante Helena, plus âgée qu’elle, pour devenir son assistante et monter en grade dans son entreprise et l’humilier : « Je renforcerai mon emprise. Je continuerai à t’isoler des autres. » Elle la conduira au suicide. Maria, qui doit jouer au théâtre le rôle d’Helena, est mal à l’aise dans sa propre vie à cause de leur histoire : « La relation entre ces deux femmes, c’est dérangeant. » Dans le film « Respire » (2014) de Mélanie Laurent, Sarah humilie son amante Charlène devant les autres camarades, la traite comme une moins-que-rien. Elle est manipulatrice, diabolique, menteuse. Charlène, à bout, finira par l’étouffer avec un coussin.
Souvent, la tension est palpable dans le couple homosexuel fictionnel, même si elle n’est pas toujours criante. La guerre que se mènent les deux amants est juste larvée dans le cynisme : « Ah ! je le savais, il était maître dans l’art des paroles sardoniques ! » (le narrateur du roman La Confusion des sentiments (1928) de Stefan Zweig, p. 50) ; « J’ai mal de toi. J’ai mal près de toi. » (cf. la chanson « J’roule » d’Hervé Nahel) ; « On s’aime beaucoup mais on s’empêche de vivre. » (Nathalie à son amante Louise, dans le film « La Répétition » (2001) de Catherine Corsini) ; « Il était si dur avec moi… » (Paul par rapport à son amant Jean-Louis dans la pièce Perthus (2009) de Jean-Marie Besset) ; « Je venais encore de m’engueuler avec Will. » (Matthieu racontant sa vie commune avec Will, dans la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H.) ; « Malgré toutes nos petites engueulades… » (Matthieu par rapport à son amant actuel Jonathan, idem) ; « Simon raconte avec pudeur que le matin-même, il est allé dans l’appartement de Gilberto détruire chacune de ses affaires. Il a déchiré les chemises de Gilberto, consciencieusement, les unes après les autres, il a brisé le joli cendrier chiné ensemble contre la table du salon (Gilberto ne fume pas). IL a aussi déchiqueté les billets d’avion des vacances qu’ils avaient passés ensemble en Hollande, et tout un tas de papiers officiels. Simon dit ‘J’ai déchiqueté ces billets parce que c’est une manière de lui dire qu’il ne peut rien garder, même pas le souvenir heureux de ce voyage.’ Il a jeté par terre dans la salle de bain toutes les affaires de toilettes de Gilberto qui se sont cassées, parfum, rasoir, eau de toilette, etc., et sur le bureau, il a shooté son Mac, allant jusqu’à enfoncer complètement son pied dans l’écran. Il a écrasé des clopes sur le tapis en prenant soin de bien le cramer. Il a fermé les rideaux, parce que le soleil qui éclaboussait l’appartement le minait. Il est allé chercher un rasoir, et il a lacéré les rideaux. Il a fait le tour de l’appartement, et a trouvé à tout ce bazar quelque chose de touchant. Comme si sa rupture était enfin matérialisée par tous les morceaux éclatés de la vie de Gilberto, la leur depuis quelques mois. Il est allé chercher sa caméra chez lui. De retour dans l’appartement de Gilberto, il a filmé en laissant la caméra caresser ce champ de bataille de sa colère, en racontant (voix off) tout ce qu’il avait brisé. Il a terminé en filmant la boîte aux lettres dans laquelle il a laissé sa clef et y a donné un énorme coup de poing qui l’a complètement déformé. ‘Voilà. J’ai monté le film toute la journée, je l’ai appelé a-mor(t). Et c’est tout.’ » (Mike Nietomertz, Des chiens (2011), pp. 109-110) ; « Elle est dure avec moi, je vous jure. Je lui lave les pieds comme si elle était Jésus et elle m’engueule, elle me parle mal. » (Polly parlant de son amante Claude, idem, p. 115) ; « Mes mères vont peut-être divorcer. Elles n’arrêtent pas de se disputer. Et moi je suis genre le ciment qui les aide à rester ensemble. » (Jackson par rapport à ses deux « mères » lesbiennes, dans l’épisode 5 de la saison 1 de la série Sex Education (2019) de Laurie Nunn) ; etc.
Par exemple, dans le film « Stand » (2015) de Jonathan Taïeb, Anton et Vlad, pourtant en couple, ont une drôle de façon de se déclarer leur « amour »… Vlad fait un doigt d’honneur à Anton, en lui disant : « Ça, ça veut dire ‘Je t’aime’. Et mes deux doigts, ça veut dire ‘Je t’aime beaucoup’. ». Dans le film « Comme les autres » (2008) de Vincent Garenq, Manu et Philippe se parlent de manière très acerbe. Dans la B.D. Rocky & Hudson, les cowboys gays (2013) d’Adao Iturrusgarai, le duo Rocky/Hudson est un couple sans cesse en crise. Dans la pièce Dans la solitude des champs de coton (1985) de Bernard-Marie Koltès, l’échange entre les deux inconnus sur le lieu de drague est semi-violent, semi-séducteur. Dans la pièce Une Cigogne pour trois (2008) de Romuald Jankow, la relation entre Paul et Sébastien est tendue, d’où la remarque de Sébastien à Marie : « Tu verras, la vie à deux, c’est pas simple… ». Dans la pièce Gouttes dans l’océan (1997) de Rainer Werner Fassbinder, Léopold et Franz n’arrêtent pas de s’engueuler : Léopold est imbuvable, capricieux et méprisant, alors que Franz se montre faible, possessif et paranoïaque. Dans la série Y’a pas d’âge diffusée sur la chaîne France 2 le 15 octobre 2013, le couple homo Luc/Yoann (joué par Dany Boon) se disputer sans arrêt et perturbent leurs voisins par leur concert. Dans la pièce Mon frère en héritage (2013) de Didier Dahan et Alice Luce, Gabriel et Philippe n’arrêtent pas de s’engueuler, et à chaque fois qu’ils sont au bord de la rupture, Gabriel propose fiévreusement le PaCS ou le mariage pour colmater inefficacement les brèches. Dans le film « Cloudburst » (2011) de Thom Fitzgerald, Stella/Dotty vivent depuis 30 ans ensemble et pourtant elles se chamaillent continuellement. Dans la pièce Brigitte, directeur d’agence (2013) de Virginie Lemoine, Monsieur Alvarez (huissier) et Damien (le héros transgenre M to F, chef d’entreprise) se gueulent dessus et se mènent une guerre sans merci, avant de former un beau couple de travestis. Dans le film « Keep The Lights On » (2012) d’Ira Sachs, les scènes de ménage entre Paul et Erik sont monnaie courante, et Paul dit à Erik qu’« il lui gâche la vie ». Dans la pièce L’un dans l’autre (2015) de François Bondu et Thomas Angelvy, François et Thomas, les deux amants, n’arrêtent pas de se prendre le chou pour des « détails ».
Dans le film « I Love You Baby », Daniel et Marcos font un petit dîner en amoureux, mais se parlent pourtant super mal : l’un d’eux a oublié la pizza au four et se le voit reprocher ; l’autre finit par être agacé des inattentions et du manque de savoir-vivre de son compagnon. C’est sur ces petits détails de la vie quotidienne que le couple homosexuel se focalise pour ne pas à avoir à se reprocher l’essentiel : le manque d’amour dans leur relation amoureuse. Leur binôme ne fera pas long feu…
Dans la pièce On vous rappellera (2010) de François Rimbau, Lucie et Léonore, les deux héroïnes lesbiennes, se déchirent, se giflent, puis s’embrassent sur la bouche, le tout dans un même mouvement… comme si la violence était pour elles la preuve de l’intensité de leur amour, alors qu’en réalité, cette fougue ne vient que confirmer un amour basé prioritairement sur la pulsion.
Assez rapidement, pour faire écran à cette violence, le mensonge s’immisce souvent comme un fonctionnement conjugal normalisé dans les couples homosexuels fictionnels. Il semble être inclus dans le pack homosexuel : « Quiconque aime vraiment renonce à la sincérité. » (Édouard dans le roman Les Faux-Monnayeurs (1997) d’André Gide, p. 83) ; « Pour rester à deux, il faut savoir mentir, et je ne sais pas. » (Cédric à son amant Laurent, dans le téléfilm « Juste une question d’amour » (2000) de Christian Faure) ; « Je mens toujours à celui que j’aime. » (le transsexuel M to F du film « Tableau de famille » (2002) de Fernan Ozpetek) ; « Je tombe que sur des connards qui ne me racontent que des bobards. » (Stéphane en parlant de ses amants, dans la pièce Confidences (2008) de Florence Azémar) ; « J’aime la Vérité, mais la Vérité ne m’aime pas. […] Pourtant, je suis simple. Je déteste le mensonge. […] S’il m’arrive de mentir, c’est pour rendre service. » (Jean Cocteau cité dans le spectacle musical Un Mensonge qui dit toujours la vérité (2008) d’Hakim Bentchouala) Par exemple, dans le ballet Alas (2008) de Nacho Duato, le héros désire « mentir effrontément ». Dans le roman Les Julottes (2001) de Françoise Dorin, Dominique vénère « l’art du mensonge » (p. 86). Pensons également au film « L.I.E. » (2001) de Michael Cuesta.
Comme le mensonge crée évidemment un climat de paranoïa croissant, il arrive que l’agacement au sein du duo homosexuel fasse place aux menaces, ou bien que la passion homosexuelle transforme le héros homosexuel (ou son partenaire) en amant excessif, un brin psychopathe et violent : « Crois-moi, Erika est dangereuse. Il vaut mieux n’être que son amie. » (Melitta à Suzanne, dans le roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, p. 202) ; « Je vais te tuer. Je te hais. » (Petra à son amante Karin, dans le film « Die Bitteren Tränen Der Petra Von Kant », « Les Larmes amères de Petra von Kant » (1972) de Rainer Werner Fassbinder)
Dans le roman La meilleure part des hommes (2008) de Tristan Garcia, Willie est décrit par son copain Doumé comme « un manipulateur » qui peut « faire des coups de pute » (p. 79) ; d’ailleurs, la guerre que se lancent les deux anciens amants après leur rupture sera sans pitié. Dans le roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, quand Esti et Ronit se retrouvent toutes les deux pour la première fois dans un bosquet et qu’elles sont prêtes à se dire leur amour, Ronit dit à Esti qu’elle « a l’air d’un tueur en série » (p. 139).
L’amour homosexuel fictionnel s’annonce souvent par la voie de la terreur et de la peur : « Pour nous, les histoires d’amour finissent toujours mal. » (Piya, un transgenre M to F, dans le film « Satreelex, The Iron Ladies » (2003) de Yongyooth Thongkonthun) ; « Tu es vraiment fou. » (Ed s’adressant à Arnold dans le film « Torch Song Trilogy » (1989) de Paul Bogart) ; « Il l’attirait puissamment, il l’attira dès le premier instant, quand il avait entendu ses sanglots et deviné plus que perçu sa voix rauque, violente, et surtout quand il avait palpé sa peur. Il n’imaginait pas encore que cette peur était le signe qu’il se trouvait assurément en présence d’un homme nerveux, de ceux qui ne peuvent se contenir, d’un despote. En le consolant et en le veillant il ne savait pas avec qui il était, et quand il en prit conscience, il se dit que ça n’avait pas d’importance, que le jeune homme l’attirait précisément pour cela, pour ce qu’il était. » (cf. la nouvelle « Las Dos Prisiones De Víctor » (1986) d’Oscar Hermes Villordo, p. 251) ; « À pas de loup, j’aime quand vous me faîtes peur. » (cf. la chanson « Consentement » de Mylène Farmer) ; « Quand on aime, on est en danger. Moi, c’est ça qui me plaît. » (Yves Saint-Laurent séduisant Jacques, le copain de Karl Lagerfeld, dans la biopic « Yves Saint-Laurent » (2014) de Jalil Lespert) ; « La honte de dépendre à ce point d’un homme que je voudrais haïr me pétrifie. » (le narrateur homosexuel du roman La Peau des zèbres (1969) de Jean-Louis Bory, p. 16) ; « À ta place, j’aurais peur. » (Henry s’adressant à Franck par rapport à Michel, l’amant de ce dernier, dans le film « L’Inconnu du lac » (2012) d’Alain Guiraudie) ; etc. Dans le film « Ma mère préfère les femmes » (2001) d’Inés Paris et Daniela Fejerman, Sofía traite son amante Eliska de « tyran ». Dans le film « I Love You Phillip Morris » (2009) de Glenne Ficarra et John Requa, Steve en fait tellement trop pour se faire aimer de Phillip que ce dernier en est effrayé.
Dans le roman The Well Of Loneliness (Le Puits de solitude, 1928) de Marguerite Radclyffe Hall, la peur s’installe entre les deux amantes Stephen et Angela, et pas uniquement du côté de la victime « logique » (p. 189) :
Stephen – « J’ai peur maintenant… j’ai peur de vous.
Angela – Mais vous êtes plus forte que moi…
Stephen – Oui, c’est pourquoi j’ai si peur… vous me faites sentir ma force… »
Dans certaines fictions homosexuelles, le désir homosexuel est décrit comme un amour démoniaque, bestial, ou sorcier, une sauvagerie : cf. le roman Bestezuela De Amor (1909) d’Antonio de Hoyos, le roman policier Un Amour radioactif (2030) d’Antoine Chainas, le ballet L’Amour sorcier (1915) de Manuel de Falla (d’ailleurs, en 1933, le danseur Miguel de Molina, lui-même homosexuel, aura le rôle principal de ce spectacle), le film « La Beauté du diable » (1949) de Claude Autant-Lara, le titre du film « Love Is Strange » (2014) d’Ira Sachs, le recueil de poésies Sonnets de l’Amour obscur (1931) de Federico García Lorca, le roman Vincent Garbo (2010) de Quentin Lamotta, le roman Les Garçons sauvages (1971) de William S. Burroughs, la chanson « Cet air étrange » d’Étienne Daho, le film « The Wild Dogs » (2002) de Thom Fitzgerald, le film « Le Messie sauvage » (1972) de Ken Russell et Derek Jarman, le film « Wild Side » (2004) de Sébastien Lifshitz, le film « Alex Strangelove » (2018) de Craig Johnson, etc. « C’est l’amour sorcier. » (cf. la chanson « Kalinda de Luna » de Dalida) ; « Nous progressions au pas dans une forêt sauvage, silencieuse, menaçante, d’obscurs voyous dont nous ne voyions luire au feu des phares et des rares réverbères que les étranges diadèmes de rangées de dents d’ivoire et d’or en couronnes. » (cf. la nouvelle « Les Garçons danaïdes » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 101) ; « Succédant à la troupe humaine, une meute de chiens galopait à notre rencontre. Il était trop tard pour arrêter. » (idem) ; « Ce qui allait suivre était justifié. Logique. C’est la loi, il y a toujours qu’un seul gagnant. Ce qui allait venir, c’était de l’amour. L’amour aveugle, sans dieu ni mère pour le protéger. C’était de la guerre. Sans paroles. En dehors du monde. Au tout début. Au-delà de moi. Au-delà de Khalid. À travers nous deux, le combat primitif, innocent, sauvage, libre, recommençait. » (Omar parlant de son amant Khalid dans le roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, pp. 163-164) ; « Mon amour, mon ange noir, pardonne-moi. […] Je l’aimais Suki. Je l’aimais. » (Kanojo parlant à Juna, son amante qu’elle a tuée par un combat de magie, dans la pièce Gothic Lolitas (2014) de Delphine Thelliez) ; « Tu es envoûtée. » (Richard, le copain de Thérèse, l’héroïne lesbienne, lui reprochant de partir avec une femme, dans le film « Carol » (2016) de Todd Haynes) ; « Le charme est rompu. » (Lola, l’héroïne lesbienne s’adressant à son amante Vera à propos de leurs infidélités « extraconjugales », dans la pièce Géométrie du triangle isocèle (2016) de Franck d’Ascanio) ; etc. Dans le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta, Luther, l’amant de Denis, a pour parfum Eau sauvage de Christian Dior. Par rapport au film « The Long Day Closes » (« Une longue journée qui s’achève », 1991) de Terence Davies, le critique Pierre Philippe dit que le personnage de Bud, le héros homo, est un « garçon bâillonné par l’amour obscur qu’il porte en lui. » (cf. le catalogue du 19e Festival Chéries-Chéris au Forum des Images de Paris, en octobre 2013, p. 85) Dans le film « Toute première fois » (2015) de Noémie Saglio et Maxime Govare, Jérémie, pour se prouver qu’il est toujours homosexuel et qu’il a encore du désir pour son futur « mari », fait un play-back strip-tease sur « I Put A Spell On You ».
Le héros homosexuel est comme ensorcelé par un amant maléfique qui le maintient en soumission : « Depuis que je t’ai rencontré, je ne sais plus quel est mon nom, je ne sais plus où vont mes pas. Que m’as-tu fait ensorceleur ? » (Raulito s’adressant à son amant Cachafaz, dans la pièce Cachafaz (1993), pp. 20-21) ; « Derrière la porte, souriait de toutes sa nacre un garçon enjôleur que n’importe qui d’un peu novice aurait immanquablement trouvé joli. Laurent resta pétrifié sur le seuil de la porte. » (cf. la nouvelle « Cœur de Pierre », (2010) d’Essobal Lenoir, p. 47) ; « Je souffre de ne pas savoir quelle blessure vous me faites. » (le héros homosexuel à l’homme qui vient le draguer, dans la pièce Dans la solitude des champs de coton (2009) de Bernard-Marie Koltès) ; « C’était étrange, ta dépendance. » (Vincent s’adressant à son ex-amant Stéphane, très possessif, dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson) ; etc. Par exemple, dans le film « L’Objet de mon affection » (1998) de Nicholas Hytner, George continue d’aimer son ex, Joley, qui l’a trompé : « Pourtant, je sais que c’est un vrai connard. » Dans son one-man-show L’Arme de fraternité massive ! (2015), quand Pierre Fatus passe son stétoscope sur un des hémisphères de son cerveau, il entend une voix lui dire : « Il y a ici crime de sorcellerie ! »
On retrouve cette idée de dangerosité de la relation amoureuse homosexuelle dans le film « Más Que Amor, Frenesí » (1996) d’Alfonso Albacete et David Menkes, le film « Assassins » (1987) de Todd Haynes, le film « Je t’aime, je te tue » (1971) d’Uwe Brandner, la pièce Burlingue (2008) de Gérard Levoyer, le film « Tristesse et beauté » (1984) de Joy Fleury, le film « Reptile » (1970) de Joseph Mankiewicz, le film « Immacolata et Concetta » (1979) de Salvatore Piscicelli, le roman El Juego Del Mentiroso (1993) de Lluís Maria Todó, le film « Regarde la mer » (1996) de François Ozon, le film « Violence et passion » (1974) de Luchino Visconti, le film « Danse macabre » (1963) d’Antonio Margheriti, le film « Gouttes d’eau sur pierres brûlantes » (1999) de François Ozon, le film « Tiresia » (2002) de Bertrand Bonello, le film « A Cold Coming » (1992) de David Gadberry, la chanson « La Débâcle aux sentiments » de Stanislas Renoult, le film « Disons, un soir à dîner… » (1969) de Giuseppe Patroni Griffi, le film « Mulholland Drive » (2000) de David Lynch, le film « Hitcher » (1985) de Robert Harmon, le film « Caravaggio » (1986) de Derek Jarman, le film « Le Rempart des béguines » (1972) de Guy Casaril, le film « Duel au soleil » (1946) de King Vidor, la chanson « Duel au soleil » d’Étienne Daho, le film « Scacco Alla Regina » (1969) de Pasquale Festa Campanile, le film « Glissements progressifs du plaisir » (1974) d’Alain Robbe-Grillet, le film « Minuit dans le jardin du bien et du mal » (1997) de Clint Eastwood, le film « Ricochet » (1991) de Russell Mulcahy, le film « Soplo De Vida » (1999) de Luis Ospina (avec un travesti martyrisé par un flic corrompu qui n’est autre que son amant), le film « Angelos » (1982) de Yorgos Kataguzinos, le film « Love Is The Devil » (1997) de John Maybury, le film « Prick Up » (1987) de Stephen Frears, le film « Le Crime d’amour » (1981) de Guy Gilles, le film « Cours privé » (1986) de Pierre Granier-Deferre, la pièce Comme ils disent (2008) de Christophe Dauphin et Pascal Rocher (avec le couple cynique composé par David et Philibert), le film « Les Poupées russes » (2002) de Cédric Klapisch (avec les querelles interminables du couple lesbien), le film « La Ley Del Deseo » (« La Loi du désir », 1986) de Pedro Almodóvar (avec Pablo et Antonio vivant une relation passionnelle auto-destructrice), le recueil de poèmes La Destrucción O El Amor (1935) de Vicente Aleixandre, le film « La Fille aux yeux d’or » (1961) de Jean-Gabriel Albicocco (avec la lesbienne manipulatrice et jalouse qui tue la gentille Marie Laforêt), le film « Furyo » (1983) de Nagisa Oshima, la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Ceglia (racontant la liaison dangereuse entre deux voisins de pallier), le film « Esos Dos » (2012) de Javier de la Torre, etc.
Dans le film « Chloé » (2009) d’Atom Egoyan, Chloé s’insère de manière intrusive dans la vie de Catherine, une femme mariée avec qui elle a eu une liaison amoureuse de passage. Dans le film « Kaboom » (2010) de Gregg Araki, on retrouve la figure de la vénéneuse amante lesbienne dont on ne peut pas se défaire, à travers la relation de Stella et de la vampirisante Lorelei. Dans le roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami, Émilie devient « envahissante » (p. 29) avec son amante Gabrielle. Dans le film « Libertango » (2009) de Sara Hribar, il est question de la dangereuse interprétation entre amitié et amour : Tamara est épuisée par la possessivité de sa colocataire Julija. Dans le film « La Robe du soir » (2010) de Myriam Aziza, Juliette voue à sa prof de français Madame Solenska un amour-passion, idolâtre, jaloux, déconnecté du Réel, démesuré.
Dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, Kévin et Bryan, les deux amants qui disent pourtant s’aimer passionnément et continuellement, se traitent en réalité très mal. Ils se font des coups bas quand l’un d’eux chute, cherchent sans arrête à faire payer à leur partenaire leur propre insatisfaction de l’amour homosexuel. Il n’y a aucune place au pardon. Ils vivent un amour sans merci, sans compromis, qui mourra de sa « belle » mort : « Mon copain m’a fait un sale coup. Je voudrais me venger en te demandant de sortir avec moi pendant quelque temps. Je t’appelle parce que tu es le seul que je connaisse. On est bien d’accord, il ne s’agit que de faire semblant, juste pour le faire souffrir. […] Je veux qu’il comprenne le mal qu’il vient de me faire. » (Kévin s’adressant à Yohann, dans le roman pp. 257-258) ; « Moi aussi je t’aime, mais mon amour est destructeur, il est toujours négatif. » (Kévin à son amant Bryan, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 325) ; « À la seconde où je t’ai vu, j’ai compris que j’étais perdu d’avance et toi aussi ! » (Kévin à son amant Bryan, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 418)
Parfois, la peur se trouve expliquée par des actes. En effet, souvent, la violence et la maltraitance s’installent dans le couple homosexuel fictionnel : « Agathe et Lou s’aiment mais sont rongées par la violence de Lou au sein du couple. » (cf. le résumé du film « Agathe et Lou » (2013) de Noémie Fy, dans le catalogue du 19e Festival Chéries-Chéris au Forum des Images de Paris, en octobre 2013, p. 68) ; « Ça me fait du mal de vous voir vous déchirer comme ça. » (Laurent Spielvogel imitant un vieux pote gay du sud s’adressant à lui par rapport à son couple raté avec son amant Marco qui lui est infidèle, dans son one-man-show Les Bijoux de famille, 2015) ; etc.
Par exemple, dans le film « L’Homme blessé » (1983) de Patrice Chéreau, Henri, le protagoniste homo, frappe son client-amant dans une chambre d’hôtel alors qu’il lui avait fait croire au départ qu’il était un prostitué consentant. Dans le film « Ylan » (2008) de Bruno Rodriguez-Haney, Ylan a été jeté dehors par son copain. Dans la pièce La dernière danse (2011) d’Olivier Schmidt, Jack pointe le révolver sur son amant et l’embrasse une dernière fois, avant de retourne le révolver contre lui et de tirer.
Dans les créations homosexuelles, l’amour homosexuel est très souvent mis sous le signe de la trahison, de la vengeance, et parfois du meurtre : cf. le film « Honey Killer » (2013) d’Antony Hickling, le film « Love Kills » (2007) de Tor Iben, etc. Par exemple, dans le film « Vil Romance » (2009) de José Celestino Campusano, Raúl maltraite Roberto, son jeune amant. Le roman Ann Vickers (1933) de Dorothy Thompson relate l’histoire d’une femme qui est conduite au suicide à cause de sa liaison avec une lesbienne cruelle et possessive. Dans le film « Ostia » (1970) de Sergio Citti, Rabbino tue son amant Bandiera. Dans le film « Claude et Greta » (1969) de Max Pécas, Mathias tire sur son copain Jean et le blesse. Dans la pièce El Vals De Los Buitres (1996) d’Hugo Argüelles, alors que Lionel a une attaque cardiaque, son amant le pousse par la fenêtre. Dans le film « La Tendresse des loups » (1973) d’Ulli Lommel, Fritz Haarman tue ses amants. Même scénario dans le film « M le Maudit » (1931) de Fritz Lang. Dans la pièce Sud (1953) de Julien Green, le jeune lieutenant Ian Wiczewski se fait volontairement tuer en duel par l’homme qu’il aime, le jeune Marc Clure, qui le transperce de son sabre. Dans le film « L’Homme blessé » (1983) de Patrice Chéreau, Henri tue son amant après lui avoir fait « l’amour ». Dans le roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, Erika, par jalousie, tire un coup de revolver sur sa copine Héloïse. Dans le film « Shower » (2012) de Christian K. Norvalls, le héros homo fracasse à mort le crâne du mec qu’il vient d’embrasser sur la bouche dans un vestiaire de douches. Dans le film « Maurice » (1987) de James Ivory, Scuder est l’homosexuel homophobe qui fait « chanter » son amant Maurice. Dans le roman Un Garçon près de la rivière (1948) de Gore Vidal, les amants vivent un amour orageux : Jim Willard tue son ami Bob. Dans le film « Él Y Él » (1980) d’Eduardo Manzanos, un jeune homme se réveille nu à côté d’un homme un lendemain de fêtes et décide de le tuer. Dans le one-man-show Un Barbu sur le net (2007) de Louis Julien, Eugène est emprisonné pour tentative de meurtre sur son petit copain « Gégé », et Stéphane tue son amant Jean-Jacques avec un marteau. Dans le roman Parloir (2002) de Christian Giudicelli, David est poignardé par Kamel, le héros homosexuel. Dans le roman Le Garçon sur la colline (1980) de Claude Brami, Pascal tire au fusil de chasse sur son amant Pierre. Dans la pièce Big Shoot (2008) de Koffi Kwahulé, le héros tue son amant Stan au revolver. Dans le roman The Well Of Loneliness (Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, la lesbienne Valérie Seymour a noyé sa compagne Polinska dans une grotte bleue de Capri. Dans la pièce Hétéro (2014) de Denis Lachaud, Gatal et son fiancé s’engueulent fort, et Gatal finit par le tuer en l’étouffant.
Non, vous ne rêvez pas ! Beaucoup d’amants homosexuels fictionnels s’entretuent sur nos écrans (y compris dans des films intentionnellement pro-gays et récents ! Un comble…) : « On vivait sur un bateau ivre. Puis la violence est arrivée. On se frappait. » (Florence en parlant de son couple avec Hélène, dans la pièce Confidences (2008) de Florence Azémar) ; « Dieu, c’est trop terrible d’aimer ainsi… c’est l’enfer… il y a des moments où je ne puis plus le supporter ! » (Stephen, l’héroïne lesbienne du roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 484) ; « Quand je suis avec une femme, je deviens une bête, un monstre. » (Florence la lesbienne dans la pièce Confidences (2008) de Florence Azémar) ; « Chacun tue l’objet de son amour. » (Oscar Wilde, Ballade de la geôle de Reading (1898), cité dans le Magazine littéraire, n°343, mai 1996, p. 17) ; « Chacun tue ce qu’il aime. » (Texor Textel dans le roman Cosmétique de l’ennemi (2001) d’Amélie Nothomb) ; « Je t’aime je t’admire je t’adore, je te tue. » (Alice à Elsa dans le film « Alice » (2004) de Sylvie Ballyot) ; « Je te tuerai si tu me le permets. […] Plus j’aime quelqu’un, plus j’ai envie de le tuer. » (Ada à son amante Cherry, dans la pièce La Star des oublis (2009) d’Ivane Daoudi) ; « Moi, c’est parce que je t’aime que je veux te tuer. » (Cherry à Ada, idem) ; « ‘Moi chais même pas si je vais pleurer pour [ma rupture avec] Claude, minaude Polly [l’héroïne lesbienne parlant de son amante], elle a un égo qui me bouffe tellement la vie que parfois j’ai envie de la buter !’ Cody [le pote gay nord-américain] me demande ce que ‘buter’ veut dire, je réponds ‘faire l’amour avec tellement de force que les gens en meurent’. Il répond qu’il veut que Nourdine [l’objet de fantasme de Cody] le bute, ça me fait rire. » (Mike, le narrateur homosexuel du roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 113) ; etc.
Souvent, le héros a des envies de meurtre par rapport à son amant… : « Je te pousserai de la falaise. » (Hervé Nahel) Dans le one-man-show Hétéro-Kit (2011) de Yann Mercanton, François rêve que son compagnon s’étouffe au hot-dog. Dans la pièce Copains navrants (2011) de Patrick Hernandez, Stéphane conseille à son pote Vivien de mettre son « mari » Norbert au congélateur pour s’en débarrasser. Dans le film « Nettoyage à sec » (1997) d’Anne Fontaine, Jean-Marie se fait sodomiser par le beau et provoquant Loïc dans le sous-sol de son pressing, avant de lui coller le fer à repasser brûlant sur la figure et de le tuer en le jetant violemment par terre. Dans le film « The Talented Mister Ripley » (« Le Talentueux M. Ripley », 1999) d’Anthony Minghella, Tom, le héros homosexuel, est presque étranglé à mort par Dick, l’homme qu’il aime, sur un bateau. Cela s’achève en crime passionnel remporté par Tom.
Dans le roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, l’amour entre Omar et Khalid est à couteaux tirés. C’est la passion et la stratégie conquérante qui régissent leur relation. « Il est terrible, ce jeu, Khalid. Tu es impitoyable. » (Omar à Khalid, p. 111) ; « Je vais me venger de tout le mal que tu me fais. » (idem, p. 119) Les amants s’adulent et se méprisent dans un même mouvement de recherche de vie par procuration : « Le combat, pour de faux, pour de vrai, a repris. La transformation aussi. L’échange de prénoms. Un film de science-fiction marocain. » (idem, p. 140) Pour survivre, Omar finit par pousser mortellement Khalid, avec le consentement de ce dernier, dans un fleuve. « Ce qui allait suivre était justifié. Logique. C’est la loi, il y a toujours qu’un seul gagnant. Ce qui allait venir, c’était de l’amour. L’amour aveugle, sans dieu ni mère pour le protéger. C’était de la guerre. Sans paroles. En dehors du monde. Au tout début. Au-delà de moi. Au-delà de Khalid. À travers nous deux, le combat primitif, innocent, sauvage, libre, recommençait. » (Omar, idem, pp. 163-164)
Dans bien des créations homo-érotiques, les amants homosexuels se donnent la mort par strangulation (je vous renvoie au code « Coït homosexuel = viol » dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels) : cf. le film « Le Détective » (1968) de Gordon Douglas, le film « La Clé de verre » (1942) de Stuart Heisler, le film « Strangers On A Train » (« L’Inconnu du Nord-Express », 1951) d’Alfred Hitchcock, le film « Voodoo Island » (1957) de Reginald Le Borg, le film « El Mar » (2000) d’Agusti Villaronga, le roman Querelle de Brest (1947) de Jean Genet, le film « L’Étrangleur » (1970) de Paul Vecchiali (avec Marcel Gassouk), le film « L’Étrangleur de Boston » (1968) de Richard Fleischer, le film « Je vois déjà le titre » (1999) de Martial Fougeron, le film « L’Homme blessé » (1983) de Patrice Chéreau, le roman La Meilleure part des hommes (2008) de Tristan Garcia, la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1986) de Copi (avec Madame Lucienne étranglée d’une seule main), le film « New Wave » (2008) de Gaël Morel, le film « L’Étrangleur » (1970) de Paul Vecchiali, le film « Je vois déjà le titre » (1999) de Martial Fougeron ; etc. « Tu m’as étranglée. » (Joséphine à Fougère dans la pièce Les Quatre Jumelles (1973) de Copi) ; « Adam introduisant son membre urino-reproducteur dans le derrière d’un canard tandis qu’il l’étranglait. » (Copi, La Cité des Rats (1979), p. 88) ; « Cinq autres [hommes] s’emparèrent de l’albatros pour lui enfoncer une bouteille de bière dans l’anus tout en l’étranglant. » (idem, p. 139) ; « Je pourrais t’étrangler. » (Cherry à son amante Ada, dans la pièce La Star des oublis (2009) d’Ivane Daoudi) ; « Aïe ! Aïe ! Aïe ! Vous m’étranglez ! » (Pédé se faisant enculer par le travesti M to F Fifi, dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; etc. Dans le film « Hôtel Woodstock » (2009) d’Ang Lee, Wilma, le flic travelo M to F, aurait tué son amant par strangulation. Dans la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi, Luc essaie de noyer son amant Jean sous la douche, après l’amour. Dans le roman Dix Petits Phoques (2003) de Jean-Paul Tapie, Rémi finit par étrangler son amant Steve. Dans la pièce Ma double vie (2009) de Stéphane Mitchell, Tania, l’héroïne lesbienne, est soupçonnée d’avoir étranglé Léa au judo.
Les liaisons dangereuses homosexuelles fictionnelles se choisissent souvent pour cadres le milieu de la drague homo classique ou bien le milieu de la prostitution. Par exemple, dans le film « L’Immeuble Yacoubian » (2006) de Marwan Hamed, un homosexuel se paie les service d’un jeune homme marié qui se prostitue et se retourne contre lui. Dans le film « Morrer Como Um Homem » (« Mourir comme un homme », 2009) de João Pedro Rodrigues, Tonia Cardoso, le héros transsexuel M to F, tue son amant en lui tirant dessus.
La violence dans le couple homosexuel ne vient pas tant des partenaires pris individuellement, que du couple et de l’acte homosexuels. Le héros, en même temps qu’il trouve en l’amant le sexe et la tendresse qui apaisent pour un temps ses besoins « naturels », se voit aussi fatalement inculpé par la sexuation gémellaire de son compagnon en tant qu’homosexuel (et oui : pour former un couple homosexuel, il faut être deux hommes, ou deux femmes, et agir homosexuellement !), et cela lui est parfois insupportable. Par exemple, dans le film « Contracorriente » (2011) de Javier Fuentes-León, Miguel est attiré autant que rebuté par Santiago, qui lui révèle son homosexualité (il ne supporte pas d’entendre de son compagnon qu’il a joui d’avoir été dominé par un homme pendant leur coït) : Santiago finira par se suicider. Dans le film « Gun Hill Road » (2011) de Rashaad Ernesto Green, le copain de Michael ne veut pas que leur relation sexuelle soit rendue visible socialement, car il n’assume pas son copain ni sa propre homosexualité. Beaucoup de héros homosexuels s’auto-détruisent ou bien détruisent leur copain du fait de mal gérer les paradoxes du désir idolâtre (pour et contre lui-même) qu’est le désir homosexuel : cf. le film « Verde Verde » (2012) d’Enrique Pineda Barnet.
c) Le paradoxe du libertin, à la fois ascétique et obsédé par le sexe, tout cela à cause de sa sincérité :
c) 1) Pseudo-ascèse :
Aussi bizarre que cela puisse paraître, les Valmont et Merteuil homosexuels des fictions, même s’ils agissent pour détruire et multiplient les conquêtes sexuelles, sont tellement obsédés par leur image (et donc leurs intentions), qu’ils veulent se persuader qu’ils sont encore purs et ascétiques après la débauche. Ils ont une réputation à parfaire ! « J’aime plusieurs personnes. Je ne parle pas de mon homosexualité mais de mon appétit sexuel… et je ne suis pas un libertin ! » (Larry, le héro homosexuel prônant l’infidélité alors qu’il est en couple avec Hank, dans le film « The Boys In The Band », « Les Garçons de la bande » (1970) de William Friedkin) ; « Je ne coucherai jamais plus avec quelqu’un ! » (le jeune Danny après sa nuit de sexe homo ratée, dans le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza) ; « Le sexe est une véritable source d’emmerdements. » (Lola, l’héroïne lesbienne dans la pièce Géométrie du triangle isocèle (2016) de Franck d’Ascanio) ; etc. Je vous renvoie au film « Vices privés, vertus publiques » (1976) de Miklos Jancso, au film « Ascetic : Woman And Woman » (1976) de Kim Shu-hyeong, à la chanson « Sextonik » de Mylène Farmer, au roman Le Bal des Folles (1977) de Copi (ou Marilyn-Garbo est décrite comme « impénétrable », p. 52), etc.
Par exemple, dans le film « Imagine You And Me » (2005) d’Ol Parker, Luce, l’héroïne lesbienne, utilise l’amitié pour fuir sa vie, et s’appuie sur celle-ci pour justifier que l’amour serait platonique et asexué. « Tu ne baises jamais. » remarque sa pote lesbienne Eddie. Luce lui répond vertement : « J’ai des amis. Ça me suffit amplement. » Dans le film « Que Viva Eisenstein ! » (2015) de Peter Greenaway, Sergueï Eisenstein, homosexuel, est présenté comme la sublime allégorie de « la frustration sexuelle sublimée ». Et en effet, son ascétisme, portée aux nues, n’est que le reflet de sa peur de lui-même : « Je dois peut-être m’initier au sexe où que ce soit. »
Ils sont en réalité des caricatures de continents. Des frustrés enchaînés à la luxure parce qu’ils diabolisent la frustration et ne la tolèrent pas de temps en temps, parce qu’ils sont terrorisés par la génitalité (même s’ils s’en goinfrent) : « Dans le fond, elle sent bien qu’elle est complètement inhibée avec le cul. » (Mike, le héros homo parlant de Polly son amie lesbienne, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 74) ; « Sur les marches qui mènent aux chiottes de la gare du Nord, je rencontre H. Il a un air triste, sa tête retenue sur ses deux mains emballées dans deux gros gants de ski, assis sur les marches. Je passe deux fois devant lui. Une première fois en allant aux pissotières. De l’ouverture à la fermeture de la gare, y a des hommes, de tous âges, de toutes origines qui se branlent lamentablement, debout, dans l’odeur de pisse et de foutre, en matant en coin les bites des autres. On dirait des puceaux, aussi fébriles que surexcités. Venir ici me désespère autant que ça me réjouit. » (Mike, le narrateur homo du roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 59)
L’ascétisme est un fantasme fort chez le libertin homosexuel. « Je crois que je ne suis pas faite pour le mariage. » (Isabelle, l’héroïne bisexuelle du film « Portrait de femme » (1996) de Jane Campion) ; « C’est bien fini, tout ça. Les aventures. Les garçons. Je me demande si je suis fait pour la vie de couple. » (Vincent, le héros homosexuel, dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson) ; etc. Par exemple, dans le film « La Reine Christine » (1933) de Rouben Mamoulian, Greta Garbo – la fameuse icône lesbienne – se prend pour la vierge et héroïque Marquise de Merteuil, qui n’aurait besoin de personne dans sa vie pour se suffire à elle-même : « Je mourrai célibataire ! » dit-elle dans un éclat de rire.
Surtout depuis les années 1970, le héros homosexuel a tendance ne pas se définir comme un homosexuel mais plutôt comme un homosensuel, un amoureux, un pur esprit artistique. Il n’aime pas dans le mot « homosexualité » le terme « sexualité » : il le trouve réducteur, trop génital, trop sale. Pour lui, dans l’amour homosexuel, seuls comptent les sentiments, la force de la passion, la tendresse, la sensation, la « douceur ». « Nous appartenons à la race d’Eros. » (le Coryphée dans la pièce Les Oiseaux (2010) d’Alfredo Arias) En revanche, il ne fait presque jamais allusion à ses actes. Il préfère montrer le visage du self control. « Je refuse d’être à la merci de mes émotions. » (Dorian Gray dans le roman Le Portrait de Dorian Gray (1890) d’Oscar Wilde) Le substantif « dragueur » ou le verbe « draguer » sont pour cette vierge effarouchée des gros mots ! « Je ne me souviens pas de t’avoir dragué. » (Denis s’adressant à son amant Luther, le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta) ; « Pourtant, j’ai pas du tout envie de coucher avec toi. […] Je me demande s’il faut baiser avec quelqu’un pour dormir avec. » (Michel s’adressant à son amant Franck dont il est pourtant amoureux, dans le film « L’Inconnu du lac » (2012) d’Alain Guiraudie) ; « Moi, je drague pas. » (Henry s’adressant à Franck qu’il aime en secret, idem) ; « Je suis désolé… Vous ne me connaissez pas… » (le beau Ian s’excusant d’adresser la parole au « déjà maqué » George, en lui proposant de sortir de la fête où ils se sont rencontrés, pour faire plus ample connaissance, dans le film « Love Is Strange » (2014) d’Ira Sachs ; en plus, George lui dit qu’il est « un bourreau des cœurs » et donc se montre célibataire) ; etc.
Le libertin homosexuel ne supporte pas la vulgarité et la trivialité (qui sont bien souvent réductibles dans son esprit aux mots « coït », « couple » ou « mariage »). Même si, en actes, il est aussi enchaîné à ses pulsions que le « beauf », il s’évertue à faire de l’esthétisme sa caution morale, en se présentant comme un homme plus raffiné/cool que lesdits « raffinés » : « J’ai la faiblesse de penser que nos dialogues valent mieux que les conversations de salon. » (la figure de Proust à Vincent, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 165). Il joue la comédie de la surprise : « Et ne croyez pas que, d’ordinaire, je sois sujette à ces sortes d’emballements. Pour moi comme pour vous, sans doute, c’est une première fois. Il me faut, il nous faut l’accepter. » (Émilie s’adressant à son amante Gabrielle, dans le roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami, p. 69) ; etc. Il feint de se surprendre lui-même, comme s’il n’avait rien maîtrisé de ses sentiments, comme s’il se retrouvait à poil devant son amant « par accident » ou « par la force de l’amour vainqueur » (genre « Je ne suis pas une fille facile ») : « J’ai pas l’habitude de coucher comme ça avec un inconnu… » (Matthieu, après avoir trompé son copain Jonathan alors qu’il l’idéalisait, dans la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H.) ; « Il faut que tu saches que d’habitude, les choses vont moins vite. » (Romeo au lit avec Johnny, avec qui il a passé juste trois soirées, dans le film « Children Of God », « Enfants de Dieu » (2011) de Kareem J. Mortimer) ; etc. Par exemple, dans la pièce Gouttes dans l’océan (1997) de Rainer Werner Fassbinder, le jeune Franz (20 ans) a suivi un inconnu de 15 ans de plus que lui, Léopold, qui l’a amené chez lui ; et là, il fait sa grande folle perdue pour ne pas assumer sa drague : « Je ne sais pas pourquoi je suis ici… Vous m’avez pris de court… » Dans le film « The Boys In The Band » (« Les Garçons de la bande », 1970) de William Friedkin, Larry est un vrai coureur, mais il trouve quand même le moyen de dire qu’« il n’est pas un libertin » et qu’il trompe son amant Hank de manière propre. Dans le film « L’Art de la fugue » (2014) de Brice Cauvin, on nous montre que Antoine et Alexis, les deux personnages en couple homo chacun de leur côté, ont dormi ensemble mais séparément (Alexis dort sur le canapé)… comme pour nous prouver que leur histoire d’infidélité est chaste et ne serait pas que sexuelle (alors qu’à un autre moment du film, Antoine avoue quand même que leur relation, « c’est que pour le sexe. »). Le héros homosexuel (et spécialement celui dont la chair est faible) a la préciosité de dire que l’important, par-delà les corps, c’est quand même la beauté intérieure : « L’attirance, ce n’est pas seulement celle des corps. » (Stéphane, le romancier bobo enchaînant les aventures sexuelles avec les jeunes et jolis garçons, dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson)
En général, cet hypocrite de compétition flatte sa proie amoureuse dont il veut s’attirer les faveurs, et qu’il rêve de « sauter » en lui faisant croire en son/leur exceptionnalité. « Putain mais tu crois pas qu’on vaut mieux que ça, franchement, se renifler le cul et baiser comme des chiens dans la rue et se barrer comme si on ne s’était jamais connu, avec l’odeur de l’autre sur la queue, sur le cul, sur la gueule, sur les mains. » (Mike s’adressant à « H. » qu’il rencontre sur un lieu de drague à la gare du Nord, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 60)
Dans le refus intellectuel du libertinage et le discours pro-ascèse du héros homosexuel, on voit apparaître un diabolisation de la sexualité dans son sens large, un dégoût pour la différence des sexes et la réalité de la sexuation, un déni de ses relations amoureuses et génitales, une homophobie latente : « Je n’ai pas cette nature qu’ont certains homosexuels, parmi ceux que j’ai rencontrés, de n’écouter que leurs instincts, quitte à briser l’union, parfois ancienne, de couples amis. » (le narrateur homosexuel – « queutard raffiné » – du roman L’Amant de mon père (2000) d’Albert Russo, p. 94) ; « Et Adrien était là aussi [sur la Place Dauphine, lieu de prostitution]. Adrien faisait comme eux. Il était l’un d’eux. Il en éprouvait de la honte. Comment lui, le prêtre, pouvait-il être impliqué dans ce vil commerce des corps, côtoyer ces êtres en manque de chair, se mettre en chasse comme eux ? » (le héros homosexuel du roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, p. 27) ; « J’pratique le non-sexe. » (Alice dans le film « Les Chansons d’amour » (2007) de Christophe Honoré) ; « On s’en fout du sexe. » (Brad dans la pièce Jerk (2008) de Dennis Cooper) ; « Je suis surtout un petit être contrôlé qui se laisse rarement emporter par ses coups de cœur ou ses coups de tête. » (Jean-Marc dans le roman Le Cœur éclaté (1989) de Michel Tremblay, p. 32) ; « J’veux pas jouir. Je veux toujours me retenir. » (Anne Cadilhac, Tirez sur la pianiste, 2011) ; « Mais n’allez pas penser que je m’enflamme toujours de la sorte pour le premier venu. » (la figure de Proust s’adressant à son amant Vincent, dans le roman En l’absence des hommes (2001) de Philippe Besson, p. 130) ; etc.
Il y a chez le libertin homosexuel un mépris des sentiments (Valmont et Merteuil, dans les Liaisons dangereuses, se rient justement de ceux qu’ils appellent « les sentimentaires », ceux qui ont la naïveté de croire en l’amour et de se laisser aller à leurs sentiments), parce qu’il en est justement trop dépendant, et qu’il est au fond un cœur d’artichaut déçu. C’est bien parce qu’il est romantique qu’il devient un vrai serial baiseur désinvolte : « Je dus lui dire au revoir, sans pouvoir la serrer dans mes bras ni lui confier les sentiments, assez ridicules d’ailleurs, que j’avais pour elle. » (Alexandra par rapport à sa cousine-amante avec qui elle a couchée, la narratrice lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 69) ; « Je sens en moi une poussée d’un romantisme assez pitoyable qui inspire tous les mots que j’écris et qui ferait fuir n’importe qui… » (idem, p. 76) ; « Je ne suis ni possessive ni jalouse en rien, c’est ma nature. » (idem, p. 97) ; « En rentrant, je retrouvai Marie à la cuisine. Elle me donna tout ce qu’elle pouvait de passion, mais j’ai bien senti, depuis l’autre nuit, qu’elle ne sait aimer qu’avec son cœur. Pour les émois du corps cela ne me suffira pas longtemps. » (idem, p. 206) ; « Il a très peu de gestes d’affection avec moi. Tous ces gestes qui font un peu pitié. » (Benjamin s’adressant à son psy par rapport à son amant Arnaud, dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit) ; etc.
Pour le libertin homosexuel, aimer est une maladie, une attitude hystérique de fan : « Je veux sortir du lot, que Mathilde remarque mon amour d’elle, sobre, à l’opposé d’un comportement de fan exubérante. […] J’avais l’air ridicule de la guetter comme un vulgaire paparazzi. » (la narratrice lesbienne du roman Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train (2005) de Cy Jung, p. 129) ; « Je me demandais si je n’étais pas folle d’éprouver de telles sensations, si les élans irrépressibles qui me poussaient n’étaient pas les manifestations d’une maladie. » (Alexandra, la narratrice lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 65) ; « C’est effrayant d’être attiré par le bonheur. » (Anthony, l’un des héros homosexuels du roman At Swim, Two Boys, Deux garçons, la mer (2001) de Jamie O’Neill) ; etc. Il surveille scrupuleusement ses accès de fanatisme : « Il fallait que je me prenne en main si je ne voulais pas devenir un de ces fanatiques névrosés qui poursuivent leur idole avec un acharnement maniaque et parfois dangereux. » (idem, p. 255) ; « J’danse pour me guérir d’aimer. » (cf. la chanson « Dans ma bulle antisismique » de Mélissa Mars) Il considère l’amour comme un terrible virus qu’il va pouvoir refiler à son compagnon pour tomber avec lui dans le précipice : « Je ne cesse de vous écrire dans ma tête. C’est comme une maladie, une douce maladie. Il y a des douleurs qu’on dit exquises. » (Émilie à son amante Gabrielle, dans le roman Je vous écris comme je vous aime (2006) d’Élisabeth Brami, p. 18) ; « J’aimerais tellement que vous soyez atteinte du même mal que moi ! » (idem, p. 72) ; « Ah, si seulement vous étiez malade de la même maladie que moi ! » (idem, p. 152) Être malade d’amour peut être pourtant chez lui un souhait caché : « Je me rendis compte que je n’avais pas pensé à Mathieu depuis presque 24h et, au lieu d’en être soulagé, j’eus peur. Guérir, oui, absolument, mais pas trop vite, quand même ! » (Jean-Marc dans le roman Le Cœur éclaté (1989) de Michel Tremblay, p. 178) ; « On se refile l’amour comme une épidémie. » (Mathan dans la pièce Un Cœur en herbe (2010) de Christophe et Stéphane Botti) ; « Me mange pas. Tu vas être malade. » (Shirley Souagnon se décrivant comme un « yaourt périmé » face aux hommes, dans son concert Free : The One Woman Funky Show, 2014) ; etc.
Malgré l’enchaînement pathétique de ses conquêtes et de ses échecs amoureux, le personnage homosexuel libertin arrive encore à se trouver héroïque d’être de temps en temps patient, sobre et dans la retenue… le temps d’une soirée ou d’une première rencontre, quoi (« On n’a pas couché le premier soir [… juste le troisième] ») : « On était si bien finalement à se caresser tendrement la nuit durant, sans éprouver le besoin de pénétrer à tout prix. » (le narrateur homosexuel de la nouvelle « Cœur de Pierre » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 50) ; « Il [Simon] bande. J’embrasse son front, il s’endort. » (Mike, le narrateur homosexuel dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 33) ; etc. En théorie, il ne veut pas « du cul », lui : il veut juste des câlins. Il ne veut pas brusquer : il dit qu’il prendra son temps. Il ne veut pas dire « je t’aime » trop vite ni s’engager : ça, c’est bon pour les adolescents, les jaloux et les possessifs. Lui, il est dans la gratuité qui ressemble à une molle contemplation du vide.
Le libertin homosexuel s’oblige à ne pas faire étalage de sa fragilité quand il tombe amoureux. La défaillance est, pour lui, une terrible trahison à lui-même… et la monstration de la fausse retenue de sa défaillance une preuve de la vérité/victoire de ses pulsions ! : « Bien sûr, au début, elle [Gabrielle, l’héroïne lesbienne] a tout essayé pour ne pas se laisser dominer par ses émotions. Elle, la dame de Bois-Rouge, l’héritière en titre d’un siècle d’industrie sucrière et d’humanisme chrétien, elle, dont la poigne de fer a su redresser l’exploitation en péril tout en prodiguant justice et bonté, jamais elle n’a toléré jouer les midinettes, les fleurs bleues. De la tenue, que diable ! De la pudeur et de la discrétion avant tout ! […] Et pourtant, voilà qu’aujourd’hui, arrivée à la fin de sa vie, ses beaux principes viennent de voler en éclats. […] Assaillie de pensées contradictoires, elle va comme à son habitude se verser un demi-verre de whisky. » (Élisabeth Brami, Je vous écris comme je vous aime (2006), pp. 14-15) ; « Non, elle ne se laissera pas ligoter au piège passionné de cette inconnue [Émilie, son amante] ! » (idem, p. 24) ; « C’est plus fort qu’elle, cette façon de couper court aux effusions pleurnichardes, de mentir à son cœur morfondu, de s’interdire tout amour. » (idem, pp. 42-43) ; « Cette impérieuse envie de fuguer qui la reprend à quatre-vingts ans. Grotesque ! » (idem, p. 77) ; « Faire court. Moins lyrique. Moins grandiloquent. Moins ridicule. Elle ne se pardonne pas les fadaises qu’elle lit sous sa plume. » (idem) ; « Elle en rougit encore. Comme du mot ‘amour’, qu’elle s’est si longtemps interdit de prononcer. » (idem, p. 126) ; « Devrais-je assumer le mot ‘amour’ et aujourd’hui, à plus de cinquante ans, me risquer à l’impudeur d’un exercice de sincérité dangereux ? » (Émilie à Gabrielle, idem, p. 147) ; etc.
Et je crois en effet que le désir homosexuel est un amour qui a honte de lui-même, de sa prétention à l’Amour et à la Vérité : « J’ai besoin d’avoir cette femme pour me sauver du ridicule d’en être amoureux. » (Valmont au sujet de Madame de Tourvel, dans la Lettre IV des Liaisons dangereuses (1782) de Pierre de Choderlos de Laclos)
c) 2) Le libertinage au nom des bonnes intentions :
La comédie de l’ascétisme et du raffinement ne dure généralement pas longtemps chez le libertin homosexuel fictionnel. Elle n’est qu’un vernis qu’il applique sur ses actions pour s’auto-persuader qu’il « agit mal mais quand même pas aussi mal que les autres ». « Fi de l’ascèse ! Ma vie s’enténèbre. Moi sans la langue, sans sexe je m’exsangue. » (cf. la chanson « L’amour n’est rien » de Mylène Farmer) ; « On n’est pas raisonnables, ni toi ni moi. […] On s’entend bien toi et moi dans un lit. On s’entend même mieux dans un lit qu’en dehors. » (Vincent ayant recouché avec son « ex » Stéphane pour une nuit, dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson) ; « Il faut bien connaître le sexe pour devenir ensuite anti-sexe. » (une réplique de la pièce My Scum (2008) de Stanislas Briche) ; « À cet instant, je compris que ma nature ‘romantique’ me porterait naturellement à toutes les cruautés et que, de toutes celles qui existaient, contrairement à ce que l’on pensait, elle était parmi les plus redoutables, puisqu’en exagérant tout de sentiments elle rendait l’être humain capable de passer du plus grand des attachements à la plus grande indifférence. » (Alexandra, la narratrice lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 50) ; « Évidemment, il prétend qu’il y va rarement, mais il passe sa vie dans des boîtes à cul. J’ai jamais rencontré de pédé aussi pudique sur sa pratique sexuelle. » (Polly, l’héroïne lesbienne par rapport à son meilleur ami homo Simon, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 28) ; etc. Je vous renvoie au film « Je suis une nymphomane » (1970) de Max Pécas, à la chanson « Nympho-man » de Catherine Lara, le one-man-show Raphaël Beaumont vous invite à ses funérailles (2011) de Raphaël Beaumont (avec le châtelain précieux organisant des parties SM dans son manoir), etc.
Derrière l’ascétique Merteuil se cache la « bite sur pattes » de Valmont. Et inversement : derrière le gogo dancer se cache un grand idéaliste, un esthète qui se croit sobre et sincèrement aimant, un être sensible qui recherche la pureté dans la débauche. Le désir homosexuel fonctionne en dents de scie parce qu’il est écartelé entre intentions et Réalité. C’est pourquoi on retrouve dans les fictions certains personnages homosexuels qui oscillent schizophréniquement d’une vie monacale à une forte activité sexuelle, parfois même prostitutive. Par exemple, dans le film « Une chose très naturelle » (1973) de Christopher Larkin, David, le séminariste défroqué, finit par « se lâcher » sexuellement après une soi-disant « longue et coûteuse » ascèse. Dans la pièce Parfums d’intimité (2008) de Michel Tremblay, le couple homosexuel composé de l’intellectuel (Jean-Marc) et du « queutard » (Luc) symbolise à lui seul le paradoxe du libertin. Dans le film « Little Lies » (2012) de Keith Adam Johnson, Phillip tombe amoureux d’un escort boy. Dans le film « Esos Dos » (2012) de Javier de la Torre, on nous fait croire que l’amour peut naître dans une backroom, à travers la monstration de la tristesse et la compassion du client (Rubén) face au prostitué (Eloy) qui se gâche. Dans le film « Keep The Lights On » (2012) d’Ira Sachs, idem : les deux amants Paul et Erik s’auto-persuadent pendant 9 années de vie commune (souffrants et chaotiques) que le « plan cul » internet qui les a réunis initialement était « bien plus qu’un plan cul ». Dans le film « Mezzanotte » (2014) de Sebastiano Riso, Davide sauve son amant qu’il trouve dans le monde de la prostitution dans lequel tous deux évoluent.
Le libertin homosexuel insiste beaucoup trop sur son « désir d’aimer » pour aimer véritablement en acte : « Je ne sais pas, fit Jason, en acceptant de croiser le regard de Mourad et de le soutenir. Je crois que je ne crois plus en rien. Et en même temps, je crois que j’ai envie de croire. […] J’ai envie de croire à l’amour, fit-il enfin, en essuyant ses joues d’un revers de main. » (Jason, le héros homosexuel du roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 357) ; « J’ai dans mon autre moi un désir d’aimer, comme un bouclier. » (cf. la chanson « Tous ces combats » de Mylène Farmer) ; etc.
Dans la démarche nostalgique du libertin homosexuel, on ne lit pas que de la mélancolie laconique, ou une contemplation morbide de soi, mais aussi un contentement narcissique et « optimiste », une sorte de « Malgré tout, j’ai aimé… » qui maintient despotiquement l’amant dans la carte postale : « J’ai rêvé qu’on pouvait s’aimer. » (cf. la chanson « Rêver » de Mylène Farmer) ; « On n’a pas couché ensemble. On a fait l’amour. […] J’ai pas couché avec Quentin. Je l’ai aimé. » (Jules en parlant de son histoire avec Quentin, dans la pièce Les Sex Friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau)
Il y a dans l’amour homosexuel un paradoxe entre fond et forme, entre désir et acte, entre sincérité et Vérité, qu’on peut observer dans la société toute entière avec les « injonctions paradoxales », énoncées par exemple dans les publicités ou les slogans politiques (« Il est interdit d’interdire ! » ; « Silence !!! » ; « Sois tolérant ! », etc.). Par exemple, dans la comédie musicale Se Dice De Mí En Buenos Aires (2010) de Stéphan Druet, Álvaro dit « Je t’aime » à Octavia tout en la passant à tabac.
La stratégie du libertin se veut anti-stratégique, d’un naturel pur et irréprochable. Le Valmont homosexuel vante les mérites de la sincérité (et tous ses dérivés : la franchise, le naturel, l’honnêteté, la spiritualité, l’art, le sentiment, la mélancolie…) : « Il n’y a pas de règles du jeu. Ce que nous vivons, c’est une aventure. » (Billy dans le film « Billy’s Hollywood Screen Kiss » (1998) de Tommy O’Haver) ; « Je m’apprête à passer des formidables vacances à Rome, j’accepte même de jouer le romantisme indispensable dans cette vieille ville entre deux coïts rapides dans un coin sombre […] » (le narrateur homosexuel du roman Le Bal des Folles (1977) de Copi, p. 22) ; « Je suis entrée en amour comme d’autres rentrent en religion. » (la voix narrative dans la pièce Arthur Rimbaud ne s’était pas trompée (2008) de Bruno Bisaro) ; « Il y a au fond de lui, comme au fond de tout mystique manqué, une nostalgie de la débauche. » (Julien Green, Si j’étais vous (1947), p. 169) ; « Nicolas allait en boîte comme on va à la messe. […] À 20 ans, infatigable, il traversa dans la débauche un moment de grâce. » (Benoît Duteurtre, Gaieté parisienne (1996), p. 34) ; « Cette nuit, je suis allé dans un lieu dont je n’ose même pas vous parler… eh bien bizarrement, j’ai l’impression qu’Il [Dieu] était là aussi. Comme si aucun lieu ne Lui échappait ! » (Malcolm dans le roman Par d’autres chemins (2009) d’Hugues Pouyé, pp. 120-121) ; « Chui quelqu’un de romantique, de sentimental. » (Fabien Tucci, homosexuel, juste au moment d’avoir un « plan cul » avec son meilleur ami Momo, dans son one-man-show Fabien Tucci fait son coming-outch, 2015) ; « J’ai rencontré le Grand Amour. Comme dans les contes de fée. On s’est trouvés dans un plan à trois. Le coup de foudre. Il m’a fait un vrai festival de Cannes » (idem) ; etc. Par exemple, dans le film « Homme au bain » (2010) de Christophe Honoré, Emmanuel, le « queutard », se la joue de temps en temps esthète mélomane, nous offrant à l’écran ses rares moments de gratuité et de désert comme des preuves qu’il est quand même, au fond, quelqu’un de profond. En réalité, cette comédie n’a rien d’un repentir ; elle tient davantage du langage du remord orgueilleux qui n’a pas conscience de lui-même et qui s’esthétise narcissiquement que du changement effectif de comportement.
Le libertin homosexuel fictionnel ne supporte pas une chose : c’est qu’on doute de sa SINCÉRITÉ. « Mais nous nous aimons, tout ce que nous avons fait est par amour ! » (le narrateur homosexuel du roman Le Bal des Folles (1977), p. 147) ; « La sincérité est inévitable. » (Madame Garbo dans la pièce L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer (1998) de Copi) ; « Il me faudra toute une vie pour te prouver ma sincérité. » (Ben à son amant George dans le film « Love Is Strange » (2014) d’Ira Sachs) ; « Il y a le risque que cette fougue te paraisse insincère, que tu me prennes pour quelqu’un qui se précipite. » (Chris s’adressant à son amant Ernest, dans le roman La Synthèse du Camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 85) ; « C’est la première fois que je mens pas à un mec, en plus. » (Mike, le narrateur homosexuel parlant de sa liaison avec Léo, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 101) ; « De toute façon avec toi, on ne sait jamais quand tu es sincère et quand tu ne l’es pas, non mais c’est vrai, tu mens tout le temps, à la fin on sait même pas quand tu dis la vérité. Même Léo, qu’est-ce que tu crois, j’ai dû lui expliquer que tu étais Foucaldien, que tu te réinventais sans cesse pour qu’il ne soit pas choqué le jour où il te connaîtrait mieux et où, en deux minutes, il te verrait changer de discours en deux secondes. » (Polly, l’héroïne lesbienne s’adressant à son pote gay Mike, op. cit., p. 119) ; etc. Il rêverait qu’elle maquille parfaitement ses pulsions les plus animales et désordonnées. Cela le met dans une colère noire que sa sincérité puisse le trahir.
Inconsciemment, il se rend compte que la sincérité, si elle n’est pas suivie des actes, est l’instrument d’un enfer humain pavé de bonnes intentions. « Au fait, qu’aimait-elle en moi ? Je perçois bien la sincérité, sinon de sa tendresse, au moins de son désir, et je crains – oui, déjà, je crains – que ce désir seul l’anime. » (Colette, Claudine en ménage (1946), pp. 147-149)
Il y a chez le libertin homosexuel un mépris des sentiments, parce qu’il en est justement trop dépendant, et qu’il est au fond un cœur d’artichaut déçu. « Nicolas songeait que les histoires d’amour n’étaient que mythologie pour midinettes. » (Benoît Duteurtre, Gaieté parisienne (1996), p. 124) Par exemple, dans le film « Comme des voleurs » (2007) de Lionel Baier, Lionel vit à travers ses livres, alors que paradoxalement, il dit que la croyance au « Grand Amour » est absurde parce qu’elle ne serait que « de la littérature ». C’est bien parce qu’il est romantique que le héros homosexuel devient un vrai serial baiseur : « Même si on ne voyait pas tellement plus loin que le bout de notre queue, on était au fond très romantiques. » (Michael, le héros homosexuel du roman Michael Tolliver est vivant (2007) d’Armistead Maupin, p. 41) ; « J’suis un grand romantique… J’attends le prince charmant… » (le protagoniste s’adressant à son partenaire sexuel attaché sur le sling et à qui il fait un fist dans une backroom, dans le one-man-show Comme son nom l’indique (2008) de Laurent Lafitte) ; « William demandait dans son testament qu’on diffuse la chanson ‘Ah si j’étais un homme, je serais romantique’. » (Liz à propos de Willie « le queutard », dans le roman La meilleure part des hommes (2008) de Tristan Garcia, p. 294) ; etc.
Le libertin homosexuel connaît intellectuellement les pièges dans lesquels il tombe : « Il n’y a que dans les films que l’on rencontre la femme de sa vie dans un train. » (la voix narrative lesbienne du roman Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train (2005) de Cy Jung, p. 26) Il se protège de son côté fleur bleue pour y retomber inconsciemment : « Je suis d’un romantisme à faire peur. Je me donne des airs de brute épaisse alors que je n’aspire qu’à une rencontre digne d’un Harlequin. » (idem, p. 81) Bercé par son désir d’aimer et sa sincérité, il décide de se rendre imbuvable avec ses amants successifs (instruments expiatoires impuissants de son auto-vengeance !), ou bien de faire n’importe quoi sexuellement, en croyant que sa sincérité « exceptionnelle » va le sauver in extremis : « Alors je deviens odieuse. Je chipote, j’ergote, je pinaille, sans motif valable. Je plaide d’emblée coupable et sollicite la sanction. » (idem, p. 6) En somme, il veut se briser en sa révolte.
FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION
PARFOIS RÉALITÉ
La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :
a) Le roman de Choderlos de Laclos inspire beaucoup la communauté homosexuelle :
Cela peut surprendre. Mais dans les faits, le roman Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos est un classique de la littérature homosexuelle, même s’il ne parle pas explicitement d’homosexualité. Par exemple, en 1988, le réalisateur britannique homosexuel Stephen Frears a adapté au cinéma le roman Les Liaisons dangereuses (la fameuse version avec Glenn Close et John Malkovich). Ce n’est pas un hasard si une des plus grandes scènes de travestissement que l’on trouve dans le trio comique des Inconnus soit le sketch des Liaisons vachement dangereuses à la sauce Jean-Claude Vandamme…). Par ailleurs, le chanteur gay Michal (de la Star Academy 3) confesse que l’œuvre de Laclos est son livre de chevet. Autrement, « Liaisons dangereuses » est le titre d’un des chapitres de l’essai L’Homosexualité au cinéma (2007) de Didier Roth-Bettoni (p. 421). Le roman Les Amies d’Héloïse (1990) d’Hélène de Monferrand se veut volontairement une réécriture des Liaisons dangereuses de Laclos. Sinon, dans le générique du film « Bulldog In The Whitehouse » (« Bulldog à la Maison Blanche », 2008), il est signalé en générique d’entrée par le réalisateur Todd Verow que l’intrigue est un remake exact des Liaisons dangereuses, mais à la sauce gay.
J’ai pu constater que beaucoup de personnes homosexuelles (en général celles qui sont dandys ou au contraire bobos) aiment reconstituer des ambiances libertines dix-huitièmistes : cf. le vidéo-clip de la chanson « Ma Révolution » de Cassandre, le vidéo-clip de la chanson « Libertine » de Mylène Farmer, le vidéo-clip de la chanson « Walking On Broken Glass » d’Annie Lennox, le vidéo-clip de la chanson « What A Girl Wants » de Christina Aguilera, la chorégraphie de la chanson « Vogue » de Madonna au MTV Music Awards en 1990, Annie Lennox en grande Marquise de Merteuil sur son navire fantôme pendant la cérémonie de clôture des J.O. de Londres le 12 août 2012, etc. Par exemple, lors de l’avant-première du film argentin « Plan B » (2010) de Marco Berger au cinéma des Halles de Paris, le 27 juillet 2010, les programmateurs nous annoncent avant la projection que ce film se situe « entre les Liaisons dangereuses et un film de Rohmer ». Dans mon cas personnel, quand je me trouvais encore dans la ville de Rennes, en 2005, j’ai assisté à un raffiné « Dîner Grand Siècle » organisé par le groupe rennais David et Jonathan (avec chandeliers, belles chemises blanches, petits plats dans les grands, et tout le tintouin).
Et par ailleurs, si on regarde les comportements relationnels dans les lieux d’homosociabilité, dans les cercles relationnels homosexuels (si rarement amicaux !), où il ne fait pas bon vivre tellement la drague biaise énormément les rapports, on trouve régulièrement cette ambiance de médisance – on dira « langues de pute » ou « briseuses de couple » – qui rappelle les rituels cruels de courtisans poudrés (cf. la caricature Les artistes pédérastes (1880) d’Heidbrinck).
Dans la pièce-biopic Pour l’amour de Simone (2017) d’Anne-Marie Philipe, il est montré le partage malsain (épistolaire) entre Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui commentent leurs histoires d’« amour » extra-conjugales (y compris homosexuelles) et qui mettent en place leur « théorie des amours contingentes ». Sartre et Beauvoir ont tout des anciens amants Valmont/Merteuil qui jouent, par le libertinage et la pleurnicherie bovaryste, à s’aimer encore. On retrouve chez Simone de Beauvoir ce goût pour la conquête séductrice et ce mépris ascétique et sentimentaliste pour les sentiments : « Pourquoi m’interdirais-je cette sotte sentimentalité ? ». À un moment, elle se moque des attitudes de vierges effarouchées de ses amantes.
Ce n’est pas un hasard que les Liaisons dangereuses et le monde homosexuel se rapprochent étant donné que le donjuanisme mondain appelle de soi au narcissisme à deux (… voire à quatre). D’ailleurs, certains penseurs attribuent parfois une homosexualité latente à la Marquise de Merteuil (vis à vis de Cécile de Volanges) et à Vicomte de Valmont (avec son rival, le chevalier Danceny), ou bien comparent leurs personnages de fiction à ces derniers.
Beaucoup trouvent cette présomption d’homosexualité abusive et « homosexuellement centrée ». Par exemple, dans son essai Queer Critics (2002), François Cusset récuse chez les universitaires de la Queer Theory leur lecture récupératrice et homosexualisante de l’œuvre de Laclos, « leur triangle favori, qu’organiseraient en fait Les Liaisons dangereuses, d’une part le désir de Valmont pour le ferme fessier de son concurrent Danceny, et d’autre part celui de la Merteuil pour la rosée intime de sa petite Volanges » (p. 94). Pourtant, en dehors de toutes considérations essentialistes ou justificatrices d’un amour homosexuel, du point de vue seulement symbolique, cette interprétation n’est pas insensée. La Marquise de Merteuil est décrite non sans raison par Dominique Grisoni comme la « femme macho » (cf. l’article « Le XXe siècle, les preuves des corps » de Dominique Grisoni, dans l’essai La première fois… ou le roman de la virginité perdue à travers les siècles et les continents (1981) de Gilbert Tordjman, p. 70) ; et Valmont a tout de l’homme-mauviette, du Don Juan misogyne et fou de la femme-objet en même temps, du courtisan qui mourra d’avoir voulu plaire à tout le monde et de ne pas avoir su s’engager avec la femme qu’il aime.
À mon avis, il ne faudrait pas juger aussi sévèrement l’empressement de certaines personnes homosexuelles à « homosexualiser » les héros des Liaisons dangereuses, car il ne me paraît pas si abusif ni insensé que cela. Cette identification dit inconsciemment la complexité et la violence du désir homosexuel. Elle est à entendre dans son sens désirant. En effet, je crois que toute personne homosexuelle a un Valmont et une Merteuil dans sa famille (je vous renvoie aux codes « Quatuor » et « Femme et homme en statues de cire » dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels), est le fruit d’un désamour – voire d’un viol – entre les sexes : « ‘Qui sont tes parents ?’ À 10 ans, j’aurais répondu avec le plus grand sérieux, sans malice, j’aurais répondu mon père est un poète et ma mère est folle. » (Christophe Honoré, Le Livre pour enfants (2005), p. 151)
b) Le couple homosexuel est explosif, compliqué, et s’organise sous forme de rapport de forces destructeur : beaucoup de personnes homosexuelles appliquent les stratégies de l’accès à l’amour par le mal
La transposition de la structure conjugale homosexuelle sur les Liaisons dangereuses traduit bien l’animosité qui existe dans beaucoup de couples homosexuels réels. Et même dans le « milieu homo ». Par exemple, lors de l’émission On n’est pas couchés de Laurent Ruquier diffusée le 20 octobre 2018 sur la chaîne France 2, le quatuor homosexuel Muriel Robin, Marc-Olivier Fogiel (les deux premiers, lesbien et gay, font une coalition « pro-GPA pour les homos »), Laurent Ruquier et Charles Consigny, s’est écharpé autour de la GPA (Gestation Pour Autrui). La scène est d’une violence homophobe gay friendly difficilement soutenable.
Mais revenons aux couples homosexuels. En général, l’amour homosexuel n’est pas un amour évident, serein, plein, apaisant. C’est même le début des ennuis. Beaucoup de personnes homosexuelles l’avouent d’un air pincé, même si ce n’est pas publicitaire : « Les histoires d’amour gays ne sont pas souvent simples. » (Franck Cnuddle dans l’émission Plus vite que la musique spécial Gay Pride, sur la chaîne M6, 2001) ; « Pour le meilleur et pour le pire. » (Voix-off parlant du « couple » Pierre et Bertrand, dans l’émission Infra-Rouge du 10 mars 2015 intitulée « Couple(s) : La vie conjugale » diffusée sur France 2) ; etc.
Que ce soit lors de la découverte du désir homosexuel, ou bien dans les premiers instants qui suivent l’émoi amoureux, ou même encore pendant les premiers mois de vie de couple, les complications et les vicissitudes de l’homosexualité apparaissent de manière manifeste : « Depuis que je sors avec des garçons, je parviens de plus en plus mal à contrôler mes émotions. » (Alexandre Delmar, Prélude à une vie heureuse (2004), p. 161) ; « Depuis bientôt deux semaines, je passe mes journées à envoyer des textos à un garçon qui ne peut pas y répondre. Je suis ridicule. Je suis malvenu. Je suis fou d’amour. Ça fait une éternité que je n’étais pas tombé amoureux. » (Christophe Honoré, Le Livre pour enfants (2005), p. 96) ; « Celui qui est amoureux à la manière romantique connaît l’expérience de la folie. Or, à ce fou-là, aucun mot moderne n’est aujourd’hui donné, et c’est finalement en cela qu’il se sent fou : aucun langage à voler. » (Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes (1975), p. 87) ; « Des emballements sentimentaux, oui. Une manière très adolescente, et sans doute passablement encombrante, de poursuivre les femmes pour lesquelles elle s’enflammait, assurément. Au point de les faire fuir. […] Certainement très peu de désir. Sauf celui d’aimer. » (Josyane Savigneau parlant de l’écrivaine lesbienne Carson McCullers, dans sa biographie Carson McCullers (1995), p. 99) ; « Pas un jour, tout au long de cette époque, je n’eus de remords ni de soucis. J’étais jeune, j’avais à mes pieds des êtres tout-puissants, riches et auxquels je prodiguais plus d’espoirs que de faveurs. J’agissais instinctivement en courtisane. Chez moi, dans l’appartement que me louait mon ami, du côté de Neuilly, j’organisais de nombreuses réceptions pour me ménager de nouvelles relations : les aventures sentimentales sont, la plupart du temps, de courte durée chez les homosexuels. » (Jean-Luc, homosexuel de 27 ans, dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, p. 84) ; « Tu es l’homme le plus compliqué de la terre, tu le sais bien. » (Laurent s’adressant à son amant André, avec qui il a vécu pendant 10 ans, dans le docu-fiction « Le Deuxième Commencement » (2012) d’André Schneider) ; etc.
Confondant la passion ou la pulsion (« Éros ») avec l’Amour vrai (à savoir la conjonction de l’amour physique « Éros » + de l’amour familial « Storgê » + de l’amour amical « Philia » + de l’amour spirituel et inconditionnel « Agapè »), beaucoup de personnes homosexuelles adoptent fatalement une conception totalitaire et chimique de l’amour. Selon elles, l’Amour s’impose à l’individu de manière naturelle et violente (cf. la croyance au coup de foudre), sans qu’on ne puisse rien maîtriser : « À soixante ans révolus, je ne sais toujours pas grand-chose de l’amour. Je sais seulement qu’il peut fondre sur moi au moment où je m’y attends le moins. » (Paula Dumont, Mauvais Genre (2009), p. 112)
J’ai remarqué (sans m’exclure en aucune façon du tableau) que le désir homosexuel a tendance à fragiliser les personnes et à les métamorphoser en individus compliqués dès qu’elles pratiquent les actes homosexuels (je vous renvoie au code « Désir désordonné » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels). Parfois, la personne homosexuelle ne sait que faire de son compagnon (ou de sa compagne) quand celui-ci/celle-ci adopte un état affectif instable/bipolaire à son contact. Par exemple Vita Sackville-West sentait que Virginia Woolf devenait une « boule de sensibilité » hystérique qui s’attachait à elle de manière malsaine et excessive (cf. l’article « Vivre à travers une femme » de Diane de Margerie, dans le Magazine littéraire, n°275, mars 1990, p. 36). Dans son autobiographie Parce que c’était lui (2005), Roger Stéphane définit sa vie de couple avec Jean-Jacques Rinieri comme « brillante, mondaine, amoureusement agitée » (p. 31). La relation de couple de Benjamin Britten et de son compagnon Peter Pears passait « du désespoir le plus noir aux hystéries de joie » (cf. l’article « Apuntes biográficos » de Benjamin Britten sur le site www.islaternura.com, consulté en janvier 2003). Sur le plateau-télé de l’émission « Vie privée, Vie publique » (2007) de Mireille Dumas, le chanteur Dave et son compagnon Patrick Loiseau, en couple depuis des années, n’arrêtent pas de se disputer pour un rien : « Ce qui n’est pas normal, c’est qu’on soit encore ensemble… » ironise Patrick ; il rajoute à propos de son drôle de couple : « On est souvent dans le conflit. » Dans le documentaire « Homos, et alors ? » de Florence d’Arthuy diffusé dans l’émission Tel Quel sur la chaîne France 4 le 14 mai 2012, Charlotte et Marion s’engueulent souvent devant les caméras, même si elles veulent donner une image positive de leur couple ; Charlotte dit qu’elle ne supporte pas que Marion dirige sa vie : « Mais laisse-moi ! T’es chiante !! » Dans le documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz, Bernard et Jacques, vivant en couple depuis quelques années, passent leur temps à se chamailler dans la cuisine et à se comparer. Ils se donnent des ordres l’un à l’autre, et Bernard manipule Jacques comme il veut. Toujours dans le même reportage, Thérèse, une femme lesbienne de 70 ans, raconte qu’elle a vécu une « passion » avec Emmanuelle, de 27 ans sa benjamine, passion destructrice dans laquelle Thérèse avoue avoir été excessive.
Ce qui est bizarre dans l’amour homosexuel, c’est qu’il ressemble à un mélange de sentiments antinomiques. « Je l’aimais par haine. » (Jean Genet cité la biographie Saint Genet (1952) de Jean-Paul Sartre, p. 147) Dans son essai L’Amour qui ose dire son nom (2001), Dominique Fernandez parle d’un « amour-haine », d’un « amour maudit » (p. 135). Dans son fameux Tristes Tropiques (1956), Claude Lévi-Strauss nous rappelle que les Indiens Nambikwara surnomment poétiquement l’amour homosexuel « l’amour-mensonge ».
On dirait que les deux partenaires du couple homosexuel ne semblent pas assez mal pour se séparer, et pas assez bien pour rester ensemble. Mais comme chacun d’eux n’a pas la force de briser sa croyance en la supposée « beauté de l’amour homosexuel », il fait alors intervenir le mensonge et la terreur (on l’appelle aussi jalousie) pour que sa tour d’amour tienne coûte que coûte, pour colmater les brèches. La rigidité et l’inconstance deviennent les ciments fragiles d’un désir homosexuel qui n’est fondé ni sur le Réel ni sur l’Amour simple et pacifié. Bien souvent, le couple homosexuel ressemble à un bras de fer (je vous renvoie à cet article sur la violence dans les unions homos, au code « Adeptes des pratiques SM » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels), une danse où les partenaires ne se laissent pas bien guider et conduire. « On se disputait tout le temps la dernière année. » (André s’adressant à son amant Laurent, dans le docu-fiction « Le Deuxième Commencement » (2012) d’André Schneider) ; « Son attitude était tellement bizarre qu’elle m’attirait mais, en même temps, elle commençait à me faire peur, et je ne tenais pas à rester seule avec elle. » (Laura, 34 ans, en parlant de sa compagne Laurence, 40 ans, dans le recueil de témoignages Le Livre des rencontres (2002) réunis par Michel Field et Julie Cléau, p. 227) ; « Dans le rapport homosexuel, il va y avoir un rapport de forces qui va s’établir… un rapport de forces qu’il faut essayer d’éviter. Mais entre deux hommes ou entre deux femmes, à cause du conditionnement qui nous entoure, il y a un rapport d’autorité, de domination, de possession qui essaie de s’exercer. Et c’est là qu’il faut suffisamment d’amour pour éviter ce rapport de possesseur à possédé. » (Jean-Louis Bory au micro de Jacques Chancel, dans l’émission Radioscopie sur France Inter, 6 mai 1976) ; « Mes amours étaient ce rayon de soleil. Elles étaient idéalisées à l’extrême. Elles ressemblaient à ses passions soudaines que l’on éprouve dans l’enfance, violentes et sans lendemain. Carpe Diem. […] Mais trop souvent, mes désirs se sont heurtés au mur apparemment inaltérable de la volonté d’autrui. » (Cathy Bernheim, L’Amour presque parfait (2003), p. 72) ; « Chaque nuit d’amour était une revanche qui se suffisait à elle-même. La jouissance de mon amante me vengeait de celles et ceux qui n’avaient joui de moi qu’à mon insu. » (idem, p. 73) ; « J’étais effrayée par le plaisir des femmes que j’aimais. Je craignais toujours de ne pas les voir revenir de ces contrées sauvages où je ne les accompagnais pas. Et quand elles en revenaient, mystérieuses, je n’étais jamais certaine qu’elles n’allaient pas fondre sur moi comme des rapaces sur leur proie à la première minute d’inattention. Je me disais que trop d’amour pouvait les rendre folles et pas assez, inaccessibles. Alors je louvoyais entre mon désir d’elles et mon envie de fuir. J’avais l’amour possessif, tyrannique, même. Puis je disparaissais au moindre reproche. Le plus petit malentendu me rejetait dans ma solitude sans fond. » (idem, p.73) ; « Je n’ai plus de temps à consacrer à mes amours. Ce que je veux, c’est du sexe. Non, je ne dis pas cela, elle n’aimerait pas, je lui dis : – Se rencontrer de temps en temps et passer d’agréables moments. – Il n’y a pas de passion entre nous, constate-t-elle, déçue. Je lui réponds que ce n’est pas ce que je recherche. » (idem, p. 174) ; « Je ne suis pas loin de croire que je n’ai aimé G. que ‘pour ça’. » (idem, p. 184) ; « Il y a, trop profondément ancré en moi, le plaisir de la soumission. » (Klaus Mann, Journal (1937-1949), p. 118) ; « Ce génie pour la découverte de formes absurdes, tragi-comiques de l’art théâtral fonctionnait comme une sorte de baume qui cicatrisait les blessures causées par ces rencontres violentes. » (Alfredo Arias parlant de l’homme transsexuel M to F Coco, dans son autobiographie Folies-Fantômes (1997), p. 16) ; « Quand je suis avec ma copine, je suis à la fois heureuse et inquiète. » (Amina, jeune femme de 20 ans, lesbienne, dans le documentaire « Homos, la haine » (2014) d’Éric Guéret et Philippe Besson, diffusé sur la chaîne France 2 le 9 décembre 2014) ; « Mon ancien camarade de classe me met sous les yeux deux photos de Janson, cinquième et quatrième, toute la classe. […] Moi, mince, l’air silencieux, innocent d’une innocence évidente. Cela m’a ému, car depuis… Et tout à coup, le visage de Durieu que j’avais oublié et qui m’a arraché un cri : un visage d’ange résolu. Silencieux aussi celui-là, on ne le voyait pas, il disparaissait, je ne pouvais pas m’empêcher de ressentir sa beauté comme une brûlure, une brûlure incompréhensible. Un jour, alors que l’heure avait sonné et que la classe était vide, nous nous sommes trouvés seuls l’un devant l’autre, moi sur l’estrade, lui devant vers moi ce visage sérieux qui me hantait, et tout à coup, avec une douceur qui me fait encore battre le cœur, il prit ma main et y posa ses lèvres. Je la lui laissai tant qu’il voulut et, au bout d’un instant, il la laissa tomber lentement, prit sa gibecière et s’en alla. Pas un mot n’avait été dit dont je me souvienne, mais pendant ce court moment il y eut entre nous une sorte d’adoration l’un pour l’autre, muette et déchirante. Ce fut mon tout premier amour, le plus brûlant peut-être, celui qui me ravagea le cœur pour la première fois, et hier je l’ai ressenti de nouveau devant cette image, j’ai eu de nouveau treize ans, en proie à l’atroce amour dont je ne pouvais rien savoir de ce qu’il voulait dire. » (Julien Green, L’Arc-en-ciel, Journal 1981-1984, avril 1981, pp. 23-24) ; « C’est dans un contexte de rivalité aiguë qu’apparaît l’homosexualité. » (René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde (1978), p. 469) ; etc. « Pour le psychanalyste Alfred Adler, la tendance à la dépréciation du partenaire, généralement normal, ne manque jamais. » (Philippe Simonnot dans son essai Le Rose et le Brun (2015), p. 197)
Dans son autobiographie Une Mélancolie arabe (2008), le romancier Abdellah Taïa associe directement l’amour homosexuel à la possession et à la jalousie : « Je sais que l’amour est une chose qui nous dépasse. Je sais que l’amour est jalousie. Maladie. Je l’ai lu dans les livres. » (p. 116) ; « Slimane est la jalousie même. » (Taïa parlant de son compagnon, idem, p. 106)
Quand on regarde par exemple le « couple » d’Yves Saint-Laurent et de Pierre Bergé, on est vite frappé de constater sa violence, et le rapport de domination/soumission est minutieusement réglé : « Entre Yves et moi, les rôles ont toujours été bien définis, dans tous les domaines, y compris sexuel. Personne n’est rentré dans le domaine de l’autre. » (Pierre Bergé dans le documentaire « Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé : l’Amour fou » (2010) de Pierre Thoretton). D’ailleurs, Betty Catroux, une amie proche des deux hommes, déclare que c’était un couple « avec beaucoup de drames, d’histoires, énormément théâtrale ». Dans la biopic « Yves Saint-Laurent » (2014) de Jalil Lespert, on voit d’ailleurs de grandes engueulades, avec Yves qui balance des statues à la gueule de Pierre (« Espèce de raté ! T’es un parasite ! ») parce qu’il en a assez de la main mise de Pierre sur lui. Et c’est sûr que Pierre a l’air de le mener à la baguette, de l’humilier (pendant certaines interviews, il lui coupe la parole : « Si c’est pour dire des conneries pareilles… »), d’agir comme un « nerveux » (« T’aboies tout le temps. » lui reproche notamment Victoire).
L’amour homosexuel est une liaison dangereuse car il peut aller jusqu’au meurtre et au viol : « On aime pour détruire et on détruit pour aimer. Alors ce n’est qu’en détruisant ce qu’on aime que l’amour renaît plus pur. » (Luis Cernuda cité dans la biographie Luis Cernuda En Su Sombra (2003) d’Armando López Castro, p. 44) ; « Lorsqu’un homosexuel passif éprouve le besoin de tuer celui auquel il s’est précédemment offert, c’est là une manifestation double de ses sentiments invertis. […] Chez certains invertis, dont les aventures sont purement sexuelles, se produit très souvent ce renversement de sentiments : la soumission fait place à la haine ; une apparence de jeu cache une rivalité : c’est à qui dominera l’autre – le châtrera. Le fameux crime du cabaret Le Poisson d’Or, survenu à Montmartre avant la guerre, en est un exemple classique : un pédéraste, jusqu’alors passif, tua son partenaire et lui tranchera le verge. Quoique ces rôles d’activité et de sa passivité se renversent fréquemment chez les invertis de sexe mâle, il n’en reste pas moins dans chaque acte la naissance de la haine qui se résout souvent par le crime. » (Jean-Louis Chardans, Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p. 260) ; « Ils se sont rapprochés de moi en se masturbant. J’étais allongé sur le dos au milieu du lit bleu. J’ai fermé les yeux et j’ai essayé de m’imaginer encore une fois à la piscine, l’eau, le chlore, le plongeoir, la paix, le luxe. Un rêve impossible à l’époque. Je nageais mais dans la peur. Je tremblais, à l’intérieur. Je ne voyais plus les garçons sauvages mais je les sentais venir, se rapprocher de mon corps, le renifler et le lécher. Dans un instant le violenter, l’un après l’autre le saigner. Le marquer. Lui retirer une de ses dernières fiertés. Le briser. » (Abdellah Taïa, Une Mélancolie arabe (2008), p. 25) ; « Très vite ses crises reprirent et empirèrent, alimentées sans cesse par mes multiples activités donnant prise à sa jalousie maladive. Il en arrivait à menacer mes parents. […] La nuit, dans l’intimité, il laissait toujours son revolver bien en évidence. Je le priais de le ranger, mais il me répondait : ‘C’est pour que tu te rappelles qui je suis.’ Notre relation devenait invivable. » (Denis Daniel à propos d’un de ses amants, dans son autobiographie Mon théâtre à corps perdu (2006), p. 98) ; « Le couple commençait à se chamailler : des regards, des non-dits qui en disaient long ! Pierre était de plus en plus nerveux. Quant à Saïd, il était de plus en plus triste. » (idem, p. 110) ; « Autre effacement : l’histoire officielle, en vigueur encore aujourd’hui dans la plupart des livres d’histoire, nous dit que l’attentat du 7 novembre 1938 qui a coûté la vie au secrétaire de l’ambassade allemande à Paris, vom Rath, a été commis par un jeune Juif, Herschel Grynszpan, qui voulait venger le sort cruel qui était fait à sa famille en Allemagne sous la férule nazie. Cet attentat d’un juif contre un fonctionnaire allemand allait servir de prétexte aux persécutions de la ‘Nuit de cristal’. Or, on sait maintenant, au moins depuis quarante ans, par les confidences d’André Gide à Maria Van Rysselberghe, qu’il s’agissait en fait d’un crime homosexuel, Rath et Grynszpan étant amants, après s’être rencontrés dans les cruising bars de Pigalle que fréquentait le même Gide. » (Philippe Simonnot dans son essai Le Rose et le Brun (2015), p. 20) ; etc.
Le cortège des couples homosexuels qui s’entretuent et se maltraitent est ahurissant (et la liste n’est pas exhaustive ! Je ne peux citer que les cas connus et que quelques statistiques : selon l’association AGIR, 11% des hommes gays et des femmes lesbiennes et 20% des personnes bisexuels, ont déclaré avoir été victimes de violence conjugale au cours de l’année 2013). Par exemple, Alfred Douglas a exercé l’outing et le chantage sur son amant Oscar Wilde. Kenneth Halliwell tue son amant Joe Orton après 14 ans de vie commune, puis se suicide. Alain Pacadis, qui avait tenté de se suicider en 1982, meurt étranglé, le 11 décembre 1986, par son compagnon, âgé de 20 ans, qui voulait, dira-t-il à la police, le « délivrer de son désespoir ». Jean-Claude Poulet-Dachary, homosexuel et chef de cabinet du nouveau maire Front-National de Toulon, est assassiné le 29 août 1995 ; le FN local y voit un crime politique ; on découvre en 1999 que l’assassin n’était autre qu’un ancien amant. L’assassinat de Jean Sénac est autant un crime politique qu’un crime passionnel : Sénac a laissé entrer son assassin chez lui car il le connaissait (cf. le documentaire « Jean Sénac, le forgeron du soleil » (2003) d’Ali Akika) : c’était l’un de ses amants. En 1949, à Madrid, un homme homosexuel nommé « La Eva » tue son jeune amant qui refuse ses avances (Fernando Olmeda, El Látigo Y La Pluma (2004), p. 73). La nuit du 29 mai 1998, toujours en Espagne, une femme, Carmen, demande à sa compagne Isabel de la tuer (idem, p. 291). En juillet 1873, à Bruxelles, Paul Verlaine tire au revolver sur Arthur Rimbaud et le blesse. Dans le documentaire « The Execution Of Wanda Jean » (2002) de Liz Garbus, la femme lesbienne Wanda Jean est condamnée à mort et exécutée en 2001 pour avoir tué son amie. Dans les années 1960, Pierre Meyer est retrouvé mort entièrement nu dans une chambre d’hôtel à Rouen : lui et un camarade se livraient à des ébats sexuels lorsqu’il succomba à une overdose. Le roman L’Increvable Monsieur Schneck (2007) de Colombe Schneck (racontant qu’un homme a découpé en plusieurs morceaux son amant et l’a trimballé dans différentes valises à travers la France) est basée sur des faits réels. Je vous renvoie bien sûr aux codes « Coït homosexuel = viol », « Violeur homosexuel », et « Homosexuel homophobe », dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels.
Dans son essai Le Deuxième Sexe (1949), Simone de Beauvoir rappelle les « violences inouïes » qu’exercent les amantes lesbiennes entre elles : « Les femmes entre elles sont impitoyables. […] Entre deux amies, il y a surenchère de larmes et de convulsions. » Je voudrais également faire mention du phénomène accru de la violence conjugale entre filles dans les couples lesbiens, car elle est bien plus courante qu’on ne l’imagine.
Certains défenseurs invétérés de l’amour homosexuel me diront certainement que je généralise trop, que je noircis le tableau, que le type de relations que je dépeins correspond aux couples typiques du Marais ou aux « exceptions d’homosexuels », et non aux couples homosexuels « durables et heureux » classiques. Alors je persiste et signe en affirmant que le fonctionnement dangereux du désir homosexuel touche universellement tous les couples homosexuels que j’ai rencontrés jusqu’à maintenant, y compris les unions « clean et durables ». Et jusqu’à ce jour, je n’ai jamais vu de couple d’amis qui m’a fait positivement changé d’avis, même s’il y a assurément des unions homos qui se débrouillent mieux que d’autres (et parfois même mieux que des couples femme-homme).
c) Le paradoxe du libertin, à la fois ascétique et obsédé par le sexe, tout cela à cause de sa sincérité :
c) 1) Pseudo-ascèse :
Aussi bizarre que cela puisse paraître, les personnes homosexuelles qui s’identifient (inconsciemment ?) au Vicomte de Valmont et à la Marquise de Merteuil, même si elles agissent pour détruire et multiplient les conquêtes sexuelles, sont tellement obsédées par leur image (et donc leurs intentions), qu’elles ont tendance à se persuader qu’elles sont encore pures et ascétiques après la débauche. Elles ont une réputation à parfaire ! des illusions d’amour à sauver, ne serait-ce que par optimisme et survie ! une mission angéliste interplanétaire à défendre ! (je vous renvoie au code « Amoureux » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels)
C’est pourquoi, certaines personnes homosexuelles se présentent comme des anges asexués, des êtres ascétiques (même si, en acte, elles ne vivent pas du tout l’abstinence), comme de « simples amoureuses » : « Je ne suis pas sexuelle. » (l’actrice bisexuelle Maïk Darah, lors de la conférence « Est-ce que j’ai une tête de quota ? » au Théâtre du Temps à Paris, le 11 octobre 2011) ; « Je ne suis pas fait pour la fête. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Je suis calviniste sans être protestant. Je ne couchais pas avec Jacques de Bascher. C’était un amour absolu. » (Karl Lagerfeld dans le documentaire « Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld : une guerre en dentelles » (2015) de Stéphan Kopecky, pour l’émission Duels sur France 5) ; « Avec ma première petite amie, je n’ai pas eu de relation sexuelle. C’était un amour platonique. Elle disait qu’on faisait quelque chose de très laid. » (Mària Takàcs, la réalisatrice hongroise lesbienne, dans le documentaire « Homo et alors ?!? » (2015) de Peter Gehardt) ; « Les gens pensent que c’est de l’érotisme mais c’est stupide. C’est profondément religieux. » (Edwarda face au tableau de la jeune fille à la salle de bain de Balthus, dans le docu-fiction « Le Dos rouge » (2015) d’Antoine Barraud) ; « Je ne vous dis pas qu’on va vivre quelque chose ensemble. On s’en fout. L’important, c’est d’imaginer. » (Celia, la conservatrice de musées séduisant Bertrand, idem) ; etc.
Dans l’émission Infra-Rouge du 10 mars 2015 intitulée « Couple(s) : La vie conjugale » diffusée sur France 2, le couple Pierre/Bertrand a mis le génital avant l’amour : « Avec les pédés c’est comme ça. C’est d’abord le cul et après les sentiments. » se justifie Bertrand. « On est passés du désirable au aimable. » (Bertrand) Et même quand ils vont voir ailleurs, ils estiment qu’ils ne se trompent pas. « Pour moi les histoires de sexe n’ont jamais été des histoires de sexe. » (Pierre) ; « Leur fidélité n’est pas sexuelle. Leur infidélité n’est pas synonyme de trahison. » (Voix-off) ; « Nous pratiquons le no-sex. C’est pour ça que j’autorise mon mari à aller voir ailleurs. » (Pierre)
Par exemple, dans son film « La Vie d’Adèle » (2013), le réalisateur Abdellatif Kechiche veut faire croire aux spectateurs qu’Emma et Adèle sont patientes, ont la sagesse de ne pas s’embrasser sur la bouche dès leur deuxième rencontre, et que cette mesure prouverait l’authenticité de leur « amour ». Dans le film « Week-end » (2012) d’Andrew Haigh est diffusée la croyance qu’un « plan cul » peut inaugurer une solide histoire d’amour : « Un vendredi soir après une fête chez ses amis hétéros, Russell finit dans un club gay. Juste avant la fermeture, il drague Glen, et ce qu’il croit être juste l’aventure d’un soir devient autre chose, quelque chose de spécial. » (cf. la plaquette du 17e Festival Chéries-Chéris, au Forum des Images de Paris, le 7-16 octobre 2011) Même tentative avec le film « Spring » (2011) de Hong Khaou : « Un jeune homme rencontre un étranger pour un plan sexe, une expérience qui va le changer à jamais… » (cf. le résumé sur la plaquette du 17e Festival Chéries-Chéris, le 7-16 octobre 2011, au Forum des Images de Paris)
Mais ne nous fions pas aux apparences. Ce discours queerisant actuel cache dans les faits un mépris des corps, de la sexualité, et de l’Amour, ce Dernier étant considéré comme une maladie. « L’amour, cette lumière dont on ne peut guérir » (Jean Sénac dans le documentaire « Jean Sénac, le forgeron du soleil » (2003) d’Ali Akika) Par rapport au roman La Mort à Venise (1912) de Thomas Mann, Kurt Hiller lui a seulement reproché que « l’amour pour un garçon soit diagnostiqué comme un symptôme de décadence et décrit presque comme le choléra » (Philippe Simonnot, Le Rose et le Brun (2015), p. 122). Je vous renvoie aux nombreuses publicités de lutte contre le Sida, qui sacralisent à leur insu la correspondance entre Amour et virus dangereux.
Dans le documentaire « Tellement gay ! Homosexualité et Pop Culture », « Inside » (2014) de Maxime Donzel, Lea Delaria, femme lesbienne, dit qu’elle est fan de l’actrice Sigourney Weaver jouant Ellen Ripley dans le film « Alien », parce qu’elle s’y identifie. Mais lorsque dans le scénario de la série de film, l’héroïne finit par coucher avec des mecs, la déception arrive : « J’étais dégoûtée qu’elle couche avec des hommes. J’étais dégoûtée qu’elle couche tout court ! »
En 1908, Weindel et Fischer distinguent deux catégories d’individus homosexuels : les sensuels « qui vont au commerce de la chair », d’une part, et d’autre part, les intellectuels qui se limitent, en l’accompagnant de caresses sans doute, « au contact de l’esprit ». « Ceux-là par haine ou fatigue du sexe peuvent devenir des abstinents, mais des abstinents aux gestes déréglés, aux passions désaxées, aux sentiments dévoyés. » D’où « un lyrisme exaspéré par l’abstinence sexuelle » (pp. 9-10).
Au bout du compte, le libertin homosexuel est un désabusé de l’Amour (ou de ce qu’il croit être de l’Amour) : « Elle en fait des dégâts dans nos vies, cette rage de l’amour-toujours qu’on nous a fourrée dans le crâne quand nous étions petites ! » (Paula Dumont, Mauvais Genre (2009), p. 112) ; « Pour la plupart d’entre nous, être aimé est insupportable. » (Carson McCullers citée dans la biographie Carson McCullers (1995) de Josyane Savigneau, p. 100)
c) 2) Le libertinage au nom des bonnes intentions :
La comédie de l’ascétisme et du raffinement ne dure généralement pas longtemps chez le libertin homosexuel. Elle n’est qu’un vernis qu’il applique sur ses actions pour s’auto-persuader qu’il « agit mal mais quand même pas aussi mal que les autres ».
Les pratiques libertines des « sages et pieux » individus homosexuels ne sont pas qu’un mythe. Par exemple, au cours de sa vie, l’écrivain espagnol Antonio de Hoyos passait insensiblement des clubs chics aux lieux sordides de prostitution de Madrid. Quant à Antonio Toig, après avoir été carmélite, il traîna dans les parcs de Londres (Hyde Park). Au départ, Alberto Cardín allait rentrer dans un ordre religieux ; il finit par fréquenter des salles obscures. Ernesto Jiménez, après avoir été un prêtre très prude, est un client régulier des saunas. On décèle la même dichotomie quand on découvre que des grands intellectuels tels que Roland Barthes, Yukio Mishima, Marcel Proust, ou Michel Foucault, allaient dans les backrooms, pratiquaient le sado-masochisme, ou tenaient des maisons closes.
D’ailleurs, beaucoup de sujets homosexuels ont tendance à se caricaturer eux-mêmes en libertin, en « grande salope » qui ne fait que des blagues en dessous de la ceinture, à se définir uniquement par leurs vils instincts et leurs actes génitaux peu glorieux, pour s’abriter dans l’auto-parodie, et pour surtout ne jamais changer de comportement : « Je ne pense décidément qu’au cul. » (Gaël-Laurent Tilium, Recto/Verso (2007), p. 40) ; « Je je suis libertine. Je suis une catin ! » (cf. la chanson-phare de Mylène Farmer, « Libertine »)
Loin de moi de penser cependant que toute personne homosexuelle est une libertine en puissance (cette tendance soulignée ne s’applique qu’aux sujets homosexuels pratiquants), ni de tout acte génital homosexuel une partie de jambes en l’air, un vulgaire défouloir pulsionnel, une victoire affligeante des instincts. Je vais plus loin ! Je dis que le passage à l’acte homosexuel est une victoire ET des pulsions ET des intentions ascétiques. Une religiosité puante et hypocrite. « J’étais au bordel comme au cloître. » (Olivier Py, L’Inachevé (2003), p. 41)
Une intuition ne m’a jamais quitté depuis que je fréquente les établissements homosexuels et mes jumeaux d’orientation sexuelle. Derrière l’imparfaite actualisation humaine de l’ascétique Merteuil se cache la « bite sur pattes » de Valmont. Et inversement : derrière le gogo dancer ou le geek se cache un grand idéaliste, un esthète qui se croit sobre et sincèrement aimant, un être sensible qui recherche la pureté dans la débauche. Le désir homosexuel, parce qu’il fonctionne en dents de scie, qu’il est pour et contre lui-même, et qu’il naît de l’écartèlement entre intentions et Réalité, permet ce genre de consanguinités bizarres.
Le libertin homosexuel insiste beaucoup trop sur son « désir d’aimer » pour aimer véritablement en acte, pour se reconnaître tel qu’il est : « Il y a une grande sincérité dans le parcours transsexuel. » (Jihan Ferjan juste avant la projection du film « Trannymals Go To Court » (2007) de Dylan Vade) ; « J’avais envie d’aimer. » (Abdellah Taïa, Une Mélancolie arabe (2008), p. 38) ; etc.
Il y a dans l’amour homosexuel un paradoxe entre fond et forme, entre désir et acte, entre sincérité et Vérité, qu’on peut observer dans la société toute entière avec les « injonctions paradoxales », énoncées par exemple dans les publicités ou les slogans politiques (« Il est interdit d’interdire ! » ; « Silence !!! » ; « Sois tolérant ! », etc.) : « Au fond, depuis l’adolescence, je suis déchiré entre mon rêve romantique et mes fantasmes parfois avilissants. » (Brahim Naït-Balk, Un Homo dans la cité (2009), p. 46)
La stratégie du libertin homosexuel se veut anti-stratégique, d’un naturel pur et irréprochable. Le Valmont homosexuel vante les mérites de la sincérité (et tous ses dérivés : la franchise, le naturel, l’honnêteté, la spiritualité, l’art, le sentiment, la mélancolie…). Pour moi, il n’y a absolument pas lieu de dissocier de manière binaire et manichéenne les individus homosexuels pratiquants soi-disant « sages », « mesurés », « romantiques », « sincères », des « victimes d’amour », des individus homosexuels pratiquants soi-disant « sans cœur », « queutards », « menteurs », « bourreaux des cœurs ». Pour moi, ils sont une seule et même personne. « Rassurez-vous : mes nombreux partenaires, loin d’être les proies innocentes d’un jeu cruel que je serais seul à maîtriser, selon mon bon vouloir, font exactement la même chose de leur côté, avec la même grille d’analyse, tout aussi sectaire, déshumanisée et implacable. » (Gaël-Laurent Tilium, Recto/Verso (2007), p. 227) ; « Il a toujours cru à ce rythme grec, la succession de l’Ascèse et de la Fête. » (Roland Barthes en parlant de lui-même à la troisième personne, dans son autobiographie Roland Barthes par Roland Barthes (1975), p. 138) ; « J’ai comme deux personnalités : le bon petit gars d’un côté, l’obsédé de l’autre. » (Bruno, un garçon bisexuel de 25 ans, cité dans l’essai Ça arrive aussi aux garçons (1997) de Michel Dorais, p. 206) ; « Je suis sentimental et vicieux. » (Christophe Honoré, Le Livre pour enfants (2005), p. 93) ; « Carson McCullers a horreur du sexe, et pourtant il est constamment présent dans ses livres. » (Jean-Pierre Joecker parlant de l’écrivaine McCullers dans la revue Masques, printemps 1984) ; « Je suis toujours surpris par le nombre de filles qui croient encore au grand amour, tendance fleur bleue et prince charmant. Il est fréquent que je console des filles effondrées, folles amoureuses d’un garçon qui les a larguées. » (Père Jean-Philippe, Que celui qui n’a jamais péché… (2012), p. 249) ; etc.
Dans la démarche nostalgique du libertin homosexuel, on ne lit pas que de la mélancolie laconique, ou une contemplation morbide de soi, mais aussi un contentement narcissique et « optimiste », une sorte de « Malgré tout, j’ai aimé… » qui maintient despotiquement l’amant dans la carte postale : « J’ai rêvé un instant (puisque tout le monde rêvait, pourquoi aurais-je dû être la seule à coller à des réalités triviales ?) à 8 jours de vacances, en ce lieu, avec Catherine. Je l’ai entrevue, devant son chevalet de peintre, sous le soleil méridional, dans l’odeur du thym, de la menthe et du romarin. Là ou ailleurs, arriverais-je un jour à vivre une semaine entière auprès d’elle ? » (Paula Dumont, La Vie dure : Éducation sentimentale d’une lesbienne (2010), p. 164)
Le libertin homosexuel ne supporte pas une chose : c’est qu’on doute de sa SINCÉRITÉ. Il rêverait qu’elle maquille parfaitement ses pulsions les plus animales et désordonnées. Cela le met dans une colère noire que sa sincérité puisse le trahir. C’est bien parce que l’usage amoureux de la sincérité peut cautionner les plus bas instincts humains que beaucoup d’auteurs homosexuels récriminent contre elle : « Que cette question de la sincérité est irritante ! Sincérité ! » (André Gide, Les Faux-Monnayeurs (1925), p. 84) ; « Un peu de sincérité est dangereux, beaucoup de sincérité est fatal. » (Oscar Wilde) ; « Quand Lulu m’écrivait des lettres brûlantes, que je viens de classer comme on classe une affaire, il était d’une sincérité absolue. Son silence aujourd’hui les rend caduques. À quoi servent des mots tendres empilés dans une boîte en carton ? Tous les Lulu se ressemblent. Je reste stoïque face à la fatalité. » (Pascal Sevran, Le Privilège des jonquilles, Journal IV (2006), pp. 161-162)
Inconsciemment, le libertin homosexuel se rend compte que la sincérité, si elle n’est pas suivie des actes, est l’instrument d’un enfer humain pavé de bonnes intentions. « Les Liaisons dangereuses désigneraient le bien par le détour du mal. » (cf. l’article « Laclos moraliste » de Marguerite Buffard, dans l’ouvrage collectif Analyses et réflexions sur Les Liaisons dangereuses de Laclos (1991) dirigé par Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos, p. 65) ; « J’aime bien détester. Ça réveille. » (Catherine dans le docu-fiction « Le Dos rouge » (2015) d’Antoine Barraud) ; etc.
Il y a chez le libertin homosexuel un mépris des sentiments (Valmont et Merteuil, dans les Liaisons dangereuses, se rient justement de ceux qu’ils appellent « les sentimentaires », ceux qui ont la naïveté de croire en l’amour et de se laisser aller à leurs sentiments), parce qu’il en est justement trop dépendant, et qu’il est au fond un cœur d’artichaut déçu. « Bon, évitons de la jouer mélodramatique. » (André à Laurent au moment du départ, dans le docu-fiction « Le Deuxième Commencement » (2012) d’André Schneider) C’est bien parce qu’il est romantique qu’il devient un vrai serial baiseur désinvolte.
Le libertin homosexuel connaît intellectuellement les pièges dans lesquels il tombe (la mièvrerie, la facilité du « plan cul », l’épanchement face à la tendresse et aux mots d’amour, le bien-être des massages, etc.) Il se protège de son côté fleur bleue pour y retomber inconsciemment. Bercé par son désir d’aimer et sa sincérité, il décide de se rendre imbuvable avec ses amants successifs (instruments expiatoires impuissants de son auto-vengeance !), ou bien de faire n’importe quoi sexuellement, en croyant que sa sincérité « exceptionnelle » va le sauver in extremis. En somme, il veut se briser en sa révolte. Mourir de frustration.
Les frustrés sexuels, contrairement à l’idée communément admise dans notre société actuelle, ne sont pas uniquement du côté des faux ascètes qui diabolisent les plaisirs sexuels. Comme l’expliquent à juste titre Alain Finkielkraut et Pascal Bruckner dans leur essai Le Nouveau désordre amoureux (1977), ils font aussi partie des libertins qui enchaînent les « plans cul » parce que justement ils n’arrivent pas à combler leur soif d’amour. « À qui décerner la palme du meilleur censeur – aux puritains qui répriment les plaisirs du corps ou aux hédonistes qui ne libèrent jamais que le corps masculin ? » (p. 85) ; « L’idéal de l’épanouissement succède à celui de l’ascétisme. » (idem, p. 361)
3 – ARRÊT SUR IMAGE :
PAULA MERTEUIL
Suite à ma critique (« Merteuil chez Sappho ») de son autobiographie Mauvais Genre sur le site Nonfiction en 2010, l’écrivaine Paula Dumont en personne m’a félicité pour mon article par un court mail personnel, daté du 23 août 2010 (qu’elle désavouerait certainement aujourd’hui depuis qu’elle a découvert que je suis catho… Tristesse de l’anti-catholicisme primaire) : « Cher Philippe, Je viens de prendre connaissance, tout à fait par hasard, de votre article. J’ai l’impression que vous me connaissez mieux que je ne me connais moi-même ! Merci de faire preuve de tant d’intérêt pour mes écrits. Amicalement, Paula. » Je vais retranscrire ce portrait ici pour vous montrer combien le commun des personnes homosexuelles pratiquantes sont des répliques comportementales de Valmont et Merteuil, quand bien même la plupart se croie sans le sous, ne vive plus dans des salons du XVIIIe, fréquente parfois assidûment le monde associatif militant LGBT, soit engagée sincèrement dans une relation d’amour.
La simulation de self control chez Merteuil
L’autobiographie La Vie dure (2010) de Paula Dumont constitue à mon sens une mine d’or pour comprendre comment nous fonctionnons tous quand nous nous jetons à corps perdu dans l’amour homosexuel sans lui reconnaître toutes ses limites : nous devenons complexes, paradoxaux, fragiles. Paula Dumont, comme beaucoup de femmes lesbiennes, me fait penser au personnage admirable et souffrant de la Marquise de Merteuil, du roman épistolaireLes Liaisons dangereuses (1782) de Choderlos de Laclos, présentée non sans raison par certains critiques comme l’archétype de « la » lesbienne, celle qui se fait piéger en amour par sa sincérité, son intellect, et son self-control. La célèbre courtisane semble apparemment un modèle d’ascèse, de savoir-vivre, de maîtrise de soi, de sérieux et d’intelligence, dans sa gestion des histoires amoureuses. Elle est loin d’être bête et rustre, cette « consciencieuse prof de Lettres qui a passé sa vie à compulser des dictionnaires » (p. 136). Elle écrit de belles missives, tantôt pour elle, tantôt pour les autres. Elle calcule tout. Elle croit qu’elle va créer l’amour par elle-même, à bout de bras et à coup de volonté (« Je n’arrivais pas à prendre au sérieux cette peur de l’amour et du désir sur laquelle elle [Catherine] revenait sans cesse et il me semblait, tant l’amour peut rendre présomptueux, que j’en viendrais facilement à bout. » idem, p. 53). Elle trouve son plaisir dans l’introspection, l’analyse littéraire, l’écriture analytique (même si elle se méfie chez les autres des analyses « psychololos »). Elle fuit la niaiserie et la naïveté comme une peste. Pour elle, la naïveté est une hérésie, une faute de goût terrible : être prise en flagrant délit de naïveté, c’est le summum de la honte, surtout quand on se revendique, comme elle, Sainte Gardienne de la Franchise et de la Maîtrise, et que l’on adopte une « vision de l’existence où la fidélité à soi-même et la recherche de l’épanouissement personnel sont primordiaux » (idem, p. 40). Et si cet excès de maîtrise, ce refus du lâcher-prise, pour aimer pourtant, l’empêchaient/nous empêchait d’aimer, finalement ? On peut se poser la question…
Sa technique de drague se veut moins grossière que celle du débauché à la recherche d’un simple « plan cul », car elle désire, parce que son code moral d’esthète surdouée l’exige, faire l’amour… mais pas aussi naïvement que tout le monde. Elle n’est pas « tout le monde » ! Elle ne ressemble pas au commun des « pauvres femmes » qui sont assez aveugles pour rester « stupidement hétérosexuelles toute leur vie » (idem, p. 178). Elle ne joue pas dans la même cour que la majorité des femmes lesbiennes. Non ! Elle, elle ne baise pas que pour le sexe, ni pour des idéaux d’amour mièvres (… même si dans les faits, ça finit quand même par être parfois le cas). Le fin’ amor est un art dont elle serait une des rares personnes à détenir les clés. « Ah la littérature ! Quelle invention géniale pour séduire les femmes ! […] Quels ravages je vais faire auprès des jeunes goudous, à cent ans, quand mon talent sera enfin reconnu ! » (idem, p. 176) La libertine homosexuelle ne rate pas une occasion pour « éblouir par sa culture » (idem, p. 225) et par ses lettres la prétendante qu’elle se sera choisie.
Merteuil est aussi une conquérante, en lutte contre son propre sexe (« Qu’en était-il des autres, asservies à leur mari et à leurs enfants, sans ressources personnelles, sans voiture, sans autre nourriture spirituelle que Marie-Claire, Elle ou Femme d’Aujourd’hui ? Bonne Déesse, quel obscurantisme ! », idem, p. 242), en lutte contre les êtres du sexe « opposé », et contre la sexualité en général : par exemple, elle ne se reconnaît pas dans la tiédeur de ses consœurs lesbiennes qui, à son goût, ne s’engagent pas assez pour la « Cause lesbienne » (« Pauvres femmes, pauvres goudous, chacune dans votre loin, au mieux avec votre chère et tendre, au pire seule et désespérée, ce n’est pas demain la veille que vous comprendrez que la sororité est vitale pour les goudous encore plus que pour les hétérottes. », idem, p. 221) ; et son but est de renverser la « millénariste » domination masculine patriarcale, bien que ce soit une bataille annoncée comme perdue d’avance : « Même quand elles ont fait de longues études et qu’elles ont bénéficié d’une formation sérieuse, les femmes n’ont rien de plus pressé que de se coller à mi-temps dès qu’elles ont un boulot ! Les institutrices que je forme font comme ça dès qu’elles sont titulaires de leur poste… Avec une mentalité pareille, ce n’est pas demain qu’on va prendre en main les commandes de la planète ! » (idem, p. 235)
La technique de drague de l’ascétique Marquise passe généralement par la victimisation, la pitié, et la stratégie de la folle perdue. Paula Merteuil se présente d’office comme fragile ou comme une oubliée de l’amour, pour apitoyer sa proie : « À 18 ans, je me suis repliée sur moi-même, et j’ai abandonné jusqu’à la simple idée qu’on puisse m’aimer d’amour. » (idem, p. 19) Avec son air de chien battu, elle demande à sa compagne du moment de lui faire le plaisir de lui prouver qu’elle vaut encore quelque chose en acceptant de sortir avec une « maudite d’amour » comme elle. On observe une forme de victimisation, de chantage aux sentiments stratégique de la libertine homosexuelle qui se croit la seule à aimer bien, à fond, en vérité, à 100%, contrairement à ses amantes de passage qui n’ont/auraient pas « joué le jeu » de l’amour jusqu’au bout, qui n’ont/n’auraient pas su l’aimer comme elle les a/aurait aimées d’un cœur entier, sacrificiel, pur, gratuit, limite ascétique et platonique. Dans La Vie dure, on assiste à ce genre de plaintes, pas du tout ridicules puisque sincères : « Lui dirais-je combien j’avais pu, adolescente, me sentir infirme, monstrueuse, vouée à jamais à la solitude quand je m’éprenais d’une fille de mon âge ? » (Paula à son amante Catherine, idem, p. 42)
La libertine homosexuelle recherche ce partage amoureux dans la souffrance, tout en le trouvant intellectuellement insupportable. Il déplore que son bonheur doive passer par le malheur. Elle sait bien au fond que les êtres humains ne peuvent pas aimer uniquement sous prétexte qu’ils détestent ensemble, qu’ils pleurent ensemble, ou pour combler une solitude mutuelle. Elle connaît par cœur la mise en scène mélancolique de l’amour homosexuel, mais la blâme/parodie surtout chez les autres. En revanche, quand elle-même devient théâtrale en amour, elle ne s’en aperçoit généralement pas. Au contraire, elle mord à l’hameçon de sa propre sincérité. Elle tombe mal amoureuse en croyant être folle d’amour, parce qu’elle se persuade que dans ses différentes liaisons sentimentales, elle est la seule à aimer véritablement comme il faut. Dans la distance, elle enjolive et pleure une relation avec une regrettée amante qu’en réalité elle n’aurait jamais aimée si celle-ci avait été accessible et vivante (c’est le cas avec Catherine dans La Vie dure). Elle est prête à se priver d’aimer, et même à considérer ses futures conquêtes amoureuses comme des objets de vengeance et d’expiation de ce cruel coup du sort qu’elle ne veut surtout jamais digérer, plutôt que de regarder la réalité en face : elle tient à son malheur et à son amour désincarné plus qu’à l’amour concret qu’elle chante pourtant à tue-tête. La libertine homosexuelle se convainc que l’amour vrai ne peut pas se dissocier de la souffrance et de la mort. Pour elle, la véritable passion se trouve dans la tyrannie doucereuse. Elle définit l’amour comme une force incontrôlable qui soumet et assigne un destin de despote ou de martyr. Elle rêve d’être possédée par l’amour, ou de faire de ce dernier un instrument de pouvoir.
Le paradoxe de la libertine
Pour se venger d’elle-même parce qu’elle s’est laissée croire à sa faiblesse de folle perdue, la libertine homosexuelle va, pour attirer les prétendantes, prendre le total contre-pied de sa première tactique de séduction qui consistait à se montrer fragile. Elle se décide à masquer sa dépression par la prétention. Elle éprouve par exemple une sorte de fierté à ne pas aller draguer (d’ailleurs, elle déteste le mot « drague »), simplement pour ne pas prendre le risque d’être congédiée, et pour avoir le plaisir de se faire éternellement désirer. Elle a honte de prétendre à l’amour, d’être fougueuse ou passionnée (« J’ai essayé de ne pas me gargariser de romantisme à deux sous. », idem, p. 53), car pour elle, aimer, c’est davantage une faiblesse qu’une force, davantage une maladie qu’une énergie curative et positive : « Je me savais incurablement sentimentale. » (idem, p. 190) ; « La sagesse populaire a raison de comparer l’amour à une rage de dents. » (idem, p. 183) L’une des règles d’or de ses manœuvres amoureuses est l’interdiction d’aimer ou de se laisser aimer. Paradoxalement, c’est pour cacher qu’elle considère l’amour comme une affreuse maladie, qu’elle cherchera à tout prix à tomber maladivement amoureuse.
Peu à peu, la libertine homosexuelle se lasse de ses stratégies compliquées qui finissent par surcharger ses amours d’artifice et de calcul. La complexité en amour, ça va bien un moment !…mais elle aspire à la légèreté de « Monsieur Toutlemonde », à la simplicité « triviale », à la spontanéité, au cliché « bobo-Nature ». « J’ai rêvé un instant (puisque tout le monde rêvait, pourquoi aurais-je dû être la seule à coller à des réalités triviales ?) à 8 jours de vacances, en ce lieu, avec Catherine. Je l’ai entrevue, devant son chevalet de peintre, sous le soleil méridional, dans l’odeur du thym, de la menthe et du romarin. Là ou ailleurs, arriverais-je un jour à vivre une semaine entière auprès d’elle ? », idem, p. 164) Elle rêve d’être l’Exception qui confirme la règle de la complexité des amours homosexuelles (c’est d’ailleurs la raison pour laquelle La Vie dure s’achève par une happy-end non-étayée…). Elle reproduit dans sa vie des clichés romantiques cartes postales : « Une fois rentrées à la maison, nous avons écouté Jessye Norman en nous serrant tendrement l’une contre l’autre sur le vieux canapé du salon où nous avions pris place. » (idem, p. 46) On mesure toute la part de narcissisme (même inconscient, même pétri d’intentions altruistes) de la personne qui s’imagine aimer parce qu’elle s’aime elle-même « en amoureuse », que l’amante en face soit là ou pas, que ce soit celle-ci ou une autre : « C’est une véritable histoire de dingue, j’aime une femme dont je ne sais rien… C’est peut-être pour ça que je l’aime, ai-je ironisé. » (idem, p. 134)
Nous touchons là au paradoxe de la courtisane homosexuelle. Entre libertinage et ascèse, Paula Merteuil condamne le plaisir sexuel à l’obsession et à la frustration. Chez la Marquise, la course au sexe et à la reconnaissance par l’image dévoile son insatisfaction et son perfectionnisme caché. Son refus catégorique de l’hyper-sexualité dit aussi sa focalisation sur le génital. Elle incarne tour à tour la célébration excessive de la sexualité et sa négation dans l’intellectualisme ou le volontarisme. Ne perdons pas de vue que derrière la Marquise de Merteuil, « la lesbienne » amoureuse de Cécile de Volanges, dissimulant son mépris du corps et sa frustration d’amour par une maîtrise quasi-parfaite d’elle-même, derrière celle qui privilégie le devoir conjugal sur l’amour, l’esprit sur le plaisir génital (même si elle réitère sans cesse dans son discours l’idée de jouissance), se cache le Vicomte de Valmont (rôle qui pourrait très bien convenir à Marc, le meilleur ami gay de Paula, et qui est décrit dans La Vie dure comme le pendant volage et dévergondé de l’auteure : Paula dit d’ailleurs que c’est leur immense solitude qui est le dénominateur commun de leur amitié). Chez la libertine lesbienne, ce n’est pas la bêtise ni la soif de sexe, qui la poussent à l’illusion amoureuse, mais bien l’excès de raison pour maîtriser l’amour : « Nous avions fait, sans le savoir, un mariage de raison. » (Paula en parlant de son couple bancal avec Martine, idem, p. 73)
À force de self control, la Marquise de Merteuil ne se voit plus agir et ne maîtrise plus la course à l’amour qu’elle avait méthodiquement organisée pour ne pas se donner totalement (l’attente des lettres ou des coups de téléphone deviennent un calvaire ; il lui arrive d’écrire la « lettre de trop » ; etc.). Derrière l’excès de maîtrise, il y a ce que le fin stratège homosexuel veut intellectuellement fuir à tout prix, mais qu’il rejoint parfois en actes : la bestialité, la vile pulsion. C’est bien là son drame ! D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si Paula Dumont insiste beaucoup dans ses écrits sur la comparaison entre l’amour lesbien et l’amour des chiens, en sachant qu’elle met le second bien au-dessus du premier : « Ce qu’il y avait entre nous [Martine et elle], c’était quelque chose de bien plus fort, à savoir la peur de la solitude. […]. On prend bien un chien, pour ne pas être seul ! » (idem, p. 78) ; « Quiconque n’a pas été aimé d’un cocker ne sait rien de l’amour. » (idem, p. 115). « Je suis allée brosser la chienne qui en avait grand besoin et qui m’aimait, elle, d’un amour exclusif. » (idem, p. 127) Déjà, dans La Mauvaise Vie, l’auteure vantait les mérites de l’amour des chiens, en citant Marguerite Yourcenar comme exemple, et en parlant de la place considérable que le « meilleur ami de l’homme » avait pris dans sa vie. Fuyons le naturel et il revient au galop…
La fausse dureté
On sent chez Paula Dumont que, sous ses airs surjoués de « gros dur » qui maîtrise sa propre situation amoureuse, qui sait s’imposer et taper du poing sur la table quand il le faut, la recherche de soumission gagne bien souvent le tableau. Sa dureté à elle est plus télévisuelle qu’effective, plus un mime de force (de magazines) qu’une force réelle. Elle l’avoue humblement : « Ne nous cherchons pas d’excuses et soyons honnête, mon propre idéal d’élégance, c’est celui du cow-boy Marlboro. À défaut d’être capable de ses prouesses au rodéo, je suis fascinée par les vrais jeans américains et les chemisiers à carreaux. » (idem, p. 173) Face à l’amour lesbien, c’est comme si elle perdait tous ses moyens, alors que dans sa vie professionnelle, amicale, associative, elle semble pourtant être un modèle de solidité, de lucidité, et de mesure. Alors on comprend encore plus combien déchirante doit être pour elle ce décalage, cette schizophrénie, cette contradiction qui est à la fois ce qui lui permet de montrer à la face de son lectorat une inquiétante fragilité, et ce qui lui donne matière à écrire un essai si touchant, si poignant, si humain. Le lecteur assiste à la méticuleuse description d’une blessure qui suinte, qui mène continuellement la vie dure à celle qui la décrit sans la dénoncer. Comme un schéma amoureux qui se reproduit à l’infini, sans que la concernée s’en rende compte puisqu’elle se donne l’illusion par l’écriture, par sa réflexion brillante, par sa posture physique même, qu’elle ne tombera jamais. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien… Au final, à son grand dam, elle est la femme faible, trop gentille, trop bonne poire, capable de se laisser marcher sur les pieds par amour… alors que l’amour véritable n’a jamais demandé une telle abnégation : par exemple, elle logera et entretiendra pendant une douzaine d’années – quand même… – l’envahissante Martine, son « ex » ; elle se voilera la face sur les indécisions de Catherine et justifiera pendant très longtemps l’immaturité et le mutisme de celle-ci ; elle idéalisera un « je t’aime » furtif, ou s’emportera dès qu’on remettra en cause la force de l’amour lesbien ; elle sera même capable de se rabaisser au statut de cinquième roue du carrosse en acceptant de jouer la maîtresse d’une femme déjà en couple avec une autre…). C’est étonnant – et pourtant logique, si l’on perçoit les paradoxes de la sincérité chez la libertine homosexuelle –, cette capacité à l’avilissement et à la soumission en amour par excès de self-control. Fascinant. Paula Dumont passe sont temps à dire « La coupe est pleine » (idem, p. 52), précisément pour mieux se laisser dominer, pour mieux se laisser déborder. Comme un disque qui tourne intérieurement, pour rien : « Catherine pensait-elle que j’étais une marionnette dont elle pouvait tirer les ficelles à son gré pour la faire gesticuler selon ses humeurs ? » (idem, p. 124) Quand Paula nous offre dans son écrit un extrait d’une des lettres de Catherine, son plus grand amour de jeunesse, on a envie d’abonder dans le sens de cette dernière quand elle s’adresse à Paula en ces termes : « Tu ne sais pas te protéger. » (idem, p. 53) C’est en effet le constat final qu’on a envie de faire : c’est en cultivant une fausse dureté que Paula s’est fragilisée. « Quel gâchis que mes amours ! » (idem, p. 134) finit-elle par conclure. Elle en a connues, des misères affectives… (qui, il faut bien le dire, sont légion dans les amours homos classiques, si alambiquées parce que leur complexité est justifiée/camouflée par la sincérité) : entre Catherine l’amante bisexuelle qui ne sait pas ce qu’elle veut, Martine l’amante immature et assistée qui se laisse entretenir, les lesbiennes hommasses de « Goudouland » comme elle le dit elle-même, Chantal l’amante cultivée et distante jouant au chat et à la souris, on a l’impression que la recherche d’amour va lui donner du fil à retordre toute sa vie… d’où « la vie dure »…
Ce qui rend la vie dure, que l’on soit homosexuel ou non, c’est bien cela, finalement : l’absence, en nous, de désir (…du Désir) ; ou bien le « désir en négatif », le « désir par défaut » : on sait plus ce que l’on ne veut pas que ce que l’on veut (idem, p. 190)… et on confond cela avec du désir.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.